Lauren Bentolila-Fanon1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
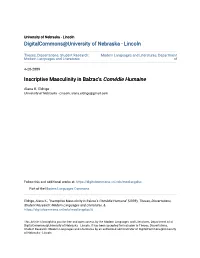
Inscriptive Masculinity in Balzac's Comédie Humaine
University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln Theses, Dissertations, Student Research: Modern Languages and Literatures, Department Modern Languages and Literatures of 4-20-2009 Inscriptive Masculinity in Balzac’s Comédie Humaine Alana K. Eldrige University of Nebraska - Lincoln, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss Part of the Modern Languages Commons Eldrige, Alana K., "Inscriptive Masculinity in Balzac’s Comédie Humaine" (2009). Theses, Dissertations, Student Research: Modern Languages and Literatures. 6. https://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/6 This Article is brought to you for free and open access by the Modern Languages and Literatures, Department of at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in Theses, Dissertations, Student Research: Modern Languages and Literatures by an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. INSCRIPTIVE MASCULINITY IN BALZAC’S COMÉDIE HUMAINE by Alana K. Eldrige A DISSERTATION Presented to the Faculty of The Graduate College at the University of Nebraska In Partial Fulfillment of Requirements For the Degree of Doctor in Philosophy Major: Modern Languages and Literature (French) Under the Supervision of Professor Marshall C. Olds Lincoln, Nebraska May, 2009 INSCRIPTIVE MASCULINITY IN BALZAC’S COMÉDIE HUMAINE Alana K. Eldrige, Ph.D. University of Nebraska, 2009. Adviser: Marshall C. Olds This reading of La Comédie humaine traces the narrative paradigm of the young hero within Balzac’s literary universe. A dynamic literary signifier in nineteenth-century literature, the young hero epitomizes the problematic existence encountered by the individual in post-revolutionary France. At the same time, he serves as a mouth-piece for an entire youthful generation burdened by historical memory. -

La Cousine Bette Sylvain Ledda Est Professeur De Littérature Française À L’Univer- Sité De Rouen, Membre Du Cérédi
La Cousine Bette Sylvain Ledda est professeur de littérature française à l’univer- sité de Rouen, membre du CÉRÉdI. Spécialiste du romantisme, il consacre ses travaux à cette période, notamment à Alfred de Musset et Alexandre Dumas. Il a publié La Confession d’un enfant du siècle, ainsi que les Nouvelles et les Contes de Musset dans la collection GF. Stéphanie Adjalian-Champeau est maître de conférences à l’université de Rouen, membre du CÉRÉdI. Spécialiste du roman auXIX e siècle, elle a consacré une partie de ses travaux aux frères Goncourt. BALZAC La Cousine Bette • PRÉSENTATION DOSSIER par Sylvain Ledda NOTES CHRONOLOGIE BIBLIOGRAPHIE par Stéphanie Adjalian-Champeau GF Flammarion © 2015, Flammarion, Paris. ISBN : 978-2-0813-5879-9 No d’édition : L.01EHPN000719.N001 Dépôt légal : mai 2015 Pour Yvan Leclerc Présentation Chaque homme a sa passion qui le mord au fond du cœur, comme chaque fruit son ver. Alexandre Dumas 1 La vengeance enfante une énergie sans nom. Elle nour- rit les passions souterraines, les désirs secrets, les haines farouches. Ceux qui s’y consacrent trouvent vigueur et vie dans son accomplissement. La Cousine Bette puise ainsi son puissant intérêt dans l’absolu d’une vengeance implacable, celle d’une vieille fille, Lisbeth Fischer, la cousine Bette, qui travaille à la destruction systématique d’une famille – sa famille. Le poison de jalousie qu’elle distille répand autour d’elle son venin mortifère ; la toile arachnéenne qu’elle tisse empiège ceux qui ont ouvert la boîte de Pandore de ses passions contrariées. Nul ne sor- tira indemne de ce thriller réaliste, pas même le lecteur de Balzac, habitué au mercure fluide de la passion romantique. -

Table Des Matières
TABLE DES MATIÈRES ÉTUDES BIOGRAPHIQUES ET LITTÉRAIRES Jean-Hervé Donnard. Balzac lecteur de la Bible ……………………………. 7 Lucette Besson. Les parents nourriciers de Balzac ………………………… 27 Agnès Kettler. De Francis Dazur à Sœur Marie des Anges : les illusions perdues de Sophie Mazure ………………………………….. 45 Charles Dédéyan. Balzac et Sismondi ………………………………………. 73 Alan Raitt. Balzac et Flaubert : une rencontre peu connue ………………… 79 « L’ÉCRIVAIN AU TRAVAIL » Alex Lascar. La première ébauche de « La Maison du chat-qui-pelote » ….. 89 Mireille Labouret. « Le Conseil » et « Le Message » : un texte émissaire ……………………………………………………………… 107 Anne-Marie Lefebvre. Visages de Bianchon …………….……………………. 125 Michel Lichtlé. Sur « L’Interdiction » ………………………………………. 141 Lise Queffélec. « La Vieille Fille » ou la science des mythes en roman-feuilleton ………………………………………………………. 163 Patrick Berthier. Les ratures du manuscrit d’ « Une fille d’Eve ». ………… 179 Danielle Dupuis. « Une princesse parisienne » ou la fascination d’un personnage ………………………………………….. 205 Myriam Lebrun. Le souvenir de la duchesse d’Abrantès dans les « Mémoires de deux jeunes mariées » ……………………………….. 219 Loïc Chotard. L’envers de l’histoire littéraire ……………………………… 233 ANALYSES ET POINTS DE VUE Arlette Michel. Balzac et la rhétorique : modernité et tradition ……………. 245 Michael Lastinger. Narration et « point de vue » dans deux romans de Balzac : « Le Peau de chagrin » et « Le Lys dans la vallée » …………. 271 Jacques Gerstenkorn. Du légitimisme drolatique : « Le Prosne du ioyeulx curé de Meudon » …………………………………………… 291 François-Xavier Mioche. « Le Médecin de campagne », roman politique ? ……………………………………………………………... 305 André Vanoncini. La représentation de l’utopie dans « Le Médecin de campagne » …………………………………………………………… 321 Evelyne Datta. Le père Goriot, alchimiste …………………………………… 335 Madeleine A. Simons. Le génie au féminin ou les paradoxes de la princesse de Cadignan ……………………………………………… 347 Annemarie Kleinert. -
The Cambridge Companion to Balzac Edited by Owen Heathcote , Andrew Watts Frontmatter More Information
Cambridge University Press 978-1-107-06647-2 — The Cambridge Companion to Balzac Edited by Owen Heathcote , Andrew Watts Frontmatter More Information the cambridge companion to balzac One of the founders of literary realism and the serial novel, Honoré de Balzac (1799–1850) was a prolific writer who produced more than a hundred novels, plays and short stories during his career. With its dramatic plots and memorable characters, Balzac’s fiction has enthralled generations of readers. La Comédie humaine, the vast collection of works in which he strove to document every aspect of nineteenth-century French society, has influenced writers from Flaubert, Zola and Proust to Dostoevsky and Oscar Wilde. This Companion provides a critical reappraisal of Balzac, combining studies of his major novels with guidance on the key narrative and thematic features of his writing. Twelve chapters by world-leading specialists encompass a wide spectrum of topics such as the representation of history, philosophy and religion, the plight of the struggling artist, gender and sexuality, and Balzac’s depiction of the creative process itself. owen heathcote is Honorary Senior Research Fellow in Modern French Studies at the University of Bradford. He researches on the relation between violence, gender, sexuality and representation in French literature from the nineteenth century to the present. His many publications include Balzac and Violence. Representing History, Space, Sexuality and Death in ‘La Comédie humaine’ (2009) and From Bad Boys to New Men? Masculinity, Sexuality and Violence in the Work of Éric Jourdan (2014). andrew watts is Senior Lecturer in French Studies at the University of Birmingham. -

GEB. Cousine Bette. D. Dupuisart 3
Art, passion et dérision dans La Cousine Bette Danielle Dupuis (Paris) Le thème de l’art est récurrent dans l’œuvre de Balzac soit par le biais de la mise en scène dans La Comédie humaine de l’artiste lui-même, écrivain, musicien, peintre, sculpteur, architecte ou du fait d’une réflexion théorique insérée tantôt dans la trame romanesque, tantôt dans des articles publiés dans les périodiques de l’époque comme le texte intitulé Des artistes 1 et les Lettres sur la littérature, le théâtre et les arts 2 ou dans les introductions suggérées à Félix Davin et à Philarète Chasles 3 et dans les préfaces. Steinbock, dans La Cousine Bette est le dernier artiste imaginé par Balzac, si l’on considère que Pons et Schmucke dans Le Cousin Pons ne sont que des interprètes et non des créateurs à part entière. Ce personnage retiendra d’autant plus notre attention que, comme l’a révélé André Lorant, il était destiné à jouer un rôle capital dans le premier volet des Parents pauvres , « le manuscrit, les variantes et les additions ne laiss[ant] nullement prévoir que Wenceslas perdra l’intérêt que son créateur lui portait au début de la rédaction de l’œuvre »4. Il nous a par conséquent paru instructif de constater ce qu’est devenue cette figure d’artiste plongé dans l’univers paroxystique et passionnel de ce roman, dans l’enfer parisien et non plus dans un cadre mythique, la Venise de Massimilla Doni par exemple, sous la Monarchie de Juillet et non plus au début d’un dix-septième siècle révolu comme dans Le Chef-d’œuvre inconnu . -

The Jealousies of a Country Town
The Jealousies of a Country Town Honore de Balzac The Jealousies of a Country Town Table of Contents The Jealousies of a Country Town..........................................................................................................................1 Honore de Balzac...........................................................................................................................................1 INTRODUCTION.........................................................................................................................................1 I. AN OLD MAID.......................................................................................................................................................2 DEDICATION...............................................................................................................................................3 CHAPTER I. ONE OF MANY CHEVALIERS DE VALOIS......................................................................3 CHAPTER II. SUSANNAH AND THE ELDERS.......................................................................................7 CHAPTER III. ATHANASE.......................................................................................................................16 CHAPTER IV. MADEMOISELLE CORMON..........................................................................................20 CHAPTER V. AN OLD MAID'S HOUSEHOLD.......................................................................................29 CHAPTER VI. FINAL DISAPPOINTMENT AND ITS FIRST -
Honoré De Balzac La Cousine Bette
Honoré de Balzac La cousine Bette BeQ Honoré de Balzac (1799-1850) Scènes de la vie parisienne La cousine Bette Les parents pauvres La Bibliothèque électronique du Québec Collection À tous les vents Volume 1103 : version 1.13 2 Du même auteur, à la Bibliothèque : Le père Goriot Eugénie Grandet La duchesse de Langeais Gobseck Le colonel Chabert Le curé de Tours La femme de trente ans La vieille fille Le médecin de campagne 3 La cousine Bette Édition de référence : Paris, Alexandre Houssiaux, Éditeur, 1855. 4 À don Michele Angelo Cajetani, prince de Téano. Ce n’est ni au prince romain, ni à l’héritier de l’illustre maison de Cajetani qui a fourni des papes à la Chrétienté, c’est au savant commentateur de Dante que je dédie ce petit fragment d’une longue histoire. Vous m’avez fait apercevoir la merveilleuse charpente d’idées sur laquelle le plus grand poète italien a construit son poème, le seul que les modernes puissent opposer à celui d’Homère. Jusqu’à ce que je vous eusse entendu, la DIVINE COMÉDIE me semblait une immense énigme, dont le mot n’avait été trouvé par personne, et moins par les commentateurs que par qui que ce soit. Comprendre ainsi Dante, c’est être grand comme lui ; mais toutes les grandeurs vous sont familières. Un savant français se ferait une réputation, gagnerait une chaire et beaucoup de croix, à 5 publier, en un volume dogmatique, l’improvisation par laquelle vous avez charmé l’une de ces soirées où l’on se repose d’avoir vu Rome. -

Balzac Gobseck Et Autres Récits D'argent Édition D'alexandre Péraud
Balzac Gobseck et autres récits d'argent Édition d'Alexandre Péraud COLLECTION FOLIO CLASSIQUE Honoré de Balzac Gobseck et autres récits d’argent Édition présentée, établie et annotée par Alexandre Péraud Maître de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne Biographie de Balzac par Samuel S. de Sacy Gallimard © Éditions Gallimard, 1972, pour la biographie de Balzac ; 2019, pour la préface, les autres textes du dossier et la présente édition. Couverture : Photo © collection Kharbine-Tapabor. L’HUMANITÉ À HAUTEUR D’ARGENT L’argent balzacien Balzac a inventé l’argent. Pas le rustre argent qu’on se contente de convoiter ou d’amasser, pas seulement l’argent objet qui excite les appétits, mais l’argent sujet. L’argent que les personnages, certes, se disputent et recherchent presque tous ; mais surtout cet argent qui tisse les jours des indi- vidus, en détermine la vie quotidienne et, véritable sang social, anime les relations interindividuelles en donnant à la société sa dynamique. Car, pour le pire ou pour le meilleur, l’argent balzacien est vivant. Vivant comme ces écus qui, selon Grandet, « vivent et grouillent comme des hommes : ça va, ça vient, ça sue, ça produit » (Eugénie Grandet). À cette aune, La Comédie humaine ne saurait être enfermée dans les seules limites d’un témoi- gnage d’époque. Même si la peinture que Balzac nous livre de la situation socio-économique est précieuse pour comprendre le premier XIX e siècle, l’argent balzacien n’est pas un simple élément de décor ou d’ancrage contextuel. Tour à tour épique, 8 Préface tragique ou fantasmagorique, il raconte ce siècle où la révolution capitaliste et libérale modifie profondé- ment les équilibres sociaux. -

For Love Or for Money
For Love or for Money For Love or for Money Balzac’s Rhetorical Realism Armine Kotin Mortimer THE OHIO STATE UNIVERSITY PRESS | COLUMBUS Copyright © 2011 by The Ohio State University. All rights reserved. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Mortimer, Armine Kotin, 1943– For love or for money : Balzac’s rhetorical realism / Armine Kotin Mortimer. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-8142-1169-4 (cloth : alk. paper)—ISBN 978-0-8142-9268-6 (cd) 1. Balzac, Honoré de, 1799–1850. Comédie humaine. 2. Realism in literature. 3. Love in literature. 4. Money in literature. I. Title. PQ2159.C72M57 2011 843'.7—dc23 2011019881 Cover design by James Baumann Text design by Juliet Williams Type set in Adobe Sabon Printed by Thomson-Shore, Inc. The paper used in this publication meets the minimum requirements of the American National Standard for Information Sciences—Permanence of Paper for Printed Library Mate- rials. ANSI Z39.48–1992. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Contents List of Illustrations vii Acknowledgments ix Chapter 1 Introduction: The Prime Movers 1 I Rhetorical Forms of Realism Chapter 2 Mimetic Figures of Semiosis 15 Chapter 3 From Heteronomy to Unity: Les Chouans 32 Chapter 4 Tenebrous Affairs and Necessary Explications 47 Chapter 5 Self-Narration and the Fakery of Imitation 63 Chapter 6 The Double Representation of the History of César Birotteau 80 Chapter 7 La Maison Nucingen, a Financial Narrative 94 II Semiotic Images of Realism Chapter 8 Myth and Mendacity: Pierrette and Beatrice Cenci 109 Chapter 9 The -

Intra Muros Et Extra »
R E V U E À C O M I T É D E P A I R S D U C E N T R E F I G U R A . P O U R L A V E R S I O N W E B E N R I C H I E , C L I Q U E Z I C I . Volume 2 Numéro 2 Article Dossier : Imaginaire de la ligne Quelques lignes « intra muros et extra » Lecture graphique de l’incipit du Père Goriot de Balzac Véronique Cnockaert Aires de recherche : Archéologie du contemporain, Penser le contemporain Contexte géographique : France, Paris, Montréal Période historique : XIXe siècle Champs disciplinaires : ethnologie, architecture, géographie, littérature, urbanisme Courants artistiques : réalisme Pour citer : L I C E N C E C R E A T I V E C O M M O N S CNOCKAERT, Véronique. 2017. « Quelques lignes “intra muros et extra”. Lecture A T T R I B U T I O N - P A S D E M O D I F I C A T I O N graphique de l’incipit du Père Goriot de Balzac », Captures, vol. 2, C C B Y - N D no 2 (novembre), dossier « Imaginaire de la ligne ». En ligne : I S S N : 2 3 7 1 - 1 9 3 0 revuecaptures.org/node/952 Date de consultation : 12/12/2018 CAPTURES Volume 2 Numéro 2 Novembre 2017 1 Quelques lignes « intra muros et extra » Lecture graphique de l’incipit du Père Goriot de Balzac Véronique Cnockaert Résumé : L’incipit du Père Goriot de Balzac présente un entrecroisement remarquable de lignes distinctes qui ne cessent d’être l’écho l’une de l’autre. -

B8 Redux.Pdf
BALZ (ALBERT GEORGE ADAM). — Cartesian studies. 80 New York, 1951. 1941 Bal — Descartes and the modern mind. 80 New Haven, 1952. 1941 Bal ADDITIONS BALZ (CHARLES F .) and STARWOOD (RICHARD H.). — eds. Literature on information retrieval and machine translation. Comp. & cd. by C. F. B., H. H. S. Owego, New York, 1962. Computer Unit Lib. *** Mimeographed typescript. J>. -/Si* 2nd ed . (supplement to first ed.) Owego, N e w York, 1966. .01078 Bal. BALZ (HORST ROBERT). Methodische Probleme der neutestameetlichen Christologie. [Wiss. Mon. z. A. u. N.T. 25.] Neukirchen-Vluyn, 1967. New Coll. Lib. BALZAC (HONORÉ LE). Index Works 1 Two or more works 2 Beatrix 2a Cesar Birotteau 2h Chouans (Les) 2m Comedie (La) humaine 3 Contes (Les) drolatiques h Cousin (Le) Pons ha Dehut (ïïn) dans la vie 5 Église (L1) 6 Étude sur M. Beyle 7 Eugenie Grandet 8 Falthume 9 Gambara 9a Histoire des Treize 9b Illusions perdues 10 Letters 11 Louis Lambert 12 [Continued overleaf.] BALZAC (HONORÉ DE) [continued]. Index [continued] Lys (Le) dans la vallee 12a Massimilla Doni 12h Menage (Un) de garçon. See RABOUILLEUSE (LA) Paysans (Les) 13 Peau (La) de chagrin 1U Pere (Le) Goriot 15 Petits (Les) "bourgeois 15a Rabouilleuse (La) 15b Scen^es de la vie privée 16 Secret (Les) des Ruggieri l6h ✓ Stenie 17 Torpille (La) 18 ) / * * Traite de la vie elegante 18b Traite des excitants modernes 19 Trois (Les) clercs de sainct Nicholas 20 Ursule Mirouet 21 Vieille (La) fille 22 Sélections 23 Appendix 2b [Continued overleaf.] ADDITIONS BALZAC (HONORÉ DE). INDEX Le médecin de campagne. 12m. -

La Vieille Fille
Honoré de Balzac La vieille fille BeQ Honoré de Balzac (1799-1850) La vieille fille La Bibliothèque électronique du Québec Collection À tous les vents Volume 1058 : version 1.0 2 Du même auteur, à la Bibliothèque : Le père Goriot Eugénie Grandet La duchesse de Langeais Gobseck Le colonel Chabert Le curé de Tours La femme de trente ans 3 La vieille fille Édition de référence : Éditions Rencontre, Lausanne, 1968. 4 À MONSIEUR EUGÈNE-AUGUSTE-GEORGES-LOUIS MIDY DE LA GRENERAYE SURVILLE, Ingénieur au Corps royal des Ponts-et- Chaussées, Comme un témoignage de l’affection de son beau-frère. 5 Beaucoup de personnes ont dû rencontrer dans certaines provinces de France plus ou moins de chevaliers de Valois, car il en existait un en Normandie, il s’en trouvait un autre à Bourges, un troisième florissait en 1816 dans la ville d’Alençon, peut-être le Midi possédait-il le sien. Mais le dénombrement de cette tribu valésienne est ici sans importance. Tous ces chevaliers, parmi lesquels il en est sans doute qui sont Valois comme Louis XIV était Bourbon, se connaissaient si peu entre eux, qu’il ne fallait point leur parler des uns aux autres ; tous laissaient d’ailleurs les Bourbons en parfaite tranquillité sur le trône de France, car il est un peu trop avéré que Henri IV devint roi faute d’un héritier mâle dans la première branche d’Orléans, dite de Valois. S’il existe des Valois, ils proviennent de Charles de Valois, duc d’Angoulême, fils de Charles IX et de Marie Touchet, de qui la postérité mâle s’est également éteinte, jusqu’à preuve contraire.