Du Monde Au Cambodge, Le Sida
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
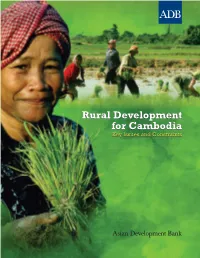
Rural Development for Cambodia Key Issues and Constraints
Rural Development for Cambodia Key Issues and Constraints Cambodia’s economic performance over the past decade has been impressive, and poverty reduction has made significant progress. In the 2000s, the contribution of agriculture and agro-industry to overall economic growth has come largely through the accumulation of factors of production—land and labor—as part of an extensive growth of activity, with productivity modestly improving from very low levels. Despite these generally positive signs, there is justifiable concern about Cambodia’s ability to seize the opportunities presented. The concern is that the existing set of structural and institutional constraints, unless addressed by appropriate interventions and policies, will slow down economic growth and poverty reduction. These constraints include (i) an insecurity in land tenure, which inhibits investment in productive activities; (ii) low productivity in land and human capital; (iii) a business-enabling environment that is not conducive to formalized investment; (iv) underdeveloped rural roads and irrigation infrastructure; (v) a finance sector that is unable to mobilize significant funds for agricultural and rural development; and (vi) the critical need to strengthen public expenditure management to optimize scarce resources for effective delivery of rural services. About the Asian Development Bank ADB’s vision is an Asia and Pacific region free of poverty. Its mission is to help its Rural Development developing member countries reduce poverty and improve the quality of life of their people. Despite the region’s many successes, it remains home to two-thirds of the world’s poor: 1.8 billion people who live on less than $2 a day, with 903 million for Cambodia struggling on less than $1.25 a day. -

Malaria in the Greater Mekong Subregion
his report provides an overview of the epidemiological patterns of malaria in the Greater Mekong Subregion (GMS) Tfrom 1998 to 2007, and highlights critical challenges facing National Malaria Control Programmes and partners as they move towards malaria elimination as a programmatic goal. Epidemiological data provided by malaria programmes show a drastic decline in malaria deaths and confirmed malaria cases over the last 10 years in the GMS. More than half of confirmed malaria cases and deaths in the GMS occur in Myanmar. However, reporting methods and data management are not comparable between countries despite the effort made by WHO to harmonize data collection, analysis and reporting among Member States. Malaria is concentrated in forested/forest-fringe areas of the Region, mainly along international borders. This providing a strong rationale to develop harmonized cross-border elimination programmes in conjunction with national efforts. Across the Mekong Region, the declining efficacy of recommended first-line antimalarials, e.g. artemisinin-based combination therapies (ACTs) against falciparum malaria on the Cambodia-Thailand border; the prevalence of counterfeit and substandard antimalarial drugs; the Malaria lack of health services in general and malaria services in particular in remote settings; and the lack of information and services in the Greater Mekong Subregion: targeting migrants and mobile population present important barriers to reach or maintain malaria elimination programmatic Regional and Country Profiles goals. Strengthening -

Mekong River in the Economy
le:///.le/id=6571367.3900159 NOVEMBER REPORT 2 0 1 6 ©THOMAS CRISTOFOLETTI / WWF-UK In the Economy Mekong River © NICOLAS AXELROD /WWF-GREATER MEKONG Report prepared by Pegasys Consulting Hannah Baleta, Guy Pegram, Marc Goichot, Stuart Orr, Nura Suleiman, and the WWF-Cambodia, Laos, Thailand and Vietnam teams. Copyright ©WWF-Greater Mekong, 2016 2 Foreword Water is liquid capital that flows through the economy as it does FOREWORD through our rivers and lakes. Regionally, the Mekong River underpins our agricultural g systems, our energy production, our manufacturing, our food security, our ecosystems and our wellbeing as humans. The Mekong River Basin is a vast landscape, deeply rooted, for thousands of years, in an often hidden water-based economy. From transportation and fish protein, to some of the most fertile crop growing regions on the planet, the Mekong’s economy has always been tied to the fortunes of the river. Indeed, one only need look at the vast irrigation systems of ancient cities like the magnificent Angkor Wat, to witness the fundamental role of water in shaping the ability of this entire region to prosper. In recent decades, the significant economic growth of the Lower Mekong Basin countries Cambodia, Laos, Thailand and Viet Nam — has placed new strains on this river system. These pressures have the ability to impact the future wellbeing including catalysing or constraining the potential economic growth — if they are not managed in a systemic manner. Indeed, governments, companies and communities in the Mekong are not alone in this regard; the World Economic Forum has consistently ranked water crises in the top 3 global risks facing the economy over the coming 15 years. -
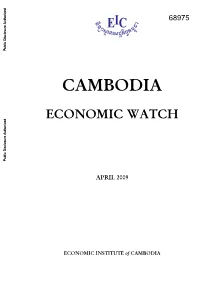
World Bank Document
Public Disclosure Authorized CAMBODIA Public Disclosure Authorized ECONOMIC WATCH Public Disclosure Authorized APRIL 2009 Public Disclosure Authorized ECONOMIC INSTITUTE of CAMBODIA This report is made possible by generous support from the World Bank. The opinions expressed herein are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the World Bank. President : Sok Hach Team Leader : Neou Seiha English Editors : Sam Campbell & Tyler Marcus Authors : Neou Seiha Chhun Dalin TABLE OF CONTENTS 1. List of Abbreviations and Acronyms iii 2. List of Tables and Figures v 3. Foreword vi 4. Executive Summary vii 5. Part I: Recent Economic Developments and Outlook 1 1. Cambodian Economic Growth 3 1.1. Agriculture 5 1.2. Industry 7 1.3. Service 11 2. Trade, Investment and Productivity 13 2.1. External Trade and Capital Movements 13 2.2. Private Investment and Stocks of Capital 16 2.3. Productivity 17 3. Price and Monetary Development 19 3.1. Inflation 19 3.2. Exchange rate 20 3.3. Money supply 22 3.4. Interest rate 24 4. Fiscal Development and External Debt 27 4.1. Budget Revenue 27 4.2. Budget Expenditure 29 4.3. Budget Financing and External Debt 30 5. Labor Force, Incomes, and Poverty 33 5.1. Employment 33 5.2. Incomes 34 5.3. Poverty 35 EIC - Cambodia Economic Watch – April 2009 i Part II: Structural Reforms: Current Implementation and Prospects 37 6. Banking and Financial Sector Reform 39 6.1. Banking and Non Bank Finance 39 6.2. Microfinance 43 7. Public Financial Management Reform 45 7.1. -

Assessment of Compulsory Treatment of People Who Use Drugs in Cambodia, China, Malaysia and Viet Nam: an Application of Selected Human Rights Principles
Assessment of compulsory treatment of people who use drugs in Cambodia, China, Malaysia and Viet Nam: An application of selected human rights principles Western Pacific Region WHO Library Cataloguing in Publication Data Assessment of compulsary treatment of people who use drugs in Cambodia, China, Malaysia and Viet Nam: an application of selected human rights principles. 1. Substance abuse, Intravenous - rehabilitation. 2. Substance abuse treatment centers. 3. Human rights. 4. HIV infections – transmission. ISBN 978 92 9061 417 3 (NLM Classification: WM 270) © World Health Organization 2009 All rights reserved. The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. The mention of specific companies or of certain manufacturers’ products does not imply that they are endorsed or recommended by the World Health Organization in preference to others of a similar nature that are not mentioned. Errors and omissions excepted, the names of proprietary products are distinguished by initial capital letters. The World Health Organization does not warrant that the information contained in this publication is complete and correct and shall not be liable for any damages incurred as a result of its use. Publications of the World Health Organization can be obtained from Marketing and Dissemination, World Health Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland (tel: +41 22 791 2476; fax: +41 22 791 4857; e-mail: [email protected]). -

A Comparative Study on Education, Development in Cambodia And
UvA-DARE (Digital Academic Repository) A comparative study of education and development in Cambodia and Uganda from their civil wars to the present Un, L. Publication date 2012 Document Version Final published version Link to publication Citation for published version (APA): Un, L. (2012). A comparative study of education and development in Cambodia and Uganda from their civil wars to the present. General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl) Download date:02 Oct 2021 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx A COMPARATIVE STUDY OF cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqEDUCATION AND DEVELOPMENT wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiIN CAMBODIA -

Legal Protections Against HIV-Related Human Rights Violations: Experiences and Lessons Learned from National HIV Laws in Asia and the Pacifi C
Empowered lives. Resilient nations. Empowered lives. Resilient nations. Legal protections against HIV-related human rights violations: Legal protections against Experiences and lessons learned from national HIV laws in Asia and the Pacifi c laws in Asia and the Pacifi Experiences and lessons learned from national HIV HIV-related human rights violations Empowered lives. Resilient nations. Experiences and lessons United Nations Development Programme learned from national HIV laws UNDP Asia-Paci c Regional Centre United Nations Service Building, 3rd Floor Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200, Thailand in Asia and the Pacifi c Email: [email protected] Tel: +66 (0)2 304-9100 Fax: +66 (0)2 280-2700 Web: http://asia-paci c.undp.org/ 2013 May For referencing purposes, we request that the following citation is used: UNDP (2013). Legal protections against HIV-related human rights violations: Experiences and lessons learned from national HIV laws in Asia and the Pacific. Bangkok, UNDP. The views expressed in this publication are those of the authors and do not necessarily represent those of the United Nations, including UNDP, or UN Member States. UNDP partners with people at all levels of society to help build nations that can withstand crisis, and drive and sustain the kind of growth that improves the quality of life for everyone. On the ground in 177 countries and territories, we offer global perspective and local insight to help empower lives and build resilient nations. Copyright © UNDP 2013 ISBN: 978-974-680-354-0 United Nations Development Programme UNDP Asia-Pacific Regional Centre United Nations Service Building, 3rd Floor Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200, Thailand Email: [email protected] Tel: +66 (0)2 304-9100 Fax: +66 (0)2 280-2700 Web: http://asia-pacific.undp.org/ Design: Ian Mungall/UNDP. -

Khmer-Kampuchea Krom, Montagnards, Land Claims, Religious Persecution, Excessive Violence and Torture, Arbitrary Arrests, Forced Repatriation
Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) Submission to the UN Office of the High Commissioner for Human Rights Universal Periodic Review: Cambodia Executive summary: Indigenous peoples, Khmer-Kampuchea Krom, Montagnards, land claims, religious persecution, excessive violence and torture, arbitrary arrests, forced repatriation. Khmer-Kampuchea Krom 5 1. Introduction The Khmers from Kampuchea-Krom, also known as Khmer Krom, are an indigenous people comprising a majority in Cambodia. There is also a significant population of Khmers living in the Mekong River delta region of Viet Nam. 10 Despite regional ties and a close relationship fostered with the peoples living in Cambodia, the territory of the Khmer Krom was incorporated into Viet Nam, rather than Cambodia. As a result, the Khmer Krom peoples are viewed in Viet Nam as Khmer and in Cambodia as Vietnamese. In addition, under the Presidency of Ngo Dinh Diem (1955 – 1963) all Khmer names were changed into Vietnamese, forever altering Khmer identity. The Khmer continue 15 to face persecution in Cambodia because of the assumption of their “foreignness”, despite their ancestral ties to Cambodia. Forced repatriations of Khmer, which are often simply deportations as many Khmer have been living within Cambodia for several generations, to Viet Nam by the Cambodian government are commonplace. The Khmers Kampuchea-Krom Foundation (KKF) is an international organisation dedicated 20 to the defence of the fundamental rights and the cultural legacy of the Khmer Krom. The Federation has been a Member of the Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) since 2001. 2. Land Rights Claims 25 During 2007, some 150,000 Cambodians, including over 20,000 residents around Phnom Penh's Boeung Kak Lake, were forcibly evicted and lost land, homes and livelihoods following land disputes and land grabbing. -
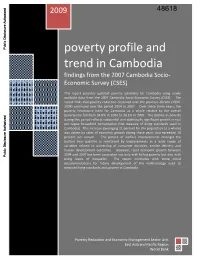
Findings from the Cambodia Socio‐Economic Survey (CSES)
2009 48618 Public Disclosure Authorized poverty profile and trend in Cambodia findings from the 2007 Cambodia Socio‐ Economic Survey (CSES) This report provides updated poverty estimates for Cambodia using newly available data from the 2007 Cambodia Socio‐Economic Survey (CSES). The report finds that poverty reduction observed over the previous decade (1994‐ Public Disclosure Authorized 2004) continued over the period 2004 to 2007. Over these three years, the poverty headcount index for Cambodia as a whole relative to the overall poverty line fell from 34.8% in 2004 to 30.1% in 2007. The decline in poverty during this period reflects substantial and statistically significant growth in real per capita household consumption (the measure of living standards used in Cambodia). This increase (averaging 21 percent for the population as a whole) was driven by rates of economic growth during these years that exceeded 10 percent per annum. The picture of welfare improvements amongst the bottom two quintiles is reinforced by improvements in a wide range of variables related to ownership of consumer durables, service delivery and human development outcomes. However, rapid economic growth between 2004 and 2007 has been associated not only with falling poverty but also with Public Disclosure Authorized rising levels of inequality. The report concludes with some initial recommendations for future development of the methodology used to measure living standards and poverty in Cambodia. Public Disclosure Authorized Poverty Reduction and Economic Management -

The Deinstitutionalization of Children in Cambodia: Intended and Unintended Consequences
THE DEINSTITUTIONALIZATION OF CHILDREN IN CAMBODIA: INTENDED AND UNINTENDED CONSEQUENCES DISSERTATION Submitted in fulfillment of the requirement for the Master in Development Studies (MDEV) by Pamela Michel Lizarazu Geneva 2018 THE DEINSTITUTIONALIZATION OF CHILDREN IN CAMBODIA Acknowledgments To Graziella Moraes Silva, my dissertation supervisor. Grazi, without your constant encouragement and guidance, I would not have been able to achieve this. I hope it does show the effort of a novice researcher who admires your wisdom, and humbleness. Thank you immensely. Professor Christophe Gironde, thank you sincerely for allowing me to learn from this fascinating experience in Cambodia and for supporting students whenever you can. A special thanks to Amaury Peeters, for your excellent leadership skills and your support throughout. Outstanding thanks to all the team of the NGO Louvain Cooperation in Cambodia, as well as the research team of the MICCAF project (special mention to Lucy P. Jordan, Thida Kim, and Emily Yao Fu). I learned greatly from your inputs, and from spending time with you. My sincere acknowledgments to the International Organization for Migration (IOM), Mission in Cambodia, for helping me connect with key informants. Moreover, a special thanks to all the key informants that shared their time and knowledge with me. I am also grateful to all the Residential Care Facilities which opened their doors to our visits and to the people who collaborated with this research. Thank you for your valuable time! My dear Cambodian brother, Hong Dy, a wise young man who taught me a lot during this experience. Thanks for your friendship and your work as a translator. -

Conservation Needs of the Dugong Dugong Dugon in Cambodia and Phu Quoc Island, Vietnam
Oryx Vol 42 No 1 January 2008 Conservation needs of the dugong Dugong dugon in Cambodia and Phu Quoc Island, Vietnam Ellen Hines, Kanjana Adulyanukosol, Phay Somany, Leng Sam Ath, Nick Cox, Potchana Boonyanate and Nguyen Xuan Hoa Abstract This research was conducted to assess the species be strengthened and enforced. In collaboration location of population groups and conservation issues with the Cambodian and Vietnamese governments and affecting dugongs Dugong dugon along the eastern Gulf NGOs, we propose the exploration of alternative non- of Thailand off Cambodia and Phu Quoc Island, Vietnam. destructive fishing methods and the initiation of an Interviews in fishing communities in 2002 and 2004 education campaign based on conservation of marine along the Cambodian coast revealed that dugongs are wildlife and the nearshore environment. National and sporadically found in fishing nets and their body parts transboundary management and community-based con- are sold for a relatively large profit. During 4 days of servation are required in conjunction with strategies to aerial surveys in Cambodia in 2004 we saw no dugongs. address overfishing and poverty. We interviewed villagers in Phu Quoc Island, Vietnam, in 2002 and learnt that dugongs are regularly found and hunted, again for high profits. In both countries Keywords Cambodia, Dugong dugon, Phu Quoc Island, we recommend that legislation addressing threatened marine mammal, Vietnam. Introduction of dugongs near Phu Quoc Island (Perrin et al., 1995). In the Gulf of Thailand there are small numbers of dugongs The dugong Dugong dugon is categorized as Vulnerable in eastern Thailand close to the border with Cambodia on the IUCN Red List because of population declines, (Hines et al., 2003, 2004). -

7. Satellite Cities (Un)Planned
Articulating Intra-Asian Urbanism: The Production of Satellite City Megaprojects in Phnom Penh Thomas Daniel Percival Submitted in accordance with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy The University of Leeds, School of Geography August 2012 ii The candidate confirms that the work submitted is his/her own, except where work which has formed part of jointly authored publications has been included. The contribution of the candidate and the other authors to this work has been explicitly indicated below1. The candidate confirms that appropriate credit has been given within the thesis where reference has been made to the work of others. This copy has been supplied on the understanding that it is copyright material and that no quotation from the thesis may be published without proper acknowledgement. © 2012, The University of Leeds, Thomas Daniel Percival 1 “Percival, T., Waley, P. (forthcoming, 2012) Articulating intra-Asian urbanism: the production of satellite cities in Phnom Penh. Urban Studies”. Extracts from this paper will be used to form parts of Chapters 1-3, 5-9. The paper is based on my primary research for this thesis. The final version of the paper was mostly written by myself, but with professional and editorial assistance from the second author (Waley). iii Acknowledgements First and foremost, I would like to thank my supervisors, Sara Gonzalez and Paul Waley, for their invaluable critiques, comments and support throughout this research. Further thanks are also due to the members of my Research Support Group: David Bell, Elaine Ho, Mike Parnwell, and Nichola Wood. I acknowledge funding from the Economic and Social Research Council.