Stratégie Espaces Naturels 2016-2026
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Sixth Meeting of the European Community Based Mental Health Service Providers (Eucoms) Network
THE SIXTH MEETING OF THE EUROPEAN COMMUNITY BASED MENTAL HEALTH SERVICE PROVIDERS (EUCOMS) NETWORK European Partnership for Delivering Quality Community Mental Health Services PRELIMINARY PROGRAM (v2) June 13th and 14th 2019, Lille Day 1 – June 13th 2019 9:00-9:30 Introduction and welcoming Frédéric Macabiau, Director of Strategy and General Affairs, EPSM Lille Metropole, Franck Gherbi, Mayor of Hellemmes (to be confirmed), Rene Keet, Chair of EuCOMS Representative of users (to be confirmed) PLENARY SESSION 1 9:30 – 10:00 Human Rights or Neglect: challenges for a well-organised Mental Health Philippe Delespaul 10:00-10:00 Laws: the French context Simon Vasseur-Bacle 10:10-10:30 Presentation of the EPSM Lille Metropole Frédéric Macabiau & Edvick Elia 10:30-10:45 Community involvement and human rights in Northern Romania Tibi Rotaru 10:45-11:00 The Norway view of Human Rights Tor Helge Tjeltja 11h – 11h30 Coffee break & networking 11h30-13h Workshops (parallel sessions) • Workshop 1. Experiential knowledge • Workshop 2. Reducing coercion • Workshop 3. WHO Quality Rights programme 14h30 – 18h30 Mental health organization in Lille: site visits (see detailed agenda below) Day 2 – June 14th 2019 PLENARY SESSION 2 9:00 – 10:30 Restitution of workshops and visits 10:30-11:00 Coffee break & networking 11:00-13:00 Presentation of the EPSM Lille Metropole EUCOMS Network Rene Keet SITE VISITS – DETAILED AGENDA SITES DESCRIPTION MEETING POINT CONTACT Visit 1 Discovery of the "Integrated Accompaniment of professionals Métro 4 cantons G Kruhelski Intensive Care in the City" (SIIC) in mobile teams (SIIC or SMPP) Ligne 1 Cadre de supérieur de and Family Therapeutic and/or with a therapeutic foster santé Alternative to Hospitalization family. -

Mairie SEW Journal-8
sainghinEn Weppes Le journal - N°8 | AVRIL 2017 LE JOURNAL - N°8 | AVRIL 2017 1 INDEX JEUNESSE INDEX 8 Actus, jeunesse, cadre de vie, MEL, sécurité, dossier, vie locale, recette du chef, culture, tribune libre, agenda, infos pratiques... Découvrez tout ce qui se passe à Sainghin- en-Weppes dans ce journal ! AMBLETEUSE VIE LOCALE : COMMERCES Séjour d’avril du Point Rencontre Jeunes 17 INDEX / 2 ÉDITO / 3 ACTUALITÉS : LA FERME DELATTRE / 4 ACTUALITÉS : LA FERME DELATTRE / 5 ACTUALITÉS / 6 JEUNESSE / 7 JEUNESSE / 8 CADRE DE VIE : TRAVAUX / 9 CADRE DE VIE : TRAVAUX / 10 CADRE DE VIE : TRAVAUX / 11 SAINGHIN EN PHOTOS / 12 SAINGHIN EN PHOTOS / 13 MEL / 14 SÉCURITÉ / 15 VIE LOCALE : VIE ASSOCIATIVE / 16 VIE LOCALE : COMMERCES / 17 DOSSIER : ÉLECTIONS 2017 / 18 RECETTE DU CHEF / 19 CULTURE / 20 EXTRAIT DU MAGAZINE MA BOITE N°8 TRIBUNE LIBRE / 21 AGENDA / 22 Matthieu Corbillon, Maire de Sainghin-en-Weppes INFOS PRATIQUES / 23 et Thierry Cardinael, patron de l’agence EXAECO ÉVÉNEMENT / 24 2 LE JOURNAL - N°8 | AVRIL 2017 ÉDITO CADRE DE VIE Matthieu Corbillon 9 Maire de Sainghin-en-Weppes EDITO Le récent vote du budget permettra à notre commune de continuer à se déve- lopper et à investir pour qu’il fasse tou- jours aussi bon vivre à Sainghin. Des dépenses en baisse, un endette- ment quasi-nul, un bénéfice en hausse nous permettent de maintenir un haut niveau d’investissement nécessaire pour l’ensem- ble des Sainghinois. Afin de préserver votre pouvoir d’achat, nous n’augmenterons pas vos impôts, ceci pour la quatrième année consécutive. Chaque euro dépensé est un euro RÉSIDENCE LMH utile pour vous. -

Etude D'impact BORNE DE L'espoir
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET D’AMENAGEMENT DE LA BORNE DE L’ESPOIR SAMBé LEZENNES - VILLENEUVE-D’ASCQ Fait à Lezennes, le 28 juin 2018 KALIES – KA15.10.008 K:\lannat\VILLENEUVE D'ASCQ-BORNE DE L'ESPOIR\Texte\Borne de l'Espoir - Etude d'impact - version Finale modiFiée.docx Evaluation environnementale BORNE DE L’ESPOIR – VILLENEUVE D’ASCQ et LEZENNES PRÉAMBULE La société d’aménagement Sambé, créée par les sociétés Leroy Merlin et Aventim, projette de réaliser une opération immobilière située Boulevard de Tournai à Villeneuve d’Ascq et Lezennes sur l’emprise d’un terrain actuellement en Friche et propriété de la Métropole Européenne de Lille (MEL). L’opération se déroulera en plusieurs phases et comprend les lots suivants : Macrolot A : concerne la relocalisation du magasin Leroy Merlin situé de l’autre côté du Boulevard de Tournai et la création d’activités tertiaires et de services ; Macrolot B2 : concerne un programme de bureaux et commerces ; Macrolot B1 : parcelle dont l’utilisateur n’est pas encore désigné et pour lequel une gestion transitoire à Fort pouvoir écologique est proposée. Les caractéristiques principales du projet sont les suivantes : terrain d’assiette d’une superficie de 10,1 hectares, périmètre du permis d’aménager de 9,9 hectares, création d’une surface de plancher de 9,5 hectares, déboisement d’1,2 hectares de jeunes boisements non soumis à autorisation de déFrichement. Compte-tenu de ces caractéristiques, le projet est visé par les rubriques suivantes de l’annexe de l’article R122-2 du Code de l’environnement : Rubrique n°39 relative aux « Travaux, constructions et opérations d'aménagement y compris ceux donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement concerté ». -

New Tools for Mental Health Care Into the Community
New tools for mental health care into the community: participative health democracy, mobile teams, host families, ambulatory cares, supportive housing The experience of Eastern Lille Suburbs : Mons en Baroeul, Hellemmes, Lezennes, Faches Thumesnil, Ronchin, Lesquin Dr DEFROMONT Laurent Head of service Public Mental Health Trust Lille-Métropole Our catchment area : Eastern Lille Suburbs : Mons en Baroeul, Hellemmes, Lezennes,Faches Thumesnil, Ronchin, Lesquin Our cactchement area 1 DIRM – EPSM Lille-Métropole The territory 6 municipalities, Eastern Lille Suburbs, 26 km² 84 193 inhabitants – Urban zone Eastern Lille Suburbs: Mental Health care needs Mental Health in General Population study 2008 Number of Number of Number of people persons with inhabitants Impact Help and with a suicidal Aged of more at least one Number of perceived on Feeling of support found risk average or than 18 yars trouble at the inhabitants day life in the close high* old MINI* being ill circle * 85 300 63 790 22 710 11 482 14 662 3 636 5 592 People in care in 2014 : 3184 persons *** Mini International Neuropsychiatric Interview SMPG NPDC Care utilisation – Perceptions “Imagine you’re unhappy. You have difficulties in your life. You’re feeling dissatisfaction and discomfort. You don’t know where you stand. You don’t understand what’s happening to you. Your state of mind is deteriorating”. 100 Who would you talk about that in first ? 80 60 42,3 40 38,4 20 11,8 7,3 0,2 0 General practicionners Psychiatrists Relations Nobody Others responses WHO recommendations for -

LISTE-DES-ELECTEURS.Pdf
CIVILITE NOM PRENOM ADRESSE CP VILLE N° Ordinal MADAME ABBAR AMAL 830 A RUE JEAN JAURES 59156 LOURCHES 62678 MADAME ABDELMOUMEN INES 257 RUE PIERRE LEGRAND 59000 LILLE 106378 MADAME ABDELMOUMENE LOUISA 144 RUE D'ARRAS 59000 LILLE 110898 MONSIEUR ABU IBIEH LUTFI 11 RUE DES INGERS 07500 TOURNAI 119015 MONSIEUR ADAMIAK LUDOVIC 117 AVENUE DE DUNKERQUE 59000 LILLE 80384 MONSIEUR ADENIS NICOLAS 42 RUE DU BUISSON 59000 LILLE 101388 MONSIEUR ADIASSE RENE 3 RUE DE WALINCOURT 59830 WANNEHAIN 76027 MONSIEUR ADIGARD LUCAS 53 RUE DE LA STATION 59650 VILLENEUVE D ASCQ 116892 MONSIEUR ADONEL GREGORY 84 AVENUE DE LA LIBERATION 59300 AULNOY LEZ VALENCIENNES 12934 CRF L'ESPOIR DE LILLE HELLEMMES 25 BOULEVARD PAVE DU MONSIEUR ADURRIAGA XIMUN 59260 LILLE 119230 MOULIN BP 1 MADAME AELVOET LAURENCE CLINIQUE DU CROISE LAROCHE 199 RUE DE LA RIANDERIE 59700 MARCQ EN BAROEUL 43822 MONSIEUR AFCHAIN JEAN-MARIE 43 RUE ALBERT SAMAIN 59650 VILLENEUVE D ASCQ 35417 MADAME AFCHAIN JACQUELINE 267 ALLEE CHARDIN 59650 VILLENEUVE D ASCQ 35416 MADAME AGAG ELODIE 137 RUE PASTEUR 59700 MARCQ EN BAROEUL 71682 MADAME AGIL CELINE 39 RUE DU PREAVIN LA MOTTE AU BOIS 59190 MORBECQUE 89403 MADAME AGNELLO SYLVIE 77 RUE DU PEUPLE BELGE 07340 colfontaine 55083 MONSIEUR AGNELLO CATALDO Centre L'ADAPT 121 ROUTE DE SOLESMES BP 401 59407 CAMBRAI CEDEX 55082 MONSIEUR AGOSTINELLI TONI 63 RUE DE LA CHAUSSEE BRUNEHAUT 59750 FEIGNIES 115348 MONSIEUR AGUILAR BARTHELEMY 9 RUE LAMARTINE 59280 ARMENTIERES 111851 MONSIEUR AHODEGNON DODEME 2 RUELLE DEDALE 1348 LOUVAIN LA NEUVE - Belgique121345 MONSIEUR -

Lille European Metropolis Key Datas - Within the French Environnement
L ILLE E UROPEAN M ETROPOLIS M ETROPOLE E EUROPEENNE L ILLE KEY DATAS & TERRITORY Lille European Metropolis Key datas - Within the French environnement FRANCE HAUTS-DE-FRANCE LILLE EUROPEAN METROPOLIS CAPITAL CAPITAL CENTRAL CITY PARIS LILLE LILLE POPULATION POPULATION POPULATION 66.9M Hbts 6M Hbts (3rd) 1.39M Hbts (1st) AREA AREA AREA 675 417Km2 31 813Km2 (3rd) 647.7Km2 (4th) DENSITY DENSITY DENSITY 116Hbts/Km2 190Hbts/Km2 1760Hbts/Km2 (1st) GPD GPD GPD 2349Bn EUR 153.9Bn EUR (4th) 70Bn EUR (4e) Lille European Metropolis Key datas – Location in Europe AMSTERDAM ROTTERDAM LONDON DORTMUND DUSSELDORF KOLN BRUSSELS LILLE FRANKFURT PARIS STRASBOURG LYON MONTPELLIER MARSEILLES Lille European Metropolis Key datas - Meropolitan Territory 1 METROPOLIS 90 MUNICIPALITES ~30 km ~33 km ECONOMIC DATAS & CENTRE OF EXCELLENCE Lille European Metropolis Economic datas HALLUIN BOUSBECQUE Business Parks WERVICQ- SUD NEUVILLE- COMINES EN-FERRAIN Clusters RONCQ & economic activities WARNETON LINSELLES DEÛLÉMONT TOURCOING QUESNOY- SUR-DEÛLE BONDUES MOUVAUX FRELINGHIEN WATTRELOS ARMENTIÈRES WAMBRECHIES ROUBAIX VERLINGHEM WASQUEHAL HOUPLINES LEERS MARQUETTE LYS-LEZ- LA CHAPELLE PÉRENCHIES ERQUINGHEM-LYS LANNOY D'ARMENTIÈRES MARCQ-EN- CROIX LANNOY LOMPRET SAINT-ANDRÉ- BAROEUL PRÉMESQUES LEZ-LILLE TOUFFLERS LA MADELEINE HEM BOIS- LAMBERSART GRENIER SAILLY-LEZ- CAPINGHEM MONS-EN- LANNOY ENNETIÈRES- BAROEUL EN-WEPPES FOREST-SUR- RADINGHEM- VILLENEUVE MARQUE WILLEMS EN-WEPPES ENGLOS LILLE D'ASCQ SEQUEDIN LE ESCOBECQUES MAISNIL HALLENNES-LEZ- LOOS TRESSIN BEAUCAMPS -

Recueil Des Actes Administratifs De La Préfecture Du Nord Année 2019- Recueil N°10 Du 14 Janvier 2019
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ANNÉE 2019 – NUMÉRO 10 DU 14 JANVIER 2019 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD ANNÉE 2019- RECUEIL N°10 DU 14 JANVIER 2019 TABLE DES MATIÈRES CABINET DU PRÉFET - DIRECTION DES SÉCURITÉS Arrêté préfectoral du 14 janvier 2019 portant sur la composition et le fonctionnement de la commission commu- nale d’accessibilité de DUNKERQUE CENTRE PENITENTIAIRE DE LILLE LOOS SEQUEDIN Décision n°42 du 14 janvier 2019 portant délégation de signature en matière disciplinaire Décision n°43 du 14 janvier 2019 portant délégation de signature en matière disciplinaire Décision n°45 du 14 janvier 2019 portant délégation de signature en matière disciplinaire DIRECCTE DES HAUTS DE FRANCE Décision du 11 janvier 2019 portant affectation des agents de contrôles dans les unités de contrôle et gestion des interims – unité départementale du Nord Lille SECRETARIAT GENERAL DE LA PREFECTURE DU NORD DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LA CITOYENNETE Arrêté du 10 janvier 2019 portant nomination des membres des commissions de contrôle chargés de la régularité des listes électorales dans les communes de l’arrondissement de LILLE (annexes) – ANNULE ET REMPLACE SECRETARIAT GENERAL DE LA PREFECTURE DU NORD DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES INTERMINISTERIELLES Arrêté préfectoral du 04 janvier 2019 fixant la composition du bureau de la commission de suivi du site (CSS) de l’établissement GALLOO FRANCE à Halluin Arrêté préfectoral du 04 janvier 2019 donnant acte de la déclaration d’ouverture de travaux miniers de -

MAIRIE DE SAILLY-Lez-LANNOY
MAIRIE DE SAILLY-lez-LANNOY ----------------- PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2020 Commune de Sailly-lez-Lannoy L’an deux mil vingt, le 23 septembre, à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune de République Française Sailly-lez-Lannoy s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Eric SKYRONKA, Maire, en suite de la convocation en date du 17 septembre 2020 dont un Département du Nord Arrondissement de Lille exemplaire a été affiché à la porte de la mairie. Canton de Villeneuve d’Ascq Séance ouverte Etaient présents : Mme Martha BOZEK, Mme Anaëlle CHEVALIER, Mme Anne-Sophie CONSTANT, Mme Elysa D’ALESSANDRO, M. Michel DELEDALLE, M. Alain DENIEUL, M. Jean-Claude D’HALLUIN, M. Patrick GOREZ, Mme Bernadette HUYGHE, Mme Amandine MOREELS, M. Luc MULLIEZ, Mme Hélène POLLET, M. Eric SKYRONKA, Mme Marie-Christine SOLER, M. Philippe SPELEERS, Mme Sophie VANBREMEERSCH, M. Benoît VANDYSTADT. Ont donné pouvoir : M. Alain CARDON à M. Eric SKYRONKA, M. Alain BOUCKHUIT à M. Philippe SPELEERS Secrétaire de séance : Mme Hélène POLLET ----------------------------------------------------------------- La séance est ouverte à 20 heures. ➢ Désignation du secrétaire de séance – Eric SKYRONKA ➢ Appel des membres – Hélène POLLET ➢ Approbation du procès-verbal de la séance précédente du 24-06-2020 – Eric SKYRONKA ➢ Lecture de l’ordre du jour – Eric SKYRONKA Délibération n°2020-44 : REMBOURSEMENT DES RESERVATIONS DES LOCATIONS DE SALLE DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE - Vu la délibération 2016-67 votée le 14 décembre 2016, - Vu la délibération 2016-68 votée le 14 décembre 2016, - Vu la délibération 2019-53 votée le 04 décembre 2019, Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, suite aux directives gouvernementales, ainsi que les différentes mesures préfectorales successives, il est proposé de déroger au règlement des locations de salles. -

Recueil Des Actes Administratifs De La Préfecture Du Nord Année 2019- Recueil N°171 Du 10 Juillet 2019 2019 2019
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS RECUEIL SPECIAL DDTM ANNÉE 2019 – NUMÉRO 171 DU 10 JUILLET 2019 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD ANNÉE 2019- RECUEIL N°171 DU 10 JUILLET 2019 2019 2019 TABLE DES MATIÈRES IRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER 1 Arrêté du 05 juillet 2019 permettant d’établir l’état des risques et pollutions pour les acquéreurs et les loca- taire- liste des communes concernées sur le département du Nord annexée 140 arrêtés communaux du 05 juillet 2019 relatifs à l’état des risques et pollutions des biens immobiliers situés sur les communes de : ABSCON ANICHE ANNOEULLIN ANZIN ARMENTIERES ARTRES AUBY AULNOYE-AYMERIES AULNOY LEZ VALENCIENNES AVESNES LES AUBERT BACHANT BAVAY BERLAIMONT BERMERAIN BERTRY BONDUES BOUCHAIN BOURBOURG BOUSBECQUES BOUSSOIS BRAY DUNES BEUVRY LA FORET BRUAY SUR ESCAUT CONDE SUR ESCAUT COUDEKERQUE BRANCHE CROIX CUINCY CURGIES DENAIN DOMPIERRE SUR HELPE DON DOUAI DOUCHY LES MINES DUNKERQUE ESCAUDAIN ESTREUX FACHES THUMESNIL FAMARS FEIGNIES FERRIERE LA GRANDE FLINES LES MORTAGNE FLOYON FOREST SUR MARQUE FOURMIES FRELINGHIEN FRESNES SUR ESCAUT GHYVELDE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD ANNÉE 2019- RECUEIL N°171 DU 10 JUILLET 2019 2019 2019 GOMMEGNIES GO NDECOURT GRAVELINES HALLUIN HAUBOURDIN HAUTMONT HAVELUY HEM HERGNIES HOMECOURT SUR ESCAUT HOUPLINES JENLAIN JEUMONT JOLIMETZ LA CHAPELLE D ARMENTIERES LA MADELEINE LAMBERSART LA SENTINELLE LE CATEAU CAMBRESIS LEERS LEFFRINCKOUCKE LE QUESNOY LESQUIN LILLE LOCQUIGNOL LOOS LOURCHES LOUVIGNIES-QUESNOY -

C. Carte De La Desserte Du Lieu D'implantation Du Projet Par Les
LEZENNES IMMO c. Carte de la desserte du lieu d’implantation du projet par les transports collectifs, voies piétonnes et pistes cyclables 3° Cartes ou plans relatifs au projet 91 LEZENNES IMMO d. Carte des principales voies et aménagements routiers desservant le projet 3° Cartes ou plans relatifs au projet 92 LEZENNES IMMO e. Plan de la zone commerciale dans laquelle s’insère le projet Projet 3° Cartes ou plans relatifs au projet 93 PARTIE 4 Effets du projet en matière d’aménagement du territoire LEZENNES IMMO LEZENNES IMMO a. Contribution à l’animation des principaux secteurs existants 1. Créer une véritable porte d’entrée à la zone commerciale L’un des principaux enjeux de l’aménagement de ce terrain en friche est de remplir une dent creuse et marquer l’entrée de la zone. Le nouveau siège mondial KIABI bénéficie d’un site offrant une forte visibilité depuis le boulevard de Tournai et une articulation adéquate entre zone commerciale-loisirs et zone tertiaire. La frange urbaine le long du boulevard de Tournai constitue aujourd’hui la liaison entre le centre ancien de Lezennes et le centre-ville de Villeneuve d’Ascq. Elle ne permet néanmoins pas aujourd’hui d’identifier visiblement et lisiblement l’entrée de ville. Le projet a donc été pensé dans un souci de créer un bâtiment à l’image d’un siège international, ancré dans une dynamique de renouvellement urbain à l’échelle d’une métropole européenne. 2. Une implantation en cohérence avec la requalification urbaine Grand Angle Le futur siège KIABI prend place dans un secteur privilégié en pleine mutation urbaine avec le projet de requalification urbaine Grand Angle de Villeneuve-d’Ascq. -
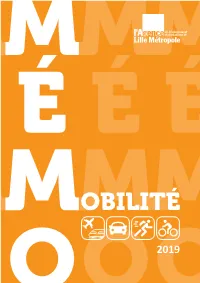
1928-Memomobilite Web.Pdf
2019 UNE MÉTROPOLE EUROPÉENNE CONNECTÉE 2,7 ers/an 201 Gare Lille-Flandres Gare Lille-Europe 19,5 7,2 millions millions ers ers ère gar1 GV e de voyageurs (hor aris) e Strasbourg 2 3e gare er (TG 1 Lyon e Part Dieu de voyageurs (hor aris) P 3e port fluvial de France 1,9 ers/an à l’aéroport Lille-Lesquin 201 ZWEVEGEM KORTRIJK Kortrijk Voie ferroviaire TER structurante MENEN Gare accessible avec l’intégration tarifaire Voie ferroviaire TER structurante dont la Leie BOESCHEPE Gare hors intégration tarifaire fermeture est programmée en décembre 2019 WERVIK HEUVELLAND UNE RESSOURCE FERROVIAIRE AVELGEM Voie ferroviaire dont le trac est suspendu HALLUIN Gare extérieure au SCOT BERTHEN COMINES CAPITALE Voie ferroviaire externe au SCOT Ypres / Ieper 18 min Temps d’accès* à partir d’Euraandre SAINT-JANS-CAPPEL WERVICQ- MESEN COMINES SUD Temps d’accès* à partir d’Euraandre BOUSBECQUE 26 min La Lys NEUVILLE- EN-FERRAIN (pour les gares hors SCOT) MOUSCRON * Optimal GARE RONCQ WARNETON DE COMINES GARE BAILLEUL 30 min 2 2 LINSELLES GARE DE MOUSCRON usagers dans les gares Dunkerque 26 min Calais DEÛLEMONT DE TOURCOING 18 min SPIERE-HELKIJN du territoire du SCOT QUESNOY- tr 201 SUR-DEÛLE TOURCOING La Deûle Lys BONDUES FRELINGHIEN MOUVAUX WATTRELOS NIEPPE La ARMENTIÈRES MONTÉES ET DESCENTES PAR JOUR WAMBRECHIES Canal de Roubaix ROUBAIX ESTAIMPUIS PECQ LE DOULIEU STEENWERCK HOUPLINES VERLINGHEM WASQUEHAL GARE de ROUBAIX GARE (Jean-Lebas) LEERS PÉRENCHIES MARQUETTE- CROIX LYS-LEZ- 10 000 D’ARMENTIÈRES LEZ-LILLE LANNOY LA CHAPELLE- 13 min -

Brevium Exempla Ad Describendas Res Ecclesiasticas Et Fiscales» In: Revue Belge De Philologie Et D'histoire
P. Grierson The Identity of the Unnamed Fiscs in the « Brevium exempla ad describendas res ecclesiasticas et fiscales» In: Revue belge de philologie et d'histoire. Tome 18 fasc. 2-3, 1939. pp. 437-461. Citer ce document / Cite this document : Grierson P. The Identity of the Unnamed Fiscs in the « Brevium exempla ad describendas res ecclesiasticas et fiscales». In: Revue belge de philologie et d'histoire. Tome 18 fasc. 2-3, 1939. pp. 437-461. doi : 10.3406/rbph.1939.1300 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rbph_0035-0818_1939_num_18_2_1300 THE IDENTITY OF THE UNNAMED FISCS IN THE <( BREVIUM EXEMPLA AD DESCRÏBENDAS RES ECCLESIASTICAS ET FISCALES » The so-called (*) Brevium exempla ad describendas res eccle- siasticas et fiscales form one of the small group of surviving documents on which is based our knowledge of the organiza- tion of the royal domain in Carolingian times (2). They consist of three specimen descriptions of property more or less fiscal in character, and were presumably drawn up for the guidance of the royal agents engaged in assessing the produce of the domain (3). The first description is of the possessions of the see of Augsburg on an island on Staffelsee in Bavaria, the second is part of a register of the possessions of the abbey of Weissenburg in Alsace, and the third is the survey of a group of royal fiscs belonging directly to the Crown. It is wit h (1) They bear no title in the manuscript, their opening portion being missing, but the title given them by Boretius is the one by which they are usually known.