La Réglementation Des Services Audiovisuels À La Demande
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Velasco Washington 0250O 16
Online Video as a Tool for Planning Education and Engagement: A Content Analysis of U.S. City Planning Departments’ YouTube Channels Stephanie J. Velasco A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Urban Planning University of Washington 2016 Committee: Branden Born Christopher Campbell Program Authorized to Offer Degree: Urban Design and Planning © Copyright 2016 Stephanie J. Velasco University of Washington Abstract Online Video as a Tool for Planning Education and Engagement: A Content Analysis of U.S. City Planning Departments’ YouTube Channels Stephanie J. Velasco Chair of the Supervisory Committee: Professor Branden Born Urban Design and Planning This study explores the potential for city planning departments to more deeply engage citizens in public planning processes by producing and sharing educational videos through such online platforms as YouTube. Many academic and professional fields have already recognized and adopted YouTube as a dynamic medium for education, however planning departments in the United States’ largest cities have yet to fully take advantage of this social media platform. This study uses content analysis to describe and categorize the digital video content published on seven city planning departments’ YouTube channels. In addition, this study illuminates relationships between video popularity—measured in number of views—and video length, production quality, production elements (e.g. voiceover, motion graphics or animation, background music, etc.), the degree of production effort (or cost) required on the part of the content creator, and the presence or absence of an explicit call to action. TABLE OF CONTENTS 1. Introduction ...............................................................................................................................1 2. Literature Review .....................................................................................................................5 2.1. -

LNCS 8518, Pp
An Alternative Media Experience: LiveLeak* Fatih Çömlekçi1 and Serhat Güney2 1 Ministry of Culture, State Theater, Mete Cad. No: 26, Beyoğlu, 34420 Istanbul Turkey [email protected] 2 Galatasaray University, Faculty of Communication, Ciragan Cad. No: 36 Ortakoy 34357 Istanbul, Turkey [email protected] Abstract. This research examines a video sharing web site called LiveLeak to be able to analyze the possibilities of democratic and horizontal social mobilization via Internet technology. In this sense, we take into consideration the Gilles Deleuze and Félix Guattari’s philosophical conceptualization of “rhizome” which provides a new approach for activities of online communities. In the light of this concept and its anti-hierarchical approach we tried to discuss the potentials of network communication models such as LiveLeak in terms of emancipating use of media and democratic communication. By analyzing the contextual traffic on the LiveLeak for a randomly chosen one week (first week of December 2013) we argue that this video sharing web site shows a rhizomatic characteristic. Keywords: LiveLeak, Rhizome, Social Networking. 1 Introduction Rapid developments in communication technologies and its social reflections, which took place especially in the 20th century, have drawn the attention of social scientists. At one extreme, Frankfurt School and its followers advanced a pessimistic approach to new media targeting specifically manipulation and standardization of the message. On the other hand, an optimistic approach formulated by Marshall McLuhan attributes an emancipating and democratic meaning to new media. Apart from these orthodox Marxist criticism and technologically deterministic liberal aspects, writers such as Bertolt Brecht [1] and Walter Benjamin [2] set forth different approaches that regard the energy and socially transforming effect of the new media, emphasizing the socialist and emancipating mission of massification in the age of mechanical reproduction. -

Challenges of 3D Printing to Repair
2013] 1147 THE CHALLENGES OF 3D PRINTING TO THE REPAIR-RECONSTRUCTION DOCTRINE IN PATENT LAW Kelsey B. Wilbanks* INTRODUCTION Patent law is no stranger to technological innovation. Just recently, courts have handled the legal uproar over smartphones,1 new forms of bio- technology,2 and more.3 Three-dimensional (“3D”) printing has now emerged,4 and patent law will once again need to adapt. Three-dimensional printing is new technology that allows consumers to manufacture a seemingly endless variety of items in the comfort of their homes. Although innovators have recently used 3D printers to make re- markable creations like functional guns, it is becoming more common for average tinkerers to 3D print replacement parts for broken home objects. * George Mason University School of Law, J.D. Candidate, May 2014; Notes Editor, GEORGE MASON LAW REVIEW, 2013-2014; Missouri State University, B.S., Entertainment Management, De- cember 2010. This Comment received the George Mason Law Review’s 2013 Adrian S. Fisher Award for best student article, and it was featured as a condensed presentation at the “ConFABulation Sympo- sium on 3D Printing in the Classroom” in Largo, Maryland. I would like to first thank my husband Jason for his help in developing this topic. I would also like to thank the organizers of the ConFABula- tion Symposium, John Anderson and Jonathan Monaghan, and its participants for their helpful com- ments. Finally, I would like to thank Professor Adam Mossoff, my friends Josh Cox, Tashina Harris, and Martin Desjardins, my cousin Penny Caudle, my mother Joyce, and the rest of my family for their help in writing and editing this piece. -
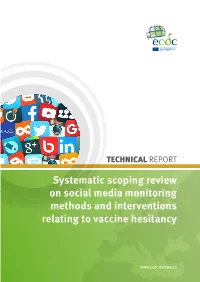
Systematic Scoping Review on Social Media Monitoring Methods and Interventions Relating to Vaccine Hesitancy
TECHNICAL REPORT Systematic scoping review on social media monitoring methods and interventions relating to vaccine hesitancy www.ecdc.europa.eu ECDC TECHNICAL REPORT Systematic scoping review on social media monitoring methods and interventions relating to vaccine hesitancy This report was commissioned by the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) and coordinated by Kate Olsson with the support of Judit Takács. The scoping review was performed by researchers from the Vaccine Confidence Project, at the London School of Hygiene & Tropical Medicine (contract number ECD8894). Authors: Emilie Karafillakis, Clarissa Simas, Sam Martin, Sara Dada, Heidi Larson. Acknowledgements ECDC would like to acknowledge contributions to the project from the expert reviewers: Dan Arthus, University College London; Maged N Kamel Boulos, University of the Highlands and Islands, Sandra Alexiu, GP Association Bucharest and Franklin Apfel and Sabrina Cecconi, World Health Communication Associates. ECDC would also like to acknowledge ECDC colleagues who reviewed and contributed to the document: John Kinsman, Andrea Würz and Marybelle Stryk. Suggested citation: European Centre for Disease Prevention and Control. Systematic scoping review on social media monitoring methods and interventions relating to vaccine hesitancy. Stockholm: ECDC; 2020. Stockholm, February 2020 ISBN 978-92-9498-452-4 doi: 10.2900/260624 Catalogue number TQ-04-20-076-EN-N © European Centre for Disease Prevention and Control, 2020 Reproduction is authorised, provided the -

Hypersphere Anonymous
Hypersphere Anonymous This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. ISBN 978-1-329-78152-8 First edition: December 2015 Fourth edition Part 1 Slice of Life Adventures in The Hypersphere 2 The Hypersphere is a big fucking place, kid. Imagine the biggest pile of dung you can take and then double-- no, triple that shit and you s t i l l h a v e n ’ t c o m e c l o s e t o o n e octingentillionth of a Hypersphere cornerstone. Hell, you probably don’t even know what the Hypersphere is, you goddamn fucking idiot kid. I bet you don’t know the first goddamn thing about the Hypersphere. If you were paying attention, you would have gathered that it’s a big fucking 3 place, but one thing I bet you didn’t know about the Hypersphere is that it is filled with fucked up freaks. There are normal people too, but they just aren’t as interesting as the freaks. Are you a freak, kid? Some sort of fucking Hypersphere psycho? What the fuck are you even doing here? Get the fuck out of my face you fucking deviant. So there I was, chilling out in the Hypersphere. I’d spent the vast majority of my life there, in fact. It did contain everything in my observable universe, so it was pretty hard to leave, honestly. At the time, I was stressing the fuck out about a fight I had gotten in earlier. I’d been shooting some hoops when some no-good shithouses had waltzed up to me and tried to make a scene. -
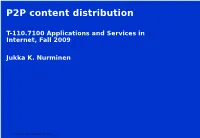
P2P Content Distribution
P2P content distribution T-110.7100 Applications and Services in Internet, Fall 2009 Jukka K. Nurminen 1 V1-Filename.ppt / yyyy-mm-dd / Initials Steps of content sharing Share content Find content Transfer content 2 V1-Filename.ppt /2008-10-22 / Jukka K. Nurminen BitTorrent – content downloading • Efficient content distribution • Bram Cohen, 2001 • Key idea: you can receive faster than what your peer is able to send • Peer serving multiple users • Asynchronous connections • E2E speed of Internet • File divided into pieces, recipient receives pieces from multiple peers • Each recipient supplies pieces of the data to newer recipients 3 V1-Filename.ppt / 2008-11-12 / Jukka K. Nurminen BitTorrent – components Maintaining Normal website – information about hosting of metadata which peers have the files (torrent-files) content available tracker website seed leech Peer with entire file Peer that is still downloading (has only parts of the file) 4 V1-Filename.ppt / 2008-11-12 / Jukka K. Nurminen Adapted from Nikitas Liogkas, Robert Nelson, Eddie Kohler, Lixia Zhang, “Exploiting BitTorrent For Fun,” University of California, BitTorrent – joining a torrent Los Angeles metadata file new leecher website 1 2 join peer list 3 data request seed/leecher tracker 4 1. obtain the metadata file (.torrent -file) 2. contact the tracker 3. obtain a peer list (contains seeds & leechers) 4. contact peers from that list for data 5 V1-Filename.ppt / 2008-11-12 / Jukka K. Nurminen BitTorrent – exchanging data leecher B leecher A I have ! seed leecher C ● Download sub-pieces in parallel ● Verify pieces using hashes ● Advertise received pieces to the entire peer list ● Look for the rarest pieces 6 V1-Filename.ppt / 2008-11-12 / Jukka K. -

A Study of Internet Based Community Interactions
Virtual Online Communities: A Study of Internet Based Community Interactions A dissertation presented to the faculty of the Scripps College of Communication of Ohio University In partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Philosophy Adrian M. Budiman August 2008 This dissertation titled Virtual Communities Online: A Study of Internet Based Community Interactions by ADRIAN M. BUDIMAN has been approved for the School of Media Arts and Studies and the Scripps College of Communication by Drew McDaniel Professor of Telecommunications Gregory J. Shepherd Dean, Scripps College of Communication ii Abstract BUDIMAN, ADRIAN M., Ph.D., August 2008, Mass Communication Virtual Online Communities: A Study of Internet Based Community Interactions (167 pp.) Director of Dissertation: Drew McDaniel The aim of this research was to better understand virtual online communities (VOCs), that is, communities that are formed and maintained through the Internet. This research was guided by four research questions: What do participants in VOCs actually seek? How does a participant critically evaluate information produced in VOCs? What differences do VOC members perceive between their online community experiences compared to their experiences in real-life face-to-face communities? In what ways might a VOC shape its members’ views toward political and social change? The methodology employed was participant observation of 20 informants within their online and offline realms plus in-depth interviews with each informant. Interviews and observations were conducted from 2005 – 2007. This research identified two different types of VOCs: dependent and self- contained VOCs. Dependent VOCs act as extensions to already existent face-to-face communities while self-sustained VOCs are communities where relationships between members are formed, developed, and nurtured purely through virtual encounters on the Internet based on shared interests. -

Australia 2019
Australia Free 77 100 A Obstacles to Access 23 25 B Limits on Content 29 35 C Violations of User Rights 25 40 Last Year's Score & Status 79 100 Free Overview Internet freedom in Australia declined during the coverage period. The country’s information and communication technology (ICT) infrastructure is well developed, and prices for connections are low, ensuring that much of the population enjoys access to the internet. However, a number of website restrictions, such as those related to online piracy or “abhorrent” content, limit the content available to users. The March 2019 terrorist attack on mosques in Christchurch, New Zealand, prompted internet service providers (ISPs) to block certain websites and the government subsequently introduced a new law that criminalized the failure to delete “abhorrent” content. Other legal changes—including court decisions expanding the country’s punitive defamation standards, an injunction silencing digital media coverage of a high-profile trial, and a problematic law that undermines encryption—shrunk the space for free online expression in Australia. Finally, an escalating series of cyberattacks sponsored by China profoundly challenged the security of Australia’s digital sphere. Australia is a democracy with a strong record of advancing and protecting political rights and civil liberties. Recent challenges to these freedoms have included the threat of foreign political influence, harsh policies toward asylum seekers, and ongoing disparities faced by indigenous Australians. Key Developments June 1, 2018 – May 31, 2019 After the March 2019 Christchurch attack, in which an Australian man who had espoused white supremacist views allegedly killed 51 people at two New Zealand mosques, ISPs acted independently to block access to more than 40 websites that hosted the attacker’s live-streamed video of his crimes. -

Unclassified DSTI/ICCP/IE(2006)7/FINAL
Unclassified DSTI/ICCP/IE(2006)7/FINAL Organisation de Coopération et de Développement Economiques Organisation for Economic Co-operation and Development 12-Apr-2007 ___________________________________________________________________________________________ English - Or. English DIRECTORATE FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY COMMITTEE FOR INFORMATION, COMPUTER AND COMMUNICATIONS POLICY Unclassified DSTI/ICCP/IE(2006)7/FINAL Working Party on the Information Economy PARTICIPATIVE WEB: USER-CREATED CONTENT English - Or. English JT03225396 Document complet disponible sur OLIS dans son format d'origine Complete document available on OLIS in its original format DSTI/ICCP/IE(2006)7/FINAL FOREWORD This report was presented to the Working Party on the Information Economy (WPIE) in December 2006 and declassified by the Committee for Information, Computer and Communications Policy in March 2007. The report was prepared by Sacha Wunsch-Vincent and Graham Vickery of the OECD's Directorate for Science, Technology and Industry as part of the WPIE work on Digital Content (www.oecd.org/sti/digitalcontent). It is published on the responsibility of the Secretary-General of the OECD. © OECD/OCDE 2007 2 DSTI/ICCP/IE(2006)7/FINAL TABLE OF CONTENTS SUMMARY.................................................................................................................................................. 4 PARTICIPATIVE WEB: USER-CREATED CONTENT (UCC) ............................................................... 7 INTRODUCTION ....................................................................................................................................... -

How Download Video Muliple Files Youtube Batch Downloader: How to Batch Download Youtube Videos in One Click
how download video muliple files YouTube Batch Downloader: How to Batch Download YouTube Videos in One Click. In this article, you will get a YouTube batch downloader that helps you to batch download YouTube videos and enjoy them anytime you want. Steven Wilson. Jun 12,2019 • Filed to: YouTube Downloader • Proven solutions. "How can I download multiple YouTube videos in batch without downloading them one by one?" "I found a wonderful YouTube playlist and want to download all the videos from the YouTube playlist, but donnot know how to do." If you feel troublesome by the above problems to download bacth Youtube videos at a time, then finding a good way to download YouTube videos in batch is an efficient method to enjoy and download YouTube videos. The following article are looking for the best way to batch download YouTube videos, just follow us to find the easiest way to download bulk YouTube videos in 1 click. keep reading, this article will intrduce 10 popular YouTube audio downloaders. Just check it out! Part 1. How to Download Multiple YouTube Videos in Batch Easily Part 2. Other 6 Youtube Batch Downloader Introduction (Desktop and Online) Part 3. The Comparison Table for This 7 Youtube Batch Downloaders. Part 1. How to Download Multiple YouTube Videos in Batch Easily. Since most Youtubers often sort videos into different thematic playlists according to the property of the video and the interest of the wide Youtube users. Downloading YouTube videos in batch at one time is in great need for most Youtube users. So a YouTube batch downloader will be the best helper. -

Download Vimeo Files Online Free How to Download Or Save a Vimeo Video to Your Computer
download vimeo files online free How to download or save a Vimeo video to your computer. Vimeo is a collection of high-quality films, videos, and animations from people all around the world. You may want to save your favorite videos to your computer so you can watch them without being connected to the Internet or mobile devices. Below are the steps required for downloading and watching Vimeo videos on your computer for free. You cannot download and save streaming videos from Vimeo using the download options below. Download within Vimeo. Unlike most video services, some of the videos on Vimeo can be downloaded to a computer. If the download option for a video is available, click the Download button below the video, as shown in the picture below. After clicking the Download button, a list of available formats is displayed. The most common video format available for download is the SD format. The download option is not available for all videos. Users must have a Business , Plus , or Pro account to enable their videos for download by other users. Saving a Vimeo video using another service. Some third-party websites allow you to enter the URL of the video you want to save to your computer, and offer a video file for you to download. Below is a simple three-step process to download any Vimeo video. If you are at a school or job that is blocking Vimeo, these steps may not work. First, go to Vimeo and navigate to the video you want to save. When you've found the page, press Ctrl + L on your keyboard to highlight the URL in the address bar, and then Ctrl + C to copy the Internet address. -

Web Browser with Video Downloader the Best Browser Video Downloaders for You to Save Videos Online
web browser with video downloader The Best Browser Video Downloaders for You to Save Videos Online. A good browser video downloader allows you to capture videos from the Internet to your computer or mobile devices easily and save you much time and energy. If you’re looking for such a tool, this article will be the best place to go. Here we will introduce to you the best video download browser add-ons, websites as well as the best desktop video downloader for saving videos from browser. Quickly install the best desktop video downloader, click here: Option 1: Download Videos with Free HD Video Converter Factory. Option 2: Websites for Video Download Browser. Option 3: Web Browser with Video Downloader Extensions/Add-Ons. YouTube, Vimeo, Dailymotion, and countless other video-hosting websites make it easier than ever for us to find the needed video types and even a particular video. Although watching videos online is convenient with a good net connection, sometimes we still want to download videos from browsers for collection or offline playback, especially when not connecting with the internet. A good browser video downloader allows us to download videos handily yet there is a wide range of similar dazzling tools on the Internet, which urges people to sort the wheat from the chaff. Fortunately, you don’t have to spend much time on this task as we have done it for you in the following parts. Please note that it’s not legal to download any copyrighted content and use them for commercial purpose. Before you download videos from a browser, you’d better to check out whether the sources are copyrighted.