150 Ans De Tourisme Au Col Du Lautaret
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

French Alps & the Jura
© Lonely Planet 238 A R JU E H T & S P L French Alps & the Jura NCH A RE HIGHLIGHTS F Conquering the Alpe d’Huez (p261) Teetering on the edge of the Gorges da la Bourne (p242) Slowly approaching the hilltop, medieval-fortified village of Nozeroy (p255) Conquering the highest pedalled pass – Col du Galibier 2645m (p241) TERRAIN Extremely mountainous in the Alps, and mainly rolling hills in the Jura with some real lung-crushers from time to time. Telephone Code – 03 www.franche-comte.org www.rhonealpestourisme.com Awesome, inspiring, tranquil, serene – superlatives rarely do justice to the spectacular landscapes of the French Alps and the Jura. Soaring peaks tower above verdant, forested valleys, alive with wild flowers. Mountain streams rush down from dour massifs, carving out deep gorges on their way. Mont Blanc, Grandes Jorasses and Barre des Écrins for mountaineers. Val d’Isère, Chamonix and Les Trois Vallées for adrenaline junkies. Vanoise, Vercors and Jura for great outdoors fans. So many mythical names, so many expectations, and not a hint of flagging: the Alps’ pulling power has never been so strong. What is so enticing about the Alps and the Jura is their almost beguiling range of qualities: under Mont Blanc’s 4810m of raw wilderness lies the most spectacular outdoor playground for activities ranging from skiing to canyoning, but also a vast historical and architectural heritage, a unique place in French cuisine (cheese, more cheese!), and some very happening cities boasting world-class art. So much for the old cliché that you can’t have it all. -

Col Du Lautaret
DREAL PACA - catalogue départemental des sites inscrits, Hautes-Alpes LE MONETIER-LES-BAINS, VILLAR D’ARENE COL DU LAUTARET Hautes-Alpes 59 CONTEXTE REGLEMENTAIRE Site inscrit Site inscrit Arrêté du 7 Novembre 1938 - Zone périphérique du Parc National des Ecrins - SC Jardin alpin du col du Lautaret (04/10/1934) Propriété Communale et privée Autres protections au titre des sites sur les communes - Zone centrale du Parc National des Ecrins Superficie - SC Abords du tunnel et col du Galibier (27/08/1937) 230 ha - SC Vallée de la Clarée et Vallée Etroite (31/07/1992) - SI Abords du tunnel et du col du Galibier (05/04/1937) Autres mesures de protection concernant le site - SI Cours de la Romanche (17/09/1942) - Réserve Naturelle Nationale du versant Nord des Pics du - SI Col d’Arsine et ses abords (29/06/1943) Combeynot - SI Face Est de la Meije Orientale (02/02/1945) Vue du Col du Lautaret depuis Serre Orel, avec le site du Jardin Alpin à gauche et le massif du Galibier en arrière plan Vue du site dominé par le massif du Combeynot, depuis la route Massif de la Meije, vu des abords du Col du col du Galibier COMPOSANTES DU SITE Motivation de la protection L'inscription du col du Lautaret fait partie d'une série de protections initiée à la fin des années trente sur le thème des grands cols alpins «afin de permettre de surveiller étroitement ces points culminants des routes touristiques de plus en plus menacés par l'installation de lignes électriques et de baraquements médiocres» (extrait du rapport de la commission des sites pour l'inscription du col de Vars, décembre 1937). -

Diary Or Mariana Fox Tuckett's Journal
Mariana Fox Tuckett (1) circa 1860. A VICTORIAN “TEENAGER’S” DIARY OR MARIANA FOX TUCKETT’S JOURNAL DEC. 1857 - MARCH 59 Transcribed for the Frenchay Tuckett Society by Gerald Franklin Copyright © June 2011 Introduction. As the Executor of her Uncle Hubert Fox’s estate, Sarah Smith nee Fox, kindly donated to the Society six volumes of a journal kept by her Great Grandmother Mariana Fox Tuckett during her teenage years 1857/59. As these volumes contain a very interesting and detailed account during that period of the Tucketts, other Quaker families, as well as friends, acquaintances and some important persons, it was felt that they should be transcribed and made available to be read by members of the Society and visitors to the Frenchay Village Museum. In writing her journal Mariana mentions a great number of relations, friends, neighbours and other people. Unfortunately, as was the practice of Quakers of the period, she generally uses initials or first names for relations and friends and, where she mentions other persons she just gives names and no details. In view of this, and to provide the reader with more information, Dramatis Personae have been added at the end of this Introduction giving whatever information that could be ascertained. This List has been divided into a number of separate sections detailing Family, Relations, Friends and other Persons, these are listed in numerical order with the appropriate number appended to the various initials/names the first few times they appear in each volume of the journals. However due to the above sections, these will not be in numerical order but will appear somewhat randomly. -
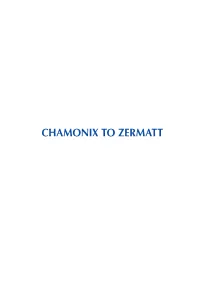
Chamonix to Zermatt
CHAMONIX TO ZERMATT About the Author Kev Reynolds first visited the Alps in the 1960s, and returned there on numerous occasions to walk, trek or climb, to lead mountain holidays, devise multi-day routes or to research a series of guidebooks covering the whole range. A freelance travel writer and lecturer, he has a long associa- tion with Cicerone Press which began with his first guidebook to Walks and Climbs in the Pyrenees. Published in 1978 it has grown through many editions and is still in print. He has also written more than a dozen books on Europe’s premier mountain range, a series of trekking guides to Nepal, a memoir covering some of his Himalayan journeys (Abode of the Gods) and a collection of short stories and anecdotes harvested from his 50 years of mountain activity (A Walk in the Clouds). Kev is a member of the Alpine Club and Austrian Alpine Club. He was made an honorary life member of the Outdoor Writers and Photographers Guild; SELVA (the Société d’Etudes de la Littérature de Voyage Anglophone), CHAMONIX TO ZERMATT and the British Association of International Mountain Leaders (BAIML). After a lifetime’s activity, his enthusiasm for the countryside in general, and mountains in particular, remains undiminished, and during the win- THE CLASSIC WALKER’S HAUTE ROUTE ter months he regularly travels throughout Britain and abroad to share that enthusiasm through his lectures. Check him out on www.kevreynolds.co.uk by Kev Reynolds Other Cicerone guides by the author 100 Hut Walks in the Alps Tour of the Oisans: GR54 Alpine Points -

The Tour De France Is Won in the Mountains!
The Tour de France is Won in the Mountains! Here is all the information you’ll need regarding the big mountains of the 2014 Tour de France. In this handout I provide you with links to the actual elevation profiles of each of the 2014 major climbs, the profile from the Tour de France website, and the details on the system of categorizing the climbs and assigning King of the Mountain points for the KOM jersey competition. Profiles of the major climbs of the 2014 Tour de France Two websites make it very easy and fun to get a close glimpse of the actual route on Google Earth and a detailed profile of each of the categorized climbs. The first one is www.cyclingthealps.com which has links to all of the stages and many of the best climbs in the Alps. They provide the profile, a direct link for a 3D tour in Google earth, a direct link for Streetview. The other is www.Climbbybike.com. You must register (it’s free) but you can search over 33,000 climbs around the world. Click on Tour de France 2014 on the left and you’ll see each of the routes and the profiles of each climb. On the following pages, I’ve done all of the work for you for the most important climbs and mountain stages and the links to the information on Climbbybike.com, from the proper side of each climb (also confusing to know and time consuming to determine on some of the climbs). Use the information and profiles in the flyers for your classes. -

Le Rêve Blanc L’Épopée Des Sports D’Hiver Dans Les Alpes Musée Dauphinois / Exposition
LE RÊVE BLANC L’ÉPOPÉE DES SPORTS D’HIVER DANS LES ALPES MUSÉE DAUPHINOIS / EXPOSITION DOSSIER DE PRESSE DOSSIER DE PRESSE CONTACT AGN ÈS JONQUÈRES 04 57 58 89 11 • [email protected] 2 LE RÊVE BLANC L’ÉPOPÉE DES SPORTS D’HIVER DANS LES ALPES MUSÉE DAUPHINOIS / EXPOSITION SOMMAIRE Communiqué de presse, page 3 L’exposition, page 4 Documentaires & entretiens filmés, page 10 Contributions et remerciements, page 12 Informations pratiques, page 14 Photographies à disposition de la presse, page 15 3 LE RÊVE BLANC L’ÉPOPÉE DES SPORTS D’HIVER DANS LES ALPES MUSÉE DAUPHINOIS / EXPOSITION COMMUNIQUÉ DE PRESSE LE RÊVE BLANC. L’ÉPOPÉE DES SPORTS D’HIVER DANS LES ALPES Exposition permanente présentée à partir du 18 avril 2018 Songer aux sports d’hiver, c’est s’évader vers de grands espaces immaculés, imaginer une poudreuse légère et revivre ses exploits entre amis autour d’un feu de cheminée. Mais ce rêve blanc suffit- il aujourd’hui à attirer les foules dans les stations de ski, tant les attentes et les pratiques ont évolué durant le XXe siècle ? La fréquentation des sites en moyenne altitude est par ailleurs dépendante d’un enneigement devenu aléatoire. En montagne, le changement climatique est une préoccupation que les acteurs locaux ont intégrée depuis longtemps déjà. Quelle sera donc le modèle de station de ski du XXIe siècle ? L’exposition raconte l’épopée des sports d’hiver dans les Alpes, le plus grand domaine skiable au monde. Peu à peu depuis la fin du XIXe siècle, la montagne perd de son hostilité et les plaisirs de la glisse gagnent un public de plus en plus nombreux. -

The British in Corsica from the Mid- Nineteenth Century to the Eve of the Second World War
From Battleground to Playground: The British in Corsica from the Mid- Nineteenth Century to the Eve of the Second World War. Submitted by Elizabeth Constance Raikes to the University of Exeter as a thesis for the degree of Doctor of Philosophy in History January, 2019. This thesis is available for Library use on the understanding that it is copyright material and that no quotation from the thesis may be published without proper acknowledgement. I certify that all material in this thesis which is not my own work has been identified and that no material has previously been submitted and approved for the award of a degree by this or any other University. Signature: ………………………………………………………….. 1 Acknowledgements This thesis is dedicated to the late Professor Colin Platt (1934-2015), and those who go on being inspired by him and take heart from his encouragement. Without Colin Platt, this thesis would never have begun. Without the support of those in the present it would not have been completed. Thanks are due to my supervisor Professor Andrew Thompson for his thoroughness and insightful comments that have sharpened and focussed this work. Staffs at the University of Exeter Library, the British Library, the National Archives, the London Metropolitan Archives, City of London and the Archives Départementales La Corse du Sud have been particularly helpful at guiding me through the various systems, processes and care of resources to enable this thesis to benefit from a rich variety of sources. They are largely an unsung body of people but vital to researchers. Finally, I have taken advantage of the good nature of my husband, Graham, for proof reading numerous drafts and for accompanying me on our research visits to Corsica, although exploring Ajaccio whilst I spent hours in the archives was no great hardship. -

Les Temps Forts De Ce Cinquantième Anniversaire À Chamrousse
Les temps forts de ce cinquantième anniversaire à Chamrousse Pages 12 à 16 www.mairiechamrousse.com Juin 2018 • Numéro 23 ÉDITORIAL INFOS MAIRIE JUIN 2018 NUMÉRO 23 * 2 Travaux pour la réouverture de milieux Éditorial Un hiver historique ! sur la commune de Chamrousse À l'aube d'une nouvelle ère, Chamrousse a > 3 9 honoré cet hiver l'esprit de conquête de toutes Infos Mairie > Travaux celles et ceux qui ont écrit son histoire. La station Budget communal a ainsi soufflé de nombreuses bougies ! Celles des 140 ans des premiers essais français à ski Environnement © Emilie Garcin Jeunesse et école d'Henry Duhamel dans les champs de poudreuse de Chamrousse, celles des 130 ans des troupes de montagne, qui font de notre des- Etat-civil, bloc-notes tination l'un de leurs camps d'entraînement privilégiés, et, bien sûr, celles des 50 10 ans des Jeux olympiques de Grenoble qui l'ont révélée aux yeux du monde. Une Les alpages de Chamrousse sont séquence souvenirs sans nostalgie, dans laquelle chacun puise l'énergie, l'enthou- exploités depuis de nombreuses Portraits > Paul Riche et Marion Haerty siasme et l'inventivité de tous les protagonistes de ces événements, afin de réussir la années. En 1998, un groupement transformation de Chamrousse comme modèle d'une nouvelle économie et d'un art pastoral composé de 5 éleveurs e 11 de vivre, la station de montagne du XXI siècle. Car comme le montre notre histoire, ovins et d'un éleveur bovin a été Vie locale > Service culturel ici plus qu'ailleurs nous avons l'esprit pionnier. -

VILLAGE RESORT 1250 M - 3330 M RIGHT at the Y of ONE of EUROPE’S MOST DYNAMIC REGIONS!
© City HallVaujanyvillage03-YCornu VILLAGE RESORT 1250 m - 3330 m RIGHT AT THE Y OF ONE OF EUROPE’S MOST DYNAMIC REGIONS! ISÈRE u A strategic location for communication networks: 265 km of motorways, 5,160 km of roads and 418 km of railway lines. u A top tourist destination that combines mountains, plains and hills u Third most-visited French department in winter u 21.8 million overnight stays, including 1.5 million for international tourists 22 winter sports resorts, 30 Nordic activity areas, 17 lakes and recreation centres, 5 trail stations, 31 via-ferratas and adventure parks, 11 golf courses, and more! Paris GRENOBLE Geneva © Laurent Salino Grenoble u “The capital of the Alps” Lyon ALBERTVILLE 100 km VAUJANY ANNECY 155 km u Amazing sunshine — more than in cities like Toulouse, Lyon or Bordeaux. GENEVA 190 km Valence u Located 14 kilometres from the Chamrousse ski resort, 16 kilometres from Sept Laux, 17 kilometres from Villard-de-Lans, 25 kilometres from L’Alpe d’Huez, 35 kilometres from Les Deux Alpes, and 48 kilo- Marseille metres from La Grave. u A key centre for innovation and scientific, industrial and social research. SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE Col du Glandon ITALY 110 km Col de la Croix de Fer PARIS 620 km “Tunnel de Fréjus” LYON 155 km CHAMBÉRY 110km OISANS Col du Télégraphe D 526 D 902 VAUJANY u 4 ski resorts: Alpe d’Huez Grand Domaine Ski, Les 2 Alpes 3600, La Grave-La Meije and Col d’Ornon ALPE D’HUEZ LA GRAVE Col du Galibier GRENOBLE 60 km A 480 - Exit no. -

LE CHEMINEAU DE LA MONTAGNE " LA VIE EN MONTAGNE " = Collection Publiée Sous La Direction De = = JACQUES DIETERLEN =
LE CHEMINEAU DE LA MONTAGNE " LA VIE EN MONTAGNE " = Collection publiée sous la direction de = = JACQUES DIETERLEN = La Collection " La Vie en Montagne " a pour but de vulgariser la meilleure documentation technique, touristique et littéraire relative à la vie en montagne, dans ses manifestations les plus diverses. C'est ainsi que paraîtront dans cette Collection des livres de technique sur le ski, l'alpinisme, le camping en montagne, des monographies touristiques inédites sur telle région encore peu connue du public ; enfin des récits ou histoires, inspirés par la vie émouvante et merveilleuse dans les montagnes, en toute saison et en tout lieu. Cette Collection pourra être mise entre toutes les mains. Elle sera la lecture favorite du skieur, de l'alpiniste, du campeur, du touriste, de tous les amis de la montagne, le recueil de souvenirs et d'études indispensable à tous, la bibliothèque la plus vivante, la plus instructive et la plus agréable. L'APPEL DU HOGGAR, par Roger Frison-Roche. Prix : 10 fr. LES BATAILLES POUR L'HIMALAYA, 1783-1936, par C.-E. Engel. Prix : 15 fr. CIMES D'OISANS, par Jacques Bœll. Préface de Lucien Devies. Prix : 15 fr. LE SKI POUR TOUS, par André Hermann et Jacques Dieterlen. Prix : 15 fr. SKI DE PRINTEMPS, par Jacques Dieterlen. Prix : 15 fr. KARAKORAM. Expédition française à l'Himalaya — 1936 —, par Jean Escarra, Henry de Ségogne, Louis Neltner et Jean Charignon. Prix : 16 fr. Chaque volume illustré de croquis et de hors-texte en héliogravure. " LA VIE EN MONTAGNE " JACQUES DIETERLEN LE CHEMINEAU DE LA MONTAGNE Préface de Henry RIPERT FLAMMARION ŒUVRES DE JACQUES DIETERLEN LES FILS DE LA NEIGE (Éditions de la Revue du ski). -

Refuges Alpins De L’Abri De Fortune Au Tourisme D’Altitude
DIRECTION DE LA CULTURE, DU PATRIMOINE ET DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE DOSSIER DE PRESSE REFUGES ALPINS DE L’ABRI DE FORTUNE AU TOURISME D’ALTITUDE Musée dauphinois Exposition présentée du 4 juin 2020 au 21 juin 2021 Contact presse : Agnès Jonquères, chargée de projets et de la communication [email protected] 04 57 58 89 11 ENTRÉERefuges alpins.GRATUITE De l’abri DANS de fortune LES 11 au MUSÉES tourisme DU d’altitude DÉPARTEMENT | Musée dauphinois DE L’ISÈRE | Du 4 juin 2020 au 21 juin 2021 | Dossier de presse DIRECTION DE LA CULTURE, DU PATRIMOINE ET DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE Sommaire, p. 3 Éditorial, p. 3 Communiqué de presse, p. 4 L'exposition, p. 5 Les partenaires, p . 9 Contributions et remerciements, p. 10 Publications, p. 12 Graphisme : L’Atelier BIS/Céline Arlaud Photo : Informations pratiques, p. 13 Refuge du Promontoire, Éric Dessert © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine Photographies mises à disposition de la presse, p. 14 culturel, ADAGP-2017 Refuges alpins. De l’abri de fortune au tourisme d’altitude | Musée dauphinois | Du 4 juin 2020 au 21 juin 2021 | Dossier de presse 2 DIRECTION DE LA CULTURE, DU PATRIMOINE ET DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE ÉDITORIAL Fidèle à l’attachement que je porte à la culture, tout en étant extrê- mement attentif à la situation sanitaire, j’ai pris la décision de rouvrir l’ensemble des musées du Département de l’Isère dès le lundi 18 mai. Les premiers visiteurs ont ainsi pu franchir les portes de nos établissements et découvrir ou redécouvrir leur grande richesse. -

La Saga Des Écrins La Saga Des Écrins La
François Labande François Labande François La Saga des Écrins La Saga des Écrins La 290 Première édition : © Éditions Guérin, 2014 © Éditions Paulsen, 2021 Guérin, Chamonix – guerin.editionspaulsen.com Les éditions Paulsen sont une société du groupe Paulsen Media. François Labande La Saga des Écrins À mes parents, qui ont su m’insuffler la passion pour les montagnes, la vallée de la Guisane, et le massif des Écrins. « La lune nous accueillit quand nous atteignîmes l’arête. Nous remontâmes solennellement l’arête immaculée, un pied dans l’ombre, un pied dans la clarté. Nous arrivâmes au sommet. Le gigantesque porte-à-faux du Doigt de Dieu se dressait contre le couchant où s’attardait encore une bande écarlate. Il semblait désigner dans le firmament une planète merveilleuse : Vénus peut-être. » Pierre Dalloz, première hivernale de la Meije orientale, 1927 préface par Lionel Daudet Vu d’en bas avec ses pics acérés aux cimes perdues, le massif des Écrins semblerait un îlot de liberté émergeant d’un océan douloureusement légiféré, embrassant un espace d’autant plus précieux qu’il est devenu rare au milieu de nos contrées urba- nisées. Il est curieusement resté intact, authentique, sauvage dit-on même, comme figé par les glaces. Comme à l’époque des premiers ascensionnistes, le regard peut tutoyer l’horizon sans qu’un pylône anachronique et malséant, ou une indécente sarabande d’hélicoptères ne viennent troubler une séculaire sérénité. Là-haut peut encore s’exercer la liberté d’être, un face- à- face(s) sans fard entre soi et les montagnes. Le massif des Écrins est scellé d’un temps à double tranchant : le premier, celui des pierres muettes, s’emploie à préserver le caractère originel de ces montagnes à l’accent méridional.