Le Couvent Des Capucins Sommaire
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Guide Storico-Artistiche Della Svizzera Canton Ticino
Guide storico-artistiche della Svizzera Canton Ticino L’oratorio del Corpus Domini di Bellinzona (ital., ted.) Maria Fazioli Foletti. 2017. n. 991. 24 p. CHF 13.- Il Cimitero monumentale di Lugano (ital.) Cristina Brazzola, Paola Capozza, Giovanna Ginex. 2016. n. 986.987. 72 p. CHF 18.- Il complesso di Santa Maria degli Angeli e il centro culturale LAC Lugano Arte e Cultura (ital., ted., ingl.) Riccardo Bergossi, Lara Calderari. 2015. n. 978-979. 52 p. CHF 15.- Il Sacro Monte della Madonna del Sasso a Orselina (ital., ted., franc., ingl.) Lara Calderari, Simona Martinoli, Patrizio Pedrioli. 2015. n. 966-967. 48 p. CHF 15.- Der Monte Verità von Ascona (ted.) Mara Folini. 2013. n. 939-940. 44 p. CHF 13.- Remo Rossi (ital., ted.) Diana Rizzi. 2012. n. 909. 40 p. CHF 12.- La chiesa di S. Maria della Misericordia e il Collegio Papio di Ascona (ital., ted.) Daniela Pace, Michela Zucconi-Poncini. 2012. n. 907. 48 p. CHF 15.- Villa dei Cedri a Bellinzona (ital.) Simona Martinoli. 2011 n. 897. 36 p. CHF 10.- I castelli di Bellinzona (ital., ted., ingl.) Werner Meyer, Patricia Cavadini-Bielander. 2010. n. 866-867. 58 p. CHF 13.– Agnuzzo (ital., ted.) Jürg Ganz. 2010. n. 876. 32 p. CHF 8.– Collina d’Oro (ital., ted.) Katja Bigger. 2010. n. 892. 46 p. CHF 12.– www.gsk.ch, [email protected] Pavillonweg 2, CH-3012 Bern, T +41 (0)31 308 38 38, F +41 (0)31 301 69 91 Il cimitero di Bellinzona Simona Martinoli, Cristina Palma, Lucia Pedrini-Stanga, Diana Rizzi. 2009. -

The Roundhouse of International Spirits’
‘the roundhouse of international spirits’ Hans Arp, Raffael Benazzi Julius Bissier Ben Nicholson Hans Richter Mark Tobey Italo Valenti in the Ticino 17 January - 15 March 2009 Teachers’ Pack Contents • Introduction to the exhibition and maps • History of the arts in the Ticino region • Friendships between the artists • Image, key questions and biography for each artist • Themes and shared techniques to consider 'the roundhouse of international spirits' Arp, Benazzi, Bissier, Nicholson, Richter, Tobey, Valenti in the Ticino 17 January - 15 March 2009 'The landscape ... is entirely magical and with the kind of visual poetry which I would like to find in my painting.' Ben Nicholson The natural beauty of the Ticino, around the famous tourist spots of lakes Maggiore and Lugano had long attracted artists and intellectuals. Writing to a friend in 1962, German painter Julius Bissier described the area of Ascona and Locarno, where he was then living, as 'the roundhouse of international spirits'. By the early 1960s a remarkable group of artists had settled in the area. Hans Arp and Hans Richter returned, having first visited in the 1910s. Julius Bissier, Italo Valenti, Ben Nicholson and Felicitas Vogler arrived in search of better living conditions and new inspiration. The American painter Mark Tobey, based in Basel and a friend of many of these artists, regularly visited. The Locarnese, as it is known locally, became a thriving intellectual hotspot, with a strong sense of community - so much so that Arp liked to refer to it as 'el kibbutz'. These artists shared ideas and swapped works and the period produced rich results. -

The Art of Hans Arp After 1945
Stiftung Arp e. V. Papers The Art of Hans Arp after 1945 Volume 2 Edited by Jana Teuscher and Loretta Würtenberger Stiftung Arp e. V. Papers Volume 2 The Art of Arp after 1945 Edited by Jana Teuscher and Loretta Würtenberger Table of Contents 10 Director’s Foreword Engelbert Büning 12 Foreword Jana Teuscher and Loretta Würtenberger 16 The Art of Hans Arp after 1945 An Introduction Maike Steinkamp 25 At the Threshold of a New Sculpture On the Development of Arp’s Sculptural Principles in the Threshold Sculptures Jan Giebel 41 On Forest Wheels and Forest Giants A Series of Sculptures by Hans Arp 1961 – 1964 Simona Martinoli 60 People are like Flies Hans Arp, Camille Bryen, and Abhumanism Isabelle Ewig 80 “Cher Maître” Lygia Clark and Hans Arp’s Concept of Concrete Art Heloisa Espada 88 Organic Form, Hapticity and Space as a Primary Being The Polish Neo-Avant-Garde and Hans Arp Marta Smolińska 108 Arp’s Mysticism Rudolf Suter 125 Arp’s “Moods” from Dada to Experimental Poetry The Late Poetry in Dialogue with the New Avant-Gardes Agathe Mareuge 139 Families of Mind — Families of Forms Hans Arp, Alvar Aalto, and a Case of Artistic Influence Eeva-Liisa Pelkonen 157 Movement — Space Arp & Architecture Dick van Gameren 174 Contributors 178 Photo Credits 9 Director’s Foreword Engelbert Büning Hans Arp’s late work after 1945 can only be understood in the context of the horrific three decades that preceded it. The First World War, the catastro- phe of the century, and the Second World War that followed shortly thereaf- ter, were finally over. -
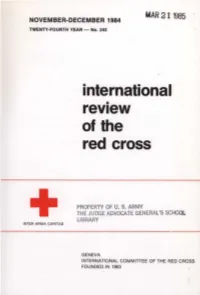
International Review of the Red Cross
MAR 211985 NOVEMBER-DECEMBER 1984 TWENTY-FOURTH YEAR - No. 243 international review• of the red cross PROPERTY OF U. S. ARMY THE JUDGE ADVOCATE GENERAL'S SCHOOL' LIBRARY INTER ARMA CARITAS GENEVA INTERNATIONAL COMMITIEE OF THE RED CROSS FOUNDED IN 1863 INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS Mr. ALEXANDRE HAY, Lawyer, former Director-General of the Swiss National Bank, President (member since 1975) Mr. MAURICE AUBERT, Doctor of Laws, Vice-President (1979) Mr. VICTOR H. UMBRICHT, Doctor of Laws, Managing Director, Vice-President (1970) Mr. JEAN PICTET, Doctor of Laws, former Vice-President of the ICRC (1967) Mrs. DENISE BINDSCHEDLER-ROBERT, Doctor of Laws, Professor at the Graduate Institute of International Studies, Geneva, Judge at the European Court of Human Rights (1967) Mr. JACQUES F. DE ROUGEMONT, Doctor of Medicine (1967) Mr. GILBERT ETIENNE, Professor at the Graduate Institute of International Studies and at the Institut universitaire d'etudes du developpement, Geneva (1973) Mr. ULRICH MIDDENDORP, Doctor of Medicine, head of surgical department of the Cantonal Hospital, Winterthur (1973) Mrs. MARION BOVEE-ROTHENBACH, Doctor of Sociology (1973) Mr. HENRY HUGUENIN, Banker (1974) Mr. RICHARD PESTALOZZI, Doctor of Laws, former Vice-President of the ICRC (1977) Mr. ATHOS GALLINO, Doctor of Medicine, Mayor of Bellinzona (1977) Mr. ROBERT KOHLER, Master of Economics (1977) Mr. RUDOLF JACKLI, Doctor of Sciences (1979) Mr. OLIVIER LONG, Doctor of Laws and Doctor of Political Science, Ambassador, former Director General of GATT (1980) Mr. DIETRICH SCHINDLER, Doctor of Laws, Professor at the University of Ziirich (1961 1973; 1980) Mr. HANS HAUG, Doctor ofLaws, Professor at the St-Gall School ofAdvanced Economic and Social Studies, former President of the Swiss Red Cross (1983) Mr. -

Art Meets Golf -.Ctlinks | People Links Processes
art meets golf Idee Golf Art - Kunst “art meets golf“ – 2007 Event‘s – Ihre Plattform Träger Kontakte Idee • Die Idee eine Kunstausstellung in einem aussergewöhnlichen Rahmen zu gestalten und die Grösse der Skulpturen mit der imposanten Kulisse der Kyburg zu verbinden, lies uns nicht mehr los. • Die Verbindung zweier Weltsprachen Kunst und Sport trifft sich im vom 15. August 2007 bis am 7. Oktober 2007 auf dem Golfplatz Kyburg zum Stelldichein. • Glamouröses Gipfeltreffen zwischen der Unvergänglichkeit einer Bronze- Skulptur und dem Augenblick eines gelungenen Schlages im Golfspiel. • Auch der Charity – Aspekt kann in diesem Rahmen ideal umgesetzt werden. Home Golf • Der Golf Club Kyburg garantiert Ihnen ein unvergessliches Golf Erlebnis • Die Anlagen Golf Kyburg liegen 20 Minuten ausserhalb der Schweizer Wirtschaftsmetropole Zürich. Der von viel Charme und Charakter geprägte Golf Club Kyburg wurde inmitten einer Waldlichtung auf 520 m ü.M. angesiedelt. Die Clubgebäude liegen im Weiler Rossberg im Zentrum des 18-Loch, 6080m langen Par 71 Meisterschaftsplatzes. Der durch Kurt Rossknecht gestaltete 18-Loch Championship Course überzeugt durch die anspruchsvolle und variantenreiche Gestaltung und bietet damit Golfern aller Spielstärke viel Spielspass. • Der 18-Loch Platz ist in zwei 9-Loch Schleifen aufgeteilt. • Damit Golf für Sie zum einzigartigen Erlebnis wird, bieten wir ein abwechslungsreiches Programm: spannende Turniere und unterhaltsame Events. Next Golf • xxx Home Art – Kunst • Ivo Soldini • „Grosse männliche und weibliche Figuren, gebrochen durch tiefe Furchen wie menschliche Nerven nach Aussen sichtbar gemacht. Hohe Reliefs und Gruppen, die die komplizierten und ungelösten Verhältnisse zueinander übermitteln. Köpfe von grösster Dimension an deren Oberflächen sich das Licht in einem unzähmbaren Netz von Gedanken und von Erfahrung spiegelt. -

Artists at Work Artists at Work
Artists at Work Artists at Work Deanna Petherbridge and Anita Viola Sganzerla edited by Ketty Gottardo and Rachel Sloan Contents First published to accompany Artists at Work The Courtauld Gallery, London, 3 May – 15 July 2018 The Courtauld Gallery is supported by the 7 Higher Education Funding Council for England (hefce) Foreword The programme of the Gilbert and Ildiko Butler Drawings Gallery is generously supported by The International Music and Art Foundation 9 Preface 11 Playful Images of Allegory and Actuality Copyright © 2018 Texts copyright © 2018 the authors deanna petherbridge All rights reserved. No part of this publication may be transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any storage or retrieval system, without the prior permission in writing from the copyright holder and publisher. 32 isbn 978-1-911300-44-1 British Library Cataloguing in Publication Data Catalogue A catalogue record for this book is available from the British Library anita viola sganzerla Produced by Paul Holberton Publishing 89 Borough High Street, London se1 1nl www.paulholberton.com 83 Designed by Laura Parker Bibliography and Photographic Credits Printing by Gomer Press, Llandysul front cover: Cat. 19 (detail) back cover: Cat. 7 (detail) frontispiece: Cat. 3 (detail, larger than actual size) Foreword Following A Civic Utopia, organised in 2016 with Drawing I wish to extend my warm thanks to Anita Viola Matter Trust, Artists at Work is the second exhibition in the Sganzerla, curator of the Katrin Bellinger collection, Gilbert and Ildiko Butler Drawings Gallery to present works who wrote the catalogue entries for this publication and chiefly from a single collection, other than The Courtauld’s contributed to many other aspects of the exhibition. -

MAKERS of ITALY? Giovanni Giolitti, Benito Mussolini, Alcide De Gasperi and Silvio Berlusconi
Department of Political Science Chair of Contemporary History MAKERS OF ITALY? Giovanni Giolitti, Benito Mussolini, Alcide De Gasperi and Silvio Berlusconi Christian Blasberg Francesca Regnani – 087252 SUPERVISOR CANDIDATE Academic Year 2019/2020 Table of contents Abstract ..............................................................................................................................................3 Introduction ........................................................................................................................................4 Chapter 1 – Historical context ...........................................................................................................6 1 . 1 Giovanni Giolitti and the humped country .............................................................................7 1 . 2 Mussolini and the two facets of his regime ..........................................................................10 1 . 3 De Gasperi: a man of faith ...................................................................................................13 1 . 4 Silvio Berlusconi and his new conception of politics ..........................................................15 Chapter 2 – Political personality ......................................................................................................18 2 . 1 Trasformismo and propaganda .............................................................................................18 2 . 2 National and international appreciation ...............................................................................22 -

Images of the Swiss Commemorative Coins in Silver
IMAGES OF THE SWISS COMMEMORATIVE COINS IN SILVER Swissmint Images of the Swiss Silver Commemorative Coins page 2 of 9 5-franc piece, silver, withdrawn of circulation Alloy: Silver-copper (Ag 83,5/Cu 16,5) Diameter: 31 mm Weight: 15 g Obverse Reverse Year Theme / Artist 1936 War loan Max Weber, Geneva Unc. 200'000 1939 Battle of Laupen Remo Rossi, Locarno Unc. 30'600 1941 Swiss National Holiday Obverse: E. Suter, Basel Reverse: Luc Jaggi, Geneva Unc. 100'150 1944 Battle of St. Jakob Emil Wiederkehr, Lucerne Unc. 101'680 1948 Swiss Federal Constitution Obverse: Max Weber, Geneva Reverse: August Blaesi, Lucerne Unc. 500'400 1963 Swiss Red Cross Max Weber, Geneva Unc. 623'000 Swissmint Images of the Swiss Silver Commemorative Coins page 3 of 9 20-franc piece, silver, with legal tender Alloy: Silver-copper (Ag 83,5/Cu 16,5) Diameter: 33 mm Weight: 20 g Obverse Reverse Year Theme / Artist 1991 700th anniversary of the Swiss Confederation Ernst Hiestand, Zollikerberg Unc. 2'440'000 Proof 100'000 1992 Gertrud Kurz Rosmarie Tissi, Zurich Unc. 325'000 Proof 36'000 1993 Paracelsus Heinz Jost, Bern Unc. 260'000 Proof 30'000 1994 Devil's Bridge (Landscapes) Peter Emch, Zurich Unc. 240'000 Proof 32'200 1995 Snakequeen of the Grisons (Landscapes) Peter Emch, Zurich Unc. 235'000 Proof 30'700 1996 Giant Gargantua (Landscapes) Peter Emch, Zurich Unc. 206'000 Proof 30'000 Swissmint Images of the Swiss Silver Commemorative Coins page 4 of 9 Obverse Reverse Year Theme / Artist 1996 Dragon of Breno (Landscapes) Peter Emch, Zurich Unc. -

Schweizerische Kunstausstellung Basel 1956
1 A 1 Schweizerische 7815 Kunstausstellung Basel 1956 H Bazaine-Bertholle-Bissière- Eble Abstrakte Maler Estève-Hartung-Lanskoy- Loutre Manessier-Le Moal-Nallard Reichel-Singier-Vieira da Silva Spiller-de Staël Ausstellung Juni, Juli Maîtres de l'art moderne Delacroix-Renoir-van Gogh Cézanne -Braque-Rouault Picasso etc. Ausstellung August, September, Oktober Illustrierte Kataloge Galerie Beyeler Basel/Bäumleingasse 9 täglich (sonntags nur 10-12 Uhr) ETHICS SIK Telephon 222558 02000001352510 Schweizerische Kunstausstellung Basel 1956 A/\ r- vf Schweizerisches Institut WlU . W für Kunstwissenschaft Zürich Schweizer Mustermesse, Halle 8, «Baslerhalle» 2. Juni bis 15. Juli 1956 (ö ö ~t s \~2-~ Dauer der Ausstellung 2. Juni bis 15. Juli 1956 Besuchszeiten Täglich 10-12 und 14-17 Uhr Sonntags durchgehend von 10-17 Uhr Eintrittspreise Einmaliger Eintritt (inkl. Billettsteuer) Fr. 1.50 Schüler und Studenten Fr.I.¬ Schüler in geführten Gruppen Fr.-.50 Tageskarte Fr. 2.50 Illustrierter Katalog Fr. 2.50 Verkäufe Alle Verkäufe haben durch Vermittlung der Kasse zu erfolgen. Fürdie ausdem Ausland eingesandten Werke hat der Käufer den Zoll zu tragen. Die Abgabe der gekauften Werke erfolgt nach Schluß der Ausstellung. Prof. Dr. Max Huggler, Bern, Präsident Walter Bodmer, Basel Serge Brignoni, Bern Charles Chinet, Rolle Charles-François Philippe, Genf Hans Stocker, Basel Frau Janebé, Boudry Frau Elsa Burckhardt-Blum, Küsnacht, Ersatz Max von Mühlenen, Bern, Ersatz Rudolf Zender, Winterthur, Ersatz Werner Bär, Zürich, Präsident Bruno Giacometti, Zürich Otto Charles Bänninger, Zürich Hermann Hubacher, Zürich Remo Rossi, Locarno Max Weber, Genf Fräulein Hildi Hess, Zürich Paul Baud, Genf, Ersatz Casimir Reymond, Lutry, Ersatz Fräulein Hedwig Frei, Basel, Ersatz Architektonische Gestaltung E. -

Als PDF Herunterladen
[Sektions Nachrichten] Objekttyp: Group Zeitschrift: Schweizer Kunst = Art suisse = Arte svizzera = Swiss art Band (Jahr): - (1946) Heft 4 PDF erstellt am: 04.10.2021 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch SCHWEIZER KUNST ART SUISSE ARTE SVIZZERA 27 Sektion Luzern. — Im verflossenen Geschäftsjahr sehwebten La mostra di pittura « Paesaggi ticinesi » da noi ordinata nella mir zwei Ziele vor. Ich wollte fürs erste den Künstler mit dem Auf- scorsa estate a Payerne alla Galleria Véandre, grazie al gentile ap- gabenkreis der heutigen Gesellschaft näher zusammenbringen und poggio del signor Vuilleumier che mise gratuitamente a disposizio- ihm dadurch Anregung und Erwerbsmöglichkeiten verschaffen. -
Micronization.Com
Entrusting the account of one’s own life and business history to an artist could appear as an unconventional idea. We did it with a sculptor and artist of international fame, so that we could explain, much better than through words, what the Sta- te of the Art of Micronization is for us. Through the years we have made our company and our skills grow, the number of our customers increase, customers who trust and rely on us; we have widened the range of our services. Thus we have risen among the world leaders of the sector. This picture and this painting represent a special place for us: we see, represented through a brush stroke, our efforts, a dedication which is, above all, a passion. A passion for our work, for the future and the beauty. The beauty of professio- nal, well-made things. JETPHARMA TEAM WHAT IS FOR US THE STATE OF THE ART The internationally renowned sculptor we have chosen to cre- ate this work is Pedro Pedrazzini. He was born in Roveredo, in the Canton of Graubünden (Switzerland) on November 11th 1953. In 1974 - 1975 he studied in London and in 1976 he was an assistant at Remo Rossi’s Atelier. In 1976 and 1977 he studied at the School of Fine Arts in Florence and from 1977 to 1980 at the School of Fine Arts in Milan. He lives and works in Minusio, Canton of Ticino. The creative process that brought to the realization of this piece of work took several months, which were preceded by some meetings between Jetpharma and the artist, during whi- ch both parties expressed their opinions about what the State of the Art is in their respective fields, in order to reach a com- mon vision connected to their constant search for the highest quality level. -

John C. ECCLES' Private Library: CATALOGUE (Labels Underlined)
John C. ECCLES‘ Private Library: CATALOGUE (labels underlined) Inst. f. History, Theory & Ethics of Medicine, Heinrich-Heine-University Düsseldorf, Germany Abelson, Raziel, Persons - a study in philosophical psychology (London, Basingstoke: MacMillan, 1977). 4B-1001 Abercrombie, Lascelles, The poems of Lascelles Abercrombie (London: Oxford University Press, 1930). 4B-7004 Abrams, A., H. H. Garner, J. E. P. Toman, ed. Unfinished tasks in behavioural sciences (Baltimore: Williams & Wilkins, 1964). 1C-260 Adam, James, The Religious teachers of Greece. Being Gifford lectures on natural religion delivered at Aberdeen (Clifton: Reference, 1965). 4B-4001 Adamczewiski, Jan, Nicolaus Copernicus and his epoch. In cooperation with Edward J. Piszek (Philadelphia, Washington: Copernicus society of America, s.a.). 4B-5065 Adler, Mortimer J., The difference of man and the difference it makes, 2 ed (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1968). 4B-1002 Adrian, Edgar D., The basis of sensation. The action of the sense organs (Melbourne: Christophers, 1928). 4B-1003 ———, The physical background of perception (Oxford: Clarendon Press, 1946). 4B-1004 Adriani, Götz, Paul Cézannes "Der Liebeskampf", 1 ed, Piper Galerie (Munich: Piper, 1980). 4B-6002 Aeschylus, ed. The Oresteian trilogy. Agamemnon. The Choephori. The Eumenides. Translated by Philip Vellacott, 2 ed (Harmondsworth: Penguin, 1959). 4B-7005 Agar, Wilfred Eade, A contribution to the theory of the living organism, 1 ed (Melbourne: Melbourne, 1943). 4B-1005 Agassi, Joseph, Science in flux (Dordrecht: Reidel, 1975). 4B-1006 Agazzi, E., Le mental et le corporel (Bruxelles Office international de librairie, 1982). 4B-1007 Agin, D. P., ed. Perspectives in membrane biophysics, a tribute to Kenneth S. Cole (London: Gordon & Breach, 1972).