Le Retable De L'annonciation D'aix De Barthélemy D'eyck
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
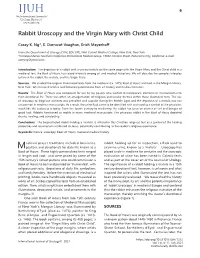
Ng Rabbit.Indd
IJUH 6 The International Journal of Urologic History© www.ijuh.org Rabbit Uroscopy and the Virgin Mary with Christ Child Casey K. Ng*, E. Darracot Vaughan, Erich Meyerhoff From the Department of Urology (CKN, EDV, EM), Weil Cornell Medical College, New York, New York *Correspondence: Southern California Permanente Medical Group, 13652 Cantara Street, Panorama City, California; e-mail: [email protected] Introduction: The depiction of a rabbit with a urinary matula on the same page with the Virgin Mary and the Christ child in a medieval text, the Book of Hours, has raised interests among art and medical historians. We will describe the complex interplay between the rabbit, the matula, and the Virgin Mary. Sources: We studied the original illuminated texts from the medieval (ca. 1475) Book of Hours archived in the Morgan Library, New York. We reviewed articles and historical publications from art history and medical literature. Results: The Book of Hours was composed for use by lay people who wished to incorporate elements of monasticism into their devotional life. There was often an amalgamation of religious and secular themes within these illustrated texts. The use of uroscopy to diagnose ailments was prevalent and popular during the Middle Ages and the depiction of a matula was not uncommon in medieval manuscripts. As a result, the urine fl ask came to be identifi ed with and used as a symbol of the physician, much like the caduceus is today. From the fourth century to modernity, the rabbit has been an averter of evil and bringer of good luck. Rabbits functioned as motifs in many medieval manuscripts. -

The Commissioning of Artwork for Charterhouses During the Middle Ages
Geography and circulation of artistic models The Commissioning of Artwork for Charterhouses during the Middle Ages Cristina DAGALITA ABSTRACT In 1084, Bruno of Cologne established the Grande Chartreuse in the Alps, a monastery promoting hermitic solitude. Other charterhouses were founded beginning in the twelfth century. Over time, this community distinguished itself through the ideal purity of its contemplative life. Kings, princes, bishops, and popes built charterhouses in a number of European countries. As a result, and in contradiction with their initial calling, Carthusians drew closer to cities and began to welcome within their monasteries many works of art, which present similarities that constitute the identity of Carthusians across borders. Jean de Marville and Claus Sluter, Portal of the Chartreuse de Champmol monastery church, 1386-1401 The founding of the Grande Chartreuse in 1084 near Grenoble took place within a context of monastic reform, marked by a return to more strict observance. Bruno, a former teacher at the cathedral school of Reims, instilled a new way of life there, which was original in that it tempered hermitic existence with moments of collective celebration. Monks lived there in silence, withdrawn in cells arranged around a large cloister. A second, smaller cloister connected conventual buildings, the church, refectory, and chapter room. In the early twelfth century, many communities of monks asked to follow the customs of the Carthusians, and a monastic order was established in 1155. The Carthusians, whose calling is to devote themselves to contemplative exercises based on reading, meditation, and prayer, in an effort to draw as close to the divine world as possible, quickly aroused the interest of monarchs. -

Souveraineté De La Lumière Provençale Jacques Lepage
Document generated on 10/01/2021 7:02 a.m. Vie des arts Souveraineté de la lumière provençale Jacques Lepage Number 45, Winter 1967 URI: https://id.erudit.org/iderudit/58343ac See table of contents Publisher(s) La Société La Vie des Arts ISSN 0042-5435 (print) 1923-3183 (digital) Explore this journal Cite this article Lepage, J. (1967). Souveraineté de la lumière provençale. Vie des arts, (45), 18–23. Tous droits réservés © La Société La Vie des Arts, 1967 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research. https://www.erudit.org/en/ zmtmz JW ^H r**$tï" 4 «>• V 9 P "Kl 4m VS Mff< EJKI <m •BH • Comment expliquer l'unité profonde de la peinture en Provence aux XlVe et XVe siècles? Comment, sinon en évoquant ce qu'elle fut au XIXe: Cézanne et Van Gogh doivent nous rendre sensible ce qui s'est passé cinq siècles auparavant lorsque Siennois, Français, Catalans, Anglais, mêlèrent leur savoir et leurs humeurs, leurs goûts et leurs techniques dans ces villes-creusets que furent Avignon et Aix. Cézanne désira peindre comme un "Parisien"; Van Gogh abordait la Provence avec un héritage nordique. Rien de commun entre ces prémisses et l'œuvre qu'ils nous ont livrée. -

Renaissance Art Reconsidered / an Anthology of Primary Sources ; Ed
Contents Notes on Contributors xiii Preface xv Introduction 1 PART I: MAKING RENAISSANCE ART 3 Drawing and Workshop Practice 5 1.1.1 Cennino Cennini on drawing 6 1.1.2 Alberti on drawing figures 8 1.1.3 Francesco Squarcione details the drawing regime for his pupils 9 1.1.4 Gerard Horenbout takes on two apprentices 10 1.1.5 A master's duty of care for his apprentices 13 1.1.6 Leonardo da Vinci on drawing 15 1.1.7 Diirer gives drawings as gifts and uses them to pay day-to- day expenses 18 1.1.8 Diirer lists the qualities required to be a painter 22 1.1.9 Joachim Camerarius praises Diirer's drawings 23 Linear Perspective 29 1.2.1 Cennino Cennini's method for depicting buildings in a painting 30 1.2.2 Alberti and the earliest written description of single-point perspective 31 1.2.3 Lorenzo Ghiberti lists the sources for perspective 41 1.2.4 Filarete's method for making drawings of buildings 43 1.2.5 Piero della Francesca's perspective for painters 47 vi Contents 1.2.6 Manetti's descriptions of Brunelleschi's experiments 49 1.2.7 Leonardo da Vinci on single-point and aerial perspective 51 Sculpture 59 1.3.1 PosthumouPosthumouss inventorinventory oof TourTournan i sculptop r Colart le Cat 60 Michelozzo and Donatelllla are contractettdd tto makmakee ththee PPratr o 1.3.2 62 Pulpit Pulpit 65 1.3.3 ReporReport to on nDonatello' Donatellos sprogres pg s on the Prato pulpit 1.3.4 Thee BrusselBrusselss painterspainters'' guilguiildd claimli s exclusivxclusive rightrightss to market painted workks of art 66 1.3.5 Extracts from De StatuaS by Leon Battista -

Renaissance Art in Northern Europe
Professor Hollander Fall 2007 AH107 T, Th 2;20-3:45 AH107 HONORS OPTION STATEMENT Martha Hollander AH107, Northern Renaissance Art, covers visual culture—manuscript and panel painting, sculpture, tapestries, and printmaking,–– in fifteenth-and sixteenth-century Netherlands, Northern France, and Germany. Within a roughly chronological framework, the material is organized according to nationality and, to some extent, thematically, The four essays focus on areas of inquiry that occur at specific moments in the course. (Each essay is due the week during or after the relevant material is covered in class.) The attached reading list, which supplements the regular reading for the course, is designed as a resource of these essays. Two essays (2 and 3) are concerned with important texts of art theory as well as secondary scholarly texts which involve reading the texts and using artworks of the student’s choosing as illustrative examples. The other two essays (1 and 4) require in- depth analysis of specific assigned artworks, guiding the student to place the works in their artistic and social context. Taken together, the four essays (comprising between 8-15 pages) supplement the regular work of the course by enhancing the essential objectives of the course. The student will have the opportunity to exercise skills in understanding and applying contemporary ideas about art; and in engaging with specific objects. Each essay grade will be 10% of the final grade. The weight of the grades for regular coursework will be adjusted accordingly. The student and I will meet during my office hour every other week for planning and discussion. -

The Fogg Triptych: Testimony of a Case Study to the Society and Artistic Production of Venetian Crete
Open Research Online The Open University’s repository of research publications and other research outputs The Fogg Triptych: Testimony of a case study to the society and artistic production of Venetian Crete Conference or Workshop Item How to cite: Lymberopoulou, Angeliki (2018). The Fogg Triptych: Testimony of a case study to the society and artistic production of Venetian Crete. In: Cross-cultural interaction between Byzantium and the West, 1204-1669. Whose Mediterranean is it anyway? (Lymberopoulou, Angeliki ed.), Society for the Promotion of Byzantine Studies, Routledge, London, pp. 59–73. For guidance on citations see FAQs. c [not recorded] https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Version: Accepted Manuscript Link(s) to article on publisher’s website: https://www.routledge.com/Cross-Cultural-Interaction-Between-Byzantium-and-the-West-12041669/Lymberopoulou/p/book/9780815372677 Copyright and Moral Rights for the articles on this site are retained by the individual authors and/or other copyright owners. For more information on Open Research Online’s data policy on reuse of materials please consult the policies page. oro.open.ac.uk THE FOGG TRIPTYCH Testimony of a case study to the society and artistic production of Venetian Crete Angeliki Lymberopoulou As an art historian and field archaeologist, I chose to focus on an actual object, and use it as a case study to highlight the volume’s theme. The object is an unpublished triptych currently in Sam Fogg’s London-based gallery.1 Its dimen- sions are modest – it measures 48.3 × 20.4 × 5 cm (fully open) and 23.7 × 20.4 × 5 cm (closed); it is a portable painting that was probably made for private use. -

La Peinture En Provence Au Xve Siècle
A la découverte de l’Histoire Cours d’Histoire 2012/2013. G. Durand COURS 13 – LA PEINTURE EN PROVENCE AU XVe SIECLE Quand, à la fin de son règne, René s’installe définitivement en Provence après 40 ans de faits d’armes, ce roi qui avait fait rêver les grands princes italiens de la Renaissance, est un monarque malheureux, ayant perdu ses couronnes de Hongrie, de Jérusalem, d’Aragon et de Naples. Il est inquiet des visées impatientes de son neveu Louis XI sur ses derniers fiefs, le duché de Bar, les comtés d’Anjou et de Provence. Usé par les épreuves, René entreprend, par un triste jour d’octobre 1471, la descente du Rhône vers ses terres de lumière, en quête de paix, pour rejoindre sa seconde épouse, la jeune Jeanne de Laval, restée à Aix. Il se réfugie dans une Provence qu’il avait négligée et qui se relève mal des épidémies de peste, des passages meurtriers des Grandes Compagnies et des atrocités commises par un triste personnage dévoyé des armées de la guerre de 100 ans, Raymond de Turenne, en qui les Provençaux avaient vécu voir un Attila des temps modernes. Aix, capitale officielle de la Provence, n’a jamais eu l’opulence commerciale de sa voisine Marseille ni le passé culturel prestigieux d’Avignon au temps des Papes. La ville est bien différente des cours princières que le monarque avait connues en Italie. Elle n’est qu’un gros bourg empuanti par les tanneries qui prolifèrent entre le quartier des Augustins et celui des Cardeurs. Le palais qui accueille René est austère et vieillot, son parc n’est plus qu’un jardin potager où on cultive les choux, les fèves, les épinards, la bourrache, le persil, les oignons, les aulx, les poireaux et quelques plans de safran, et où se dressent, bien visibles, les potences des condamnés à mort. -

 Enguerrand Quarton's Coronation of the Virgin
Berghahn Books Enguerrand Quartern's "Coronation of the Virgin": This World and the Next, the Dogma and the Devotion, the Individual and the Community Author(s): Véronique Plesch Source: Historical Reflections / Réflexions Historiques, Vol. 26, No. 2, The Last Things (Summer 2000), pp. 189-221 Published by: Berghahn Books Stable URL: http://www.jstor.org/stable/41299173 . Accessed: 21/10/2014 21:21 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Berghahn Books is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Historical Reflections / Réflexions Historiques. http://www.jstor.org This content downloaded from 137.146.177.126 on Tue, 21 Oct 2014 21:21:29 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions Enguerrand Quartern's Coronation of the Virgin : This World and the Next, the Dogma and the Devotion, the Individual and the Community1 Veronique Plesch On September 11,1834 ProsperMerimee, then Inspecteur general des monuments historiques,visited Villeneuve-lez-Avignon with the primary goal ofseeing Pope InnocentVI's tomb at the Charterhouseof the Val-de- Benediction. While there he also paid a visitto other sites. Aftervisiting the Chartreuseand the church he went to the hospital: "The hospital of the same town," he wrote in an account published the followingyear, 1. -

Text & Image in René D'anjou's Livre Des
Text & Image in René d'Anjou's Livre des tournois, c. 1460: Constructing Authority and Identity in Fifteenth-Century Court Culture. Presented with a Critical Edition of BnF, ms. français 2695 3 Volumes Volume I Justin Meredith Sturgeon Doctor of Philosophy University of York Medieval Studies September 2015 Abstract This thesis addresses René d'Anjou's Livre des tournois as a holistic product of late- medieval court culture. It argues that the work can only be decoded when text and image are considered as inseparable mutually exegetic components. This thesis adopts an interdisciplinary methodology and draws on a diverse range of visual, historical, material and literary sources. The structure is based on a series of focussed case studies into aspects of the Livre des tournois that have been understudied or are in need of reconsideration. Chapter 1 explores the relationship between the work's images and text and the impact on the author's identity as an authority on the subject. Chapter 2 scrutinises the use and depiction of heraldry essential to the construction of a visual narrative within the work. Chapter 3 addresses the heralds' duties and how these roles compare to the precedents found in late- medieval tournament and court culture. Chapter 4 examines René's influences and sources by focussing on the similarities between the form of tournament described and historic precedents related to the combat, location, participants and equipment. Chapter 5 utilises spatial and ritual theories to engage with a series of spectacles surrounding the punishment and review of the tourneyers in relation to group identity. -

Structural Conservation of Panel Paintings: Proceedings
PART THREE History of the Structural Conservation of Panel Paintings 188 Critical History of Panel Painting Restoration in Italy Andrea Rothe panel conservation techniques are directly related to a long history of panel construction that dates to Mantiquity and flourished from the Middle Ages to the Renaissance (see Uzielli, “Historical Overview,” herein). The ingenuity and intuition of the woodworkers of the past compensated for their lack of scientific understanding of this complex and widely diverse material. Central Italy, in particular, produced a large quantity of paintings on panel. Many of them—such as the Cimabue Crucifix in the Church of Santa Croce in Florence—were constructed to the highest standards of craftsmanship. The early woodworkers often used techniques or methods similar to those applied by modern-day restorers in treating panels—techniques such as movable crossbars (Figs. 1, 2) and coats of gesso, paint, or red lead to seal the backs of panels (Fig. 3). These sealants were probably applied as humidity barriers and protection against wood-boring insects, and panels treated in this manner have often survived better than untreated panels. The large number of panel paintings in Italian churches and muse- ums created the need for appropriate conservation work, particularly in modern times. The state-run centers of Florence and Rome have become the largest and most advanced in Italy and have generated a group of highly qualified experts in this field. The volume of panel work that has been executed in Florence far surpasses that of any other conservation center in the world. Figure 1, right Fra Angelico, Annunciation, ca. -

The Structural Conservation of Panel Paintings
PROCEEDINGS The Getty Conservation Institute PR Proceedings of Los Angeles OCEEDINGS a Symposium at the J. Paul The Structural Getty Museum, April 1995 Conservation of Panel Paintings The Str uctur al Conser va tion of P anel Paintings The Getty Conservation Institute The Structural Conservation of Panel Paintings Proceedings of a symposium at the J. Paul Getty Museum 24–28 April 1995 Edited by Kathleen Dardes and Andrea Rothe T G C I L A Front cover: Alessandro Allori, The Abduction of Proserpine, 1570. Detail. Oil on panel, 228.5 ϫ 348 cm. The J. Paul Getty Museum (73.PB.73), Los Angeles. Back cover and page 305: Girolamo di Benvenuto, Nativity, ca. 1500, reverse. Tempera on panel, 204 ϫ 161 cm. The J. Paul Getty Museum (54.PB.10), Los Angeles. The panel bears witness to the his- tory of its conservation: This light, modern cradle was installed in 1987, after the removal of heavy, traditional crossbars (see page 187), traces of which are still evident. Strips of aged poplar, inserted to repair cracks caused by earlier restorations, can also be seen. Page 1: Transverse surfaces of chestnut (Castanea sp.) (left) and poplar (Populus sp.) (right), showing pore structures. Page 109: Illustration showing sawyers producing veneers; from J. A. Roubo, L’art du menuisier (Paris: Académie Royale des Sciences, 1769). Page 187: Girolamo di Benvenuto, Nativity, reverse. A cumbersome, traditional cradle, installed around 1900 and removed in 1987, is shown. Tevvy Ball, Managing Editor Sylvia Tidwell, Copy Editor Anita Keys, Production Coordinator Jeffrey Cohen, Series Designer Hespenheide Design, Book Designer Printed in the United States of America 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 © 1998 The J. -

Download Article
Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 142 4th International Conference on Education, Language, Art and Inter-cultural Communication (ICELAIC 2017) Influence of Dante on the Iconographic Concept of the Last Judgement Simeon Tomachinsky Kursk Theological Seminary Moscow Theological Academy Moscow, Russia Abstract—The article is investigating the history of The ideas pertaining to the ‘purgatorial fire’ (Origen appearance of purgatory in the iconographic model of the Last and others) – the pre-Christian times and the first Judgment. Until the 18th century, representations of the after- eleven centuries of Christianity; life exclusively included hell and heaven, and there was no purgatory. Starting from the second half of the 14th century, Invention of the word purgatorium, limbo, – the late once the Divine Comedy of Dante was published, certain 12th century; elements of purgatory started to appear, in particular, on frescoes of Nardo di Cione in the Florence Basilica of Santa The Union of Lyon between the Latin and Greek Maria Novella. Some Last Judgement representations, dated Churches; there was no such word as purgatory, but back to the middle of the 15th century, began to suggest a an idea of purgation – the Second Council of Lyon, certain structural accentuation of purgatory. The article 1274; analyses the influence of Dante’s Divine Comedy on the after- An extended poetic religious concept of purgatory – life iconography and offers conclusions about its special contribution into the development of iconographic concept of The Divine Comedy of Dante, 1321; the Last Judgement. The Doctrine of Purgatory becomes the official teaching of the Roman Catholic Church – The Keywords—iconography; Last Judgement; purgatory; Divine Council of Ferrara-Florence, 1438-1439.