Plan De Gestion 2014-2018 RNN Du Luberon
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Les Hébergements Dans Les Alentours Du Clos
HEBERGEMENTS DANS LES ALENTOURS N° Nom Type Distance Ville Web LES ANNEXES DU CLOS - LOCATION NEGOCIEE (1 ou 2 NUITEES MINI) 1 Chez Cynthia Gîte 0,5 km Oppedette [email protected] 2 Le Fenouillet Gîte 0,7 km Oppedette [email protected] 3 Chez Aline Gite 1,7 km Oppedette [email protected] HEBERGEMENT NON NEGOCIE - NUITEE OU SEMAINE - A MOINS DE 15 MINUTES EN VOITURE 4 La Chaume Gîte 1 km Vachère Vacheres-Gite-Campagne-La-Chaume 5 Village house Gîte 2 km Oppedette www.airbnb.fr/rooms 6 La Cocoune Gite 2 km Oppedette www.lacocoune.com 7 La grange des Davids Gîte 2 km Oppedette www.la-grange-des-davids.com 8 Villa du Maronnier Gîte 2 km Oppedette www.airbnb.fr/rooms 9 L'Estasiau Gîte 3 km Vachère Vacheres-Gite-L-estasiau 10 Le Jas du Lubéron Gite 3 km Oppedette www.jasduluberon.com 11 Saint Laurent Gîte 4 km Vachère www.gite-saintlaurent.fr 12 Sainte Baume Gîte 4 km Vachère Vacheres-Gite-Sainte-baume 13 La Lave Gîte 4 km Vachère www.lalave.com/ 14 La Bourgade Gîte 5 km Vachère Vacheres-Gite-La-Bourgade 15 Tresvieille Gîte 6 km Simiane la Rotonde Simiane-la-rotonde-Gite-Tresvieille 16 Chaloux B&B 6 km Simiane la Rotonde www.gite-chaloux.com 17 Le Garan Gîte 6 km Simiane la Rotonde Simiane-la-rotonde-Gite-Le-Garan 18 Saule Gîte 6 km Vachère Vacheres-Gite-Saule 19 La Font Neuve Gîte 7 km Vachère www.lafontneuve-luberon.com 20 La Grange aux Lavandes B&B 7 km Simiane la Rotonde www.airbnb.fr/rooms 21 Domaine de Valsainte Camping 7 km Simiane la Rotonde www.valsaintes.com 22 Les Basses Combes Gîte 7 km Vachère www.bassescombes.com -

Provence Lavender 4-Day Bike Tour Celebrate Lavender Season in Sault
+1 888 396 5383 617 776 4441 [email protected] DUVINE.COM Europe / France / Provence Provence Lavender 4-Day Bike Tour Celebrate Lavender Season in Sault © 2021 DuVine Adventure + Cycling Co. Visit the iconic lavender field at the Notre-Dame de Sénanque Abbey Smell the intoxicating fragrance of lavender at a distillery in Sault, the lavender capital of Provence Be treated to a tasting of Côtes du Luberon AOC wine Ride the Gorge de la Nesque within the UNESCO Mont Ventoux Biosphere Reserve Arrival Details Departure Details Airport City: Airport City: Paris, France Paris, France Pick-Up Location: Drop-Off Location: Avignon Train Station Avignon Train Station Pick-Up Time: Drop-Off Time: 10:30 am 12:00 pm NOTE: DuVine provides group transfers to and from the tour, within reason and in accordance with the pick-up and drop-off recommendations. In the event your train, flight, or other travel falls outside the recommended departure or arrival time or location, you may be responsible for extra costs incurred in arranging a separate transfer. Emergency Assistance For urgent assistance on your way to tour or while on tour, please always contact your guides first. You may also contact the Boston office during business hours at +1 617 776 4441 or [email protected]. Tour By Day DAY 1 Welcome to the Lavender Capital Our beautiful bike adventure begins with a transfer to Villes-sur-Auzon, a charming village in the region of Mont Ventoux and an ideal starting point for the Gorges de la Nesque. Fuel up with a seasonal Provençal lunch at a farm set in the middle of vineyards, followed by our bike fitting and safety talk. -

100 Fun Things to Do at Les Murets: 1. Walk to the Bakery in Cabrieres For
100 fun things to do at Les Murets: 1. Walk to the bakery in Cabrieres for fresh croissants in the morning 2. Experience a morning market in a different town each day 3. Visit the spectacular town of Gordes and have coffee in one of the outdoor cafes; don’t miss the special exhibit at the new “Mairie” or the many art galleries and shops in town 4. Attend a concert in one of the many churches or parks in the area 5. Visit the Palais des Papes in Avignon and have tea at the lovely Hotel la Mirande as you leave 6. Buy pizza off the pizza truck in Coustellet 7. Hike through the dramatic Grand Canyon of Roussillon and then get ice cream at the shop next to the ochre quarry 8. Tour a few local wineries and vote on a favorite wine 9. Buy and cook only what is in season and grown locally … and savor the flavors 10. Visit the Musee Granet in Aix and marvel at their permanent collection of Cezanne’s; then go visit Cezanne’s studio 11. Drive to Bonnieux on Friday morning and listen to the live band performing French standards in the market 12. Buy fresh goat cheese from the goat farmer on the hidden road above Buoux 13. Hike to Gordes and try not to get lost; hike it again and again until you get it right and feel rightfully proud 14. In June and July, follow the spectacular lavender road that crests the Luberon mountain from Bonnieux to Saignon ; take the same road any other time of year, and enjoy the open views 15. -

Copil Ocres Avril2016
COMPTE RENDU COMITÉ DE PILOTAGE du SITE NATURA 2000 FR9301583 « Ocres de Roussillon et Gignac, Marnes de Perréal » BILAN 2014-2015 & PROGRAMMATION 2016-2017 Apt, le jeudi 26 avril 2016 Feuille de présence en fin document Relevé de décisions et synthèse des discussions. • M. Plauche (ONF) a rappelé la réglementation sur les espèces protégées (toutes les chauves souris). Si le travail de sensibilisation et d’information est efficace il ne faut pas oublier que la protection inclut les gîtes de reproduction et d’hibernation de ces espèces. • Mme Létteron (Apt) a réagit sur le sujet de la pollution lumineuse et propose de communiquer d’avantage sur les actions en faveur des chiroptères a travers des documents de sensibilisation. • Des échanges entre plusieurs interlocuteurs ont pour sujet le motocross de Goult. Son existence au sein du site Natura 2000 est-elle possible? L'autorité préfectorale a jugé possible l'homologation du circuit. Dans son rôle, l’animateur du site apporte ses conseils au porteur de projet pour éviter les impacts. • L’autorité de gestion diminue les crédits d’animation, le PNRL s’interroge sur les possibilités de financer 15% de l’animation après 2017. • Les membres du Copil remercient le PNRL pour les actions réalisées et valident le programme d’actions futures. Animation du Document d’Objectifs Site Ocres de Roussillon et Gignac, Marnes de Perréal - FR9301583 Apt Bonnieux Caseneuve Gargas Gignac Goult Roussillon Rustrel Comité de Pilotage, Apt le 26/04/2016 St Saturnin Lès Apt Viens Villars VAUCLUSE Bilan 2014-2015 -

Avis D'enquete Publique
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE Par arrêté n° 2014281-0002 du 08 octobre 2014, une enquête publique relative au projet de révision du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin Calavon-Coulon sollicitée par le Président de la commission locale de l'eau (CLE) est ouverte du 03 novembre au 05 décembre 2014 inclus. Cette demande de révision impacte les départements de Vaucluse (28 communes) et des Alpes-de-Haute- Provence (8 communes). En application de l'article 2 de l'arrêté délimitant le périmètre du SAGE, la préfecture de Vaucluse est désignée comme autorité chargée d'organiser l'enquête publique. Département de Vaucluse Département des Alpes-de-Haute-Provence - Apt, - Les Beaumettes, - Bonnieux, - Cabrières-d'Avignon, - Banon, - Céreste, - Montjustin, - Caseneuve, - Castellet, - Cavaillon, - Gargas, - Gignac, - Gordes, - Oppedette, - Reillanne, - Goult, - Joucas, - Lacoste, - Lioux, - Maubec, - Ménerbes, - Sainte-Croix-à-Lauze, - Murs, - Oppède, - Robion, - Roussillon, - Rustrel, - Saignon, - Simiane-la-Rotonde, - Vachères. - Saint-Martin-de-Castillon, - Saint-Pantaléon, - Saint-Saturnin-lès- Apt, - Les Taillades, - Viens, - Villars. Le Parc Naturel Régional du Luberon est responsable du projet. Des informations peuvent être obtenues auprès de monsieur Cédric PROUST au 04 90 04 42 06 – [email protected] Une commission d'enquête a été désignée par le Président du tribunal Administratif de Nîmes, comme suit : - le président : Monsieur Yves LE HO, - les membres titulaires : Messieurs Gérard CHAMPEL et Alex SICILIANO -

Avis Sur Le Projet De Périmètre De La
REPUBLIQUE FRANÇAISE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE DE LA COMMUNE DE MONTAGNAC-MONTPEZAT SEANCE DU 22 JUIN 2016 L’an deux mille seize et le vingt-deux du mois de juin à 18 heures et 10 minutes, Le Conseil Municipal de la Commune de MONTAGNAC-MONTPEZAT dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur François GRECO, Maire. Date de la convocation du Conseil Municipal : 16 juin 2016. Date d’affichage : 16 juin 2016. Etaient présents : Mme Martine GRECO – MM. Francis GRAÖ – Antoine PES – Serge VASELLI – Lionel VOGEL - Absents représentés : M. Henri COSENZA, donne pouvoir à M. François GRECO – M. Denis MALOSSANE, donne pouvoir à Mme Martine GRECO – M. Bernard BATIFOULIER, donne pouvoir à M. Lionel VOGEL – M. Armel AÏTA, donne pouvoir à M. Serge VASELLI – Secrétaire de séance : M. Serge VASELLI – DELIBERATION N° 2016/28 Pour : 00 Contre : 09 Abstention : 01 OBJET : AVIS SUR LE PROJET DE PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BANON – HAUTE – PROVENCE Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur le Préfet des Alpes de Haute Provence a notifié à la commune, l’arrêté N° 2016-112.004 portant projet de périmètre de la communauté de communes BANON – HAUTE – PROVENCE afin de recueillir l’avis du conseil municipal. Il ajoute que ce projet de périmètre comprend la fusion de la communauté du Pays de Banon (Banon, Simiane-la-Rotonde, Revest-du-Bion, Revest-des-Brousses, Vachères, Saumane, Montsalier, La Rochegiron, l’Hospitalet, Sainte-Croix-à-Lauze, Redortiers, Oppedette), avec la communauté de communes Haute-Provence (Reillane, Mane, Saint-Michel l’Observatoire, Dauphin, Villemus, Saint-Martin-les-Eaux, Aubenas-les-Alpes, Montjustin) et l’ajonction de la commune de Saint Maime. -

Apt, Gordes, Ménerbes, Bonnieux, Saignon : Les Musicales Du Luberon Proposent Un Été Baroque À Partir Du 16 Juillet
24 septembre 2021 | Apt, Gordes, Ménerbes, Bonnieux, Saignon : les Musicales du Luberon proposent un été baroque à partir du 16 juillet Apt, Gordes, Ménerbes, Bonnieux, Saignon : les Musicales du Luberon proposent un été baroque à partir du 16 juillet «En 2020, pour leur 31e édition, les Musicales reviennent à leurs premières amours, confie Patrick Canac, président et fondateur –en 1989- des Musicales de Luberon, la musique baroque, une musique des origines qui, malgré son ancienneté, garde une éternelle jeunesse. Sa structure relève des mêmes codes que le jazz ou la variété : le groupe rythmique, l’improvisation, la liberté d’interprétation. Elle s’ouvre sur des pratiques actuelles de la musique, en lien avec la danse et le théâtre chanté. Le chef anglais Jonathan Cohen, connu pour son exigence musicale novatrice, dirigera son ensemble Arcangelo – parmi les meilleurs en Europe – et la soprano Mary Bevan. Il révélera pour nous un Haendel inédit. La violoniste https://www.echodumardi.com/culture-loisirs/apt-gordes-menerbes-bonnieux-saignon-les-musicales-du-luberon-proposent-un-ete-baroque-a-partir-du-16-juillet/ 1/2 24 septembre 2021 | Apt, Gordes, Ménerbes, Bonnieux, Saignon : les Musicales du Luberon proposent un été baroque à partir du 16 juillet Geneviève Laurenceau, à la tête de son ensemble Smoking Joséphine, renouvellera la forme du concert classique dans les Quatre Saisons de Vivaldi. L’ensemble Il Pomo d’Oro qui parcourt le monde, proposera, en compagnie de la mezzosoprano Éva Zaïcik, un programme vénitien. L’ensemble Café Zimmermann, conduit par la claveciniste Céline Frisch, proposera ses interprétations de Bach. Le duo Hoza offrira enfin une version ‘pop’ et intimiste du récital baroque. -

Nouveau Territoire D'itinérance
Alpes de Haute-Provence / Provincia di Cuneo nuovo territorio da scoprire - nouveau territoire d’itinérance Produits labellisés Huile d’olive Autoroutes Patrimoine naturel remarquable Olio d’oliva Routes touristiques / Strade turistiche Autostrade Patrimonio naturale notevole Torino Torino Fromage de Banon Carignano Routes principales Espaces protégés Formaggio di Banon Route des Grandes Alpes Asti Strada principale Strada delle Grandi Alpi Aree protette Vins régionaux / Caves / Musées Variante Routes secondaires Sommets de plus de 3 000 mètres Asti Enoteche regionali / Cantine / Musei Pinerolo Strada secondaria Routes de la lavande Montagne >3.000 metri Agneau de Sisteron Strade della lavanda Rocche del Roero Voies ferrées Via Alpina Agnello di Sisteron Ferrovie Itinéraire rouge - Point d’étape Casalgrasso Montà Govone Itinerario rosso – Punto tappa Canale Vergers de la Durance Route Napoléon Ceresole Polonghera S. Stefano Roero Priocca Train des Pignes Strada Napoléon Itinéraire bleu - Point d’étape Faule Caramagna d’Alba Frutteti della Durance Piemonte Monteu Roero Les Chemins de fer Itinerario blu – Punto tappa Castellinaldo de Provence Montaldo Vezza Sommariva Roero d’Alba Magliano Point étape des sentiers de randonnée trekking Racconigi d. Bosco Alfieri Maisons de produits de pays Murello Baldissero Digne-les-Bains > Cuneo Bagnolo Moretta d’Alba Castagnito Points de vente collectifs Piemonte Sanfrè Corneliano Punto tappa dei sentieri di trekking Cavallerieone Sommariva d’Alba Aziende di prodotti locali Perno Digne-les-Bains > Cuneo Rucaski Cardè Guarene Neive Raggruppamento di produttori con vendita diretta Villanova Piobesi M. Granero Torre Monticello Solaro d’Alba 3.171 m Abbazia S. Giorgio Pocapaglia d’Alba Barbaresco Barge Staffarda Castiglione Marchés paysans C. d. -

PRÉFECTURE Des Alpes-De-Haute-Provence
PRÉFECTURE des Alpes-de-Haute-Provence Recueil spécial des actes administratifs 14/janvier 2021 2021-014 Publié le 21 janvier 2021 PRÉFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 2021-014 SPÉCIAL 14/JANVIER 2021 SOMMAIRE La version intégrale de ce recueil des actes administratifs est en ligne sur le site Internet de la Préfecture : www alpes-de-haute-provence gouv fr, rubrique "Publications" MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE Décret du 24 décembre 2020 prolongeant la concession de mines de sels de sodium dite « concession de Passaire » (Alpes-de-Haute-Provence) à la Société Salinière de Provence (SSP) p. 1 PRÉFECTURE Direction des Services du Cabinet Arrêté préfectoral n° 2021-020-004 du 20 janvier 2021 abrogeant l’arrêté préfectoral n° 2021-006-014 du 6 janvier 2021 imposant le port du masque sur une partie de la commune de Montclar p. 2 Arrêté préfectoral n° 2021-020-008 du 20 janvier 2021 portant fermeture de la classe de 4e4 du collège Itard à Oraison du jeudi 21 au mercredi 27 janvier 2021 inclus p. 4 Direction de la citoyenneté et de la légalité Arrêté préfectoral n° 2021-021-002 du 21 janvier 2021 modifiant l’arrêté préfectoral n°2020-241-010 du 28 août 2020 fixant le nombre et l’emplacement des bureaux de vote dans le département des Alpes-de-Haute- Provence pour les élections politiques pour la période du 1er janvier au 21 décembre 2021 p. 6 SOUS PRÉFECTURE DE FORCALQUIER Arrêté préfectoral n° 2021-020-005 du 20 janvier 2021 portant la liste des communes éligibles aux aides à l’électrification rurale p. -

Céreste Village De Vacances VTF "Le Domaine Du Grand Luberon" Pension Complète • ½ Pension Ouverture Mars À Octobre
À partir de 66€ / pers* PROVENCE • CéRESTE Village de vacances VTF "Le Domaine du Grand Luberon" Pension complète • ½ Pension Ouverture Mars à Octobre Confort • 72 chambres réparties en plusieurs unités d’hébergements. • Capacité : 206 personnes Équipements de loisirs • Piscine extérieure chauffée du 3/04 à fin septembre. • Espace forme : sauna, hammam, spa. • Equipements sportifs : boulodrome, tennis municipal gratuit, mini-golf. Animation • Dès votre arrivée, un apéritif de bienvenue ! • Des temps de rencontres, d’échanges et d’animation ainsi que des * Par nuit, en pension complète (séjour de 4 nuits minimum) en pension nuit, * Par soirées animées ! Situation • Au cœur du Parc Naturel Régional du Luberon. • Implanté dans un parc ombragé de 2,5 ha. VOUS AIMEREZ • 20 km d’Apt, Manosque et Forcalquier, 82 km de Mar- • Ce village aux chaudes couleurs provençales. • La piscine extérieure chauffée et l’espace forme. seille (aéroport), 75 km d’Avignon (gare SNCF). • La belle terrasse ombragée où il fait bon de se restaurer aux beaux jours. Adresse Av. des Plantiers 04280 Céreste 22/ + d’infos : 04 42 221 221 | [email protected] | www.vtf-vacances.com/groupes saveur de provence IDéE DE SEJOUR RANDO 7 jours/6 nuits 7 jours/6 nuits À partir de 483€/pers.** À partir de 513€/pers.** L’incontournable • Découverte de Roussillon et ses ocres, d’une infinie variété de couleurs. • Visite de la fontaine de Vaucluse, impressionnante source qui jaillit au pied d’une falaise. • Découverte de la cité phocéenne : Marseille et son Vieux Port, Notre-Dame de la Garde, petit train touristique... Coup de • Lurs, village perché au-dessus de la vallée de la Durance. -
Trait D'union
PAYS D’APT LUBERON > Septembre 2016 < # 6 TRAIT D’UNION Le magazine de votre interco ! dossier spécial Coup de projecteur sur un service public de proximité vital ! x erpi kief ia© fotol © Philippe Clin p. 4 L’actu p. 11 Finances p. 13 Dossier p. 19 Territoire p. 22 Agenda en bref… spécial • Bientôt le très haut débit • Coûts des principaux services • L’eau du territoire Auribeau, Castellet, Saignon Les événements de la rentrée • La French Tech a le vent en poupe • Répartition des prévisions • La ressource, le prix, les Nos communes racontent • Le souk des sciences • Financement des services investissements le Luberon CONCOURS PHOTOS p. 23 • Adhésion au PNRL… • Projets à venir… Fontaines et lavoirs… Communauté de communes Pays d’Apt Luberon / www.paysapt-luberon.fr 1 CCPAL / Infos pratiques Toute l’actu de l’interco sur www.paysapt-luberon.fr > Siège de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon > EAU ET ASSAINISSEMENT > DÉCHETS Chemin de la Boucheyronne 84400 Apt Accueil Siège CCPAL Collecte et traitement des Lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30 Lundi au jeudi : 9h-12h / 13h30-17h déchets ménagers et assimilés Vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h30 Vendredi : 9h-12h / 13h-16h30. Actualités et informations générales 04 90 04 49 70 / [email protected] 04 90 74 65 71 04 90 04 80 21 www.paysapt-luberon.fr [email protected] [email protected] www.sirtom-apt.fr > Petite enfance Astreinte / Eau Accueil 04 90 78 07 34 CCPAL 06 84 80 39 19 Service de ramassage des [email protected] Apt, Auribeau, -
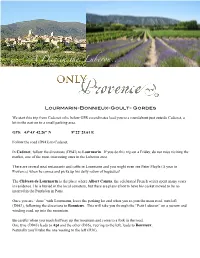
A Day in the Luberon
A Day in ! Luberon... Lourmarin-Bonnieux-Goult- Gordes We start this trip from Cadenet --the below GPS co-ordinates lead you to a roundabout just outside Cadenet, a bit to the east on to a small parking area. GPS: 430 43' 42.26" N 50 22' 25.61 E Follow the road (D943) to Cadenet. In Cadenet, follow the directions (D943) to Lourmarin. If you do this trip on a Friday, do not miss visiting the market, one of the most interesting ones in the Luberon area. There are several neat restaurants and cafés in Lourmarin and you might even see Peter Mayle (A year in Provence) when he comes and picks up his daily ration of baguettes! The Château de Lourmarin is the place where Albert Camus, the celebrated French writer spent many years in residence. He is buried in the local cemetery, but there are plans afoot to have his casket moved to be re- interred in the Panthéon in Paris. Once you are “done” with Lourmarin, leave the parking lot and when you re-join the main road, turn left (D943), following the directions to Bonnieux. This will take you through the “Petit Luberon” on a narrow and winding road, up into the mountain. Be careful when you reach halfway up the mountain and come to a fork in the road. One tyne (D943) leads to Apt and the other (D36), veering to the left, leads to Bonnieux. Naturally you’ll take the one veering to the left (D36). As you drive even higher, you will recognize that this stretch of the winding mountain road was used to film the wine harvest drive in the “No Brakes” WW2 ex-US army truck, to the winery in the TV series:”A Year in Provence”, shown on PBS in the US.