Sur LA Coévolution Plantes Avec Les Animaux, Dont Leurs Pollinisateurs
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
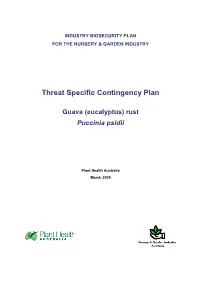
Guava (Eucalyptus) Rust Puccinia Psidii
INDUSTRY BIOSECURITY PLAN FOR THE NURSERY & GARDEN INDUSTRY Threat Specific Contingency Plan Guava (eucalyptus) rust Puccinia psidii Plant Health Australia March 2009 Disclaimer The scientific and technical content of this document is current to the date published and all efforts were made to obtain relevant and published information on the pest. New information will be included as it becomes available, or when the document is reviewed. The material contained in this publication is produced for general information only. It is not intended as professional advice on any particular matter. No person should act or fail to act on the basis of any material contained in this publication without first obtaining specific, independent professional advice. Plant Health Australia and all persons acting for Plant Health Australia in preparing this publication, expressly disclaim all and any liability to any persons in respect of anything done by any such person in reliance, whether in whole or in part, on this publication. The views expressed in this publication are not necessarily those of Plant Health Australia. Further information For further information regarding this contingency plan, contact Plant Health Australia through the details below. Address: Suite 5, FECCA House 4 Phipps Close DEAKIN ACT 2600 Phone: +61 2 6215 7700 Fax: +61 2 6260 4321 Email: [email protected] Website: www.planthealthaustralia.com.au PHA & NGIA | Contingency Plan – Guava rust (Puccinia psidii) 1 Purpose and background of this contingency plan ............................................................. -

Revision of Kunzea (Myrtaceae). 2. Subgenera Angasomyrtus and Salisia
© 2016 Board of the Botanic Gardens & State Herbarium (South Australia) Journal of the Adelaide Botanic Gardens 29 (2016) 71–145 © 2016 Department of Environment, Water & Natural Resources, Govt of South Australia Revision of Kunzea (Myrtaceae). 2. Subgenera Angasomyrtus and Salisia (section Salisia) from Western Australia and subgenera Kunzea and Niviferae (sections Platyphyllae and Pallidiflorae) from eastern Australia H.R. Toelken State Herbarium of South Australia, G.P.O. Box 1047, Adelaide, South Australia 5001 E-mail: [email protected] Abstract This contribution to a revision of the Australian species of Kunzea is, similarly to previous publications on western Australian groups, primarily based on the gross morphology examined on herbarium specimens and field observations. The species are, however, arranged in infrageneric groupings supported by molecular research. Descriptions and brief discussions of four subgenera and six sections are included throughout in order to provide an overall classification of the genus, although not all species are described in full detail. Keys, descriptions and illustrations to the following 23 accepted species are provided (new taxa in bold): K. ambigua (Sm.) Druce, K. aristulata, K. axillaris, K. badjaensis, K. bracteolata Maiden & Betche, K. caduca, K. calida F.Muell., K. cambagei Maiden & Betche, K. capitata (Sm.) Rchb. ex Heynh. subsp. capitata, subsp. seminuda, K. dactylota, K. flavescens C.T.White & Francis, K. graniticola Byrnes, K. juniperoides subsp. juniperoides, subsp. pernervosa, K. muelleri Benth., K. obovata Byrnes, K. occidentalis, K. opposita F.Muell. var. opposita, var. leichhardtii Byrnes, K. parvifolia Schauer, K. petrophila, K. pomifera F.Muell., K. rupestris Blakeley, K. sericothrix, K. truncata. Natural putative hybrids between taxa occurring in close proximity have been examined and evaluated. -

A Summary of the Published Data on Host Plants and Morphology of Immature Stages of Australian Jewel Beetles (Coleoptera: Buprestidae), with Additional New Records
University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln Center for Systematic Entomology, Gainesville, Insecta Mundi Florida 3-22-2013 A summary of the published data on host plants and morphology of immature stages of Australian jewel beetles (Coleoptera: Buprestidae), with additional new records C. L. Bellamy California Department of Food and Agriculture, [email protected] G. A. Williams Australian Museum, [email protected] J. Hasenpusch Australian Insect Farm, [email protected] A. Sundholm Sydney, Australia, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.unl.edu/insectamundi Bellamy, C. L.; Williams, G. A.; Hasenpusch, J.; and Sundholm, A., "A summary of the published data on host plants and morphology of immature stages of Australian jewel beetles (Coleoptera: Buprestidae), with additional new records" (2013). Insecta Mundi. 798. https://digitalcommons.unl.edu/insectamundi/798 This Article is brought to you for free and open access by the Center for Systematic Entomology, Gainesville, Florida at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in Insecta Mundi by an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. INSECTA MUNDI A Journal of World Insect Systematics 0293 A summary of the published data on host plants and morphology of immature stages of Australian jewel beetles (Coleoptera: Buprestidae), with additional new records C. L. Bellamy G. A. Williams J. Hasenpusch A. Sundholm CENTER FOR SYSTEMATIC ENTOMOLOGY, INC., Gainesville, FL Cover Photo. Calodema plebeia Jordan and several Metaxymorpha gloriosa Blackburn on the flowers of the proteaceous Buckinghamia celcissima F. Muell. in the lowland mesophyll vine forest at Polly Creek, Garradunga near Innisfail in northeastern Queensland. -
Fitzgerald River National Park Hamersley Drive Upgrade
FITZGERALD RIVER NATIONAL PARK HAMERSLEY DRIVE UPGRADE VEGETATION & FLORA Gillian F Craig Ellen J Hickman A report prepared for Main Roads Western Australia Great Southern Region Chester Pass Road, PO Box 503, Albany WA 6331 October 2009 Ellen J. Hickman Dr G F Craig Botanist & Artist Environmental Consultant ABN: 11 842 247 206 ABN: 96 108 756 719 5 Harry Street, Albany 6330 PO Box 130, Ravensthorpe 6346 © GF Craig & EJ Hickman 2009. Reproduction of this report in whole or in part by any means, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system is strictly prohibited without the express approval of the authors, Main Roads Western Australia (Albany) and/or the Department of Environment and Conservation (Albany). In undertaking this work, the authors have made every effort to ensure the accuracy of the information. Any conclusions drawn or recommendations made in the report are done in good faith and the consultants take no responsibility for how this information is used subsequently by others. Cover photos: [top left] Eucalyptus burdettiana (Burdett’s Gum), [top centre] Morelia imbricata (Carpet Python), [top right] Lechenaultia superba (Barren Leschenaultia), [centre] East Mt Barren and wave-cut bench from east), [bottom left] Eucalyptus coronata (Crowned Mallee) bud and flowers, [bottom centre] Adenanthos ellipticus (Oval-leaf Adenanthos), [bottom right] Stylidium galioides (Yellow Mountain Triggerplant), (©E.J.Hickman 2009). FRNP Hamersley Drive upgrade – Stage 1 GF Craig & EJ Hickman – October 2009 -

South Coast, Western Australia
Biodiversity Summary for NRM Regions Guide to Users Background What is the summary for and where does it come from? This summary has been produced by the Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities (SEWPC) for the Natural Resource Management Spatial Information System. It highlights important elements of the biodiversity of the region in two ways: • Listing species which may be significant for management because they are found only in the region, mainly in the region, or they have a conservation status such as endangered or vulnerable. • Comparing the region to other parts of Australia in terms of the composition and distribution of its species, to suggest components of its biodiversity which may be nationally significant. The summary was produced using the Australian Natural Natural Heritage Heritage Assessment Assessment Tool Tool (ANHAT), which analyses data from a range of plant and animal surveys and collections from across Australia to automatically generate a report for each NRM region. Data sources (Appendix 2) include national and state herbaria, museums, state governments, CSIRO, Birds Australia and a range of surveys conducted by or for DEWHA. Limitations • ANHAT currently contains information on the distribution of over 30,000 Australian taxa. This includes all mammals, birds, reptiles, frogs and fish, 137 families of vascular plants (over 15,000 species) and a range of invertebrate groups. The list of families covered in ANHAT is shown in Appendix 1. Groups notnot yet yet covered covered in inANHAT ANHAT are are not not included included in the in the summary. • The data used for this summary come from authoritative sources, but they are not perfect. -

Vegetation and Flora Fitzgerald River National Park Improvement Project
Fitzgerald River National Park Improvement Project Culham Inlet to Hamersley Inlet Vegetation and Flora FITZGERALD RIVER NATIONAL PARK IMPROVEMENT PROJECT CULHAM INLET to HAMERSLEY INLET VEGETATION & FLORA Gillian F Craig A report prepared for Main Roads Western Australia Great Southern Region Chester Pass Road, PO Box 503, Albany WA 6331 July 2010 Dr G F Craig Environmental Consultant ABN: 96 108 756 719 PO Box 130, Ravensthorpe 6346 T 08 9838 1071 © GF Craig 2010. Reproduction of this report in whole or in part by any means, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system is strictly prohibited without the express approval of the authors, Main Roads Western Australia (Albany) and/or the Department of Environment and Conservation (Albany). In undertaking this work, the author has made every effort to ensure the accuracy of the information. Any conclusions drawn or recommendations made in the report are done in good faith and the consultant takes no responsibility for how this information is used subsequently by others. Cover photos: Clockwise from top left: Microcorys longiflora, Anthocercis fasciculata, Kunzea similis, Pimelea physodes (Qualup Bell), view west from East Mt Barren, Adenanthos ellipticus (Oval-leaf Adenanthos), Napolean Skink, Stylidium galioides (Yellow Mountain Triggerplant), Hibbertia papillata (©G.F.Craig 2010). FRNP Improvement Project: Culham Inlet to Hamersley Inlet GF Craig– July 2010 TABLE OF CONTENTS Executive Summary ......................................................................................................................iii -

Conservation Science Western Australia
Volume Six Number Two Conservation Science November 2007 Western Australia The translation of Diels 1906 Plant Life in Western Australia – editor’s note NEIL GIBSON1,2 1) Science Division, Department of Environment and Conservation, PO Box 51 Wanneroo WA 6065 2) School of Plant Biology, The University of Western Australia, 35 Stirling Highway, Crawley WA 6009 After some 100 years it has now been possible to publish for the first time a complete translation of Diel’s seminal work on Western Australian biogeography (Diels 1906). The production of this translation has stretched over many decades and involved a number of people who recognized the need to provide an accessible version of the first major work on the ecology, vegetation and biogeography of Western Australian plants to an Australian audience. Soon after his appointment as Head of the Department of Botany, University of Western Australia (now the School of Plant Biology within the Facility of Natural and Agricultural Sciences) in 1947, Dr B.J. Grieve located a partially completed draft translation of Diels’ work which had been commenced by Professor and Mrs W. Dakin after their arrival in the Biology Department of the University in 1914. Unfortunately, after they returned to England in 1920, the work largely lapsed. Some minor additions appears to have been undertaken on this manuscript by Dr D. Herbert and C.A. Gardner with copies dated 1927 lodged in library of the Western Australian Herbarium (Diels et al. 1927). Appreciating the value of Diels’ work for teaching and research purposes, Grieve completed a definitive translation which included updated taxonomy and ecological data. -

Managing Coextinction of Insects in a Changing Climate Final Report
Managing coextinction of insects in a changing climate Final Report Melinda Moir and Mei Chen Leng MANAGING COEXTINCTION OF INSECTS IN A CHANGING CLIMATE Developing management strategies to combat increased coextinction rates of plant-dwelling insects through global climate change AUTHORS Melinda L Moir (University of Melbourne) MC Leng (University of Melbourne) Published by the National Climate Change Adaptation Research Facility ISBN: 978-1-925039-03-0 NCCARF Publication 32/13 © 2013 The University of Melbourne and National Climate Change Adaptation Research Facility This work is copyright. Apart from any use as permitted under the Copyright Act 1968, no part may be reproduced by any process without prior written permission from the copyright holder. Please cite this report as: Moir, ML, Leng, MC 2013 Developing management strategies to combat increased coextinction rates of plant-dwelling insects through global climate change. National Climate Change Adaptation Research Facility, Gold Coast, 111 pp. Acknowledgements This work was carried out with financial support from the Australian Government (Department of Climate Change and Energy Efficiency) and the National Climate Change Adaptation Research Facility. The role of NCCARF is to lead the research community in a national interdisciplinary effort to generate the information needed by decision makers in government, business and in vulnerable sectors and communities to manage the risk of climate change impacts. The authors acknowledge Peter Vesk, Mick McCarthy (University of Melbourne), David Coates, Karl Brennan (WA DEC), Lesley Hughes (Macquarie University) and David Keith (NSW National Parks and Wildlife Service) for their support at the project’s inception and throughout the duration.They thank Sarah Barrett (WA DEC) for her support with field logistics, particularly with the translocation of insects and the following for field assistance in often very difficult terrain; Karl Brennan, Don Moir, Sean White, Farhan Bokhari and Sonja Creese. -

Cover Page DU.Pub
IDENTIFICATION AND CONSERVATION OF FIRE SENSITIVE ECOSYSTEMS AND SPECIES OF THE SOUTH COAST NATURAL RESOURCE MANAGEMENT REGION. Sarah Barrett Sarah Comer Nathan McQuoid Meghan Porter Cameron Tiller Deon Utber ACKNOWLEDGEMENTS This project was funded by South Coast NRM Inc. and supported by the Department of Environment and Conservation. Members of the steering committee, Alan Danks, Deon Utber, Brad Barton, Lachie McCaw, Roger Armstrong and Greg Broomhall, provided advice and support throughout the project. Alison O’Donnell kindly provided access to her unpublished data on the Lake Johnson area. We are grateful to Malcom Grant, Greg Freebury, Greg Broomhall and Vince Hilder for their input into the section deatling with past and present fire management practices. Anne Cochrane kindly provided assistance with the development of example monitoring protcols. Meredith Spencer, Janet Newell, Saul Cowen, Louisa Bell and Pierre Rouxel assisted with compilation of references. In particular we would like to acknowledge the peer review of the document by Neil Burrows, Lachie McCaw, Stephen van Leeuwen, Carl Gosper, Klaus Tiedemann and Roger Armstrong. The following individuals provided valueable input through their participation in the Fire Ecology Workshop held in Albany on the 4th of March 2009: Emma Adams, Brad Barton, Neil Blake (facilitator), Bruce Bone, Brett Beecham, Wendy Bradshaw, Klaus Braun, Karl Brennan, Neil Burrows, Greg Broomhall , Allan Burbidge, Anne Cochrane, Gil Craig Alan Danks, Paula Deegan, Rob Edkins, Greg Freebury, Tony Friend, Sandra Gilfillan, Malcom Grant, Carl Gosper, Roger Hearn, Vince Hilder, Trevor Howard, Peter Keppell, Jennifer Jackson, Maria Lee, Sylvia Leighton, Laurent Marsol, Lachie McCaw, Shapelle McNee, Nathan McQuoid, Nicole Moore, Cassidy Newland, Mick Rose, Angela Sanders, Meredith Spencer, Peter Thompson, Klaus Tiedemann, Cameron Tiller, John Tonkin, Paul Van Heurk, Ian Wilson, Gavin Wornes and Joanna Young. -

Approved Conservation Advice for Proteaceae Dominated Kwongan
Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (EPBC Act) (s266B) Approved Conservation Advice for Proteaceae Dominated Kwongkan Shrublands of the southeast coastal floristic province of Western Australia 1. The Threatened Species Scientific Committee (the Committee) was established under the EPBC Act and has obligations to present advice to the Minister for the Environment (the Minister) in relation to the listing and conservation of threatened ecological communities, including under sections 189, 194N and 266B of the EPBC Act. 2. The Committee provided its advice on the Proteaceae Dominated Kwongkan Shrublands of the southeast coastal floristic province of Western Australia ecological community to the Minister as a draft of this approved conservation advice. In 2014, the Minister accepted the Committee’s advice, adopting it as the approved conservation advice. 3. The Minister amended the list of threatened ecological communities under section 184 of the EPBC Act to include the Proteaceae Dominated Kwongkan Shrublands of the southeast coastal floristic province of Western Australia ecological community in the endangered category. It is noted that elements of the ecological community are also on the Western Australian list of threatened ecological communities. 4. The nomination and a draft description for this ecological community were made available for expert and public comment for a minimum of 30 business days. The Committee and Minister had regard to all public and expert comment that was relevant to the consideration of the ecological community. 5. This approved conservation advice has been developed based on the best available information at the time it was approved; this includes scientific literature, advice from consultations, existing plans, records or management prescriptions for this ecological community.