Eugene De Beauharnais
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
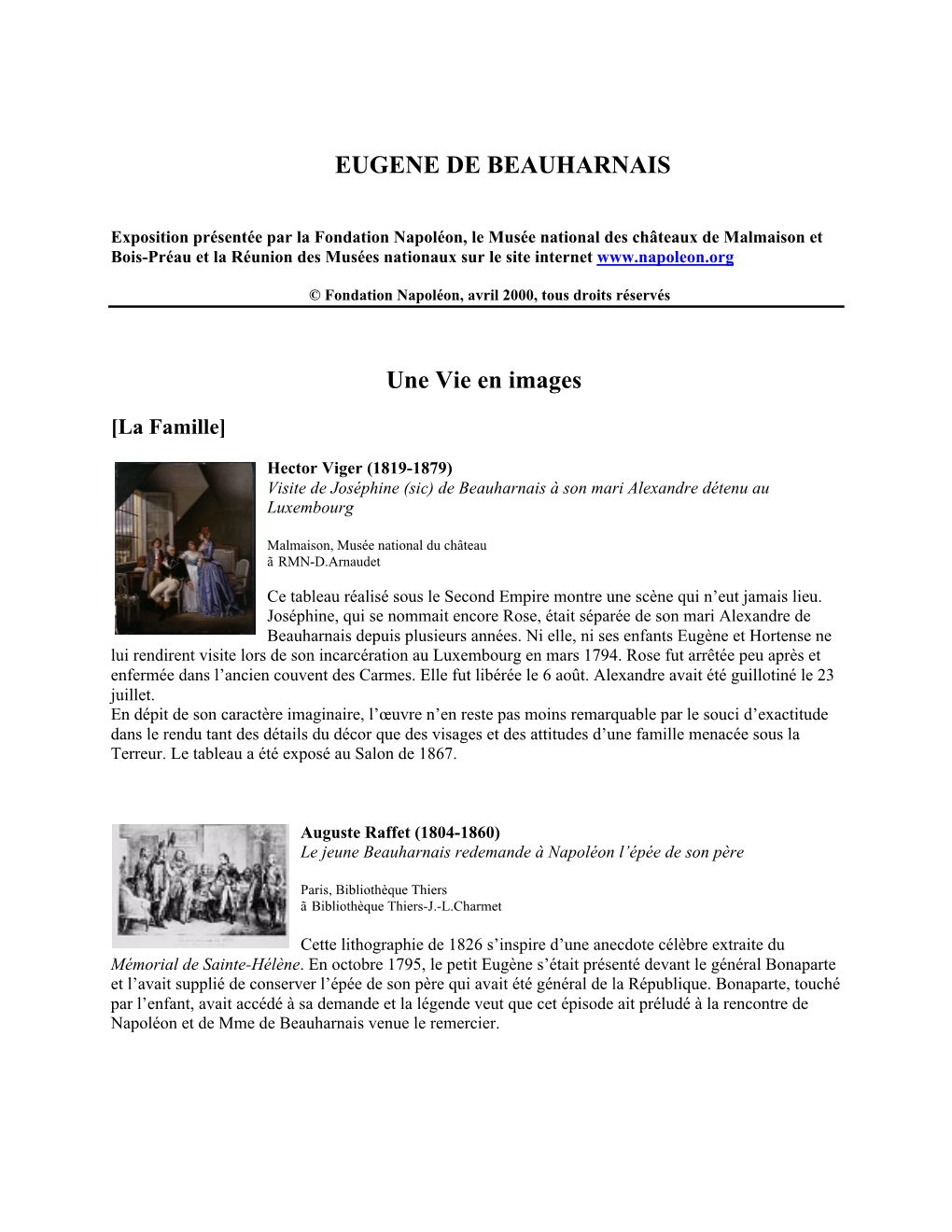
Load more
Recommended publications
-

The Furnishing of the Neues Schlob Pappenheim
The Furnishing of the Neues SchloB Pappenheim By Julie Grafin von und zu Egloffstein [Master of Philosophy Faculty of Arts University of Glasgow] Christie’s Education London Master’s Programme October 2001 © Julie Grafin v. u. zu Egloffstein ProQuest Number: 13818852 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a com plete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest ProQuest 13818852 Published by ProQuest LLC(2018). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States C ode Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC. 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106- 1346 l a s g o w \ £5 OG Abstract The Neues SchloB in Pappenheim commissioned by Carl Theodor Pappenheim is probably one of the finest examples of neo-classical interior design in Germany retaining a large amount of original furniture. Through his commissions he did not only build a house and furnish it, but also erected a monument of the history of his family. By comparing parts of the furnishing of the Neues SchloB with contemporary objects which are partly in the house it is evident that the majority of these are influenced by the Empire style. Although this era is known under the name Biedermeier, its source of style and decoration is clearly Empire. -

PROLOGUE Josephine Beheaded
PROLOGUE Josephine Beheaded Marble like Greece, like Faulkner’s South in stone Deciduous beauty prospered and is gone . —Derek Walcott, “Ruins of a Great House,” Collected Poems There is a spectacle in Martinique’s gracious Savane park that is hard to miss. The statue honoring one of the island’s most famous citizens, Josephine Tascher, the white creole woman who was to become Napoleon’s lover, wife, and empress, is defaced in the most curious and creative of ways. Her head is missing; she has been decapitated. But this is no ordinary defacement: the marble head has been cleanly sawed off—an effort that could not have been executed without the help of machinery and more than one pair of willing hands—and red paint has been dripped from her neck and her gown. The defacement is a beheading, a reenactment of the most visible of revolutionary France’s punitive and socially purifying acts—death by guillotine. The biographical record shows Josephine born of a slaveholding family of declining fortunes, married into the ranks of France’s minor aristocracy, and surviving the social chaos of the French Revolution, which sentenced countless members of the ancien régime to the guillotine. In the form of this statue, she received her comeuppance in twentieth-century Martinique, where she met the fate that she narrowly missed a century earlier. Scratched on the pedestal are the words—painted in red and penned in creole— “Respe ba Matinik. Respe ba 22 Me” [Respect Martinique. Respect May 22]. The date inscribed here of the anniversary of the 1848 slave rebellion that led to the abolition of slavery on Martinique is itself an act of postcolonial reinscription, one that challenges the of‹cial French-authored abolition proclamation of March 31, 1848, and 2 CULTURAL CONUNDRUMS Statue of Josephine in Fort-de-France, Martinique, today. -

Juan Mauricio Rugendas Letters, 1835-1845 Finding
Special Collections and University Archives UMass Amherst Libraries Johann Moritz Rugendas Collection 1835-1845 1 box (0.5 linear ft.) Call no.: MS 271 About SCUA SCUA home Credo digital Scope Overview Series 1. Domingo de Oro Series 2. Juan Gualberto Godoy Series 3. Juan de Espinosa Series 4: José Javier y Tomás Bustamante Inventory Series 1: Domingo de Oro Series 2: Juan Gualberto Godoy Series 3: Juan de Espinosa Series 4: José Javier y Tomás Bustamante Admin info Download xml version print version (pdf) Read collection overview The painter Johann Moritz Rugendas was born in Augsburg, Germany, in 1802, and achieved fame for his depictions of the landscape, natural history, and cultural history of South American early in the era of independence. Beginning as a member of George Heinrich Langsdorff's scientific expedition to Minas Gerais in 1821, and then on his own, Rugendas traveled widely in Brazil, Mexico, Argentina, Uruguay, Chile, and Peru. His best-known published work is the monumental four-volume set, Malerische Reise in Brasilien (1827-1835). The Rugendas collection consists of 192 letters and 4 poems written to Rugendas by four of his South American artist friends who shared his passion for the country and culture of Argentina. See similar SCUA collections: Arts and literature Central and South America Background on Johann Moritz Rugendas Johann Moritz Rugendas (also known as Juan Mauricio Rugendas) was among the most influential European artists to travel in South America during the first half of the nineteenth century. Born in Augsburg (present-day Germany) on Mar. 29, 1802, and raised in a family of renowned painters and engravers, Rugendas was provided with a strong academic artistic foundation, training in father's art school and studying under the painter Albrecht Adam and then under Lorenz Quaglio at the Academy of Arts in Munich. -

THE TALISMAN of CHARLEMAGNE: NEW HISTORICAL and GEMOLOGICAL DISCOVERIES Gerard Panczer, Geoffray Riondet, Lauriane Forest, Michael S
FEATURE ARTICLES THE TALISMAN OF CHARLEMAGNE: NEW HISTORICAL AND GEMOLOGICAL DISCOVERIES Gerard Panczer, Geoffray Riondet, Lauriane Forest, Michael S. Krzemnicki, Davy Carole, and Florian Faure The gem-bearing reliquary known as the Talisman of Charlemagne is closely associated with the history of Europe. Its legend follows such figures as Charlemagne, Napoleon I, Empress Josephine, Hortense de Beauharnais, Napoleon III, and Empress Eugénie. This study provides new historical information collected in France, Germany, and Switzer- land about the provenance of this exceptional jewel, which contains a large glass cabochon on the front, a large blue-gray sapphire on the back, and an assortment of colored stones and pearls. The first scientific gemological analysis of this historical piece, carried out on-site at the Palace of Tau Museum in Reims, France, has made it possible to identify the colored stones and offer insight into their possible geographic origins. Based on our data and com- parison with similar objects of the Carolingian period, we propose that the blue-gray sapphire is of Ceylonese (Sri Lankan) origin, that the garnets originate from India or Ceylon, and that most of the emeralds are from Egypt except for one from the Habachtal deposit of Austria. The estimated weight of the center sapphire is approximately 190 ct, making it one of the largest known sapphires as of the early seventeenth century. he Talisman of Charlemagne is a sumptuous Chapelle in French) on February 28, 814 CE. Since jewel that has passed through the centuries. At the emperor did not leave specific instructions, his Tvarious times it has been said to contain frag- entourage decided to bury him in Aachen Cathedral ments of the hair of the Virgin Mary and a remnant (Minois, 2010). -

PRESS RELEASE NEUMEISTER Special Auction FINE ART and ANTIQUES 365 on 24 September 2014
1/4 5 PRESS RELEASE NEUMEISTER special auction FINE ART AND ANTIQUES 365 on 24 September 2014 Munich, 22 July 2014 Family Bonds – 100 paintings of Wittelsbach and Habsburg possession In a spectacular evening sale on 24 September 2014 NEUMEISTER Fine Art Auctioneers will auction about one hundred paintings and drawings from the collection of the former ruling houses of Bavaria and Austria. Many new discoveries. ”It’s a very special opportunity auctioning off this unique collection of paintings stemming from several estates. An auction reminiscining me of classical attic sales like at Chatsworth 2010 or the Guelph auction of 2005.“ enthuses Katrin Stoll, owner of Munich based auction house NEUMEISTER Fine Art Auctioneers. ”Of course it is the imperial, royal and princely origin, that dynastic element, which makes this auction so outstanding. Its spell, this touching human charm, however, is due to the privacy, the intimacy, one feels when looking at these pictures, most of which have never before been on public display. Take the children’s portraits for instance: The children of Gisela, which the Austrian Emperor's daughter had portrayed for the proud imperial grandparents, or the portrait of Marie Valerie as a two-year old by Hans Makart, which the emperor gave to his wife on the occasion of a return from one of her travels ... This sale really is a very unique opportunity to acquire historic memorabilia – not least about Empress Elisabeth, also known as Sisi.“ Almost all objects called up in this auction (Preview Days in NEUMEISTER’s Vienna office from 10 to 13 September, and at the Munich headquarter from 18 to 22 September), may they be estimated high or low, may they be quaint or charming, or, as in one or two cases truly tragic, have always been in the possession of the Habsburg and Wittelsbach families. -

Download 1 File
.V,. t , v* W' £ v* • -Xi*’ A V. 'f 'v -Vr-. .W ofsfcV >; : ,• : ->. I % -T ->-v ^ 3f ■ $J5^J0£>aS %4J§fc-£ V*1 frAVj ■ \! f* * . , •*', r *S'* * H 4b2 ’ •„ . / • 4 ■ * * l /t- ~ V 4^- ' V * * £ ml * ~ * W.f • i l‘ *• V . ’ A-. , W •/ ,ir r V ■ - /■■ ;•"• '.s ■£■/;*? '.:■'«.•]■ *5>*«33». ■ • 4: • -V.J ; >S /*'-■■ . •*■ ■* J -> ■ . - i V*v**< • • +t* ~ rfT .•#** . r • • X, *.. v v -/,**vxtfv,«. v * i; v* * / • v v* • •■ • % •.*, j» •. •#• * vi-. .yr - * . .•«* *''>;*■.-«r •*.• ^ *V#f‘ . *■ .V ■•. /. •• • . • * _ ■ s- i ■' . V ' ’ . > • •• .’x C -' ■ ■\ .:. ' .?■■ %‘v: ;£ t- '•■••■ • ^ ' V ,‘v • . .••; . 1- ■ V. • • . v .V - - . * * *' VC y -• S'. !Cs* ; . * • • -*'■■• - • _ „ » _ * 7: -«,'1 :r-vy * , yJrv >■- ■$ '■'.-•V ’»A'- V • * r * H ft -. • - .-• - - ♦ , _ r . * •>.2 ; • *• d i, ‘ j , ) ' •'«' '•*> *i'AP' , W. * LV.Vtff* • ,-ir .. i. ..v J'-V ‘•.itv . c.> A-c?v ,yv‘'Vr^-..VM& . r*' . -St ^l> 1 * *f : ;- A iSr’4- V-jT L-‘ ><- ^',*•>» • Wi,'" -5^ V,-?r v • mv>* w V ■/• ;.■• . ■• -;v •*■; ■• * , > c ** •, . t ■ ; ^ **. ■ ' * ’ —-. , r# : ^ *- t •» . | ^ ’v^-* 1 -. L. - ' : V. - 4^/ . ■ > .•? . *: • •-* ■X'. *!$' :<. '•> - - - ' - »'• fr P . r. •->•-. si1 - >j£Sg•.1 • ‘ .?j|ragt S5 , ' • •!> • ■ ■•• ’ •■ ■ '••• ■ • • .- ■ ’i ■ V. '■ ■-• •■'■' . »/ » • - ■>,'• }a -.•*; v>:^Kiiafap:^eBgrt • -1 - ’ ?» • A 4jr - V>J , * r-. • p "A« »/v* ,'* .. ;V> •:‘ - J, ’ V : / J*-' .'.' ' •’. Vy ’tv'?!' 'V ;■*& ‘'T v 1. !%.r- ^ * 1 ■ V . ^ . #X. , - 1 , \ i * . V ✓ . ..-A - * . .•■ r , •!-. -. w * “4* ,J .k1 :* • ■-. • -• Ju. , , * - ■ ' p -* .V V - 4 v "- . - . ■ . '*t *. 4 - aT*i , .> • • . 1 ■ • ‘ • - '.*• 1 K ’ * ■ f*.-4V ' U$,V i %* .- • . ■-v .• . -J. / . •. -r / •/ - . '• s.\ ., i a V • .•„••-•-■: . f-'j- :!> ,.* • :■ - , -9* , •*, ...'• .';. 7--‘ •• ^ Fvir’-vrS- ^jf’-■ • ;-gg a V-pi’-'-L. ■•• $ '• '*-V ;7^-V-’- ,.v.r'& -p ''-/-.A;-: ^ .'•v ~p, '0>A:‘'> fgt . y- . -

Potestas N8-4
TERESA LLÁCER VIEL Te Empress of the French. Iconography of Joséphine de Beauharnais 241 THE EMPRESS OF THE FRENCH. ICONOGRAPHY OF JOSÉPHINE DE BEAUHARNAIS TERESA LLÁCER VIEL Universitat Jaume I Recibido: 04-03-2015 / Evaluado: 14-04-2015 / Aprobado: 20-04-2015 RESUMEN: El 2 de diciembre de 1804, Josefina de Beauharnais (Martinica, 23 de junio de 1763 - Rueil-Malmaison, 29 de mayo de 1814), fue coro- nada como emperatriz de los franceses en la catedral de Notre-Dame. Su esposo, Napoleón Bonaparte (Ajaccio, 15 de agosto de 1769 - Santa Elena, 5 de mayo de 1821), colocaba sobre su cabeza la réplica de la coro- na de Carlomagno ante la mirada del papa Pío VII (1742-1823). La que fuera vizcondesa de Beauharnais, de nacimiento criolla, llevaría el manto imperial durante seis años hasta la formalización de su divorcio de Bonaparte el 10 de enero de 1810. Palabras clave: iconografía del poder, Josefina de Beauharnais, Napoleón Bonaparte, Primer Imperio francés. ABSTRACT: On the second of December 1084, Joséphine de Beauharnais (née Tascher de la Pagerie in Martinica; 23 June 1763 – 29 May 1814 in Rueil-Mailmaison) was crowned as Empress of the French in the Cathedral of Notre-Dame. Her husband, Napoleon Bonaparte (Ajaccio, 15 August 1769 – Saint Ellen, 5 May 1821) placed on her head the replica of the crown of Charlemagne before Pope Pius VII (1742-1823). Te former vizcountess of Beauharnais, born a creole, would be wearing the imperial cape for six years until her official divorce from Napoleon on 10 January 1810. Keywords: Iconography of power, Joséphine de Beauharnais, Napoleon Bonaparte, First French Empire. -

Mineral Masterpieces of Mexico
MINERAL MASTERPIECES OF MEXICO г Amethyst , 12.7 cm. La Sopressa Mine, Amatitlan, Guerrero, Mexico. б Wulfenite with Cerussite , 5.7 cm. Los Lamentos, Chihuahua, Mexico. Я Cumengeite , 2.5 cm. Amelia Mine, Santa Rosalia, Boleo District, Baja California Sur, Mexico. в Manganoadamite , 7.6 cm. Ojuela Mine, Mapimi, Durango, Mexico. б Smithsonite with Hemimorphite , 7.6 cm. The San Antonio Mine, Santa Eulalia, Chihuahua, Mexico. г Acanthite (paramorph after argentite) on Calcite , 10.2 cm. La Sirena Mine, Guanajuato, Mexico. Collection and photo: Stuart Wilensky. Я Mimetite , 11.4 cm. Congreso-Leon Mine, San Pedro Corralitos, Chihuahua, Mexico. THE DUKE LEUCHTENBERG COLLECTION IN THE MINERALOGICAL STATE COLLECTION, MUNICH Dr. Rupert Hochleitner Mineralogische Staatssammlung, M ünchen , [email protected] The Mineralogical State Collection (Mineralogische Staats - sammlung M ünchen) is a research institution that forms part of the МBavarian Natural History Collections. Its scientific tasks include the collection, storage and study of the minerals forming our planet earth and the other planets of our solar system. One focus is, of course, on Bavarian minerals. Other main research topics are meteorites (especially those of martian origin), CSH phases, phos - phate minerals, archeometry and biomineralisation. The Mineralogical State Collec - tion is also engaged in public education. This is done through the Museum " Kingdom of Crystals " (Museum Reich der Kristalle), located in Munich. It presents a didactically structured exhibition and gives a highly aesthetic insight into the world of minerals, crystals and gemstones. Special exhibitions show additional themes such as diamonds, stones from Mars, and jewels. Numerous lectures and guided tours through the museum, as well as the advanced training opportunities for teachers, pupils and students, are designed to make the visitors aware of the mineralogical treasures of our planet. -

Albrecht Adam Created Several Oil Paintings of the King Creators
herd of Weil in 1932, as well as in numerous private This series of articles covers the most important aspects and state breeding programs worldwide. King Wilhelm of the work and life of Orientalist artists depicting Arabian I of Wurttemberg founded a stud farm near Stuttgart horses. However, there were many others – some more, ORIENTALISM AND THE ARABIAN HORSE : PART 7 in 1817 using only the noblest and purest blood lines some less, well-known. Moreover, one should not forget from Arabia – a very uncommon practice at that time. the numerous works of art which were not signed by their Albrecht Adam created several oil paintings of the king creators. Some of them are real treasures – even if we will riding on his noble steeds as well as fantastic portraits never know who was the mastermind behind them. When of King Wilhelm’s exclusive Arabian horses. we marvel at old Arabian horse pictures today, we should ALBRECHT ADAM briefly think of the brilliant artists who left us this source of In 1844 Albrecht Adam painted the Arabian stallion inspiration. They were thrilled by the same passion as we Siglavi – one of the foundation sires of the Lipizzan are today: The beauty and spirit of Arabian horse! Noerdlingen 1786 – München 1862 race. Another of Albrecht Adam’s most beautiful paintings depicting Arabian horses shows five Arabian stallions with their grooms in front of the royal stable For inquiries regarding the Arabian horse in art please in Munich. Adam created this charming work of art in contact: 1834. Albrecht Adam was a versatile painter, always By Judith Wich-Wenning true to nature with great love for the details. -

Rev Olution 1848
REVOLUTION 1848 st The Schleswig Question, Hungarian Revolution & 1 Italian Risorgimento 1 Francaise Vol III Vol Francaise L’Armee L’Armee Francaise Vol III “Only three people have ever really understood the Schleswig-Holstein business — the Prince Consort, who is dead — a German professor, who has gone mad—and I, who have forgotten all about it.” Lord Palmerston, British Prime Minister On the cover, “Soldaternes hjemkomst til København, 1849” by Otto Bache and in the Public Domain. 2 L’Armee Francaise Vol III Age of Valor Age of Eagles II for European Warfare by Blood and Iron, 1848 thru 1914 REVOLUTION 1848 Table of Contents SUBJECT Page SUBJECT PAGE INTRODUCTION …………………………….….…. 4 STORMING THE DANEVIRKE …………………….. 19 REVOLUTION 1848………….………...…………. 5 BATTLE OF ISASZEG....……………….….….…… 24 Background………………………………….. 5 BATTLE OF TEMESVAR…………………………… 29 Rules Modifications………………………… 6 BATTLE OF ST LUCIA ……………………………. 36 Wargamers Reference Shelf……………… 7 BATTLE OF NOVARA …………………………….. 40 Leader and Unit Data Tables……..………. 9 REDUCED SCALE AGE OF VALOR ..…………….. 45 BATTLE OF IDSTEDT…..…………………………. 1 5 CHARTS & TABLES ……………………………… (49) Final AOV Conflict Module Listing BALKAN WARS FREE TEST DRIVE FRANCO-PRUSSIAN WAR IMPERIAL PERIOD Battle of Lule Burgas Battles of Spicheren, Bourney & Columbey THE CRIMEAN WAR FRANCO-PRUSSIAN WAR REPUBLICAN PERIOD Battles of the Alma, Inkermann, Traktir, Malakov Battles of Coulmiers and la Lisaine 2D RISORGIMENTO 1859 - 1861 THUNDER IN THE EAST Battle of Magenta,Solferino,San Martino, Volturno Russo-Turkish and Russo-Japanese Wars AUSTRO PRUSSIAN WAR & 3D RISORGIMENTO BEFORE THE LEAVES FALL Battle of Trautenau, Problus, Kissingen, Custoza Battles of Mons, Charleroi, Gumbinnen, Krasnik “Ottende brigades angreb ved Dybbøl 18. april 1864” by Vilhem Rosenstand and in the Public Domain. -

Fonds Beauharnais (1624-1843)
Fonds Beauharnais (1624-1843) Répertoire (251AP/1-251AP/6) Par M. Massot, S. d'Huart et S. Lacombe Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 1964 1 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_004380 Cet instrument de recherche a été encodé en 2012 par l'entreprise Numen dans le cadre du chantier de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales sur la base d'une DTD conforme à la DTD EAD (encoded archival description) et créée par le service de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales 2 Archives nationales (France) INTRODUCTION Référence 251AP/1-251AP/6 Niveau de description fonds Intitulé Fonds Beauharnais Date(s) extrême(s) 1624-1843 Nom du producteur • Beauharnais, Claude de (1756-1819) • Beauharnais, François de (1756-1846) • Beauharnais, Alexandre de (1760-1794) Importance matérielle et support Localisation physique Pierrefitte Conditions d'accès Libre. DESCRIPTION Présentation du contenu 251AP/1-3. Famille de Beauharnais, dont le sénateur comte Claude de Beauharnais : fonctions maritimes, coloniales et militaires, biens. 1633-1839. 251AP/4-5. François de Beauharnais. 1802-1836. 251AP/6. François de Beauharnais, 1807-1811 ; Alexandre de Beauharnais, 1791-1793 ; Eugène de Beauharnais, 1809-1815. Présentation du contenu PRÉSENTATION DU CONTENU Famille de robe et de marins, les archives de la famille Beauharnais auraient pu, si elles existaient, constituer une documentation très importante sur les colonies au XVIIIe siècle, grâce aux fonctions que remplirent les Beauharnais tant au Canada qu'aux Antilles (les renseignements les plus détaillés qu'on puisse trouver sur cette question sont dans le Mémoire de d'Hozier sur la famille Beauharnais, conservé dans la série des Pièces originales du Cabinet des Titres, à la Bibliothèque nationale). -

Eugène De Beauharnais Fils Et Vice-Roi De Napoléon
Michel Kerautret Eugène de Beauharnais Fils et vice-roi de Napoléon Tallandier Cartes : © Éditions Tallandier/Légendes cartographie, 2021 © Éditions Tallandier, 2021 48, rue du Faubourg‑Montmartre – 75009 Paris www.tallandier.com ISBN : 979‑10‑210‑4536‑1 Introduction Eugène de Beauharnais, beau‑fils et fils adoptif de Napoléon, auquel il doit entièrement son existence historique, est une figure paradoxale dans la grande fresque de l’épopée : omni‑ présent du début à la fin, il paraît pourtant moins nette‑ ment campé que certains caractères plus typés, Talleyrand ou Fouché, Ney ou Murat ; et moins romanesque que sa sœur Hortense, si touchante et si malheureuse. Comme s’il n’ac‑ crochait pas la lumière, ou demeurait dans l’ombre portée de l’empereur. La postérité ne l’a certes pas ignoré – plusieurs biographies lui ont été consacrées –, mais elle l’a laissé au second plan, le trouvant sans doute un peu terne, manquant de relief. Elle a manifestement préféré les bravaches aux modestes, les flamboyants aux laborieux, les scélérats gran‑ dioses aux vertueux discrets. Eugène aura paru trop sage pour cette époque haletante où se bousculent tant de figures hautes en couleur. On peut comprendre ce tropisme. Cependant, outre ce qu’il comporte d’injustice, il aboutit à occulter en partie le rôle d’un acteur important et, à travers lui, tout un pan de l’histoire napoléonienne. Eugène, fils de l’épouse de l’empereur, est aussi proche qu’on peut l’être du centre de cette histoire. Mais il en constitue aussi, comme vice‑roi en Italie et comme prince bavarois, un élément détaché, sinon tout à fait autonome.