Val-Allier-Vieille-Brioude
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

Carte Rando Vélo 2017
SAINT-BONNET- Circuit LA CHAISE-DIEU Circuit Circuit LANGEAC LE CHAMBON- AUREC-SUR-LOIRE LE-FROID Circuit SUR-LIGNON Circuit BRIOUDE Circuit MONT-GERBIER-DE-JONC La Chaise-Dieu 5h45 Saint-Bonnet-le-Froid 3h45 Langeac 3h45 (Départ Abbaye) (Temps moyen) (Départ Mairie) (Temps moyen) (Départ Office de Tourisme) (Temps moyen) Le Chambon-sur-Lignon 4h15 RB Brioude 4h30 Deux départs différents : 7 10 12 (Départ Mairie) (Temps moyen) (Parking Centre Historique) (Temps moyen) 97 km 1749m 69,5 km 1153m 105 km 1997m 15 16 Aurec-sur-Loire / Mont-Gerbier-de-Jonc (Distance) (Denivelé positif) (Distance) (Denivelé positif) (Distance) (Denivelé positif) 107 km 2454m 98 km 1923m Mont-Gerbier-de-Jonc / Aurec-sur-Loire 22 itinéraires cyclo (Distance) (Denivelé positif) 5 (Distance) (Denivelé positif) en Haute-Loire ENTRE MONTAGNES ET VOLCANS, FLEUVES ET SOURCES SAUVAGES ■ Rivières et vieilles pierres au pays des ■ Mais c’est bien sûr : gastronomie ■ Dans la roue des cyclosportifs de la ■ Évasion dans l’inspiration littéraire ■ La route des Vents ■ Vivez la Loire Sauvage moines et des châtelains oblige ! Pierre Chany Albert Camus, Jules Romains, Jules Vallès, George Sand,… Après avoir remonté la rivière Allier, comme le saumon La Loire sauvage à vélo ! Laissez-vous tenter par une Après avoir longtemps flirté avec la douce Senouire, rivière Après avoir appuyé sur le champignon tout au long des A fond sur les pédales dans les reliefs souvent escarpés du ont laissé de beaux écrits sur ce territoire d’altitude où atlantique encore présent dans cette rivière, jusqu’à la belle pédalée intense de 300 km fractionnable sur les routes aux paillettes d’or, votre route vous conduira de châteaux secteurs très roulants du Velay oriental, vous ne manquerez Haut-Allier, envolez-vous sur le tracé de l’une des plus belles règnent la lauze, le chaume et le granit. -

Hydro-Électricité Et Enjeux Environnementaux CERAMAC Centre D’Etudes Et De Recherches Appliquées Le Cas Du Barrage De Poutès (Haute-Loire) Au Massif Central
Hydro-électricité et enjeux environnementaux CERAMAC Centre d’Etudes et de recherches appliquées Le cas du barrage de Poutès (Haute-Loire) au Massif Central Toutes les énergies renouvelables sont-elles des énergies vertes ? En effet, les deux termes ne sont pas synonymes, le second pouvant être défini comme une énergie dont les moyens de production ont le moins d'impact possible sur l'environnement. A Poutès, il y a deux enjeux contradictoires : produire de l'énergie renouvelable (une directive qui nous demande d'arriver à 21 % d'énergie renouvelable en 2010) et améliorer la qualité des cours d'eau notamment pour faciliter la remontée du saumon. Alors que la concession du barrage arrive à terme, la question d'un prolongement de son activité s’est posée. Des enjeux énergétiques et financiers Schéma de fonctionnement du complexe hydro-électrique de Poutès-Monistrol Un site aux emprises multiples 0 1 000 2 000 Mètres Mètres ± 700 Allier 800 900 1 000 R u i s s e au d ce n A e P Barrage de Poutès ' l e ey d r e au e s s Rui A Monistrol-d'Allier, trois barrages alimentent une unité de production électrique. Le principal est celui de Poutès, implanté sur l'Allier, terminé en 1941. D'une hauteur de 65 mètres, il emmagasine 2,4 millions de m3. Les deux autres, sur un affluent, l’Ance, servent à Barrage de Pouzas alimenter une autre conduite forcée. L'usine située à proximité de Monistrol-d'Allier produit 82 millions de GWh, soit l'équivalent de la consommation domestique de 50 000 habitants. -

Val-Allier-Vieille-Brioude
S.M.A.T. du Haut-Allier LISTE DES ANNEXES Annexe 1 : Composition des différents groupes de travail de Natura 2000 Val d'Allier Annexe 2 : Comptes rendus des réunions du Comité de Pilotage, du Groupe de Pilotage, du Groupe de Coordination, de la Commission Environnement, de la Commission Agricole, de la Commission Forêt, de la Commission Cadre de Vie – Tourisme et de la Commission Artisanat – Commerce – Industrie Annexe 3 : Cartes à l'échelle 1/10 000ème des Habitats relevant de la Directive 92/43/CEE du site Natura 2000 "Val d'Allier / Vieille-Brioude / Langeac" Annexe 4 : Cartes à l'échelle 1/10 000ème des espèces relevant de la Directive 92/43/CEE du site Natura 2000 "Val d'Allier / Vieille-Brioude / Langeac" Annexe 5 : Protocoles des suivis relatifs à la forêt alluviale, fiche A1 Annexe 6 : Fiche relative à l'étude d'évaluation des désagréments potentiels occasionnés par les modifications artificielles du fonctionnement hydraulique de l'Allier. Annexe 7 : Schéma d'une cage-piège spéciale pour l'élimination sélective des gros rongeurs introduits relative à la loutre, fiche A3 Annexe 8 : Protocole du suivi relatif aux Dunes continentales, fiche A5 Annexe 9 : Protocole du suivi relatif Chenopodion rubri des rivières sub-montagnardes, fiche A6 Annexe 10 : Suivi et actions à réaliser en relation avec les chiroptères, fiche B3 Annexe 11 : Justificatifs de calcul des primes compensatrices et protocoles des suivis relatifs aux prairies maigres de fauche, fiche C1 Annexe 12 : Autorisation d'exploitation de la carrière du Fraisse, période de nidification et protocole du suivi relatif aux pelouses sèches, fiche C2 Annexe 13 : Protocole du suivi relatif au Damier de la succise, fiche C3 Site Natura 2000 Val d'Allier S.M.A.T. -

(A) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament
3.2.2018 EN Official Journal of the European Union C 41/13 V (Announcements) OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of an amendment application pursuant to Article 50(2)(a) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (2018/C 41/07) This publication confers the right to oppose the application pursuant to Article 51 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (1). APPLICATION FOR APPROVAL OF NON-MINOR AMENDMENTS TO THE PRODUCT SPECIFICATION FOR A PROTECTED DESIGNATION OF ORIGIN OR PROTECTED GEOGRAPHICAL INDICATION Application for approval of amendments in accordance with the first subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 ‘LENTILLE VERTE DU PUY’ EU No: PDO-FR-0202-AM02 — 18.5.2017 PDO ( X ) PGI ( ) 1. Applicant group and legitimate interest Comité de Défense et de Gestion de la Lentille verte du Puy AOC – Immeuble Interconsulaire 16 boulevard Président Bertrand 43000 Le Puy-en-Velay FRANCE Tel. +33 471072133 Email: [email protected] The applicant group Comité de Défense et de Gestion de la Lentille verte du Puy AOC is composed of ‘Lentille verte du Puy’ PDO operators (producers, collectors and packagers) and has a legitimate interest in submitting the application. 2. Member State or Third Country France 3. Heading in the product specification affected by the amendment(s) — Product name — Description of product — Geographical area — Proof of origin — Method of production — Link — Labelling — Other: geographical area, link, contact details of the inspection bodies, national requirements (1) OJ L 343, 14.12.2012, p. -

Secteurs De Recrutement Des Collèges Publics
Secteurs de recrutement des collèges publics I – BASSIN DE FORMATION DU PUY-en-VELAY Collège Stevenson LANDOS : Alleyras Arlempdes Barges Le Bouchet Saint-Nicolas Le Brignon Cayres Costaros Goudet Lafarre Landos Ouïdes Pradelles Rauret Saint-Arcons de Barges Saint-Etienne du Vigan Saint-Haon Saint-Jean Lachalm Saint-Paul de Tartas Seneujols Vielprat Collège L. Eynac – LE MONASTIER/GAZEILLE. : Alleyrac Chadron Les Estables Freycenet La Cuche Freycenet La Tour Moudeyres Laussonne Le Monastier sur Gazeille Salettes Présailles Saint-Martin de Fugères Arsac en Velay Solignac sur Loire (1) Coubon (1) Réseau du Haut Velay Granitique Collège du Mont-Bar ALLEGRE : Allègre Bellevue La Montagne Céaux d’Allègre La Chapelle Bertin Monlet Fix Saint-Geneys Lissac Saint-Paulien Saint-Geneys près Saint-Paulien Varennes Saint-Honorat Vazeilles Limandre Vernassal Borne Collège des Hauts de l’Arzon de CRAPONNE/ARZON : Beaune sur Arzon Boisset Chomelix Craponne sur Arzon Jullianges Saint-Julien d’Ance Saint-Georges Lagricol Saint-Jean d’Aubrigoux Saint-Victor sur Arlanc Saint-Pal en Chalencon Saint-Pierre du Champ Tiranges Collège Henri Pourrat LA CHAISE DIEU : La Chaise-Dieu La Chapelle Geneste Saint Pal de Senouire Bonneval Malvières Connangles Félines Sembadel Cistrières 1 Secteur du PUY EN VELAY Collège Clos de Corsac : BRIVES CHARENSAC Collège Jules Vallès : LE PUY-EN-VELAY Collège Lafayette : LE PUY-EN-VELAY (Pour ces 3 collèges le secteur est globalisé.) Aiguilhe Blavozy (2) Bains Blanzac Ceyssac Chadrac Brives-Charensac Chaspuzac Coubon -

Festival De La Chaise-Dieu
e 48 Festival de musique La Chaise-Dieu Le Puy-en-Velay Brioude Ambert Chamalières-sur-Loire Saint-Paulien du au août 2014 20 31 Bilan 2014 Contact Festival de La Chaise-Dieu 10 rue Jules Vallès - BP 80150 43004 LE PUY-EN-VELAY Cedex [email protected] Tél : 04 71 09 48 28 - Fax : 04 71 09 55 58 Une fréquentation globalement stable Le 48e Festival de La Chaise-Dieu s’est déroulé du 20 au 31 août 2014, avec au total 79 événements (40 concerts payants et 39 propositions gratuites) répartis sur douze jours. Si l’Abbaye de La Chaise-Dieu (son abbatiale, son cloître, son auditorium) reste le lieu principal des concerts, le Festival n’en a pas moins poursuivi sa desserte d’un territoire désormais bien défini, allant du Puy-en-Velay, au sud, à Ambert (Puy- de-Dôme) au nord, et de Brioude, à l’ouest, à Chamalières-sur-Loire, à l’est. Pour sa 48e édition, le Festival de La Chaise-Dieu a accueilli au total : > 23 000 spectateurs, soit autant qu’en 2013 > 1 300 artistes > Les 40 concerts payants qui se sont succédés ont réuni près de 18 000 spectateurs, et font apparaître un taux de remplissage moyen en léger recul par rapport à 2013 (-2%). Sur ces 40 concerts : > 32 concerts ont eu lieu à La Chaise-Dieu : 22 en l’abbatiale Saint-Robert,10 à l’auditorium Cziffra ; > 5 concerts se sont déroulés au Puy-en-Velay, du vendredi 22 au mardi 26 août inclus 2 au théâtre municipal, 1 à l’auditorium des Ateliers des Arts, 1 en l’église des Carmes, 1 en l’église du Collège. -

Méthanisation
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE État d'avancement des projets de méthanisation (Décembre 2016) FRUGERES STE VEZEZOUX LES-MINES FLORINE CHASSIGNOLLES LEMPDES AUZON CHAMBEZON SUR ST-HILAIRE ALLAGNON ST-VERT ST-JEAN AUREC VERGONGHEON D'AUBRIGOUX SUR-LOIRE ST FERREOL LAVAL LA TORSIAC AZERAT ST-PAL-DE MALVALETTE D'AUROURE LEOTOING CHAMPAGNAC SUR CHAPELLE ST-JUST-MALMONT BOURNONCLE CHALENCON ST AGNAT LE-VIEUX DOULON GENESTE MALVIERES ST GERON ST-VICTOR LA PONT PIERRE SUR-ARLANC CHAPELLE SALOMON VALPRIVAS D'AUREC COHADE AUTRAC CISTRIERES CRAPONNE BAS ST-DIDIER BLESLE BOISSET LORLANGES SUR-ARZON EN-BASSET EN-VELAY BONNEVAL LA ST LAMOTHE MONISTROL ST CHANIAT ST-DIDIER JULIEN BEAUMONT CHAISE JULLIANGES SUR-LOIRE VICTOR ST-ETIENNE SUR-DOULON DIEU D'ANCE MALESCOURS CONNANGLES ST LA SUR ESPALEM BRIOUDE PAULHAC GEORGES TIRANGES SEAUVE BLESLE FONTANNES BEAUNE SUR JAVAUGUES LAGRICOL ST SUR-ARZON SEMENE GRENIER-MONTGON BERBEZIT LAURENT ST-ANDRE VALS ST-BEAUZIRE CHABREUGES FRUGIERES DE-CHALENCON LE SEMBADEL LE-PIN FELINES ST-ROMAIN CHASTEL ST-PAL-DE LACHALM MONTCLARD BEAUZAC STE SENOUIRE CHOMELIX ST-PIERRE ST SOLIGNAC SIGOLENE VIEILLE LAVAUDIEU DU-CHAMP SOUS LUBILHAC BRIOUDE PREJET COLLAT ROCHE LES ST-PAL ST-JUST DOMEYRAT ARMANDON RIOTORD VILLETTES DE-MONS PRES-BRIOUDE ROCHE-EN LA REGNIER MONLET DUNIERES CHOMETTE BELLEVUE CHASSAGNES JOSAT LA ST-MAURICE LA-MONTAGNE RETOURNAC CHAPELLE DE-LIGNON PAULHAGUET ST STE BERTIN MARGUERITE PRIVAT SALZUIT RAUCOULES DU-DRAGON VILLENEUVE BEAUX GRAZAC ST-JULIEN D'ALLIER MAZERAT ALLEGRE MONTFAUCON MOLHESABATE ST VOREY EN-VELAY -

Assessing Relationships Between Human Adaptive Responses and Ecology Via Eco-Cultural Niche Modeling William E
Assessing relationships between human adaptive responses and ecology via eco-cultural niche modeling William E. Banks To cite this version: William E. Banks. Assessing relationships between human adaptive responses and ecology via eco- cultural niche modeling. Archaeology and Prehistory. Universite Bordeaux 1, 2013. hal-01840898 HAL Id: hal-01840898 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01840898 Submitted on 11 Nov 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Thèse d'Habilitation à Diriger des Recherches Université de Bordeaux 1 William E. BANKS UMR 5199 PACEA – De la Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie Assessing Relationships between Human Adaptive Responses and Ecology via Eco-Cultural Niche Modeling Soutenue le 14 novembre 2013 devant un jury composé de: Michel CRUCIFIX, Chargé de Cours à l'Université catholique de Louvain, Belgique Francesco D'ERRICO, Directeur de Recherche au CRNS, Talence Jacques JAUBERT, Professeur à l'Université de Bordeaux 1, Talence Rémy PETIT, Directeur de Recherche à l'INRA, Cestas Pierre SEPULCHRE, Chargé de Recherche au CNRS, Gif-sur-Yvette Jean-Denis VIGNE, Directeur de Recherche au CNRS, Paris Table of Contents Summary of Past Research Introduction .................................................................................................................. -
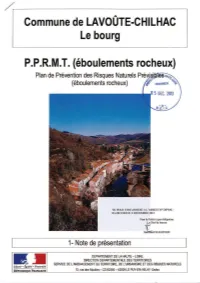
De LAVOUTE-CHILHAC
PPR Mouvements de terrain de Lavote-Chilhac Note de présentation Table des matières 1 INTRODUCTION........................................................................................................................................2 1.1 O jet du PPR......................................................................................................................................2 1.2 Un r$le réglementaire.........................................................................................................................2 1.3 Un r$le de connaissance du risque....................................................................................................3 1.4 Un r$le d)information...........................................................................................................................3 1.5 Motivation et prescription du PPR......................................................................................................3 1., Contenu du PPR.................................................................................................................................4 1.7 Les étapes successives de l)éla oration du PPR mouvement de terrain de L./OU01- C2IL2.C....................................................................................................................................................4 1.8 Révision du PPR.................................................................................................................................5 2 CONTEXTE NATUREL..............................................................................................................................6 -

Carte De Secteurs
SECTEURS CONSEILLERS en élevage Lait AVRIL 2021 1 – BONNEFOI Cyril 20 – MASCLAUX Emilie 06.12.81.64.16 07.81.43.14.38 3 – GASTEL Vincent 12 – RAMEL Loïc 06.37.68.56.94 Ste 06.98.38.74.59 Florine Frugères les Mines Aurec sur Loire Auzon St-Eugénie St-Ferréol St Vert Villeneuve Malvalette St-Just Malmont Chambezon St Hilaire d'Auroure St Pal Chapelle Pont Malvières St Victor en Chalencon Leotoing Azerat Agnat sur Arlanc Craponne d'Aurec Salomon 7 – GACHET Jérôme Torsiac La /Arzon Bas en St Didier 06.11.69.96.64 Cistrières Chaise St Victor Chaniat Boisset Valprivas Basset La en Velay St Didier Dieu Jullianges St Julien Malescours Autrac Lamothe Monistrol Seauve Blesle sur Doulon Connangles d'Ance /Semène St Etienne Tiranges sur Loire Espalem Brioude St Romain sur Blesle St André Frugières Ste- Lachalm St- St Laurent Vals le Felines de Chalencon Grenier St Pal de Chomelix Beauzac Les Sigolène Chabreuges le Pin Chastel Montclard Solignac St Pal Montgon Beauzire Lavaudieu Senouire Villettes Vieille s/Roche de Mons Riotord Collat Dunières Lubilhac Brioude Domeyrat Roche en St Maurice Monlet Régnier St Just La Bellevue de Chapelle Retournac près Brioude Chomette Cha ssagne s la Montagne Lignon 18 - BRIGNON Sébastien Josat Bertin Vorey St Julien Salzuit Beaux Grazac 06.67.04.23.73 St Lapte Molhesabate Ilpize St Privat Allègre Céaux St-Geney s Montregard Mercoeur du Dragon Jax d'Allègre près St-Paulien St Vincent Mezères Chavaniac St- Yssingeaux Chenereilles Chilhac Julien Lavoûte Laf. Vernassal Rosières Tence Le Fix St- St Paulien du Pinet Ally Chilhac Geneys Lavoûte Mas de St-Jeures Tence St Cirgues Aubazat Mazeyrat d'Allier sur Loire Malrevers Blanzac Le Pertuis 05 – NOTIN Antoine Loudes Borne Chaspinhac 06.47.06.64.63 St- Polignac Arcons Siaugues Blavozy St Hostien Araules Langeac d'Allier Ste Marie St Monteil Le Cronce St Jean Chaspuzac Vidal Chadrac St Pierre Le Mazet Chambon de Nay Aig. -

Carte It43 01-07-2018.Pdf
Répartition des sections d’inspection dans le département de la HAUTE-LOIRE Vézézoux SteFlorine St-Jean-d'Aubrigoux FrugèreslesMines Chassignoles St-Ferréol-d'Auroure Chambezon Auzon St-Vert St-Hilaire Lempdes Vergongheon Aurec-sur- La Malvalette Loire Laval- StJustMalmont Chapelle- St-Pal-en- sur- Geneste Léotoing Azérat Agnat Champagnac- Malvières St-Victor- Craponne- Chalencon Pont-Salomon Doulon Torsiac Bournoncle- le-Vieux sur-Arlanc sur-Arzon La Chapelle- St-Victor- Autrac St-Pierre Bas-en- d'Aurec Saint-Didier- Malescours Cohade Cistrières St- Basset Lorlanges St St- en-Velay Géron Georges Boisset La Chaise-Dieu Lagricol Julien- Beaumont Lamothe Chaniat St-Didier- d'Ance St-Etienne- Valprivas Blesle sur-Doulon Connangles Jullianges sur-Blesle Bonneval Beaune- Monistrol-sur- La Séauve- Espalem Paulhac Fontannes Javaugues surArzon St- Tiranges sur-Semène BRIOUDE André- Loire StRomain StLaurent Berbezit de-Chalencon St-Beauzire Frugières- Félines Lachalm le-pin Vals- StPal Beauzac Chabreuges Grenier- de- Chomelix St-Pierre- Sainte-Sigolène Montgeon Sénouire Sembadel Duchamp Lavaudieu Collat Solignac-sous- Les Villettes Vieille-Brioude Domeyrat St-Préjet- Roche St Pal de Lubilhac Armandon Roche- St-Maurice- Mons Dunières Riotord La en-Régnier de-Lignon St-Just- Chomette près-Brioude Chassagnes La Chapelle-Bertin Retournac Ste- Josat Monlet Bellevue- Salzuit Montfaucon Marguerite La-Montagne Grazac Vorey Beaux Raucoules Villeneuve- Paulhaguet St-Julien- Couteuges Allègre Céaux- Molhesabate Mercoeur d'Allier St-Ilpize St-Privat- Varennes-St-Honorat -

Haute-Loire 2020
Haute-Loire BIENVENUE à la ferme En direct de nos fermes, vous pourrez déguster des produits 2020 authentiques, manger des bons petits plats dans nos fermes- auberges, en table d’hôtes, dormir et profi ter dans nos Chambres d’hôtes, nos gîtes, nos fermes de découverte et surtout nous rencontrer et échanger. Alors à tous…. BIENVENUE A LA FERME… EN HAUTE-LOIRE Denise Souvignet, Présidente du réseau Bienvenue à la ferme. Les Marchés des Producteurs de Pays Ils garantissent des produits en direct, du producteur au consommateur, avec en prime, la convivialité et l’échange. Réservés exclusivement aux producteurs fermiers ou artisans, les Marchés des Producteurs de Pays sont des lieux d’acceuil chaleureux et colorés. Ils valorisent pleinement la richesse et la diversité de nos terroirs. AUREC-SUR-LOIRE LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE Toute l’année Du 2 juillet au 27 août Les vendredis soirs de 15h30 à 19h Les jeudis soirs de 17h à 19h30 Renseignements : 04 77 35 40 13 Renseignements : 04 71 03 80 01 CHOMELIX MONISTROL-SUR-LOIRE Du 2 juillet au 27 août Toute l’année les jeudis soirs de 17h30 à 20h Les samedis matins de 8h à 12h Renseignements : 04 71 03 63 10 Renseignements : 04 71 66 53 45 SAINT JEURES SAINT-ROMAIN-LACHALM Les vendredis soirs du 26 juin au 21 aôut Du 26 juin au 28 août Renseignements : 04 71 59 62 07 Les vendredis soirs de 17h à 20h Renseignements : 04 71 61 00 08 LAVOUTE CHILHAC VOREY-SUR-ARZON crédit photo :GettyImages - Beerpixs :GettyImages photo crédit Gastronomie à la ferme Le dimanche 21 juillet de 9h à 13h et le dimanche 9 aout de 9h à 17h Les mercredis de 18h à 22h : Renseignements : 04 71 77 45 67 du 8 juillet au 26 août Une question ? Retrouvez nous sur : Séjours à la ferme Renseignements : 04 71 03 40 39 CONTACTEZ VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE HAUTE-LOIRE AU : bienvenue-a-la-ferme.com Loisirs à la ferme 04 71 07 21 00 Chambre d’Agriculture Haute-Loire - Hôtel Interconsulaire 16 Bd Bertrand - BP 20343 - 43012 Le Puy en Velay Cedex Découvrez nos recettes originales Tél.