Pprm Math Presentation
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

PPRM La Mure 2019
Rapport d’enquête publique Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM) sur le Plateau Matheysin (38) du 5 décembre 2018 au 19 janvier 2019 enquête n° E18000327/38 Tribunal Administratif de Grenoble Ponsonnas, le 19 février 2019 Rapport d’enquête publique : Plan de Prévention des Risques Miniers sur le Plateau Matheysin (38) – enquête n° E18000327/38 – Jean-Pierre Blachier. 1 PLAN DU DOSSIER A. PREAMBULE A.1. Désignation du commissaire-enquêteur B.2. Arrêté préfectoral d’enquête publique B. INFORMATION DU PUBLIC B.1. Par voie de presse B.2. Par affichage dans les mairies B.3. Réunion publique d’information B.4. Par voie informatique B.5. Bulletins communaux C. HISTORIQUE DE L’EXPLOITATION DU CHARBON SUR LE PLATEAU MATHEYSIN C.1. Les concessions C.2. Les méthodes d’exploitation C.3. Les travaux miniers D. AUTRES EXPLOITATIONS MINIÈRES E. LE PROJET DE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS (PPRM) E.1. Prescription du PPRM E.2. Note de présentation et évaluation environnementale E.3. Association, concertation et consultation E.4. Réglementation relative à l’enquête publique E.5. Application du PPRM Rapport d’enquête publique : Plan de Prévention des Risques Miniers sur le Plateau Matheysin (38) – enquête n° E18000327/38 – Jean-Pierre Blachier. 2 E.6. Révision et modification du PPRM E.7. Rôle des services de l’État dans l’élaboration du PPRM E.8. Définitions F. MILIEU NATUREL F.1. Situation et cadre géographique F.2. Le milieu anthropique G. ALÉAS G.1. Études, méthodes et supports utilisés G.2. Description et qualification des aléas retenus G.3. -
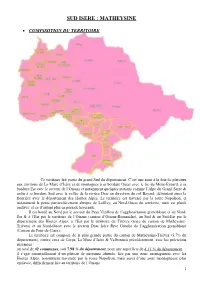
Sud Isère : MATHEYSINE Pdf 499 Ko
SUD ISERE : MATHEYSINE • COMPOSITION DU TERRITOIRE Ce territoire fait partie du grand Sud du département. C’est une zone à la fois de plateaux aux environs de La Mure d’Isère et de montagnes à sa bordure Ouest avec le lac du Mont-Eynard, à sa bordure Est avec le secteur de l’Oisans et notamment quelques stations comme l’Alpe du Grand Serre & enfin à sa bordure Sud avec la vallée de la rivière Drac en direction du col Bayard, délimitant ainsi la frontière avec le département des Hautes Alpes. Le territoire est traversé par la route Napoléon, et notamment la pente particulièrement abrupte de Laffrey, au Nord-Ouest du territoire, mais est plutôt enclavé, et ce d’autant plus en période hivernale. Il est bordé au Nord par le secteur du Pays Vizillois de l’agglomération grenobloise et au Nord- Est & à l’Est par le territoire de l’Oisans (canton d’Oisans-Romanche), au Sud & au Sud-Est par le département des Hautes Alpes, à l’Est par le territoire du Trièves (reste du canton de Matheysine- Trièves) et au Nord-Ouest avec le secteur Drac Isère Rive Gauche de l’agglomération grenobloise (Canton du Pont-de-Claix). Le territoire est composé de la plus grande partie du canton de Matheysine-Trièves (5,7% du département), contre ceux de Corps, La Mure d’Isère & Valbonnais précédemment, avec les précisions suivantes : un total de 42 communes, soit 7,98 % du département, pour une superficie de 8,11 % du département il s’agit essentiellement d’un plateau de moyenne altitude, liée par une zone montagneuse avec les Hautes Alpes, notamment traversée par la route Napoléon, mais aussi d’une zone montagneuse plus enclavée, difficilement liée au territoire de l’Oisans. -

Liste Des Communes Objets De La Demande De Reconnaissance En
Liste des communes objets de la demande de reconnaissance en calamité sécheresse 2018 secteur n°1 centre Isère : communes de : Allevard, Autrans-Méaudre en Vercors, Barraux, Bernin, Biviers, Bresson, Brié-et- Angonnes, Champ-sur-Drac, Champagnier, Chamrousse, Chapareillan, Château-Bernard, Châtelus, Chichilianne, Choranche, Claix, Corenc, Corrençon-en-Vercors, Coublevie, Crêts en Belledonne, Crolles, Domène, Échirolles, Engins, Entre-deux-Guiers, Eybens, Fontaine, Froges, Gières, Goncelin, Grenoble, Gresse-en-Vercors, Herbeys, Hurères, Jarrie, La Buissière, La Chapelle-du-Bard, La Combe-de-Lancey, La Ferrière, La Flachère, La Pierre, La Sure en Chartreuse, La Terrasse, La Tronche, Lans-en-Vercors, Laval, Le Champ-près-Froges, Le Cheylas, Le Gua, Le Moutaret, Le Pont-de-Claix, Le Sappey-en- Chartreuse, Le Touvet, Le Versoud, Les Adrets, Lumbin, Malleval-en-Vercors, Meylan, Miribel-Lanchâtre, Miribel-les-Échelles, Mont-Saint-Marn, Montaud, Montbonnot-Saint-Marn, Montchaboud, Murianee, Notre-Dame-de-Mésage, Pinsot, Poisat, Pont-en-Royans, Pontcharra, Presles, Proveysieux, Quaix-en-Chartreuse, Rencurel, Revel, Saint-Andéol, Saint-Aupre, Saint-Bernard, Saint-Christophe-sur- Guiers, Saint-Éenne-de-Crossey, Saint-Guillaume, Saint-Hilaire, Saint-Ismier, Saint-Jean-le-Vieux, Saint- Joseph-de-Rivière, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Marn-d'Hères, Saint-Marn-d'Uriage, Saint-Maximin Saint-Michel-les-Portes, Saint-Mury-Monteymond, Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Nicolas-de-Macherin, Saint-Nizier-du-Moucheroe, Saint-Pancrasse, Saint-Paul-de-Varces, Saint-Pierre-d'Entremont, -

La Matheysine Pharmacie : Médicaments Spécifiques), Personnels, Pansements, Fauteuil Manuel Si Nécessaire
Contenu du sac de voyage : ET Contenu du sac à la journée : Maxi 10 kg impératif Pour tous gants et bonnet, cape de pluie, Sac de sport coupe-vent, lunettes, chapeau, ou sac à dos crème solaire, stick pour lèvres. Gourde ou poche à eau 2 l. Couchage : duvet de montagne Pour les Passagers Joëlette confort jusqu’à -5° (environ 1.5 Kg), (2 sacoches latérales mises à tapis de sol, couverture de survie, disposition sur la joëlette) drap sac (pour nuits en refuge), Equipement adapté : casque type lampe frontale. cycliste (facultatif), bassin ou Vêtements : se référer à la urinal (en cas de besoin la nuit), rubrique « séjours » du site HCE. matériel de maintien sur la joëlette (coque, sangles La Matheysine Pharmacie : médicaments spécifiques), personnels, pansements, fauteuil manuel si nécessaire. Depuis Vizille, la fameuse côte de Laffrey rejoint le plateau de la protections ampoules… Pour les marcheurs Matheysine perché à 1000m d’altitude entre le Trièves et le Taillefer. Divers : petits jeux, carnet de Sac à dos 40 à 50 l pour Lacs bleus et alpages verdoyants, la Matheysine affiche des couleurs chants, instruments de musique… transporter vos affaires de contrastées et exerce une réelle attraction pour les randonneurs. Tente 2/3 places (facultatif). bivouac (duvet, tapis de sol…). Chaussures de rando indispensables. Gants de cycliste conseillés. Notre camp de base installé dans un cadre de verdure au hameau des Signaraux, nous permettra de découvrir les richesses de cette belle région située à l’est du Vercors. Les nombreuses possibilités de Matériel collectif fourni ce secteur permettent des parcours agréables en toutes 4 Joëlettes, 2 grandes tentes Marabout, matériel de cuisine circonstances, de l’initiation à la randonnée un peu plus technique. -

Revue De Géographie Alpine, 107-4 | 2019 the End of "White Gold" in the Mountains? 2
Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine 107-4 | 2019 Varia 2019 The end of "white gold" in the mountains? Evolutions of the dairy economy in the territories of Sud-Isère Sophie Madelrieux, Maud Hirczak, Agnès Bergeret and Françoise Alavoine- Mornas Electronic version URL: http://journals.openedition.org/rga/5779 DOI: 10.4000/rga.5779 ISSN: 1760-7426 Publisher Association pour la diffusion de la recherche alpine Electronic reference Sophie Madelrieux, Maud Hirczak, Agnès Bergeret and Françoise Alavoine-Mornas, « The end of "white gold" in the mountains? », Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine [Online], 107-4 | 2019, Online since 24 June 2019, connection on 04 April 2020. URL : http://journals.openedition.org/rga/ 5779 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rga.5779 This text was automatically generated on 4 April 2020. La Revue de Géographie Alpine est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International. The end of "white gold" in the mountains? 1 The end of "white gold" in the mountains? Evolutions of the dairy economy in the territories of Sud-Isère Sophie Madelrieux, Maud Hirczak, Agnès Bergeret and Françoise Alavoine- Mornas Introduction: what are the future of undifferentiated milk production in mountain areas? 1 Many studies converge on the observation of an uncertain future of milk production in certain mountain areas, following the end of milk quotas and widespread competition among producers (Dervillé et al., 2012). Relationships between milk production and territories are evolving with major restructuring (Roguet et al., 2015) and gaps are widening between production basins, particularly between plains and mountains (Ricard, 2014), except for areas benefiting from high added value as some Protected Designations of Origin (PDO). -

A Tourist's Guide
A Tourist’s guide to Grenoble In Grenoble, let innovation inspire your events! 6HWLQDEUHDWKWDNLQJQDWXUDO HQYLURQPHQWDWWKHKHDUWRI WKH)UHQFK$OSV*UHQREOHKDV LQQRYDWLRQZULWWHQDOORYHULW &RQYHQWLRQ%XUHDX The greater Grenoble area is home to many universities and competitive international research centers. It also stands out for its strong policies in favour of sustainable development. This means that, like the city’s VFLHQWLÀFUHVHDUFKDGYDQFHVLWV companies also shine on the world scene. Enterprises specialized in outdoor activities and especially mountain activities drive Grenoble’s dynamic economy. Grenoble boasts a wealth of exceptional cultural and heritage sites, with two national stages, more than a dozen museums, and numerous festivals. On top of all this, the city offers three convention centers that can welcome up to 3000 people, 200 meeting facilities, more than 4500 starred hotel rooms, plus several charming and unique venues. :LWKRXWDGRXEW*UHQREOHLVD 7RXULVW2IÀFH&RQYHQWLRQ%XUHDX WRSSLFNIRUSURIHVVLRQDOHYHQW 14 rue de la République - 38000 Grenoble - France RUJDQL]HUV Tel. +33 (0)4 76 03 37 53 [email protected] Table of contents Welcome to Grenoble ..............................................................................................................5 Highlights ................................................................................................................................................6 Dauphinois delights ................................................................................................................10 -

À Vélo : Prélenfrey Le Drac La Liaison Entre Grenoble Et Mens
parfaite, n’hésitez pas à nous contacter pour toute remarque. Proverbe Triévois : Ravioles dans le bidon, en tête du peloton ! peloton du tête en bidon, le dans Ravioles : Triévois Proverbe remarque. toute pour contacter nous à pas n’hésitez parfaite, Les informations fournies par les prestataires n’engagent en aucun cas l’O ce de Tourisme. Malgré le soin apporté à cette édition, elle ne saurait être être saurait ne elle édition, cette à apporté soin le Malgré Tourisme. de ce l’O cas aucun en n’engagent prestataires les par fournies informations Les contractuel. non Document E. Breteau, L. Sabatier, O. Zanardi, N. Peters, P. Abeille, Inspiration Vercors, Focus Outdoor Focus Vercors, Inspiration Abeille, P. Peters, N. Zanardi, O. Sabatier, L. Breteau, E. : photo Crédits Imprimerie Du Pont de Claix - www.imprimeriedupontdeclaix.fr. www.imprimeriedupontdeclaix.fr. - Claix de Pont Du Imprimerie : Impression www.eskarpe.fr - Eskarpé : Graphisme Trièves du Tourisme de ce O Réalisation : Réalisation VIF www.francevelotourisme.com [email protected] [email protected] accueil vélo SAINTPIERRE 04 82 62 63 50 63 62 82 04 DEMÉSAGE du Trièves du O ce de Tourisme Tourisme de ce O Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit aux cyclistes un accueil et des services Valence Grenoble de qualité le long des itinéraires cyclables. N SAINTGEORGES bienvenue en trièves Accueil Vélo, concerne un établissement : D63C DECOMMIERS D1075 Lyon Que vous souhaitiez vous remettre • Situé à proximité d’un itinéraire vélo Sommet du Ranc LE GUA • -
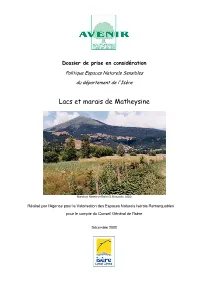
Lacs Et Marais De Matheysine
Dossier de prise en considération Politique Espaces Naturels Sensibles du département de l'Isère Lacs et marais de Matheysine Marais de Nantes-en-Ratier (S. Beaussier, 2000) Réalisé par l'Agence pour la Valorisation des Espaces Naturels Isérois Remarquables pour le compte du Conseil Général de l'Isère Décembre 2000 TABLE DES MATIÈRES Préambule ________________________________________________________________________________ 5 1ère Partie – Description du milieu naturel _______________________________________________________ 6 1. Généralités__________________________________________________________________________________ 6 1.1. Présentation du site_____________________________________________________________________ 6 1.1.1. Description sommaire __________________________________________________________________ 6 1.1.1.1. District naturel et situation____________________________________________________________ 6 Figure 1 : Carte du secteur 1 des lacs et marais de Matheysine ___________________________________________ 7 Figure 2 : Carte du secteur 2 des lacs et marais de Matheysine ___________________________________________ 8 1.1.1.2. Géologie et hydrologie_______________________________________________________________ 9 1.1.2. Contexte réglementaire et inventaires______________________________________________________ 9 1.1.3. Divers _____________________________________________________________________________ 10 1.1.3.1. Contexte socio-économique __________________________________________________________ 10 1.1.3.2. Historique________________________________________________________________________ -

Département De L'isère
Département de l'Isère Délimitation des zones de sismicité Prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations de la classe dite "à risque normal" Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 Vertrieu Parmilieu La Balme Porcieu les-Grottes Amblagnieu Montalieu Charette Hières Vercieu sur-Amby Saint-Baudille Bouvesse Anthon Quirieu Villette-d'Anthon de-la-Tour Chavanoz Vernas Saint-Romain Annoisin Chatelans Pont-de de-Jalionas O Janneyrias ptevoz Creys Chéruy Leyrieu Mépieu Tignieu Siccieu Charvieux S Jameyzieu Crémieu aint-Julien Courtenay Chavagneux et-Carisieu Vill Arandon emoirieu Dizimieu Saint-Victor Soleymieu de-Morestel Chozeau Chamagnieu Moras Passins Brangues Trept M Satolas Veyssilieu Saint-Hilaire orestel et-Bonce Le Bouchage Panossas de Brens Salagnon Sermerieu Vezeronc Vénérieu Grenay -Curtin Les Avenières Frontonas Saint Saint-Marcel Saint-Sorlin Chef Vignieu Veyrins Saint-Quentin Bel-Accueil de-Morestel La Verpillière Thuellin Fallavier Vasselin Heyrieux Vaulx Saint-Savin L'Isle-d'Abeau Dolomieu et-Milieu Corbelin Montcarra Saint-Jean Gra Villefontaine Bourgoin-Jallieu Faverges nieu Valencin de-Soudain de-la-Tour Bonnefamille Sa Ruy Aoste Villette int-Alban Rochetoirin La Chapelle Saint-Just de-Roche de-Vienne Luzinay Diémoz de-la-Tour La Batie Chaleyssin Chimilin Chasse-sur Roche Domarin Nivolas La Tour Saint-Clair Montgascon Cessieu Rhone Chuzelles Four Maubec Vermelle du-Pin de-la-Tour Romagnieu Oytier Saint-Georges Sérezin-de Fitilieu C Meyrié Saint-André Saint-Oblas d'Espéranche hezeneuve la-Tour -

Département De L'isère
Département de l'Isère Délimitation des zones de sismicité Prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations de la classe dite "à risque normal" Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 Vertrieu Parmilieu La Balme Porcieu les-Grottes Amblagnieu Montalieu Charette Hières Vercieu sur-Amby Saint-Baudille Bouvesse Anthon Quirieu Villette-d'Anthon de-la-Tour Chavanoz Vernas Saint-Romain Annoisin Chatelans Pont-de de-Jalionas O Janneyrias ptevoz Creys Chéruy Leyrieu Mépieu Tignieu Siccieu Charvieux S Jameyzieu Crémieu aint-Julien Courtenay Chavagneux et-Carisieu Vill Arandon emoirieu Dizimieu Saint-Victor Soleymieu de-Morestel Chozeau Chamagnieu Moras Passins Brangues Trept M Satolas Veyssilieu Saint-Hilaire orestel et-Bonce Le Bouchage Panossas de Brens Salagnon Sermerieu Vezeronc Vénérieu Grenay -Curtin Les Avenières Frontonas Saint Saint-Marcel Saint-Sorlin Chef Vignieu Veyrins Saint-Quentin Bel-Accueil de-Morestel La Verpillière Thuellin Fallavier Vasselin Heyrieux Vaulx Saint-Savin L'Isle-d'Abeau Dolomieu et-Milieu Corbelin Montcarra Saint-Jean Gra Villefontaine Bourgoin-Jallieu Faverges nieu Valencin de-Soudain de-la-Tour Bonnefamille Sa Ruy Aoste Villette int-Alban Rochetoirin La Chapelle Saint-Just de-Roche de-Vienne Luzinay Diémoz de-la-Tour La Batie Chaleyssin Chimilin Chasse-sur Roche Domarin Nivolas La Tour Saint-Clair Montgascon Cessieu Rhone Chuzelles Four Maubec Vermelle du-Pin de-la-Tour Romagnieu Oytier Saint-Georges Sérezin-de Fitilieu C Meyrié Saint-André Saint-Oblas d'Espéranche hezeneuve la-Tour -

5-GAIA Inscriptions Par Modules V141013
N° sessio n 10115 - JOUER ET INNOVER A L'ECOLE MATTRAS AURELIE MATERNELLE 0381923J - ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 38650 MONESTIER DE CLERMONT 01 ADAM CHRISTEL 0380343S - ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 38930 CLELLES EN TRIEVES 01 ASTRUC NINA 0382657G - ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LES CLOS 38350 ST HONORE 01 BERLIOUX GWENAEL 0380216D - ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LA FARE 38520 LE BOURG D OISANS 01 BLANCHET FLORENCE 0380708N - ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 38710 MENS 01 CHARLES EMILIE 0380736U - ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 38450 MIRIBEL LANCHATRE 01 COUVE ANNIE 0382020P - ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LA FESTINIERE 38119 PIERRE CHATEL 01 FAURE AUDREY 0380343S - ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 38930 CLELLES EN TRIEVES 01 FOUGEROUSSE CLAIRE 0380765A - ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LE VILLAGE 38860 MONT DE LANS 01 GACHET ISABELLE 0382657G - ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LES CLOS 38350 ST HONORE 01 GARCIN LIONEL 0381531H - ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LES ARDOISIERES 38114 ALLEMOND 01 GERBERT SYLVIE 0380372Y - ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 38970 CORPS 01 GODEFROY ERIC 0382657G - ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LES CLOS 38350 ST HONORE 01 GOUJON NATHALIE 0381531H - ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LES ARDOISIERES 38114 ALLEMOND 01 HARDY ADELINE 0381531H - ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LES ARDOISIERES 38114 ALLEMOND 01 LOZINGUEZ NATHALIE 0381457C - ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 38119 VILLARD ST CHRISTOPHE 01 NOTTAT STEPHANIE 0380792E - ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LES BASTIONS 38350 LA MURE D ISERE 01 PACHOUD VERONIQUE 0380768D - ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES BLAIS 38770 MONTEYNARD 01 PAIRONE CARINE -

INFORMATION PREFECTORALE Épisode De Pollution De L'air De Type
INFORMATION PREFECTORALE Épisode de pollution de l'air de type mixte (PM !" sur les #assins d$air Lyonnais nord%Isère' grenoblois et )one alpine Isère A*ti+ation de la proc,dure pr,-e*torale d$information%re*ommandation Grenoble, le lundi 22 février 2021 Compte tenu des prévisions émises par Atmo Auvergne Rhône-Alpes, la pro*,dure pr,-e*torale d$in-ormation-recommandation est activée compter de ce !our pour les bassins d’air L$onnais nord %s&re, grenoblois et zone alpine %s&re( Afin de protéger la population des effets du pic de pollution et de réduire les sources d’émissions polluantes, le préfet de l"%s&re formule les recommandations suivantes ) Re*ommandations aux personnes sensi#les et +ulnéra#les . • *loigne' vous des grands a+es routiers aux périodes de pointes , • *loigne' vos enfants de la pollution automobile , • #imite' les sorties durant l"apr&s-midi (13h-20h/ • #imite' les activités ph$siques et sportives intenses -dont les compétitions/ en plein air, celles à l’intérieur peuvent être maintenues , • 2n cas de s$mptômes ou d’inquiétudes, prene' conseil aupr&s de votre pharmacien ou de votre médecin( Re*ommandations aux usa(ers de la route . • 3tiliser les modes de transport permettant de limiter le plus possible les émissions de polluants ) vélo, transports en commun, covoiturage, etc. 4our les entreprises, adapter les horaires de travail, faciliter le télétravail , • 5"abstenir de circuler avec un véhicule de norme inférieure ou égale 23R6 . et7ou dont la date d"immatriculation est antérieure au 1er !anvier 2006 -hormis les véhicules d’intér1t général visés l"article R 311-1 du code de la route/ , • *viter la conduite agressive , entretenir réguli&rement son véhicule , • Abaisser sa vitesse de 20 9m7h sur les voies pour lesquelles la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à :0 km7h( • Abaisser sa vitesse ;0 9m7h sur les voies pour lesquelles la vitesse ma+imale autorisée est égale 80 km7h( Re*ommandations à l$ensem#le de la population .