Orthotypo-Lacroux
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Savage Childhood; a Study of Kafir Children
CORNELL UNIVERSITY LIBRARY BOUGHT WITH THE INCOME OF THE SAGE ENDOWMENT FUND GIVEN IN 1S91 BY HENRY WILLIAMS SAGE UniVersi GN482 .M™" ' v Ubrar* ""nUSSSSSLl.adt.o! Kafir child 3 1924 olin 029 867 532 The original of this book is in the Cornell University Library. There are no known copyright restrictions in the United States on the use of the text. http://www.archive.org/details/cu31924029867532 SAVAGE CHILDHOOD — *B7 THE SAME AUTHOR THE ESSENTIAL KAFIR Demy 8vo, bound in cloth gilt top Price 1 8s. net Containing 452 pp., including Biblio- graphy and Index also a Map and 100 , full-page Illustrations from photographs by the Author "We know of no book in which the essential humanity of the tribes is so vividly presented. Mr. Kidd*s power of observation, and his insight into character are unusual . He takes his readers with him into the innermost recesses of native thought, whether of things material or things spiritual, of hope or fear, joy or grief. We get, indeed, an insight into the Kafir view of the mysteries of life, of his relation to the universe and his fellows ... as useful as it is inter- esting." The Standard, A. & C. BLACK Soho Square, London, W. SAVAGE CHILDHOOD A STUDY OF KAFIR CHILDREN BY DUDLEY KIDD AUTHOR OF "THE ESSENTIAL KAFIR," ETC. WITH THIRTY-TWO FULL-PAGE ILLUSTRATIONS FROM PHOTOGRAPHS BY THE AUTHOR LONDON ADAM AND CHARLES BLACK iqo6 ;; PREFACE The beginnings of things are always interesting and instructive. The mind cannot rest until it reaches the beginning of a process. -

Les Pommes De Chez Nous / Our Apples
A description of over 250 apple cultivars grown in Eastern and Central Canada including 400 photographs of the fruits, flowers and leaves Description de plus de 250 variétés de pommiers cultivés dans le centre et l’est du Canada, avec 400 photos des fruits, fleurs et feuilles Canadian Cataloguing in Publication Data Khanizadeh, Shahrokh, 1953- Our apples = Les pommiers de chez nous Text in English and French «A description of over 250 apple cultivars grown in Eastern and Central Canada including 400 colored photographs of the fruits, flowers and leaves» ISBN 0-660-60543-0 Cat no. A22-170/1998 1. Apples — Varieties — Canada, Eastern. 2. Apples — Identification — Canada, Eastern I. Cousineau, Johanne, 1959- II. Canada, Agriculture & Agri-Food Canada, Research Station (St-Jean-sur-Richelieu) (Quebec)) III. Title. IV. Title: Les pommiers de chez nous. SB363.2C3K42 1998 634.117’09713 C98-980191-8E Données de catalogage avant publication (Canada) Khanizadeh, Shahrokh, 1953- Our apples = Les pommiers de chez nous Texte en anglais et en français «Description de plus de 250 variétés de pommiers cultivés dans la région Centrale et de l’Est du Canada incluant 400 photos des fruits, fleurs et feuilles» ISBN 0-660-60543-0 No de cat.. A22-170/1998 1. Pommiers — Variétés — Canada, (Est). 2. Pommiers — Variétés — Canada, (Est). I. Cousineau, Johanne, 1959- II. Canada, Agriculture & Agro-alimentaire Canada, Station de recherches (St-Jean-sur-Richelieu) (Quebec)) III. Titre. IV. Titre: Les pommiers de chez nous. SB363.2C3K42 1998 634.117’09713 C98-980191-8E 3 Our Apples Authors: Shahrokh Khanizadeh and Johanne Cousineau Reviewers: Raymond Granger and Pierre Philion Technical Assistants: Yvon Groleau and Bertrand Thériault Publisher and Editor, photos, illustrations and design: Shahrokh Khanizadeh The images in this book, with the exception of the cut apples and leaves, were taken by Shahrokh Khanizadeh and enhanced using several graphic software packages. -

The Oberholtzer Book
THE OBERHOLTZER BOOK A Foundation Book of Oberholtzer Immigrants and Unestablished Litres DATE 1! IRORLMED JAN 10 2QQ1 7 ' • id c 1 ROL # CALL # 42 8 H42 5IM ? Barbara B. Ford Yt-te users Compiler and Editor yr JAU FAMILY HISTORY LIBRARY 35 NORTH WEST TEMPLE SALT LAKE CITY, UTAH 84150 Published by The Overholser Family Association Compiled and typeset by Barbara B. Ford. Copyright 1995 by Overholser Family Association 313 Henry Lane Wallingford, PA 19086 Library of Congress Catalog Number 94-74043 Printed by Olde Springfield Shoppe 10 West Main Street, P. O. Box 171 Elverson, PA 19520-0171 Dedicated to J. SPENCER OVERHOLSER President and Genealogist of the Overholser Family Association 1956-1986. Without his dedication and guidance, this book would never have been published. ^ til Wappe n OBERHOLZER von Wald/ZH IV FAMILY COAT OF ARMS OBERHOLZER OF WALD, SWITZERLAND In 1958 the Overholser Family Association adopted the Family Coat of Arms of Wald, Switzerland. It was recommended by Dr Hans Klaui, Genealogical Investigation Office, Oberwinterthur, Switzerland through correspondence with Spencer Overholser and Dr Winfred Overholser, then Supt. of St Elizabeth's Hospital in Washington DC. Pertinent portions of the letter of 2/29/1956 are quoted as follows: "In the historical-biographical dictionary of Switzerland, the coat-of-arms Oberholzer is described as follows: 'Obliquely divided, above of red with a half moon and two stars, below of silver with two green oaks.' This emblazoning is not to be described as very happy, since it leaves in respect of the anangement of the half moon and the stars, as well as of both oaks, considerable freedom to the designer. -
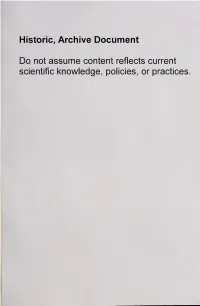
LIST of FRUIT VARIETIES, TOTAL 1,936 in Private Experimental Orchard O Benj
Historic, Archive Document Do not assume content reflects current scientific knowledge, policies, or practices. LIST OF FRUIT VARIETIES, TOTAL 1,936 In Private Experimental Orchard o Benj. Buckman, Farmingdale, Illinois. 1913. APPLES Balls Choice Blood Red Abe Lincoln Baltimore Blood (Ver.) Abernathy Baltzby Bloomfield Abram Banks Gravenstein Blooming Orange Acme Banner Blue ^Mountain Adams Barcelona Pearm lin Blue Pearmain Aikin (crab) Barchard Blushed Calville Ailes Barnes Choice Bogdanoff Akero Barnock Boiken Akin Barry Bombshell Alleghany Barthol Bonegardnt" Alaska (crab) Barton Favorite Bonum Alexander Bartv Sweet Boren Winter Alexander Ice Cream Bartz Borovinka Alfriston B. 2 Borsdorfer Allanbank Bassett Bostick Queen Allis Batingme Bottle Greening All Summer Battulen Boucken Alamance Battyani Bowers Nonpareil Almond Baxter Bowman Excelsior Almota Baxter Pearmain Boyd Alstott Beach Blush Bradford American Beach Garden Brakefield American Summer Bear Brandywine Amblush Cra Beauty of Bath " Breech American Pippin Kent Breitling Aucuba Leaved Reinette " " Nordhaussan Berthecourt Brewington Pip. Aniere de Bedford Briar (crab) Anisim Beechwood Sweet Brierly ^^'ood Annas Gregoire Belbod Roozka Brightwater Annie Elizabeth Bella British Columbia Annette of Ya. Belle de Boskoop Broadleaf Hereford A pi Xoir Belle Pontoise Broadnax Arabian Bellflower Pip. Broadwell Arabka Bellis (Hun.) Broome Archibald Belmont Brownlee Pais. Arctic Ben Bolt Bryant Arkansaw Ben Davis Bryant Favorite (crab) Arkansaw Beauty Benham Buckingham .Vrmorel Ben Hur Bullett Arnold Beauty Benninger Bullock Pip. Aromatic Russet Benoni Burlington Arthur Bentley Sweet Burns Seed. Ashmead Kernel Benton Co. Beauty Bush Ashton Berkott Butter S^eet of Pa. Astrachan Spaneholm Berlin Calville Byers Atkins Seed Berry Red Atropurpurea (^crab) Bertha Cache August (crab) Bess Pool Cadwallader Aunt Ginnie Bethel Cagle Seed. -

Varieties of Apples in Ohio, II
BULLETIN 411 OCTOBER, 1927 . Varieties Of Apples In Ohio, II C. W. Ellenwood OHIO AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION Wooster, Ohio ... Looking north from the "Hort" barn Fruit storage building, left; garden and variety cherry orchard, center; variety apple orchards, right Varieties Of Apples In Ohio, II C. W. Ellenwood This bulletin is supplementary to Bulletin 290, published in 1915. It is the purpose of this series to set forth the behavior of the several varieties under trial in the Experiment Station orchards at Wooster. The earlier plantings in these orchards, beginning in 1893, were largely for variety trials. Thus far approximately 500 named varieties of apples have been planted. Those included in this bulletin have not been previously described by this Station. The descriptions in every case have been made from specimens grown at Wooster. Many of these varieties have little or no value in Ohio. None of them is a leading com mercial sort. Some are rarely cataloged, others are not cataloged at all. Many of the varieties have already been removed and others are being eliminated each year. This report is intended to serve as a permanent record of the behavior of these varieties at Wooster. It is also hoped that the data may contribute to the knowledge of these varieties and be of some value to growers in the selection and elimination of varieties. Records are kept of the dates of the first and full bloom of each tree, the date of ripening, and the quantity of fruit produced annually. A detailed description of tree and fruit and ink drawing of every variety fruited are kept in the files of the Horticultural Department. -

I I F YOU HAVE a U N TS to CO L L ECT RCCOUNIS Cofficied Ead Office, Corner James and Mlrritâ Bta'eeta, CALL at the OFFICE for TESTII[Oiiialâ
ELFORD Gi. PAYNE, IN3ûRANCE AGENT WALTER AMBROSE, ROYsL HOTEL BLOCK OIHrr •at JAMES ST. S. ORtrr Trlrphonr, NKO. Ilousr Telephone. 19« ONTARIO MUTUAL Lib A.saroaee Co. Norwich Union Firo Insarwoo Co. 214 t.'IT\ ul• II.A\tti r()% t'11'l' 0I• II \^tII.Tu^ 215 Mackie, Alex, book binder, 41 Leemmg Magill, Lieut-Col Charles, 33 Jack- Major, Geo, coachman, r 126 Young lfalloney, Mrs Mary (wid John), 330 )tlackie, Jas, carpenter, :08 Hughson n son w Major, Richd, gardener, zo2 Main e Mary Mackie, Robt, engineer, 28 Napier Magill, Chas (Magill & Sons), It 321 Makins, Edwd T, machinist, 24 Morden Malloncy, John, laborer, bd" 330 Mary Mackie, ' l'hos, (' F., bds Dominion hotel Main w Malamphy, Mrs Susan (wid Thos), 136 Mallory, K'm, agent, i r t r121 King e Mackinson, (: has, machinist, Gibson ave n Magill, Mrs Esther (wid George), 0a Hess n Malloy, Nits Amelia ( wid 'l'hos), 246 \iac- Mrcklem, Miss 1larctaret. 232 Locke s Hunter c Malcolm, Mn Annie (wtd Jas A), 259 nab n Dlacklin, Maurice, \laeklin Magill, Fredk, laborer, 410 Main w York Malloy & Malcolm, carriage builders, t7 Macoomb, E T, mgr %V Halle & Co, \lagill, Geo, moulder, 71 West ave n Malcolm, Jas, to7 Macnab s Park n h 2o6 Iat kson w Magill, Geo, hds Brunswick hotel Malcolm & Souter ("'m Malcolm, A Malloy, John, glassblower, 528 James n Madden, Edwd plumber, 367 Main w Magill, Samuel (Magill & Sons), h 331 M Souter), furniture manfrs and carpet \talloy, John ( Malloy & Malcolm), h 93 M.tdden, Alrs E, 367 Main w Main w merchants, 9 t-; King w(seeadvt, page 3) Bold Madden, ' 1'h.,s E. -

“Daffodils,” Kathleen Mcclelland, the Historical Gardener
Nymphs and Narcissi buying and selling that afflicted tu- Narkissos was a handsome but lips and hyacinths in the 17th and vain young man in Greek mythol- 18th centuries. (The hyacinth also ogy. After the beautiful ny mph Echo derives its name from myth. Hyak- died of unrequited desire for him, inthos was transformed into the fra- the gods caused Narkissos to fall in grant flower after being killed; dif- love with his own reflection in the ferent versions attribute his death to water of a fountain. This was not a either Apollo the sun god or Zephy- very satisfying relationship for ros the wind god.) There are 24,000 Narkissos, who pined away and cultivars listed in the Royal Horti- turned into a narcissus flower. cultural Society's international Daf- Which came first, the flower or the fodil Checklist, but of these perhaps myth? We may never know. All we 50 originated in the 1600s and a can be sure of is that the legend further 350 pre-date 1860, and not gives us our word "narcissism" for all of these were well known in their excessive self-admiration, a warn- own day. All that changed between ing to treat the feelings of nymphs 1860 and 1900, Scott says, when with courtesy, and the immortaliza- British breeders introduced about tion of one of the oldest and most 1,000 new narcissus varieties. From rewarding flowers in the historical the turn of the century to 1930, an- garden. other 6,000 appeared on the market, Narcissus is a plant genus na- but few of them are still commer- tive to the Mediterranean that in- , cially available. -

Manual of the North Indiana Conference of the Methodist Episcopal Church, 1844-1889
MHNUHL OF THE NORTH INDIANA CONFERENCE OF THE METHODIST EPISCOPAL CHURCH. lSZ^zi 1589 COMPILED BY Rev. L. W. MONSON, Copyright 1890 by L. W Monson. WABASH: Printed by The Plain Dealer Company 1890. PREFACE THE compiler sends forth this Manual with the hope that it will be of assistance to his brethren in the ministry and laity. The information contained in it is what many of the older members of the Conference have been called upon to give; it is now brought together in one volume, open to all. None but those who have engaged in similar work, can understand the labor involved. Hours have been spent in following up the record of a single name, and then failing to gain any satisfactory knowledge of it. In some instances names were dropped from the Conference roll and no record made of it, especially in the first few years of its organization. In the preparation of this Manual, the written and printed official records have been searched, newspapers examined, correspondence carried on with persons in various parts of the country, and interviews had with those who were in a position to know the facts desired. Yet, after all had been done, in some instances the information gained was quite meager and unsatisfactory. And yet, we be- lieve that the Manual is, in the main, accurate, and contains all the informa- tion available. We are indebted to Rev. G. T. Reynolds, of the Pittsburg # Conference, for the plan, and the use of the same; and to Rev. C. G. Hudson, Secretary of our Conference, for favors shown; also, to Rev. -

Methodist Episcopal Church
7VT75 N U K L. OF THE NORTH INDIANA CONFERENCE OF THE METHODIST EPISCOPAL CHURCH. ISZiZi 15SQ COMPILED BY Re^. L. W. MONSON. Copyright 1890 by L. W Monson. WABASH: PRINTKI) BY THE PLAIN DEALER COMPANY 1890. PREFACE HE compiler sends forth this Manual with the hope that it will be of assistance to his brethren in the ministry and laity. The information T contained in it is what many of the older members of the Conference have been called upon to give; it is now brought together in one volume, open to all. None but those who have engaged in similar work, can understand the labor involved. Hours have been spent in following up the record of a single name, and then failing to gain any satisfactory knowledge of it. In some instances names were dropped from the Conference roll and no record made of it, especiallj' in the first few years of its organization. In the preparation of this Manual, the written and printed official records have been searched, newspapers examined, correspondence carried on with persons in various parts of the country-, and interviews had with those who were in a position to know the facts desired. Yet, after all had been done, in some instances the information gained was quite meager and unsatisfactory. And yet, we be lieve that the Manual is, in the main, accurate, and contains all the informa tion available.^ We are indebted to Rev. G. T. Reynolds, of the Pittsburg <!^onference, for the plan, and the use of the same; and to Rev. -

Thomas Brush Brown 1804-1894 The
PREFACE When this autobiography was written it was the intention of the author to have given a complete history of his Life and Times, with a special reference to the early settle- ment of Nissouri. However, after it was written so far the infirmities of old age came on, which prevented the accomplishment of his object. This accounts for its incomplete and fragmentary character. For this reason many interesting events and the names of indi- viduals who were prominent in the early settlement of the township are unnoticed; but as it is it will be a valuable contribution toward preserving in a permanent form its early his- tory. It will be a pleasing reminder to many who were personally acquainted with the au- thor during his lifetime. In order to make the work as complete and interesting as possible a few additional facts are given. HIS WORK AS A LOCAL PREACHER Being blessed with strong physical constitution and great force of character, what he determined to do he did with all his might. His leading motive was not to amass prop- erty, except to provide for the reasonable wants of himself and family, nor to attain to the petty offices of the township, but to serve the church of his choice as a local preacher. When he commenced as a worker in the church the few scattered settlers of Nissouri and surrounding townships were but scantily supplied with opportunities they had were mostly on week-days, leaving the Sabbath unprovided for. Under these circumstances he commenced his work as a local preacher, preaching regularly once or more nearly every Sabbath. -

St George, Utah March 23-24, 2018 Kelli Calvert Master Class Instructor Kelli Has Been Dancing Since She Was Three Years Old and Started Dancing Professionally at 15
St George, Utah March 23-24, 2018 Kelli Calvert Master Class Instructor Kelli has been dancing since she was three years old and started dancing professionally at 15. Her whole life has revolved around studios, being on sets, and learning skills that have helped her become a successful working dancer for the last 13 years. She has been fortunate to have variety through her career stretching beyond the stage and into tv and film as well. Movies, commercials, and even music videos like the High School Musical movies, MGM and Columbus Zoo commercials, and Vanessa Hudgens’ Sneaker Night. She has danced with Odyssey Dance Theater, for Cirque du Soleil, and was the dance captain for Donny and Marie in Las Vegas. Most recently, she has just accepted a contract with the new show, Marilyn the Musical, which will be opening June 1, at the Paris hotel. She loves helping students find their purpose and passion on and off the stage and is so excited to be here with you! Master Class: Saturday March 24th Master Class Schedule Teacher - Kelli Calvert Class A - 9:30 AM - 10:15 AM - All Junior Dancers Class B - 10:30 AM - 11:45 AM - Teen & Senior Novice & Competitive Dancers Class C - 12:15 PM - 1:15 PM - All Petite & Mini Dancers Class D - 2:30 PM - 4:00 PM - Teen and Senior Elite and Premier Dancers Friday March 23 - Competition Schedule All Solos 12:45 PM Doors Open 1:00 PM Competition Begins 4:02 PM Awards for Petite and Mini Soloists 7:36 PM Awards for Junior Soloists 10:20 PM Awards for Teen and Senior Soloists Saturday March 24 - Competition Schedule -

Prince William County Virginia
Prince William County Virginia The 18 60 Census: Annotated Compiled By David Anderson Turner 1 PRINCE WILLIAM COUNTY VIRGINIA The 1860 Census: Annotated Copyright 1993 by David Anderson Turner Printed in the United States of America PRINCE WILLIAM COUNTY, VIRGINIA The 1860 Census: Annotated By David Anderson Turner 746/722 Able, Albert 28 Dumfries Boatman VA Susan 28 VA Laura V 03 VA Anna 02 VA William 4/12 VA 591/569 Abel, Alexander 35 Dumfries Farm Lab VA {[o A, 49th VA Inf.] Elizabeth 20 VA {d 27 Nov 1889] Catherine 04 VA {M 21 May 1871, Wm J Wiggington s/o Peter & Nancy] Mollie A 03 VA Martha 02 VA Sarah 01 VA 2 605/583 Abel, Allen 53 Dumfries Farmer VA Elizabeth 52 VA Robert A 26 Boatman VA {Co F, 49 VA Inf; m N E Wright d/o Wm & Marg.] Guinetta V 21 VA Quinten 20 Farm Lab VA Mary E 19 VA {m William H Knight s/o Wm & Louisa Fush 17 Farm Lab VA Signora 12 VA Hensey, Margaret 30 VA Isobella 04 VA {m 22 Apr 1888 Charles Dunn s/o Alex & Mary] James R 02 VA {m 05 May 1886 C L Lunsford d/o Wm & Mary] Elonza 01 VA 689/664 Able, Benjamin 39 Dumfries Miller VA Julia 27 VA 614/590 Abel, Clarisy 67 Dumfries VA Rachel 58 VA Grandison 32 Boatman VA {Co B, 49th VA Inf; POW Ft Del] Thomas L 28 Farm Lab VA 490/469 Able, Elijah 37 Landsdowne Farmer VA Sarah J 25 VA {d/o Wm & Susan Jewel; m 20 Dec 1856] William H 02 VA {m 11 Jul 1878 Fau Ann E Luech d/o Ellen]` Sarah 6/12 VA 484/463 Able, George W 44 Landsdowne Shoemaker VA Jane 42 VA William P 12 VA {m Frances Holmes d/o James & Elizabeth 505/483 Abel, James 71 Landsdowne Farmer VA Margaret 70 VA George 21 Farm Lab VA 612/588 Abel, John 60 Dumfries Farm Lab VA Catherine 60 MD {d 12 Oct 1870, age 70] Martha 39 VA Mahala C 29 VA John H 28 Farm Lab VA {Co G, 49th VA Inf] 753/729 Able, Julia A 60 Dumfries VA {w/o Levi Able] George H 27 VA {Co G, 49th VA Inf.