La Partie De Thé Des Patriotes
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

PERUTA; MICHELLE No
FOR PUBLICATION UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE NINTH CIRCUIT EDWARD PERUTA; MICHELLE No. 10-56971 LAXSON; JAMES DODD; LESLIE BUNCHER, DR.; MARK CLEARY; D.C. No. CALIFORNIA RIFLE AND PISTOL 3:09-cv-02371- ASSOCIATION FOUNDATION, IEG-BGS Plaintiffs-Appellants, v. COUNTY OF SAN DIEGO; WILLIAM D. GORE, individually and in his capacity as Sheriff, Defendants-Appellees, STATE OF CALIFORNIA, Intervenor. Appeal from the United States District Court for the Southern District of California Irma E. Gonzalez, Senior District Judge, Presiding 2 PERUTA V. CTY. OF SAN DIEGO ADAM RICHARDS; SECOND No. 11-16255 AMENDMENT FOUNDATION; CALGUNS FOUNDATION, INC.; BRETT D.C. No. STEWART, 2:09-cv-01235- Plaintiffs-Appellants, MCE-DAD v. OPINION ED PRIETO; COUNTY OF YOLO, Defendants-Appellees. Appeal from the United States District Court for the Eastern District of California Morrison C. England, Chief District Judge, Presiding Argued and Submitted En Banc June 16, 2015 San Francisco, California Filed June 9, 2016 Before: Sidney R. Thomas, Chief Judge and Harry Pregerson, Barry G. Silverman, Susan P. Graber, M. Margaret McKeown, William A. Fletcher, Richard A. Paez, Consuelo M. Callahan, Carlos T. Bea, N. Randy Smith and John B. Owens, Circuit Judges. Opinion by Judge W. Fletcher; Concurrence by Judge Graber; Dissent by Judge Callahan; Dissent by Judge Silverman; Dissent by Judge N.R. Smith PERUTA V. CTY. OF SAN DIEGO 3 SUMMARY* Civil Rights The en banc court affirmed the district courts’ judgments and held that there is no Second Amendment right for members of the general public to carry concealed firearms in public. -

26Th Annual Gun Rights Policy Conference
DRAFT AGENDA (9-17-2014) 29th Annual Gun Rights Policy Conference September 26-28, 2014 Hyatt Regency Chicago O’Hare Airport FRIDAY, September 26, 2014—International Ballroom 7:00 p.m. Registration Table Opens 7:00-9:00 p.m. Reception with Cash Bar Co-hosted by Citizens Committee for the Right to Keep and Bear Arms & National Shooting Sports Foundation (NSSF) SATURDAY, September 27, 2014—Rosemont Ballroom 7:30 a.m. Registration Table Opens Beverages hosted by Women & Guns Magazine and Jews for the Preservation of Firearms Ownership 8:00 a.m. CALL TO ORDER Moderator—Julianne Versnel, publisher, Journal on Firearms & Public Policy, director of operations, SAF Star Spangled Banner – Colleen Lawson, plaintiff, McDonald v. Chicago Trooping of the Colors – American Legion Post 206 – Arlington Heights, Illinois Pledge of Allegiance—Rhonda Ezell, plaintiff, Ezell v. Chicago Invocation—TBD 8:15 a.m. State of the Gun Rights Battle Welcoming Remarks The Road Traveled—Joseph P. Tartaro, editor of TheGunMag.com, president, Second Amendment Foundation (SAF) The Road Ahead—Alan M. Gottlieb, chairman, Citizens Committee for the Right to Keep and Bear Arms (CCRKBA) and founder, SAF 8:30 a.m. Federal Affairs Briefing Mark Barnes, President, Mark Barnes Associates, CCRKBA federal lobbyist Jeff Knox, Director, The Firearms Coalition, founder of GunVoter.org Larry Pratt, Executive Director, Gun Owners of America Seth Waugh, director of Government Relations- Federal Affairs, NSSF 9:00 a.m. Disarming the Jews and “Enemies of the State” Stephen P. Halbrook, Esq., Research Fellow at the Independent Institute 9:15 a.m. State Legislative Affairs Briefing I Philip Van Cleave, president, Virginia Citizens Defense League Scott Bach, chairman, Association of NJ Rifle and Pistol Clubs, board member, NRA Jim Wallace, executive director, Gun Owners Action League (GOAL) Massachusetts Richard Pearson, executive vice president, Illinois State Rifle Association Sean Maloney, Esq., Buckeye Firearms Association leader Stephen Aldstadt, president, Scope NY, Inc. -

17-56081, 10/12/2017, ID: 10616291, Dktentry: 13-4, Page 1 of 285
Case: 17-56081, 10/12/2017, ID: 10616291, DktEntry: 13-4, Page 1 of 285 17-56081 IN THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE NINTH CIRCUIT VIRGINIA DUNCAN, et al, Plaintiff and Appellees, v. XAVIER BECERRA, in his Official Capacity as Attorney General of the State of California, Defendant and Appellant. On Appeal from the United States District Court for the Southern District of California No. 17-cv-1017-BEN-JLB The Honorable Roger T. Benitez, Judge APPELLANT’S EXCERPTS OF RECORD, VOLUME IV, ER 0650-0921 XAVIER BECERRA ALEXANDRA ROBERT GORDON Attorney General of California Deputy Attorney General THOMAS S. PATTERSON State Bar No. 207650 Senior Assistant Attorney General 455 Golden Gate Avenue, Suite 11000 TAMAR PACHTER San Francisco, CA 94102-7004 Supervising Deputy Attorney Telephone: (415) 703-5509 General Fax: (415) 703-5480 NELSON R. RICHARDS Email: ANTHONY P. O’BRIEN [email protected] Deputy Attorneys General Attorneys for Defendant-Appellant Case: 17-56081, 10/12/2017, ID: 10616291, DktEntry: 13-4, Page 2 of 285 TABLE OF CONTENTS Date Page VOLUME I 6/29/17 Order Granting Preliminary Injunction (Docket No. 28) ER0001 7/27/17 Notice of Appeal (Docket No. 32) ER0067 6/13/17 Reporter’s Transcript of Proceedings (Hearing on Motion for ER0069 Preliminary Injunction) 6/12/17 Attorney General Xavier Becerra’s Answer (Docket No. 25) ER0134 5/26/17 Order Granting Ex Parte Application for Order Shortening ER0148 Time (Docket No. 5) 5/25/17 Plaintiff’s Ex Parte Application for Order Shortening Time ER0150 to Hear Plaintiff’s Motion for Preliminary Injunction (Docket No. -

The Right to Keep and Bear Arms Dilemma. the Second Amendment Between Constitution, History and Politics
Department of Political Science Master’s Degree in International Relations Chair of History of the Americas The Right to Keep and Bear Arms Dilemma. The Second Amendment between Constitution, History and Politics. SUPERVISOR CANDIDATE Prof. Gregory Alegi Francesca Greco ASSISTANT SUPERVISOR Student ID 621072 Prof. Andrea Ungari ACADEMIC YEAR 2013/2014 1 Smile, even if there is a tangle in your throat. Smile, even if your heart is full of fears. D.G. 2 Table of Contents Acknowledgments………………………………………………………………………………...5 Introduction .................................................................................................................................... 8 Chapter I - The Origins of the Amendment ................................................................................. 12 1. Starring of the Debate ...................................................................................................... 13 2. Back to the Mother-Country: Britain, Militia and Arms .................................................. 16 3. To have Arms: From duty to right .................................................................................... 19 4. Militia and Arms in the Colonies ..................................................................................... 22 5. Redskins and Blacks ......................................................................................................... 24 6. The Boston turning point .................................................................................................. 28 7. Building -

The Grassroots Action Guide for Ohio Gun Owners.Qxd
Buckeye Firearms Association The Grassroots Action Guide for Ohio Gun Owners Page 1 — 5-Minute Handbook for Grassroots Activists Page 6 — How to Be an Effective Volunteer Page 8 — 15 Ways to Fight for Our Second Amendment Rights Page 15 — Become 500 Times More Powerful Politically Page 20 — Gun Rights Are About More Than Guns Page 22 — A Psychiatrist Examines The Anti-Gun Mentality Page 1 5-Minute Handbook for Grassroots Activists Adapted from an essay circulating the Internet — author unknown I’ve been a gun rights activist for nearly 10 years. I wasted a lot of time for the first 5 years because no one gave me the rule book you are now reading. Maybe that’s because no one had written it. This is the stuff I wish I had known starting on Day One. The next 5 minutes you spend reading this might save you 5 years of other- wise wasted time and energy. If you’ve been in the gun rights game for a while, this handbook will be the fastest refresher course you’ve ever taken. This past year I’ve received a lot of mail from jittery gun owners who are finally waking up to what’s happening to our right to keep and bear arms(RKBA). This handbook is mostly for them. If the rules I list below scare off a few folks, so be it. I want to tell it like it really is to give a quick snapshot of the tips, tricks and tactics that actually work in RKBA activism. The bad news is that this is not a complete list of the rules. -
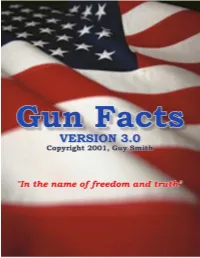
Gun Fact Book
7x Table of Contents Purpose.................................................................................................................... vi Copyright information........................................................................................... vi Questions, corrections and suggestions................................................................ vi Sources..................................................................................................................... vi Contributions.......................................................................................................... vi Palm Pilot users ...................................................................................................... vi The availability of guns........................................................................................... 1 Myth: The availability of guns cause crime................................................................................ 1 Myth: Gun availability is what is causing school shootings....................................................... 2 Myth: Handguns are 43 times more likely to kill a family member than a criminal .................. 2 Myth: High gun retail rates lead to more gun violence............................................................... 3 Myth: 58% of murder victims are killed by either relatives or acquaintances............................ 3 Myth: Guns in poor communities cause many deaths ................................................................ 4 Children and guns -

Activity 1 Gun Safety Survey Rate Your Agreement with the Statements
Activity 1 Gun Safety Survey Rate your agreement with the statements below by circling the choice, below the statement, that most closely matches your feelings on the statement. SA A U/N D SD Strongly Agree Undecided/ Disagree Strongly Agree Neutral Disagree 1. Fear is the primary motivation underlying gun-rights advocates’ staunch resistance to gun controls. SA A U/N D SD 2. US pioneer history created a gun culture that continues to inspire gun-rights advocates today. SA A U/N D SD 3. Prohibiting assault-style weapons would dramatically reduce gun violence deaths and injuries. SA A U/N D SD 4. Mental illness is a large underlying factor that drives individuals to commit mass shootings. SA A U/N D SD 5. If all states had militias/state defense forces, they could prevent tyranny of the federal government. SA A U/N D SD 6. Violence must be viewed as a public health problem and researched by the CDC using federal funding. SA A U/N D SD 7. Background checks, prior to gun purchases, would prevent future mass shootings. SA A U/N D SD 8. The 2nd Amendment could be modified to clarify which clause should dominate in law. SA A U/N D SD 9. The current list of persons who may not possess firearms is appropriate and sufficient for safety. SA A U/N D SD 10. Fear is the primary motivation underlying gun-control advocates’ keen desire to increase restrictions. SA A U/N D SD 11. “Liberty for all” means that gun rights may not be infringed upon by the federal government. -

Fight for Freedom
33rd Annual GUN RIGHTS POLICY CONFERENCE FIGHT FOR FREEDOM September 21-23, 2018 • Chicago, IL Co-Sponsoring Organizations CITIZENS COMMITTEE SECOND FOR THE RIGHT TO KEEP AMENDMENT AND BEAR ARMS FOUNDATION Official GRPC Radio Station: WIND 560 AM – The Answer Funding Sources American Legacy Firearms KeepAndBearArms.com Ammo.Com Merril Press Armed American Radio Microsoft© Gun Club CrossBreed Holsters Henry Repeating Rifles Delta Defense Heroes and Patriots Firearms Dillon Precision SCCY Firearms Glock TheGunMag.com Gun Talk Radio U S Law Shield IAPCAR U.S. Concealed Carry Association Jews for the Preservation of Firearms Ownership Women & Guns Magazine Participating Organizations and Entities: A Girl and a Gun Shooting League • Accuracy in Media • Accuracy in Academia • American Political Action Committee • Ammoland.com • Arizona Citizens Defense League • Arizona Rifle & Pistol Association • Armed American Radio • Arms Room Radio • Association of New Jersey Rifle & Pistol Clubs • AZFirearms.com • Black Guns Matter • Bloomfield Press • Breitbart.com • Buckeye Firearms Association • Cal-FFL • CalGuns Foundation • Cato • Chicago Guns Matter • Coloradans for Civil Liberties • Commonwealth 2A • Crime Prevention Research Center • Defense Small Arms Advisory Council • Doctors for Responsible Gun Ownership • EyeOnTheTargetRadio.com • FASTER Colorado • ForeFront • Firearms Coalition • Firearms Policy Coalition • Firearms United Global • Florida Rifle & Pistol Association • Florida Carry, Inc. • Florida Shooting Sports Association • FrontSightPress.com • GeorgiaCarry.org • Golden State Second Amendment Council • Gottlieb-Tartaro Report • Grassroots North Carolina • Gun Freedom Radio • Gun Owners Action League (Massachusetts) • Gun Owners Action League of Washington • Gun Owners of America • Guns Save Life • Gun Freedom Radio • Guns.com • Hawaii State Rifle and Pistol Association • The Heartland Institute • Heroes and Patriots Firearms • Human Events • I.C.E. -

Peruta V. County of San Diego
(1 of 190) Case: 10-56971, 06/09/2016, ID: 10007709, DktEntry: 333-1, Page 1 of 89 FOR PUBLICATION UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE NINTH CIRCUIT EDWARD PERUTA; MICHELLE No. 10-56971 LAXSON; JAMES DODD; LESLIE BUNCHER, DR.; MARK CLEARY; D.C. No. CALIFORNIA RIFLE AND PISTOL 3:09-cv-02371- ASSOCIATION FOUNDATION, IEG-BGS Plaintiffs-Appellants, v. COUNTY OF SAN DIEGO; WILLIAM D. GORE, individually and in his capacity as Sheriff, Defendants-Appellees, STATE OF CALIFORNIA, Intervenor. Appeal from the United States District Court for the Southern District of California Irma E. Gonzalez, Senior District Judge, Presiding (2 of 190) Case: 10-56971, 06/09/2016, ID: 10007709, DktEntry: 333-1, Page 2 of 89 2 PERUTA V. CTY. OF SAN DIEGO ADAM RICHARDS; SECOND No. 11-16255 AMENDMENT FOUNDATION; CALGUNS FOUNDATION, INC.; BRETT D.C. No. STEWART, 2:09-cv-01235- Plaintiffs-Appellants, MCE-DAD v. OPINION ED PRIETO; COUNTY OF YOLO, Defendants-Appellees. Appeal from the United States District Court for the Eastern District of California Morrison C. England, Chief District Judge, Presiding Argued and Submitted En Banc June 16, 2015 San Francisco, California Filed June 9, 2016 Before: Sidney R. Thomas, Chief Judge and Harry Pregerson, Barry G. Silverman, Susan P. Graber, M. Margaret McKeown, William A. Fletcher, Richard A. Paez, Consuelo M. Callahan, Carlos T. Bea, N. Randy Smith and John B. Owens, Circuit Judges. Opinion by Judge W. Fletcher; Concurrence by Judge Graber; Dissent by Judge Callahan; Dissent by Judge Silverman; Dissent by Judge N.R. Smith (3 of 190) Case: 10-56971, 06/09/2016, ID: 10007709, DktEntry: 333-1, Page 3 of 89 PERUTA V. -

The Right to Keep and Bear Arms Dilemma. the Second Amendment Between Constitution, History and Politics
Department of Political Science Master’s Degree in International Relations Chair of History of the Americas The Right to Keep and Bear Arms Dilemma. The Second Amendment between Constitution, History and Politics. ABSTRACT SUPERVISOR CANDIDATE Prof. Gregory Alegi Francesca Greco ASSISTANT SUPERVISOR Student ID 621072 Prof. Andrea Ungari ACADEMIC YEAR 2013/2014 Table of Contents Introduction ....................................................................................................................... 8 Chapter I - The Origins of the Amendment ..................................................................... 12 1. Starring of the Debate .............................. Errore. Il segnalibro non è definito.13 2. Back to the Mother-Country: Britain, Militia and ArmsErrore. Il segnalibro non è definito.16 3. To have Arms: From duty to right……………………………………………….19 4. Militia and Arms in the Colonies .............. Errore. Il segnalibro non è definito.22 5. Redskins and Blacks ............................................................................................. 24 6. The Boston turning point .......................... Errore. Il segnalibro non è definito.28 7. Building the Amendment ........................... Errore. Il segnalibro non è definito.32 8. The destiny of the militia .......................... Errore. Il segnalibro non è definito.39 Chapter II - The Amendment in Courts and Codes ......................................................... 44 1. A difficult comprehension (or Much Ado about…a comma)Errore. Il segnalibro -

2015 Gun Rights Policy Conference Agenda
2015 GUN RIGHTS POLICY CONFERENCE AGENDA September 25-27, 2015 • Phoenix, AZ Co-Sponsoring Organizations CITIZENS COMMITTEE SECOND FOR THE RIGHT TO KEEP AMENDMENT AND BEAR ARMS FOUNDATION Independent Talk 1100 KFNX Official Radio Partner of GRPC Funding Sources 1st National Reserve American Legacy Firearms Ammoseek.com Armed American Radio Crossbreed Holsters DefendersOutdoors.com Dillon Precision Glock Gun Talk Radio GunAuction.com GunBroker.com IAPCAR Gunsite Academy Century International Arms ILoveGunsandCoffee.com JPFO Kahr Arms KeepAndBearArms.com Merril Press Microsoft© Gun Club National Shooting Sports Found. North American Arms TheGunMag.Com U.S. Concealed Carry Assoc. U.S. Law Shield Women & Guns Magazine Participating Organizations and Entities: Academics for the Second Amendment • Accuracy in Media • Alabama Gun Rights • American Political Action Committee • Ammoland.com • Arizona Citizens Defense League • Arizona Rifle & Pistol Association • Armed American Radio • Association of New Jersey Rifle & Pistol Clubs • Bloomfield Press • Breitbart.com • Buckeye Firearms Association • CAL-FFL • CalGuns Foundation • California Rifle & Pistol Association • Comm2A • Crime Prevention Research Center • Defense Distributed • Defense Small Arms Advisory Council • Doctors for Responsible Gun Ownership • Firearms Coalition • Firearms Policy Coalition • Florida Sport Shooting Association • Florida Carry Inc. • GeorgiaCarry.org • Golden State Second Amendment Council • Gottlieb-Tartaro Report • Grass Roots North Carolina • Gun Owners Action -

Gun Violence in America
GUN VIOLENCE IN AMERICA GUN VIOLENCE IN AMERICA The Struggle for Control Alexander DeConde Northeastern University Press Boston Northeastern University Press Copyright 2001 by Alexander DeConde All rights reserved. Except for the quotation of short passages for the purposes of criticism and review, no part of this book may be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system now known or to be invented, without written permission of the publisher. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data DeConde, Alexander Gun violence in America : the struggle for control / Alexander DeConde. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 1–55553–486–4 (cloth : alk. paper) 1. Gun control—United States. 2. Violent crimes—United States. 3. Firearms ownership—United States. 4. United States—Politics and government. I. Title. HV7436.D43 2001 363.3Ј3Ј0973—dc21 00–054821 Designed by Janis Owens Composed in Electra by Coghill Composition Company in Richmond, Virginia. Printed and bound by The Maple Press Company in York, Pennsylvania. The paper is Sebago Antique, an acid-free sheet. Manufactured in the United States of America 050403020154321 Contents Introduction 3 1 Origins and Precedents 7 2 The Colonial Record 17 3 To the Second Amendment 27 4 Militias, Duels, and Gun Keeping 39 5 A Gun Culture Emerges 53 6 Reconstruction, Cheap Guns, and the Wild West 71 7 The National Rifle Association 89 8 Urban Control Movements 105 9 Gun-Roaring Twenties 119 10 Direct Federal Controls 137 11 Guns Flourish, Opposition Rises 155 12 Control Act of 1968 171 13 Control Groups on the Rise 189 14 Gun Lobby Glory Years 203 15 A Wholly Owned NRA Subsidiary? 219 16 The Struggle Nationalized 235 17 The Brady Act 249 18 School Shootings and Gun Shows 265 19 Clinton v.