Organisation Et Exploitation Des Connaissances Sur Les Réseaux D
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
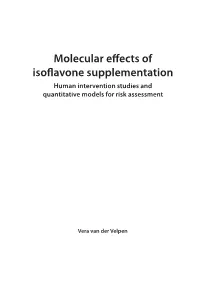
Molecular Effects of Isoflavone Supplementation Human Intervention Studies and Quantitative Models for Risk Assessment
Molecular effects of isoflavone supplementation Human intervention studies and quantitative models for risk assessment Vera van der Velpen Thesis committee Promotors Prof. Dr Pieter van ‘t Veer Professor of Nutritional Epidemiology Wageningen University Prof. Dr Evert G. Schouten Emeritus Professor of Epidemiology and Prevention Wageningen University Co-promotors Dr Anouk Geelen Assistant professor, Division of Human Nutrition Wageningen University Dr Lydia A. Afman Assistant professor, Division of Human Nutrition Wageningen University Other members Prof. Dr Jaap Keijer, Wageningen University Dr Hubert P.J.M. Noteborn, Netherlands Food en Consumer Product Safety Authority Prof. Dr Yvonne T. van der Schouw, UMC Utrecht Dr Wendy L. Hall, King’s College London This research was conducted under the auspices of the Graduate School VLAG (Advanced studies in Food Technology, Agrobiotechnology, Nutrition and Health Sciences). Molecular effects of isoflavone supplementation Human intervention studies and quantitative models for risk assessment Vera van der Velpen Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of doctor at Wageningen University by the authority of the Rector Magnificus Prof. Dr M.J. Kropff, in the presence of the Thesis Committee appointed by the Academic Board to be defended in public on Friday 20 June 2014 at 13.30 p.m. in the Aula. Vera van der Velpen Molecular effects of isoflavone supplementation: Human intervention studies and quantitative models for risk assessment 154 pages PhD thesis, Wageningen University, Wageningen, NL (2014) With references, with summaries in Dutch and English ISBN: 978-94-6173-952-0 ABSTRact Background: Risk assessment can potentially be improved by closely linked experiments in the disciplines of epidemiology and toxicology. -

Stroke Genetics and Genomics
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa Unidade Neurológica de Investigação Clínica PhD Thesis Stroke Genetics and Genomics Tiago Krug Coelho Host Institution: Instituto Gulbenkian de Ciência Supervisor at Instituto Gulbenkian de Ciência: Doctor Sofia Oliveira Supervisor at Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa: Professor José Ferro PhD in Biomedical Sciences Specialization in Neurosciences 2010 Stroke Genetics and Genomics A ciência tem, de facto, um único objectivo: a verdade. Não esgota perfeitamente a sua tarefa se não descobre a causa do todo. Chiara Lubich i Stroke Genetics and Genomics ii Stroke Genetics and Genomics A impressão desta dissertação foi aprovada pela Comissão Coordenadora do Conselho Científico da Faculdade de Medicina de Lisboa em reunião de 28 de Setembro de 2010. iii Stroke Genetics and Genomics iv Stroke Genetics and Genomics As opiniões expressas são da exclusiva responsabilidade do seu autor. v Stroke Genetics and Genomics vi Stroke Genetics and Genomics Abstract ABSTRACT This project presents a comprehensive approach to the identification of new genes that influence the risk for developing stroke. Stroke is the leading cause of death in Portugal and the third leading cause of death in the developed world. It is even more disabling than lethal, and the persistent neurological impairment and physical disability caused by stroke have a very high socioeconomic cost. Moreover, the number of affected individuals is expected to increase with the current aging of the population. Stroke is a “brain attack” cutting off vital blood and oxygen to the brain cells and it is a complex disease resulting from environmental and genetic factors. -

Comparative Gene Expression Profiles in Parathyroid Adenoma
Journal of Clinical Medicine Article Comparative Gene Expression Profiles in Parathyroid Adenoma and Normal Parathyroid Tissue Young Jun Chai 1,† , Heejoon Chae 2,† , Kwangsoo Kim 3 , Heonyi Lee 2, Seongmin Choi 3 , Kyu Eun Lee 4 and Sang Wan Kim 5,* 1 Department of Surgery, Seoul Metropolitan Government-Seoul National University Boramae Medical Center, Seoul 07061, Korea; [email protected] 2 Division of Computer Science, Sookmyung Women’s University, Seoul 04310, Korea; [email protected] (H.C.); [email protected] (H.L.) 3 Division of Clinical Bioinformatics, Biomedical Research Institute, Seoul National University Hospital, Seoul 03080, Korea; [email protected] (K.K.); [email protected] (S.C.) 4 Department of Surgery, Seoul National University Hospital & College of Medicine, Seoul 03080, Korea; [email protected] 5 Department of Internal Medicine, Seoul National University College of Medicine, and Seoul Metropolitan Government-Seoul National University Boramae Medical Center, Seoul 07061, Korea * Correspondence: [email protected]; Tel.: +82-2-870-2223 † These two authors contributed equally. Received: 29 January 2019; Accepted: 22 February 2019; Published: 2 March 2019 Abstract: Parathyroid adenoma is the main cause of primary hyperparathyroidism, which is characterized by enlarged parathyroid glands and excessive parathyroid hormone secretion. Here, we performed transcriptome analysis, comparing parathyroid adenomas with normal parathyroid gland tissue. RNA extracted from ten parathyroid adenoma and five normal parathyroid samples was sequenced, and differentially expressed genes (DEGs) were identified using strict cut-off criteria. Gene Ontology (GO) and Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) pathway enrichment analyses were performed using DEGs as the input, and protein-protein interaction (PPI) networks were constructed using Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes/Proteins (STRING) and visualized in Cytoscape. -

Positional Plasticity in Regenerating Amybstoma Mexicanum Limbs Is Associated with Cell Proliferation and Pathways of Cellular Differentiation Catherine D
McCusker et al. BMC Developmental Biology (2015) 15:45 DOI 10.1186/s12861-015-0095-4 RESEARCH ARTICLE Open Access Positional plasticity in regenerating Amybstoma mexicanum limbs is associated with cell proliferation and pathways of cellular differentiation Catherine D. McCusker1, Antony Athippozhy2, Carlos Diaz-Castillo3, Charless Fowlkes4, David M. Gardiner3 and S. Randal Voss2* Abstract Background: The endogenous ability to dedifferentiate, re-pattern, and re-differentiate adult cells to repair or replace damaged or missing structures is exclusive to only a few tetrapod species. The Mexican axolotl is one example of these species, having the capacity to regenerate multiple adult structures including their limbs by generating a group of progenitor cells, known as the blastema, which acquire pattern and differentiate into the missing tissues. The formation of a limb regenerate is dependent on cells in the connective tissues that retain memory of their original position in the limb, and use this information to generate the pattern of the missing structure. Observations from recent and historic studies suggest that blastema cells vary in their potential to pattern distal structures during the regeneration process; some cells are plastic and can be reprogrammed to obtain new positional information while others are stable. Our previous studies showed that positional information has temporal and spatial components of variation; early bud (EB) and apical late bud (LB) blastema cells are plastic while basal-LB cells are stable. To identify the potential cellular and molecular basis of this variation, we compared these three cell populations using histological and transcriptional approaches. Results: Histologically, the basal-LB sample showed greater tissue organization than the EB and apical-LB samples. -

Positional Plasticity in Regenerating Amybstoma Mexicanum Limbs Is Associated with Cell Proliferation and Pathways of Cellular Differentiation Catherine D
University of Kentucky UKnowledge Biology Faculty Publications Biology 11-23-2015 Positional Plasticity in Regenerating Amybstoma mexicanum Limbs is Associated with Cell Proliferation and Pathways of Cellular Differentiation Catherine D. McCusker University of Massachusetts Antony Athippozhy University of Kentucky, [email protected] Carlos Diaz-Castillo University of California Charless Fowlkes University of California David M. Gardiner University of California - Irvine See next page for additional authors Follow this and additional works at: https://uknowledge.uky.edu/biology_facpub Right click to open a feedback form in a new tab to let us know how this document benefits oy u. Part of the Biology Commons Repository Citation McCusker, Catherine D.; Athippozhy, Antony; Diaz-Castillo, Carlos; Fowlkes, Charless; Gardiner, David M.; and Voss, S. Randal, "Positional Plasticity in Regenerating Amybstoma mexicanum Limbs is Associated with Cell Proliferation and Pathways of Cellular Differentiation" (2015). Biology Faculty Publications. 99. https://uknowledge.uky.edu/biology_facpub/99 This Article is brought to you for free and open access by the Biology at UKnowledge. It has been accepted for inclusion in Biology Faculty Publications by an authorized administrator of UKnowledge. For more information, please contact [email protected]. Authors Catherine D. McCusker, Antony Athippozhy, Carlos Diaz-Castillo, Charless Fowlkes, David M. Gardiner, and S. Randal Voss Positional Plasticity in Regenerating Amybstoma mexicanum Limbs is Associated with -

The Genetic Determinants of Cerebral Palsy
The genetic determinants of cerebral palsy A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) to the University of Adelaide By Gai McMichael Supervisors: Professors Jozef Gecz and Eric Haan The University of Adelaide, Robinson Institute School of Medicine Faculty of Health Science May 2016 Statement of Declaration This work contains no material which has been accepted for the award of any other degree or diploma in any university or other tertiary institution and to the best of my knowledge and belief, contains no material previously published or written by another person, except where due reference has been made in the text. I give consent to this copy of my thesis, when deposited in the University Library, being available for loan and photocopying. Gai Lisette McMichael January 2016 i Table of contents Statement of declaration i Table of contents ii Acknowledgements ix Publications xi HUGO Gene Nomenclature gene symbol and gene name xiii Abbreviations xvi URLs xix Chapter 1 Introduction 1 1.1 Definition of cerebral palsy 2 1.2 Clinical classification of cerebral palsy 3 1.2.1 Gross motor function classification system 5 1.3 Neuroimaging 7 1.4 Incidence and economic cost of cerebral palsy 8 1.5 Known clinical risk factors for cerebral palsy 9 1.5.1 Preterm birth 9 1.5.2 Low birth weight 9 1.5.3 Multiple birth 10 1.5.4 Male gender 10 1.6 Other known clinical risk factors 11 1.6.1 Birth asphyxia 11 1.7 Other possible risk factors 12 1.8 Evidence for a genetic contribution to cerebral palsy causation 13 1.8.1 Sibling risks -

A Meta-Analysis of the Effects of High-LET Ionizing Radiations in Human Gene Expression
Supplementary Materials A Meta-Analysis of the Effects of High-LET Ionizing Radiations in Human Gene Expression Table S1. Statistically significant DEGs (Adj. p-value < 0.01) derived from meta-analysis for samples irradiated with high doses of HZE particles, collected 6-24 h post-IR not common with any other meta- analysis group. This meta-analysis group consists of 3 DEG lists obtained from DGEA, using a total of 11 control and 11 irradiated samples [Data Series: E-MTAB-5761 and E-MTAB-5754]. Ensembl ID Gene Symbol Gene Description Up-Regulated Genes ↑ (2425) ENSG00000000938 FGR FGR proto-oncogene, Src family tyrosine kinase ENSG00000001036 FUCA2 alpha-L-fucosidase 2 ENSG00000001084 GCLC glutamate-cysteine ligase catalytic subunit ENSG00000001631 KRIT1 KRIT1 ankyrin repeat containing ENSG00000002079 MYH16 myosin heavy chain 16 pseudogene ENSG00000002587 HS3ST1 heparan sulfate-glucosamine 3-sulfotransferase 1 ENSG00000003056 M6PR mannose-6-phosphate receptor, cation dependent ENSG00000004059 ARF5 ADP ribosylation factor 5 ENSG00000004777 ARHGAP33 Rho GTPase activating protein 33 ENSG00000004799 PDK4 pyruvate dehydrogenase kinase 4 ENSG00000004848 ARX aristaless related homeobox ENSG00000005022 SLC25A5 solute carrier family 25 member 5 ENSG00000005108 THSD7A thrombospondin type 1 domain containing 7A ENSG00000005194 CIAPIN1 cytokine induced apoptosis inhibitor 1 ENSG00000005381 MPO myeloperoxidase ENSG00000005486 RHBDD2 rhomboid domain containing 2 ENSG00000005884 ITGA3 integrin subunit alpha 3 ENSG00000006016 CRLF1 cytokine receptor like -

RNA-Sequencing Analysis of Hepg2 Cells Treated with Atorvastatin
RNA-Sequencing Analysis of HepG2 Cells Treated with Atorvastatin Camilla Stormo1*, Marianne K. Kringen2, Robert Lyle3, Ole Kristoffer Olstad1, Daniel Sachse4, Jens P. Berg1,4, Armin P. Piehler5 1 Department of Medical Biochemistry, Oslo University Hospital, Ulleva˚l, Oslo, Norway, 2 Department of Pharmacology, Oslo University Hospital, Ulleva˚l, Oslo, Norway, 3 Department of Medical Genetics, Oslo University Hospital and University of Oslo, Oslo, Norway, 4 Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo, Oslo, Norway, 5 Fu¨rst Medical Laboratory, Oslo, Norway Abstract The cholesterol-lowering drug atorvastatin is among the most prescribed drug in the world. Alternative splicing in a number of genes has been reported to be associated with variable statin response. RNA-seq has proven to be a powerful technique for genome-wide splice variant analysis. In the present study, we sought to investigate atorvastatin responsive splice variants in HepG2 cells using RNA-seq analysis to identify novel candidate genes implicated in cholesterol homeostasis and in the statin response. HepG2 cells were treated with 10 mM atorvastatin for 24 hours. RNA-seq and exon array analyses were performed. The validation of selected genes was performed using Taqman gene expression assays. RNA-seq analysis identified 121 genes and 98 specific splice variants, of which four were minor splice variants to be differentially expressed, 11 were genes with potential changes in their splicing patterns (SYCP3, ZNF195, ZNF674, MYD88, WHSC1, KIF16B, ZNF92, AGER, FCHO1, SLC6A12 and AKAP9), and one was a gene (RAP1GAP) with differential promoter usage. The IL21R transcript was detected to be differentially expressed via RNA-seq and RT-qPCR, but not in the exon array. -

ALLEN Human Brain Atlas
ALLEN Human Brain Atlas TECHNICAL WHITE PAPER: COMPLETE LIST OF GENES CHARACTERIZED BY IN SITU HYBRIDIZATION IN ADULT HUMAN BRAIN STUDIES Table 1. Genes characterized by ISH in 1,000 gene survey in cortex (Cortex Study). Category Gene Symbol EntrezID Gene Description Gene Family Disease Comparative Marker Type Genomics A2M 2 alpha-2-macroglobulin extracellular Alzheimer’s VEC matrix AANAT 15 arylalkylamine N-acetyltransferase metabolic enzyme protein evolution AATF 26574 apoptosis antagonizing transcription transcription factor other factor neurodegenerative ABAT 18 4-aminobutyrate aminotransferase metabolic enzyme epilepsy interneuron ABCD1 215 ATP-binding cassette, sub-family D transporter other (ALD), member 1 neurodegenerative ACCN1 40 amiloride-sensitive cation channel 1, ion channel autism neuronal (degenerin) ACE 1636 angiotensin I converting enzyme metabolic enzyme Alzheimer’s (peptidyl-dipeptidase A) 1 ACHE 43 acetylcholinesterase (Yt blood group) metabolic enzyme Alzheimer’s OCTOBER 2012 v.2 alleninstitute.org Complete List of Genes Characterized by in situ Hybridization in Adult Human Brain Studies brain-map.org page 1 of 92 TECHNICAL WHITE PAPER ALLEN Human Brain Atlas Table 1. Genes characterized by ISH in 1,000 gene survey in cortex (Cortex Study). Category Gene Symbol EntrezID Gene Description Gene Family Disease Comparative Marker Type Genomics ACTB 60 actin, beta cytoskeletal mental retardation protein ACTN2 88 actinin, alpha 2 cytoskeletal schizophrenia protein ADAM23 8745 ADAM metallopeptidase domain 23 extracellular -

XLMR Genes: Update 2007
European Journal of Human Genetics (2008) 16, 422–434 & 2008 Nature Publishing Group All rights reserved 1018-4813/08 $30.00 www.nature.com/ejhg REVIEW XLMR genes: update 2007 Pietro Chiurazzi*,1, Charles E Schwartz2, Jozef Gecz3,4 and Giovanni Neri*,1 1Institute of Medical Genetics, Catholic University, Rome, Italy; 2JC Self Research Institute of Human Genetics, Greenwood Genetic Center, Greenwood, SC, USA; 3Department of Genetic Medicine, Women’s and Children’s Hospital, Adelaide, South Australia, Australia; 4Department of Paediatrics, University of Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia X-linked mental retardation (XLMR) is a common cause of inherited intellectual disability with an estimated prevalence of B1/1000 males. Most XLMR conditions are inherited as X-linked recessive traits, although female carriers may manifest usually milder symptoms. We have listed 215 XLMR conditions, subdivided according to their clinical presentation: 149 with specific clinical findings, including 98 syndromes and 51 neuromuscular conditions, and 66 nonspecific (MRX) forms. We also present a map of the 82 XLMR genes cloned to date (November 2007) and a map of the 97 conditions that have been positioned by linkage analysis or cytogenetic breakpoints. We briefly consider the molecular function of known XLMR proteins and discuss the possible strategies to identify the remaining XLMR genes. Final remarks are made on the natural history of XLMR conditions and on diagnostic issues. European Journal of Human Genetics (2008) 16, 422–434; doi:10.1038/sj.ejhg.5201994; -

Bovine Milk Exosomes Contain Microrna and Mrna and Are Taken up by Human Macrophages
J. Dairy Sci. 98 :2920–2933 http://dx.doi.org/ 10.3168/jds.2014-9076 © American Dairy Science Association®, 2015 . Bovine milk exosomes contain microRNA and mRNA and are taken up by human macrophages Hirohisa Izumi ,*1 Muneya Tsuda ,* Yohei Sato ,* Nobuyoshi Kosaka ,† Takahiro Ochiya ,† Hiroshi Iwamoto,* Kazuyoshi Namba ,* and Yasuhiro Takeda * * Nutritional Science Institute, Morinaga Milk Industry Co. Ltd., Zama, Kanagawa 252-8583, Japan † Division of Molecular and Cellular Medicine, National Cancer Center Research Institute, Chuo-ku, Tokyo, 104-0045, Japan ABSTRACT hormones (Cross and Gill, 2000; van Hooijdonk et al., 2000). In recent years, studies have revealed that hu- We reported previously that microRNA (miRNA) are man (Kosaka et al., 2010b; Weber et al., 2010; Zhou present in whey fractions of human breast milk, bovine et al., 2012; Munch et al., 2013), bovine (Chen et al., milk, and rat milk. Moreover, we also confirmed that 2010; Hata et al., 2010; Izumi et al., 2012, 2013; Sun et so many mRNA species are present in rat milk whey. al., 2013), pig (Gu et al., 2012), and rat milk (Izumi et These RNA were resistant to acidic conditions and to al., 2014) also contain microRNA (miRNA). Some of RNase, but were degraded by detergent. Thus, these these studies reported that mRNA are also contained in RNA are likely packaged in membrane vesicles such whey (Hata et al., 2010; Izumi et al., 2012, 2013, 2014). as exosomes. However, functional extracellular circulat- Moreover, these RNA are stable under harsh condi- ing RNA in bodily fluids, such as blood miRNA, are tions, such as low pH, and in the presence of RNase present in various forms. -
RNA-Sequencing Analysis of Hepg2 Cells Treated with Atorvastatin
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by NORA - Norwegian Open Research Archives RNA-Sequencing Analysis of HepG2 Cells Treated with Atorvastatin Camilla Stormo1*, Marianne K. Kringen2, Robert Lyle3, Ole Kristoffer Olstad1, Daniel Sachse4, Jens P. Berg1,4, Armin P. Piehler5 1 Department of Medical Biochemistry, Oslo University Hospital, Ulleva˚l, Oslo, Norway, 2 Department of Pharmacology, Oslo University Hospital, Ulleva˚l, Oslo, Norway, 3 Department of Medical Genetics, Oslo University Hospital and University of Oslo, Oslo, Norway, 4 Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo, Oslo, Norway, 5 Fu¨rst Medical Laboratory, Oslo, Norway Abstract The cholesterol-lowering drug atorvastatin is among the most prescribed drug in the world. Alternative splicing in a number of genes has been reported to be associated with variable statin response. RNA-seq has proven to be a powerful technique for genome-wide splice variant analysis. In the present study, we sought to investigate atorvastatin responsive splice variants in HepG2 cells using RNA-seq analysis to identify novel candidate genes implicated in cholesterol homeostasis and in the statin response. HepG2 cells were treated with 10 mM atorvastatin for 24 hours. RNA-seq and exon array analyses were performed. The validation of selected genes was performed using Taqman gene expression assays. RNA-seq analysis identified 121 genes and 98 specific splice variants, of which four were minor splice variants to be differentially expressed, 11 were genes with potential changes in their splicing patterns (SYCP3, ZNF195, ZNF674, MYD88, WHSC1, KIF16B, ZNF92, AGER, FCHO1, SLC6A12 and AKAP9), and one was a gene (RAP1GAP) with differential promoter usage.