VONS Guido Guidi.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

History of Medicine 201 a Renaissance Promoter of Modern Surgery
Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat., Iaşi – 2016 – vol. 120, no. 1 HISTORY OF MEDICINE A RENAISSANCE PROMOTER OF MODERN SURGERY I. Velenciuc1 , Raluca Minea2* , Letiţia Duceac3 , T. Vlad2 1. CF (/Railway) General Hospital Paşcani 2. University of Arts “G. Enescu” Iaşi Faculty of Visual Arts and Design Department of Mural Arts, Conservation – Restoration and Art History 3. University “Apollonia” Iaşi Faculty of Dental Medicine Department of Medicine *Corresponding author: [email protected] A RENAISSANCE PROMOTER OF MODERN SURGERY (Abstract): The present paper aims, exploring the history of Renaissance medicine, to evoke the figure and work of the priest, surgeon and anatomist, Guido Guidi (Vidus Vidius) (1509-1569). The XVIth century is considered a period marked by artistic and scientific effervescence in the western part of Europe and Guido Guidi was a first order personality, grandson of Domenico Ghirlandaio and friend of Benvenuto Cellini. He was appointed by the King Francis I the first professor of anatomy and surgery at the newly founded Collège de France. On demand of the King, he wrote Chirurgia è Graeco in Latinum conversa Vido Vidio Florentino interprete, cum nonnullis eiusdem Vidii comentariis (1544), a beautifully illustrated original surgery book that became for the following two centuries the main source in teaching surgery. Our study realized a detailed assessment of the book and especially of its illustrations belonging to Francesco Salviati. Exploring the life of Guido Guidi, we were also able to point out other significant contributions in the field of anatomy and clinical medicine as De anatome the first book where are presented disarticulated, the bones of the skull base and also the disco- very of the chickenpox. -

Andreas Vesalius O F Brussels Holds
A N D R E A S V ES AL I US TH REFO RMER O F ANATO M Y M S OO B LL . JA E M RES A , M D . SAINT LO UIS MEDICAL SCIENCE PRESS MDCCCCX TO THE MEM O RY OF THOSE I LLUSTRIOUS MEN WH O OFTEN U N DER A DVE RSE CIRCUMSTAN CES AND SOMETIMES I N DANG E R O F DEATH SUCC EEDED I N UNRAV EL L I NG THE MYSTERIES OF THE STRUCTURE O F THE HUM AN BODY TO THE FATHERS O F ANATO MY AND TO THE A RTIST - ANATOMISTS THIS BO OK IS DEDI CATED PREFAC E N T H E A N NA L S O F TH E medical profession the name of Andreas Vesalius o f Brussels holds a place second to none . Every him physician has heard of , yet few know the details of his life , the circumstances under which his labors were carried out , the o f extent those labors , or their far o f m reaching influence upon the progress anato y , physi m ology and surgery . Co paratively few physicians have m seen his works ; and fewer still have read the . The m m refor ation which he inaugurated in anato y , and inci o f m dentally in other branches edical science , has left im m m o f only a d i press upon the inds the busy , science loving physicians o f the nineteenth and twentieth centuries . That so little should be known about him is not surpris ing , since his writings were in Latin and were published m o f . -

L'imagination Inventive De Francesco Salviati
Entre espaces de création et réseaux de production: l’imagination inventive de Francesco Salviati (1510-1563) Nelda Damiano Department of Art History and Communication Studies McGill University, Montreal March 2011 A thesis submitted to McGill University in partial fulfilment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy Copyright 2011 by Damiano, Nelda All right reserved 1 Table des matières Résumés 3 Remerciements 5 Abréviations 6 Liste des illustrations 8 Introduction 13 Historiographie De l’effacement à la redécouverte : la volte-face de l’opinion moderne 20 Partie 1 Superficie / espace I. San Francesco a Ripa 41 II. San Marcello al Corso 49 III. San Giovanni Decollato 61 Partie 2 Collaboration / expérimentation I. Positionnement social/géographique 104 II. Venise, entre Aretino et Marcolini 108 III. Rome: un traité d'anatomie et une dédicace à François 1er 128 IV. Florence et les ateliers de tapisserie 135 V. Rome et le marché de l'image gravée 154 VI. Un retour aux sources: l'artiste et l'orfèvrerie 164 Conclusion 168 Appendice A 170 Bibliographie 189 Illustrations 2 Résumé Ma recherche se concentre sur l’artiste florentin Francesco Salviati (1510-1563). Tout particulièrement, mon étude cherche à mieux comprendre les traits caractéristiques de son œuvre, dans ses particularités et dans son ensemble. En analysant son parcours, on constate que celui-ci est ponctué de projets allant de la peinture à fresque, au tableau d’autel, en passant par la gravure et les dessins destinés aux objets d’orfèvrerie. Il s’agit alors de discerner l’approche préconisée par Salviati. Est-ce que celui-ci crée en huis clos ou décide-t-il de transiger avec des artistes qui s’adonnent à une forme d’art qui lui est étrangère? La polyvalence dont il fait preuve nous indique clairement qu’il embrasse les possibilités de collaboration qui s’offrent à lui au gré de ses déplacements, que ce soit avec des graveurs, des lissiers ou des éditeurs. -
Illustrations from the Wellcome Library Vesalius's Method of Articulating the Skeleton and a Drawing in the Collection of the Wellcome Library
Medical History, 2000, 44: 97-110 Illustrations from the Wellcome Library Vesalius's Method of Articulating the Skeleton and a Drawing in the Collection of the Wellcome Library MONIQUE KORNELL* ne ofthe recent acquisitions ofthe Wellcome Library, a sixteenth-century Italian drawing of the bones of the pelvis (Plate 1), is particularly significant because it clearly depicts the copper wires and iron rod used in the method of articulation of the skeleton described by Andreas Vesalius (1514-1564) in the thirty-ninth chapter of the first book of De humani corporis fabrica, published in 1543.1 This procedure was the most detailed yet to have appeared in print and it was further enlivened by its visual de- L__________________________ monstration in initial letters decorating the book.2 * Monique Kornell, MA, PhD, Iconographic of the human skeleton by Andreas Vesalius of Collections, Wellcome Library for the History & Brussels', Bull. Hist. Med., 1946, 20: 433-60; and Understanding of Medicine, 183 Euston Road, more recently in Andreas Vesalius, On the fabric London NWI 2BE. of the human body. A translation of "De humani corporis fabrica libri septem"; Book I. The bones I am indebted to Dr Robert R Coleman of The and cartilages, by William Frank Richardson, in Medieval Institute, University of Notre Dame, collaboration with John Burd Carman, San, for his kind assistance with the Biblioteca Francisco, Norman Publishing, 1998, pp. 370-84. Ambrosiana drawings collection, to Dr Kliment P For a commentary on the chapter, see also M Gatzinsky of the Department of Anatomy, Roth, Andreas Vesalius Bruxellensis, Berlin, Georg Gothenburg University, Sweden, for his Reimer, 1892, app. -

Histoire De La Médecine Est Celle Des Hommes
Table of Contents Cover image Chez le même éditeur Copyright Préface à la 3e edition Préface à la 1re edition Remerciements 1. Médecine chinoise 2. Médecine des Sumériens et des Assyro-Babyloniens 3. Médecine égyptienne 4. Médecine des Hébreux 5. Médecine grecque 6. Médecine romaine 7. Médecine précolombienne 8. Médecine byzantine 9. Médecine arabe 10. Médecine du Moyen Âge occidental 11. Médecine de la Renaissance 12. Médecine du XVIIe siècle 13. Médecine du XVIIIe siècle 14. Médecine du XIXe siècle 15. Médecine du XXe siècle Bibliographie générale Index des noms Index des périodes, pays, lieux et peuples Index des organes, maladies et spécialités Index des ouvrages Chez le même éditeur Du même auteur Dermatologie infectieuse. Collection Abrégés de médecine. 1998, 224 pages. Dans la même collection Anthropobiologie. Évolution humaine, par É. Crubézy, J. Braga, G. Larrouy. 2008, 2e édition, 360 pages. Sciences humaines et sociales, par G. Lazorthes. 2001, 6e édition, 504 pages. Autres ouvrages Dictionnaire médical Manuila, par L. Manuila, A. Manuila, P. Lewalle, M Nicoulin et T. Papo. 2007, 10e édition, 704 pages. La santé à travers les sciences humaines et sociales, par A. D’Houtaud, 1999, 144 pages. Les comportements humains. Étiologie humaine, par G. Zwang. 2000, 296 pages. Les hallucinés célèbres, par G. Lazorthes. 2001, 144 pages. Médecin ou malade ? La médecine en France aux XIXe et XXe siècles, par J. Poirier et F. Salaün. 2001, 336 pages. Sciences humaines et sociales PCEM1, par E. Iardella, 1998, 2e édition, 192 pages. Sciences humaines et sociales, par S. Bimes-Arbus, Y. Lazorthes, D. Rougé, J. Ariès et coll, 2006, 412 pages. -
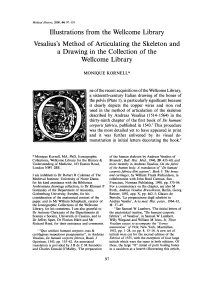
Illustrations from the Wellcome Library Vesalius's Method of Articulating the Skeleton and a Drawing in the Collection of the Wellcome Library
Medical History, 2000, 44: 97-110 Illustrations from the Wellcome Library Vesalius's Method of Articulating the Skeleton and a Drawing in the Collection of the Wellcome Library MONIQUE KORNELL* ne ofthe recent acquisitions ofthe Wellcome Library, a sixteenth-century Italian drawing of the bones of the pelvis (Plate 1), is particularly significant because it clearly depicts the copper wires and iron rod used in the method of articulation of the skeleton described by Andreas Vesalius (1514-1564) in the thirty-ninth chapter of the first book of De humani corporis fabrica, published in 1543.1 This procedure was the most detailed yet to have appeared in print and it was further enlivened by its visual de- L__________________________ monstration in initial letters decorating the book.2 * Monique Kornell, MA, PhD, Iconographic of the human skeleton by Andreas Vesalius of Collections, Wellcome Library for the History & Brussels', Bull. Hist. Med., 1946, 20: 433-60; and Understanding of Medicine, 183 Euston Road, more recently in Andreas Vesalius, On the fabric London NWI 2BE. of the human body. A translation of "De humani corporis fabrica libri septem"; Book I. The bones I am indebted to Dr Robert R Coleman of The and cartilages, by William Frank Richardson, in Medieval Institute, University of Notre Dame, collaboration with John Burd Carman, San, for his kind assistance with the Biblioteca Francisco, Norman Publishing, 1998, pp. 370-84. Ambrosiana drawings collection, to Dr Kliment P For a commentary on the chapter, see also M Gatzinsky of the Department of Anatomy, Roth, Andreas Vesalius Bruxellensis, Berlin, Georg Gothenburg University, Sweden, for his Reimer, 1892, app. -

The Thorax in History 5Discovery of the Pulmonary Transit
Thorax: first published as 10.1136/thx.33.5.555 on 1 October 1978. Downloaded from Thorax, 1978, 33, 555-564 The thorax in history 5 Discovery of the pulmonary transit R K FRENCH From the Wellcome Unit for the History of Medicine, University of Cambridge The discovery that blood passes from the heart to in the belief that the Arabs had merely corrupted the lungs and from the lungs back again to the the true spirit of Greek medicine. Moreover, the heart was the first major development in physi- Arabic texts in Latin guise contained ugly, barbaric ology since the early days of the Alexandrian words that did not decline properly and which school more than a thousand years before. It obscured the meaning of the purer Greek. followed shortly after the rediscovery of the The dispute about where to let blood was not ancient writings, particularly those of Galen and merely an academic one, for it had immediate Aristotle. The scholarly evaluation of these texts practical significance. The humanists found that showed that on certain fundamental issues, in our the Greek texts of Hippocrates and Galen in- case the structure and function of the heart and structed the physician to let blood from a vein on lungs, Aristotle's opinion could not be reconciled the same side of the body as the diseased part, with that of Galen. The same texts provided a while the traditionalists believed the vein should model of scientific procedure including a con- be on the opposite side. Everyone agreed in general sidered evaluation of scientific "fact" derived from that blood was one of the four cardinal humours, historical sources. -

Life of Guido Guidi (Vidus Vidius), Who Named the Vidian Canal
Child's Nervous System (2020) 36:881–884 https://doi.org/10.1007/s00381-018-3930-7 COVER EDITORIAL Life of Guido Guidi (Vidus Vidius), who named the Vidian canal İlhan Bahşi1 Received: 16 July 2018 /Accepted: 23 July 2018 /Published online: 31 July 2018 # Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2018 His life His works Guido Guidi (Latinized name Vidus Vidius) was an Italian Thompson [3] said that Benvenuto Cellini has told us in anatomist and surgeon [1]. In the literature, much of the his autobiography that near the house in which he had details regarding his life are lacking. He was born in lived in Paris, there were some little dwellings inhabited Florence [2]. Different information is present about his by different sorts of men, among whom was a printer of date of birth in the literature: there are sources indicating books of much excellence in his own trade. He was Petrus thathewasbornin1500[3], 10 February 1508 [4], 1500/ Galterius who was first printed the named Chirurgia è 1509 [5], 1509 [2], and 10 February 1509 [1]. His mother graeco in latinum conuersa, Vido Vidio Florentino (Costanza) was daughter of painter Domenico del interprete cum nonnullis ejusdem Vidii cõmentarijs of Ghirlandajo who work as an apprentice for Guido Guidi in 1544. This book is paper that complied Michelangelo [2, 4]. His father, Giuliano di Guido dei to the works of ancient Greek surgeons and prepared as Guidi was a family of physicians [4]. handwritten by Nicetas in the 10th century. Guidi had He probably trained in medicine and surgery in a native translated this book Greek into Latin and he added to city and soon after that earned reputation as a good capable his interpretations. -

This Was No Dry Recital of Dates and Titles, but a Vivid Word-Picture Of
News, Notes and Queries have been unearthed. Local interest has been further stimulated by occa- sional local exhibitions ofmaterial and by contributions to the Press relating to pharmacy in the area. Important papers concerning the development of pharmacy in hospitals have appeared, as well as articles illustrating the changes in drug jar forms and decoration. Discussion meetings have been arranged and contact made with societies having similar interests in many countries, enhanced during the meeting in London in I955 of the Union Mondiale and the Academie Internationale d'Histoire de la Pharmacie when papers from many countries were offered. Material so far acquired includes a notable collection of old proprietary medicines of the last two centuries, apothecaries' tokens of the seventeenth century, series of apothe- caries' bills of the eighteenth century and many early prescription books. The records of a wholesale business from mid-eighteenth century, including what are believed to be the earliest extant shipping bills to Tobago in I 772, have been made available for study. The first two numbers of a bulletin to keep correspondents in touch with the subject have been issued. Theses upon selected subjects have already been accepted for post-graduate degrees. Interest is steadily growing, and publications in Great Britain now deserve to rank alongside those of countries where the history of pharmacy has been long established as a discipline. LESLIE G. MATTHEWS VIDUS VIDIUS (1508-69) THOSE who went to hear Dr. William Brockbank's Thomas Vicary lecture on 'The Man who was Vidius' found themselves transported in spirit from Lincoln's Inn Fields to the Italy and France of the Renaissance.