Robert Springer Université De Metz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
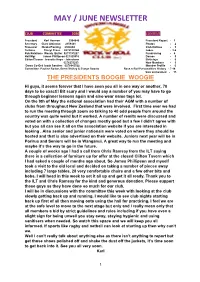
2020 May June Newsletter
MAY / JUNE NEWSLETTER CLUB COMMITTEE 2020 CONTENT President Karl Herman 2304946 President Report - 1 Secretary Clare Atkinson 2159441 Photos - 2 Treasurer Nicola Fleming 2304604 Club Notices - 3 Tuitions Cheryl Cross 0275120144 Jokes - 3-4 Pub Relations Wendy Butler 0273797227 Fundraising - 4 Hall Mgr James Phillipson 021929916 Demos - 5 Editor/Cleaner Jeanette Hope - Johnstone Birthdays - 5 0276233253 New Members - 5 Demo Co-Ord Izaak Sanders 0278943522 Member Profile - 6 Committee: Pauline Rodan, Brent Shirley & Evelyn Sooalo Rock n Roll Personalities History - 7-14 Sale and wanted - 15 THE PRESIDENTS BOOGIE WOOGIE Hi guys, it seems forever that I have seen you all in one way or another, 70 days to be exact!! Bit scary and I would say a number of you may have to go through beginner lessons again and also wear name tags lol. On the 9th of May the national association had their AGM with a number of clubs from throughout New Zealand that were involved. First time ever we had to run the meeting through zoom so talking to 40 odd people from around the country was quite weird but it worked. A number of remits were discussed and voted on with a collection of changes mostly good but a few I didn’t agree with but you all can see it all on the association website if you are interested in looking . Also senior and junior nationals were voted on where they should be hosted and that is also advertised on their website. Juniors next year will be in Porirua and Seniors will be in Wanganui. -

Songs by Artist
Reil Entertainment Songs by Artist Karaoke by Artist Title Title &, Caitlin Will 12 Gauge Address In The Stars Dunkie Butt 10 Cc 12 Stones Donna We Are One Dreadlock Holiday 19 Somethin' Im Mandy Fly Me Mark Wills I'm Not In Love 1910 Fruitgum Co Rubber Bullets 1, 2, 3 Redlight Things We Do For Love Simon Says Wall Street Shuffle 1910 Fruitgum Co. 10 Years 1,2,3 Redlight Through The Iris Simon Says Wasteland 1975 10, 000 Maniacs Chocolate These Are The Days City 10,000 Maniacs Love Me Because Of The Night Sex... Because The Night Sex.... More Than This Sound These Are The Days The Sound Trouble Me UGH! 10,000 Maniacs Wvocal 1975, The Because The Night Chocolate 100 Proof Aged In Soul Sex Somebody's Been Sleeping The City 10Cc 1Barenaked Ladies Dreadlock Holiday Be My Yoko Ono I'm Not In Love Brian Wilson (2000 Version) We Do For Love Call And Answer 11) Enid OS Get In Line (Duet Version) 112 Get In Line (Solo Version) Come See Me It's All Been Done Cupid Jane Dance With Me Never Is Enough It's Over Now Old Apartment, The Only You One Week Peaches & Cream Shoe Box Peaches And Cream Straw Hat U Already Know What A Good Boy Song List Generator® Printed 11/21/2017 Page 1 of 486 Licensed to Greg Reil Reil Entertainment Songs by Artist Karaoke by Artist Title Title 1Barenaked Ladies 20 Fingers When I Fall Short Dick Man 1Beatles, The 2AM Club Come Together Not Your Boyfriend Day Tripper 2Pac Good Day Sunshine California Love (Original Version) Help! 3 Degrees I Saw Her Standing There When Will I See You Again Love Me Do Woman In Love Nowhere Man 3 Dog Night P.S. -

BEAR FAMILY RECORDS TEL +49(0)4748 - 82 16 16 • FAX +49(0)4748 - 82 16 20 • E-MAIL [email protected]
BEAR FAMILY RECORDS TEL +49(0)4748 - 82 16 16 • FAX +49(0)4748 - 82 16 20 • E-MAIL [email protected] KÜNSTLER Chuck Berry TITEL Rock And Roll Music Any Old Way You Choose It Die Gitarrenkoffer-Edition LABEL Bear Family Productions KATALOG # BCD 17053 PREIS-CODE ZY EAN-CODE ÇxDTRBAMy170539z FORMAT Original-Gitarrenkoffer inkl. 16 CD-Box mit 2 gebundenen Büchern (356 Seiten), in leinengebundenem Schuber (28 x 28 x 6 cm) plus magnetischem Schlüsselhalter (12,5 x 20 cm) und signiertem Zertifikat Limitierte Edition: 88 Stück GENRE Rock ‘n’ Roll ANZAHL TITEL 396 SPIELDAUER 1271:04 "Sollten Sie nach einem anderen Namen für Rock And Roll suchen, so könnten Sie ihn auch 'Chuck Berry' nennen." (John Lennon) Seit der Gründung von BEAR FAMILY im Jahre 1975 wollten wir Chuck Berry und sein Lebenswerk würdigen. Chuck Berry-Zusam- menstellungen gab es zu jeder Zeit wie Sand am Meer, mehr als man wird jemals zählen können. Wir jedoch wollten Maßstäbe setzen mit unserer Edition. Zur Feier von Chuck Berrys 88. Geburtstag am 18. Oktober 2014 legen wir eine ultra-limitiere und numerierte Edition unserer Chuck Berry-Box von lediglich 88 Stück auf! Diese Rarität enthält zusätzlich ein signiertes Zertifikat. G Diese Deluxe-Edition kommt in einem exklusiven Gitarrenkoffer in Originalgröße (ES-Series). In solch einem Koffer lag die Gitarre, die Chuck Berry seit den 50er Jahren spielt. G Ebenfalls enthalten: ein magnetischer Schlüsselhalter mit einem seltenen Chuck Berry-Motiv. G Die auf 88 Stück limitierte und numerierte Chuck Berry-Geburtstagsausgabe enthält zusätzlich ein signiertes Zertifikat. G Diese Box enthält jede einzelne auf Single oder LP erschienene Aufnahme, beginnend mit der seltenen Single von Joe Alexander die entstand, bevor Chuck Berry zu CHESS ging. -

Wavelength (October 1981)
University of New Orleans ScholarWorks@UNO Wavelength Midlo Center for New Orleans Studies 10-1981 Wavelength (October 1981) Connie Atkinson University of New Orleans Follow this and additional works at: https://scholarworks.uno.edu/wavelength Recommended Citation Wavelength (October 1981) 12 https://scholarworks.uno.edu/wavelength/12 This Book is brought to you for free and open access by the Midlo Center for New Orleans Studies at ScholarWorks@UNO. It has been accepted for inclusion in Wavelength by an authorized administrator of ScholarWorks@UNO. For more information, please contact [email protected]. Pipes of Pan Presents ... A best seller. versus the best. icro-Acoustics Bose 301 FRM-3dx *33QOOper patr. *34900per pair Compare these two speakers, and you'd probably expect the one on the left - with the lower price - to be the better seller. You'd be right ... but is it the better value? Before you aecide, it pays to consider how much more a little more money will bu~: Comfare bass. The new FRM-3dx uses a twin-ducted enclosure with thicker cabine panels and larger cubic volume for rich, full bass. Compare highs. The new FRM-3dx1s unique Vari-AxiSTM control system, damped isolated tweeter suspension and rim-damped cone give lifelike h1ghs. Compare warranties. The new FRM-3dx is warrantied twice as long. The Micro-Acoustics new FRM-3dx. When you compare, there's really no com parison. Quality worth a 10-year warranty Micro-Acoustics Reg. $349.00 Bose 301" FRM·3dx Tweeter One, fixed. One, rotatable, rim·damped. Tweeter Attached Isolated from SALE NOW directly to baffle. -

Rock`N Roll † – Chuck Berry (90) Hat Sich Auf
Rock`n Roll † – Chuck Berry (90) hat sich auf den Weg gemacht Ein paar Jahre, bevor mich so um 1963 das Beatfieber packte, hörte ich bereits Chuck Berry. Er war zwar nicht der Erfinder des Rock`n Roll, aber bis in die heutige Zeit einer seiner wichtigsten Entrepreneurs. Ganz sicher war er es, der die Gitarre erstmals an die prominente Position in der populären Musik stellte und aus dem Schattendasein als reines Rhythmusinstrument herausführte. Die Gibson Modelle E 335 /E 355 und E345 (Stereo) blieben zeitlebens seine Werkzeuge. Die großvolumigen Körper passten denn auch perfekt zu dem von ihm ersonnenen „Duck Walk“, seinem Markenzeichen auf der Bühne. Gibson ES-355 Bigsby 60s Beatles und Rolling Stones, ja auch die Beach Boys hatten enormen Erfolg mit Berry Kompositionen wie Maybellene, Roll over Beethoven, You never can tell, Sweet little Sixteen, Memphis Tennessee, und natürlich Johnny Be Good. Obwohl Johnny ein begnadeter Gitarrist ist (who never ever learned to read or write so well..but he could play a guitar just like a ringing a bell) , hat Chuck Berry den Song eigentlich dem Pianisten Johnnie Johnson gewidmet, in dessen Band er ab den 1960ern fast 20 Jahre gespielt hat. Die Yardbirds mit dem gerade zum Überflieger propagierten Eric Clapton spielten 1964 Berrys „Too Much Monkey Business“ mit zwei überragenden Gitarrensoli (5 live Yardbirds) und die Rolling Stones verwendeten auf ihren ersten Alben die LiederAround and Around, Carol, Little Queenie, Come on und Bobby Troups 1946er Komposition Route 66 in der Version von Chuck Berry. Auch Santana borgte sich 1983 Havanna Moon aus. -

Wavelength (September 1982)
University of New Orleans ScholarWorks@UNO Wavelength Midlo Center for New Orleans Studies 9-1982 Wavelength (September 1982) Connie Atkinson University of New Orleans Follow this and additional works at: https://scholarworks.uno.edu/wavelength Recommended Citation Wavelength (September 1982) 23 https://scholarworks.uno.edu/wavelength/23 This Book is brought to you for free and open access by the Midlo Center for New Orleans Studies at ScholarWorks@UNO. It has been accepted for inclusion in Wavelength by an authorized administrator of ScholarWorks@UNO. For more information, please contact [email protected]. MEXICAN A! and ... Double Mexicana! MARGARITAS 2 for the price of one through September 15th both locations. If you have not yet discovered Vera Cruz, then you are in for a treat ... its delicious, authentic Mexican cuisine, wonderfully extensive menu, casual and charming atmosphere and friendly staff have made Vera Cruz one of the most popular meeting spots in the city. Stop by and sample one of our superb daily specials or have a cooler at the bar and acquaint yourself with an extraordinary restaurant! Uptown - Mon.-Sat. 11:30 am-10:30 pm, later on weekends Sunday - 11:30 am-9:00 pm Downtown - Mon.-Fri. 5:00 pm-10:30 pm . Saturday 12 noon-10:30 pm 1 Sunday 12 noon-9:00 pm Uptown on Maple Street French Quarter on Decatur 1141 Decatur (corner of Gov. Nicholls) 523.. 9377 • 7537 Maple St. 866-1736 ISSUE NO. 23 • SEPTEMBER 1982 "I'm not sure, but I'm almost positive, that all music came from New Orleans. -

Jukebox Oldies
JUKEBOX OLDIES – MOTOWN ANTHEMS Disc One - Title Artist Disc Two - Title Artist 01 Baby Love The Supremes 01 I Heard It Through the Grapevine Marvin Gaye 02 Dancing In The Street Martha Reeves & The Vandellas 02 Jimmy Mack Martha Reeves & The Vandellas 03 Reach Out, I’ll Be There Four Tops 03 You Keep Me Hangin’ On The Supremes 04 Uptight (Everything’s Alright) Stevie Wonder 04 The Onion Song Marvin Gaye & Tammi Terrell 05 Do You Love Me The Contours 05 Got To Be There Michael Jackson 06 Please Mr Postman The Marvelettes 06 What Becomes Of The Jimmy Ruffin 07 You Really Got A Hold On Me The Miracles 07 Reach Out And Touch Diana Ross 08 My Girl The Temptations 08 You’re All I Need To Get By Marvin Gaye & Tammi Terrell 09 Where Did Our Love Go The Supremes 09 Reflections Diana Ross & The Supremes 10 I Can’t Help Myself Four Tops 10 My Cherie Amour Stevie Wonder 11 The Tracks Of My Tears Smokey Robinson & The Miracles 11 There’s A Ghost In My House R. Dean Taylor 12 My Guy Mary Wells 12 Too Busy Thinking About My Marvin Gaye 13 (Love Is Like A) Heatwave Martha Reeves & The Vandellas 13 The Happening The Supremes 14 Needle In A Haystack The Velvelettes 14 It’s A Shame The Spinners 15 It’s The Same Old Song Four Tops 15 Ain’t No Mountain High Enough Diana Ross 16 Get Ready The Temptations 16 Ben Michael Jackson 17 Stop! (in the name of love) The Supremes 17 Someday We’ll Be Together Diana Ross & The Supremes 18 How Sweet It Is Marvin Gaye 18 Ain’t Too Proud To Beg The Temptations 19 Take Me In Your Arms Kim Weston 19 I’m Still Waiting Diana Ross 20 Nowhere To Run Martha Reeves & The Vandellas 20 I’ll Be There The Jackson 5 21 Shotgun Junior Walker & The All Stars 21 What’s Going On Marvin Gaye 22 It Takes Two Marvin Gaye & Kim Weston 22 For Once In My Life Stevie Wonder 23 This Old Heart Of Mine The Isley Brothers 23 Stoned Love The Supremes 24 You Can’t Hurry Love The Supremes 24 ABC The Jackson 5 25 (I’m a) Road Runner JR. -

The Rolling Stones Complete Recording Sessions 1962 - 2020 Martin Elliott Session Tracks Appendix
THE ROLLING STONES COMPLETE RECORDING SESSIONS 1962 - 2020 MARTIN ELLIOTT SESSION TRACKS APPENDIX * Not Officially Released Tracks Tracks in brackets are rumoured track names. The end number in brackets is where to find the entry in the 2012 book where it has changed. 1962 January - March 1962 Bexleyheath, Kent, England. S0001. Around And Around (Little Boy Blue & The Blue Boys) (1.21) * S0002. Little Queenie (Little Boy Blue & The Blue Boys) (4.32) * (a) Alternative Take (4.11) S0003. Beautiful Delilah (Little Boy Blue & The Blue Boys) (2.58) * (a) Alternative Take (2.18) S0004. La Bamba (Little Boy Blue & The Blue Boys) (0.18) * S0005. Go On To School (Little Boy Blue & The Blue Boys) (2.02) * S0006. I'm Left, You're Right, She's Gone (Little Boy Blue & The Blue Boys) (2.31) * S0007. Down The Road Apiece (Little Boy Blue & The Blue Boys) (2.12) * S0008. Don't Stay Out All Night (Little Boy Blue & The Blue Boys) (2.30) * S0009. I Ain't Got You (Little Boy Blue & The Blue Boys) (2.00) * S0010. Johnny B. Goode (Little Boy Blue & The Blue Boys) (2.24) * S0011. Reelin' And A Rockin' (Little Boy Blue & The Blue Boys) * S0012. Bright Lights, Big City (Little Boy Blue & The Blue Boys) * 27 October 1962 Curly Clayton Sound Studios, Highbury, London, England. S0013. You Can't Judge A Book By The Cover (0.36) * S0014. Soon Forgotten * S0015. Close Together * 1963 11 March 1963 IBC Studios, London, England. S0016. Diddley Daddy (2.38) S0017. Road Runner (3.04) S0018. I Want To Be Loved I (2.02) S0019. -

Silver Eagle Discography
Silver Eagle USA Discography by Mike Callahan, David Edwards & Patrice Eyries © 2018 by Mike Callahan Silver Eagle Discography Silver Eagle was a Canadian company headquartered near Toronto at 115 Apple Creek Blvd., Markham, Ontario, Canada. The label was a subsidiary of LaBuick & Associates Media, Inc., and label President was Ed LaBuick. The Media company specialized in TV marketing, and in addition to Silver Eagle also promoted Time-Life. In addition to LPs, Cassettes, and CDs, Silver Eagle also released videos. They established an office in the US at 4 Centre Drive, Orchard Park, NY (later, 777 N. Palm Canyon Dr., Palm Springs, CA), and often licensed product from the Special Products Divisions of the major record labels. They typically would pre-sell an album using 2-minute TV spots in stations across the country, then use that demand to place product in retail stores. They had their own manufacturing plant and distribution system, and according to LaBuick, sold many millions of albums. LaBuick later became head of the Music Division and Special Products Division of the major Quality Label in Canada. Note: All distributed by Silver Eagle unless noted otherwise. Silver Eagle Main Series: Silver Eagle SE-1000 Series: SE-1001 - Peter Marshall Hosts One More Time, The Hits of Glenn Miller and Tommy Dorsey with the Original Artists - Various Artists [1981] (2-LP set) Disc 1: Moonlight Serenade - Tex Beneke/In The Mood - Tex Beneke/Ida - Tex Beneke/Tuxedo Junction - Tex Beneke/Little Brown Jug - Modernaires//Serenade In Blue-Sweet Eloise-At -

The Guardian, February 20, 1975
Wright State University CORE Scholar The Guardian Student Newspaper Student Activities 2-20-1975 The Guardian, February 20, 1975 Wright State University Student Body Follow this and additional works at: https://corescholar.libraries.wright.edu/guardian Part of the Mass Communication Commons Repository Citation Wright State University Student Body (1975). The Guardian, February 20, 1975. : Wright State University. This Newspaper is brought to you for free and open access by the Student Activities at CORE Scholar. It has been accepted for inclusion in The Guardian Student Newspaper by an authorized administrator of CORE Scholar. For more information, please contact [email protected]. February 20, 1975 Vol II Issue 37 Wrifjh·t Sta : _~e . ___ ) ARA. ~mployees speak their minds by Samuel Latham on the subject. (Editor's note: Last week the There were several employee Guardian printed a story on what suggestions on how to improve students think about ARA Slater, Wright Station. the campus foodservice. This issue, "Lower the prices, they're a after another unscientific poll, nickel too high," said an ARA will try to reveal what the peo worker. "They should add a diet ple on the other side of the plate. They should open on counter think about students time," replied an employee. and ARA. This poll was taken in "Keep stuff stocked up a little the four campus foodservice better," observed another. · operations.) In the University Center, the Employees in Wright Station, employees of the Rathskeller where students tended to took some offense to students' complain the most, felt many of comments. the students complaints are Their main complaints were justified. -
Keith Richards © Felix Aeppli 03-2020 / 08-2021
Not Guilty Keith Richards © Felix Aeppli 03-2020 / 08-2021 3001 December 18, 1943 Born in Dartford, Kent: Keith Richards. 3002 Early 60’s School gigs, Eltham, S.E. London, and Sidcup Art College, Kent: Country and western band (not recorded) KR, Michael Ross: vocals, guitar. 3003 Late 1961 Bob Beckwith’s home, Bexleyheath, near Dartford, and/or Dick Taylor’s home, Dartford, Kent: LITTLE BOY BLUE AND THE BLUE BOYS, SOME OLD SONGS (Download EP, Promotone/iTunes, May 27, 2013: cuts 1-6, 8 [1, 4, 5 plus repeats of 2, 3 all incomplete]); THE ROLLING STONES FILES 1961-1964 (BT CD: cuts 1-6, 8 [1, 4, 5 plus repeats of 2, 3 all incomplete]); THE ROLLING STONES, REELIN’ & ROCKIN’ (BT CD: cuts 1-5 [all incomplete]); DOWN THE ROAD APIECE (STONES TOURING HISTORY VOL. 1) (BT CD: cuts 1, 9 [1 longer, but still incomplete]); HOW BRITAIN GOT THE BLUES (BT CD: cuts 2, 3, 6, 8); BILL WYMAN’S BLACK BOX (BT CD [VGP]: cuts 2, 3, 6, 8); GENUINE BLACK BOX (BT CD box set [Disc 1]: cuts 5, 11-13); REEL TIME TRIP (BT CD: cut 7): 1. Around And Around, 2. Little Queenie, 3. Beautiful Delilah (all Berry), 4. La Bamba (Trad. arr. Valens), 5. Go On To School (Reed) [not Wee Baby Blues (Turner, Johnson)], 6. I Ain’t Got You (Arnold), 7. I’m Left, You’re Right, She’s Gone (Kesler, Taylor), 8. Down The Road Apiece (Raye), 9. Don’t Stay Out All Night (Arnold), 10. I Ain’t Got You (Arnold), 11. -
Songs by Artist
Songs by Artist Title Title Title +44 3 Doors Down 5 Stairsteps, The When Your Heart Stops Live For Today Ooh Child Beating Loser 50 Cent 10 Years Road I'm On, The Candy Shop Beautiful When I'm Gone Disco Inferno Through The Iris When You're Young In Da Club Wasteland 3 Doors Down & Bob Seger Just A Lil' Bit 10,000 Maniacs Landing In London P.I.M.P. (Remix) Because The Night 3 Of Hearts Piggy Bank Candy Everybody Wants Arizona Rain Window Shopper Like The Weather Love Is Enough 50 Cent & Eminem & Adam Levine These Are Days 30 Seconds To Mars My Life 10CC Closer To The Edge My Life (Clean Version) Dreadlock Holiday Kill, The 50 Cent & Mobb Deep I'm Not In Love 311 Outta Control 112 Amber 50 Cent & Nate Dogg Peaches & Cream Beyond The Gray Sky 21 Questions U Already Know Creatures (For A While) 50 Cent & Ne-Yo 1910 Fruitgum Co. Don't Tread On Me Baby By Me Simon Says Hey You 50 Cent & Olivia 1975, The I'll Be Here Awhile Best Friend Chocolate Lovesong 50 Cent & Snoop Dogg & Young 2 Pac You Wouldn't Believe Jeezy California Love 38 Special Major Distribution (Clean Changes Hold On Loosely Version) Dear Mama Second Chance 5th Dimension, The How Do You Want It 3LW Aquarius (Let The Sun Shine In) 2 Pistols & Ray J No More Aquariuslet The Sunshine You Know Me 3OH!3 In 2 Pistols & T Pain & Tay Dizm Don't Trust Me Last Night I Didn't Get To She Got It StarStrukk Sleep At All 21 Demands 3OH!3 & Ke$ha One Less Bell To Answer Give Me A Minute My First Kiss Stoned Soul Picnic 3 Doors Down 3OH!3 & Neon Hitch Up Up & Away Away From The Sun Follow Me Down Wedding Bell Blues Be Like That 3T 6 Tre G Behind Those Eyes Anything Fresh Citizen Soldier 4 Non Blondes 702 Duck & Run What's Up I Still Love You Here By Me 4 P.M.