Alexandriesports Last.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Cultural Diplomacy in Africa Table of Contents: Cultural Diplomacy in Africa
Cultural Diplomacy in Africa Table of Contents: Cultural Diplomacy in Africa 1. Introduction 2. Research Method on Country List 3. North Africa 3.1 Egypt: Introduction 3.2 Egypt: Cultural Diplomacy Projects 3.3 Egypt: Analysis 3.4 Morocco: Introduction 3.5 Morocco: Cultural Diplomacy Projects 3.6 Morocco: Analysis 4. West Africa 4.1 Burkina Faso: Introduction 4.2 Burkina Faso: Cultural Diplomacy Projects 4.3 Burkina Faso: Analysis 4.4 Ghana: Introduction 4.5 Ghana: Cultural Diplomacy Projects 4.6 Ghana: Analysis 4.7 Nigeria: Introduction 4.8 Nigeria: Cultural Diplomacy Projects 4.9 Nigeria: Analysis 5. East Africa 5.1 Kenya: Introduction 5.2 Kenya: Cultural Diplomacy Projects 5.3 Kenya: Analysis 5.4 Tanzania: Introduction 5.5 Tanzania: Cultural Diplomacy Projects 5.6 Tanzania: Analysis 5.7 Uganda: Introduction 5.8 Uganda: Cultural Diplomacy Projects 5.9 Uganda: Analysis 6. Southern Africa 6.1 South Africa: Introduction 6.2 South Africa: Cultural Diplomacy Projects 6.3 South Africa: Analysis 6.4 Zimbabwe: Introduction 6.5 Zimbabwe: Cultural Diplomacy Projects 6.6 Zimb abwe: Analysis 7. Conclusion 8. References 1. Introduction The growth of cultural diplomacy as a means of engaging in international discourse has become increasingly prevalent in developed countries in the Western World, but it is by no means restricted to these states. In recent years, there have been numerous examples of cultural diplomatic effort exercised by states, corporations and individuals across the African continent. In the last fifty years, this region has undergone numerous political and economic changes. The UNDP commends the region’s progress in democratisation, stating that since the independence movements of the 1960s, Africa has the highest number of countries operating under democratic systems. -
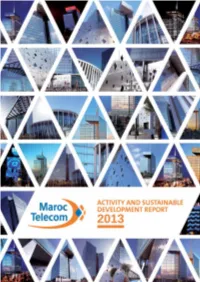
Developement-Report2013 En.Pdf
MAROC Maroc Telecom MAURITANIE MALI Mauritel Sotelma BURKINA FASO Onatel GABON Gabon Télécom 2001 2004 2005 Strategic partner Vivendi IPO, with 14.9% of Vivendi increases its key acquires a 35% stake in the Company's share stake in Maroc Telecom, Maroc Telecom. capital floated on the from 35% to 51%. Acquisition of Casablanca and Paris dates 54% of Mauritel, stock exchanges. Mauritania's incumbent telecommunications operator. A major player in the socioeconomic development of five african countries More than 37 millions customers, + 13,3% year on year 34,7 millions 1,64 millions 3,3 millions customers customers customers mobile-telephony fixed-line active internet MAD 28,56 billion - 4,3 % * from 2012 in revenues MAD 16,2 billion MAD 5,54 billion in EBITDA in net income (Group share) - 3 % * from 2012 - 17,4 % * from 2012 *Like for like 2006 2007 2009 2013 Acquisition in December Acquisition in February of Acquisition in July Vivendi and Etisalat of 51% of Onatel, Burkina 51% of Gabon Télécom of 51% of Sotelma, enter into exclusive Faso's incumbent SA, Gabon's incumbent Mali's incumbent negotiations for the sale telecommunications telecommunications telecommunications of Vivendi's 53% stake in operator. operator. Vivendi operator. Maroc Telecom. increases its stake in Maroc Telecom, from 51% to 53%. 03 Business activity in Morocco MAD 21,3 billion MAD 12,3 billion in revenues in EBITA - 8,1 % from 2012 - 8,2 % from 2012 Mobile customer base Fixe-line customer base Internet customer base ADSL 99,95 % market share 42,85 % 88,01 % * market share market share Internet 3G *Excl. -

QNET Helps Unearth New African Talent Via Tour Du Faso
Oct 29, 2012 02:30 +08 QNET helps unearth new African talent via Tour Du Faso The 26th edition of the Tour Du Faso, one of Africa's premier cycling events, has attracted 15 teams and 70 riders including four teams from outside of Africa. Burkina Cycling Federation chairman, Alassan Ouangrawa, said the competition serves as an excellent platform for African cyclists to compete against some of the world's best riders. "This tour is one of the oldest and most competitive races in Africa and has been around for 26 years. "The level of competition is very high and demanding. It also attracts a lot of media attention from around the world," he said. Ouangrawa said as with any premier sporting event, sponsors play an important role in making the event successful. He added he is very pleased an international company such as QNET has come forward to help develop sports in Africa especially cycling. Cyclists from Burkina Faso, Germany, France, Netherlands, Belgium and other African countries experience an air of festivity at every location with QNET colours and branding prominently welcoming them at the end of each gruelling race. Cycling enthusiasts here are being treated to a world class event with the sport being the second most popular in the country after football. QNET Director of Sports Sponsorships, Mr Joachim Steffen, said the company is delighted to help the development of sport in Burkina Faso and Africa in general. “We understand and appreciate the hard work and commitment put in by the cyclists to reach this level of competition. -

There's Little to Celebrate Over African City Summits - International Business Times
Africités 2006, le rendez-vous kenyan des autorités locales africaines : ... Jean-Pierre Elong Mbassi - Pan Afrique - Kenya - Développement - Afrique Télécharger vos logos et sonneries avec afrik.com Lundi 13 Novembre 2006 :: Société :: Afrique de l’Est :: Kenya :: Pan Afrique Edito Société Africités 2006, le rendez-vous kenyan des autorités locales Economie Internet africaines Entretien avec Jean-Pierre Elong Mbassi Culture Sport lundi 18 septembre 2006, par Falila Gbadamassi Découverte Brèves Dossiers L’Afrique des collectivités locales se retrouve à compter de ce lundi à Nairobi, la capitale Infos par thèmes kenyane, dans le cadre du sommet Africités. Jean-Pierre Elong Mbassi, le secrétaire général du Infos par régions CGLUA (Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique), en résume les enjeux pour Afrik. Infos par pays Carte d'Afrique Archives Voir aussi De notre envoyée spéciale au Kenya GROS PLAN - Le Pnud rend son La vie des Médias « Des stratégies qui permettent de s’ajuster aux Objectifs du millénaire pour le rapport 2006 sur l’indice de Monde créole développement, car, au rythme actuel, ils ne seront atteints que dans 110 ans », dixit Jean-Pierre Elong Mbassi. Les propos du secrétaire général du Partenariat pour le développement Femmes d'Afrik développement municipal (PDM) et du CGLUA (Cités et gouvernements locaux unis humain Clips africains d’Afrique), organisateur du quatrième sommet des collectivités locales, Africités, - Pour une plus Beauté d'Afrik situe bien la portée de la rencontre qu’accueille la ville de Nairobi du 18 au 24 grande présence de septembre 2006. Après Abidjan (Côte d’Ivoire) en 1998, Windhoek (Namibie) en l’Afrique au sein du AfrikEco 2000 et Yaoundé (Cameroun) en 2003, les collectivités locales - le continent africain système onusien compte 15 000 communes - et leurs partenaires se donnent encore rendez-vous - La Chine promet SERVICES pour faire rimer décentralisation et développement. -

SKS-2018-Catalogue.Pdf
2018 EDITION THE MAGAZINE RIDEAIR Air from a can IN THE FAST LANE On the road with an e-bike FIRMLY IN THE SADDLE Team Sauerland NRW MADE IN GERMANY 36 04 26 Ride on CONTENTS.2018 18 24 02 Made in Sundern Dear Biking Fans! The future is orange »Life is like riding a bike. You have to keep on the 06 BIKE LIQUIDS move or you will lose your balance.« These clever Wellness treatment for bikes words from Albert Einstein make our Ride on! slogan clear. Those who want to get things moving 14 SKS-Bike-Trail have to move themselves – pick up speed in order Röhrtal bikers on a test ride to accomplish goals. Keep moving with us! We en- sure that the wheels keep moving with proven pro- 18 MonkeyLink ducts, innovative solutions and fresh ideas. A smart connection Ride on! is not only a request but also a philosophy 24 Air for all! of life that is reflected in our magazine. 48 pages that are brimming with information on the world of The pump station as a model for success SKS make you want to ride on! Let yourself be ins- 32 In the fast Lane pired by our innovations, get valuable tips and get On the road with an eBike to know people who are enthusiastic about biking and who live our message everyday with a passion: 36 Firmly in the Saddle Team Sauerland NRW 42 Cult for the past 50 years Ride on! The RENNKOMPRESSOR Your SKS GERMANY-Team Ride on THE MAGAZINE.2018 THE FUTUREOrange IS It is the colour that stands for power, dynamics »Made in Germany« seal of quality reflects and progress. -

Ecfg-Burkina-Faso-Revised-2019.Pdf
About this Guide This guide is designed to prepare you to deploy to culturally complex environments and achieve mission objectives. The fundamental information contained within will help you understand the cultural dimension of your assigned location and gain skills necessary ECFG for success. The guide consists of 2 parts: Part 1 introduces Burkina Faso “Culture General,” the foundational knowledge you need to operate effectively in any global environment. Part 2 presents “Culture Specific” Burkina Faso, focusing on unique cultural features of Burkina Faso’s society and is designed to complement other pre- deployment training. It applies culture-general concepts to help increase your knowledge of your assigned deployment Location. For further information, visit the Air Force Culture and Language Center (AFCLC) website at https://www.airuniversity.af.edu/AFCLC/ or contact AFCLC’s Region Team at [email protected]. Disclaimer: All text is the property of the AFCLC and may not be modified by a change in title, content, or labeling. It may be reproduced in its current format with the expressed permission of the AFCLC. All photography is provided as a courtesy of the US government, Wikimedia, and other sources as indicated. GENERAL CULTURE CULTURE PART 1 – CULTURE GENERAL What is Culture? Fundamental to all aspects of human existence, culture shapes the way humans view life and functions as a tool we use to adapt to our social and physical environments. A culture is the sum of all of the beliefs, values, behaviors, and symbols that have meaning for a society. All human beings have culture, and individuals within a culture share a general set of beliefs and values. -

Highlights Der Tour-Starter 2015
PALMARES 67. Österreich Rundfahrt 4. - 12. Juli 2015 www.oesterreich-rundfahrt.at Highlights der Tour-Starter 2015 Olympische Spiele 2. Platz: Gustav Larsson, SWE, Cult Energy, Einzelzeitfahren 2008, hinter Fabian Cancellara Weltmeister/Medaillengewinner 1. Platz: Sven Erik Bystrom, NOR, Katusha, U23-Weltmeister Straße 2014 1. Platz: Matej Mahoric,, SLO, Cannondale, U23-Weltmeister Straße 2013 1. Platz: Matej Mahoric, SLO, Cannondale, Junioren-Weltmeister Straße 2012 1. Platz: Gerald Ciolek, GER, MTN, U23-Weltmeister 2006 (Salzburg) 2. Platz: Gustav Larsson, SWE, Cult Energy, Einzelzeitfahren 2009, hinter Fabian Cancellara 3. Platz: Kristoffer Skjerping, NOR, Cannondale, U23-Straßenrennen 2014 2. Platz: Adrien Petit, FRA, Cofidis, U23-Straßenrennen 2011 Tour de France-Etappensieger 1x Kadri Blel, FRA, AG2R, 2014 1x Linus Gerdemann, GER, Cult Energy, 2007 Giro d’Italia-Etappensieger 1x Gustav Larsson, SWE, Cult Energy, 2010 1x Angel Vicioso, ESP, Katusha, 2011 1x Evgeny Petrov, RUS, Tinkoff-Saxo, 2010 1x Chris-Anker Sörensen, DEN, Tinkoff-Saxo, 2010 Vuelta-Etappensieger 3x Daniel Moreno, ESP, Katusha, 2011 und 2013 1x Oliver Zaugg, SUI, Tinkoff-Saxo, 2011 1x Peter Velits, SVK, BMC, 2010 Ö-Tour-Etappensieger 1x Evgeny Petrov, RUS; TInkoff-Saxo, 2014, Dobratsch 1x Chris-Anker Sörensen, DEN, Tinkoff-Saxo, 2007, Kitzbüheler Horn Zahlenspiele, Statistik zur Ö-Tour auf www.oesterreich-rundfahrt.at unter „Media“ und „Statisik & Geschichte!“ Thomas Rohreggers Tour-Analyse 5 Sterne: Stefan Denifl, AUT, IAM Cycling Wir haben heuer sehr viele starke Österreicher bei der Tour, aber Stefan Denifl ist mein absoluter Einserkandidat für den Gesamtsieg. Er hatte im letzten Jahr viel Pech mit seiner Verletzung und hat große Moral bewiesen und gezeigt, dass er einen starken Kopf hat. -

Fp2020 the Way Ahead
FP2020 THE WAY AHEAD 2016 – 2017 WWW.FAMILYPLANNING2020.ORG @FP2020GLOBAL #FP2020PROGRESS WWW.FACEBOOK.COM/FAMILYPLANNING2020 FP2020 THE WAY AHEAD 2016 – 2017 1 PART 01 FP2020 IN COUNTRIES FP2020 PROGRESS REPORT TABLE OF CONTENTS Photo by Ryan Lobo Bill & Melinda Gates Foundation INTRODUCTION SECTION 03 P. 03-16 MEASUREMENT P. 89-126 SECTION 01 FP2020 IN COUNTRIES ESTIMATE TABLES P. 17-70 P. 127-172 SECTION 02 FP2020 AND GLOBAL PARTNERS APPENDICES P. 71-88 P. 173-184 FP2020 works by supporting country-level activities with the HOW backing and participation of global-level partnerships. TO USE SECTION 01 THIS FP2020 in Countries opens with a conceptual map of the REPORT FP2020 process in commitment-making countries, outlining how family planning programs are designed, implemented, monitored, and funded. Subsequent chapters describe the FP2020 country support structure and explore the major ele- ments of a family planning strategy. Progress notes are high- lighted throughout, including commitments announced at the 2017 Family Planning Summit. SECTION 02 FP2020 and Global Partners focuses on the role of the FP2020 partnership in cultivating international support for rights-based family planning. The 2017 Family Planning Sum- mit is featured here, with a summary of the commitments made and the group initiatives (“Global Goods”) announced. This section also reports on bilateral funding and global ex- penditures for family planning, and provides an update on FP2020’s role in the global health architecture. The digital edition of this report is interactive and SECTION 03 includes additional content: Measurement presents analyses of Core Indicators for FP2020 familyplanning2020.org/ focus countries, drawing on the latest estimates. -

Burkina Faso Commercial Guide
Burkina Faso Doing Business in Burkina Faso: 2017 Country Commercial Guide for U.S. Companies Table of Contents Doing Business in Burkina Faso _____________________________________ 5 Market Overview ______________________________________________________________ 5 Market Challenges _____________________________________________________________ 5 Market Opportunities ___________________________________________________________ 6 Market Entry Strategy ___________________________________________________________ 6 Political Environment _______________________________________________ 8 Selling US Products & Services ______________________________________ 8 Establishing an Office __________________________________________________________ 8 Franchising ___________________________________________________________________ 8 Direct Marketing _______________________________________________________________ 8 Joint Ventures/Licensing ________________________________________________________ 9 Selling to the Government _______________________________________________________ 9 Distribution & Sales Channels ____________________________________________________ 9 Express Delivery _______________________________________________________________ 9 Selling Factors & Techniques ____________________________________________________ 9 eCommerce ___________________________________________________________________ 9 Trade Promotion & Advertising ___________________________________________________ 9 Pricing ______________________________________________________________________ -

Burkina Faso's Ouedraogo Wins QNET-Sponsored Tour Du Faso 2012
Oct 30, 2012 17:26 +08 Burkina Faso's Ouedraogo wins QNET- sponsored Tour Du Faso 2012 It was a day of national joy and pride for Burkina Faso when Rasmane Ouedraogo was crowned the Champion of Tour Du Faso 2012. The local boy achieved this feat after completing a gruelling 1,337.3km over 10 stages under the punishing sun, crossing tough but magnificent landscape in this West African nation. The 26th edition of the Tour Du Faso, sponsored by Direct Selling giant QNET, is one of Africa's premier cycling events. It attracted 15 teams and 70 riders including a team each from Germany, France, Netherlands and Belgium. Champion Ouedraogo, who took up cycling as a sport in 2002, said he is very happy that QNET has come on board to sponsor the Tour. He attributed his success to determination and hard work. "I spent the last four months in France preparing for the Tour Du Faso with an intensive training program prepared by my coach. "Since this is the fourth time I am participating in this Tour, I know the level of competition is very high and I was determined to be fully prepared," he said. QNET Director of Sports Sponsorships, Mr Joachim Steffen, said he is delighted that a local rider from Burkina Faso won the 2012 edition of Tour Du Faso. "We share the joy and pride of the people of Burkina Faso today, and I say congratulations to you. It is truly amazing what Ouedraogo has achieved in this very competitive cycling event. "As a company that prides itself in harnessing the power of sport, QNET is truly proud to be a part of the Tour Du Faso. -

News Release
NEWS RELEASE QNET-SPONSORED TOUR DU FASO CONCLUDES TO MUCH ACCOLADE The direct selling giant expresses delight at association with Burkina Faso’s premier sports event October 30, 2012: Global direct selling company, QNET, has been honoured to be a partner of the Tour Du Faso, the 10-day annual cycling event in Burkina Faso, which took place from 19 to 28 October. In this 26th edition, the Tour Du Faso made its way through 10 stages, beginning and ending in Ouagadougou, crossing some of the magnificent landscape of this West African nation. The total distance covered by the cyclists was a staggering 1,337.3km. The Tour Du Faso was first staged in 1987 and has since prospered, becoming an integral part of the Burkina Faso cycling calendar. The event attracted 15 teams and 70 riders including four contingents from outside of Africa. Cyclists from Burkina Faso, Germany, France, Netherlands, Belgium and other African countries experienced an air of festivity at every location with QNET colours and branding prominently welcoming them at the end of each gruelling race. Cycling enthusiasts were treated to a world class event with the sport being the second most popular in the country after football. Burkina Cycling Federation chairman, Alassan Ouangrawa, said the competition serves as an excellent platform for African cyclists to compete against some of the world's best riders, "This tour is one of the oldest and most competitive races in Africa and has been around for 26 years. "The level of competition is very high and demanding. It also attracts a lot of media attention from around the world," he said. -
ECFG Burkina Faso 2021R.Pdf
About this Guide This guide is designed to prepare you to deploy to culturally complex environments and achieve mission objectives. The fundamental information contained within will help you understand the cultural dimension of your assigned location and gain skills necessary for success. The guide consists of 2 ECFG parts: Part 1 introduces “Culture General,” the foundational knowledge you need to operate effectively in Burkina Faso any global environment. Part 2 presents “Culture Specific” Burkina Faso, focusing on unique cultural features of Burkina Faso’s society and is designed to complement other pre- deployment training. It applies culture-general concepts to help increase your knowledge of your assigned deployment Location. For further information, visit the Air Force Culture and Language Center (AFCLC) website at www.airuniversity.af.edu/AFCLC/ or contact AFCLC’s Region Team at [email protected]. Disclaimer: All text is the property of the AFCLC and may not be modified by a change in title, content, or labeling. It may be reproduced in its current format with the expressed permission of the AFCLC. All photography is provided as a courtesy of the US government, Wikimedia, and other sources as indicated. GENERAL CULTURE CULTURE PART 1 – CULTURE GENERAL What is Culture? Fundamental to all aspects of human existence, culture shapes the way humans view life and functions as a tool we use to adapt to our social and physical environments. A culture is the sum of all of the beliefs, values, behaviors, and symbols that have meaning for a society. All human beings have culture, and individuals within a culture share a general set of beliefs and values.