Annecy-Ugine À 1/50 000
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Depliant-Paroisse-2019-2020.Pdf
CÉLÉBRER les SACREMENTS CÉLÉBRER les FUNÉRAILLES Année Baptême Référent : Jean-Luc GUDERZO 06 89 94 19 01 2019-2020 Petits enfants : S’inscrire à l’accueil 4 mois avant Dans chaque communauté locale de la paroisse, des Duingt – Entrevernes la date souhaitée pour la célébration. Des chrétiens, mandatés par l’évêque, préparent et La Chapelle-St-Maurice rencontres ont lieu avec l’équipe paroissiale de animent la cérémonie religieuse avec les familles. Leschaux – Saint-Eustache préparation au baptême. Les parents rencontrent Duingt : Jean-Claude CADOUX 04 50 68 67 38 Saint-Jorioz – Sevrier ensuite le prêtre ou le diacre pour préparer la Entrevernes : Thérèse LIEVRE 04 50 68 55 82 célébration. La paroisse catholique Sainte-Teresa-de- Enfants en âge scolaire : prendre contact avec La Chapelle, Saint Eustache et Leschaux : Calcutta les bords du lac a le plaisir de vous les responsables catéchèse ou aumônerie. Marie-Claude BONNOT 04 50 32 00 49 présenter les activités de la communauté Adultes : Voir Pastorale des Jeunes. Catherine BRIQUET 04 50 51 85 36 paroissiale, avec les coordonnées des Eucharistie Saint Jorioz : Monique BASSET 04 50 52 45 78 responsables. N’hésitez pas à nous contacter. Nous restons à votre entière disposition. Préparation de la première communion : Sevrier : Andrée BAYETTO 04 50 52 42 44 Enfants et jeunes en âge scolaire : a lieu dans ADRESSE – TEL – COURRIEL – SITE ANIMATION LITURGIQUE – CHORALES le cadre de la catéchèse ou de l’aumônerie. Presbytère 251, route de l’église Adultes : se renseigner à l’accueil de la paroisse. « Chanter, c’est prier deux fois ! » Saint Augustin. -

Ordre Du Jour Ainsi Modifié
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU BUREAU SYNDICAL DU 15 NOVEMBRE 2018 L'An deux mille dix-huit, le quinze novembre, à 14 heures 30, le BUREAU du Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie, dûment convoqué en date du 08/11/2018, s'est réuni ‘Salle de réunion’ du SYANE sous la présidence de Monsieur Jean-Paul AMOUDRY. Etaient présents : MM AMOUDRY, ALLARD, BACHELLARD, BOISIER, CATALA, DEAGE, DESCHAMPS, FRANCOIS, GOLLIET-MERCIER, JACQUES, MUGNIER, TRIVERIO, VILLET. MME FRANCESCHI. Avaient donné pouvoir : MM. BOSLAND, PEILLEX, PITTE, STEYER. Etaient absents ou excusés : MM AYEB, BARDET, BAUD-GRASSET, CALMUS, DUCROZ, LAGGOUNE, MOUCHET, PERRET, PEUGNIEZ. Assistaient également à la réunion : MM. SCOTTON, CHALLEAT, GAL, VIVIANT. Mmes DARDE, GIZARD, PERRILLAT, RENOIR : du SYANE Membres en exercice : 27 Présents : 14 Représentés par mandat : 4 ____________________________ Le Président ouvre la séance et propose de retirer le point N°6 « Commune d’YVOIRE - Voie Verte - Aménagement de voirie, renforcement des réseaux humides et enfouissement coordonné des réseaux secs / Lot n°1 - Marchés de travaux dans le cadre du groupement de commandes avec la Communauté d’Agglomération Thonon Agglomération ». Après accord du Bureau, il donne connaissance de l’ordre du jour ainsi modifié : 1. Désignation du secrétaire de séance. 2. Approbation du Compte-rendu de la réunion précédente - 18 octobre 2018. Marchés de travaux 3. Construction de réseaux de distribution publique d’électricité, d’éclairage public et de télécommunications - Programme de Novembre 2018 - Marchés de travaux. 4. Commune d’ANNECY - Commune déléguée d’ANNECY-LE-VIEUX - Rue du Pré d’avril / Rue des Foulques / Rue du Commandant Charcot - Aménagement de voirie et enfouissement coordonné des réseaux secs - Marchés de travaux dans le cadre du groupement de commandes avec la commune. -

Plan Bellecombe
A B C D E F G H I J Commune de 1 La Chapelle-Saint-Maurice Le Néplier t n a n Leschaux Po Commune d’Alèves Sevrier Sevrier Annecy X Le Ferrand Annecy U Commune A du H Liste des voies 2 C S de Leschaux E L C H E E M .................................G5 D I 14 Juillet (Rue du) au N e s IER s L Ancienne scie à grand cadre i D P U É u N R E S T U U 4 Juillet 1944 (Place du).......................G6 U A D 912 O V . D Le Villard derrière R E CH LARD ............................... I5 IL S Adui (Chemin de l’) V Chalets R ES OUTE D R du Sollier O Aix-les-Bains (Route d’)...... A6-7-8-A9-B9 U Y T C UDE E CHEMIN DU A E H C D MURGER N E E E Le Batiéret N T S ............ A9-B7-8-C2à7 T Annecy (Route d’) Ô 3 T A C ’ Côte Chaude E V E E CHEMIN DE I D S D D L Commune S . L I NOVELET A H A E R C P C6-C7- T Bellecombe-en-Bauges (Route de) U D R O S A d’Entrevernes E L T Le Villard devant U D6-E5-E6-F5-F6 O R X U Trou de la A H .........B8 C Bois de la Charniaz (Chemin du) Poteresse S E L S D R ....................... D5-E5 Broissieux (Route de) A L L E I Les Carrons V D Maison S E Précheret ...............................G5 y Carcole (Rue de la) Y D N E Blanche G n I E T P g i T U A Les p U 4 L O a O l G R ........................G5 R Carrière (Chemin de la) G Taissonnières S La Gonnallaz e O d L E C Sur la Size D t S ......................F6-G6 Champ d’Or (Rue du) E Y n D C a Rosset E Glapigny E CH . -

MP Carte Vol Libre (Page 1)
B LÉGENDE LEGEND Décollage Parapente Speed-Riding Danger particulier Brises de vallées Paragliding Takeoff Speedriding Danger Valley breeze A Décollage Deltaplane Décollage Vol rando Interdiction de survol Confluences Hanggliding Takeoff Takeoff Hike and Fly Flyover prohibited Winds converge Kite-Surf Atterrissage Thermiques Survol réglementé - Atterrissage interdit Kitesurfing Landing zone Thermals Flyover regulated - Landing prohibited Snow-Kite Balise Météo Dynamiques Unique zone de pose et décollage dans la RNCFS Snowkiting Weather station Updrafts Only zone where takeoff-landing allowed in RNCFS N D W C E S 3 E F H 6 G 6 a 2 J 6 b I K 7 b 7 a Zones de nidification du Gypaète barbu. Survol à éviter ! 1 Bearded Vulture nesting areas. Please avoid flying over ! Zone de grande sensibilité des rapaces. Être attentif à leur comportement ! Raptor area sensitive to human presence. Please be attentive to their behavior. N 5 1 L M O 4 4 2 P eux de l’environnement Édition 2012 - Ne pas jeter sur la voie publique. 6 1 b 5 Mieux connaitre vos compagnons de vol a Q Vol tranquille : L’oiseau plane ou cercle à coté de vous sans com- 2 5 portement nerveux. Profitez-en en vous éloignant doucement. INFOS PRATIQUES PRACTICAL INFORMATION Vol en feston : Le rapace effectue une alternance de piqués et de Aéroports Airports 1 remontés rapides à coté de vous. Eloignez-vous de la falaise ou de Genève Geneva - Tel.: (+41) 22 717 71 11 - www.gva.ch l’oiseau rapidement. Accueil Rhône-Alpes Rhône-Alpes welcome Desk - (+41) 22 798 2000 - www.accueil-france.org Attaque en piqué : Vous êtes trop près de son aire. -

Bassin Albanais – Annecien
TABLEAU I : BASSIN ALBANAIS – ANNECIEN COLLEGES COMMUNES ET ECOLES René Long ALBY -SUR -CHERAN ; ALLEVES ; CHAINAZ -LES -FRASSES ; CHAPEIRY ; CUSY ; GRUFFY ; HERY -SUR -ALBY ; MURES ; SAINT - ALBY-SUR-CHERAN SYLVESTRE ; VIUZ-LA-CHIESAZ Les Balmettes ANNECY - Annecy : groupes scolaires Vaugelas, La Prairie, Quai Jules Philippe (selon un listing de rues précis – cf. Conseil ANNECY- ANNECY Départemental ou collège) ANNECY- Annecy : groupes scolaires Carnot, La Plaine (selon un listing de rues précis – cf. Conseil Départemental ou collège) , Le Raoul Blanchard Parmelan (selon un listing de rues précis – cf. Conseil Départemental ou collège), Les Romains, Quai Jules Philippe (selon un ANNECY- ANNECY listing de rues précis – cf. Conseil Départemental ou collège), Vallin-Fier (selon un listing de rues précis – cf. Conseil Départemental ou collège) Les Barattes ANNECY- Annecy : groupes scolaires Le Parmelan (selon un listing de rues précis – cf. Conseil Départemental ou collège), Novel (selon un listing de rues précis – cf. Conseil Départemental ou collège); ANNECY- Annecy-le-Vieux (selon un listing de rues ANNECY- ANNECY-LE-VIEUX précis – cf. Conseil Départemental ou collège); BLUFFY ; MENTHON-SAINT-BERNARD ; TALLOIRES-MONTMIN ; VEYRIER-DU-LAC ANNECY-Annecy : groupes scolaires Vallin-Fier (selon un listing de rues précis – cf. Conseil Départemental ou collège), La Plaine Evire (selon un listing de rues précis – cf. Conseil Départemental ou collège), Novel (selon un listing de rues précis – cf. Conseil ANNECY- ANNECY-LE-VIEUX Départemental ou -

Présentation Du Pays De Faverges Et Du Laudon
Présentation du Pays de Faverges et du Laudon Références du dossier Numéro de dossier : IA74001476 Date de l'enquête initiale : 2010 Date(s) de rédaction : 2010 Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire du Parc naturel régional du Massif des Bauges Désignation Aires d'études : Pays de Faverges et du Laudon Présentation Eléments d'historique Ce territoire fut longtemps une mosaïque de paysages. Aux marais de Saint-Jorioz, Doussard et Giez répondaient les vignes établies sur les coteaux calcaires de Sévrier, Duingt, Doussard et Faverges. Les châtaigneraies qui s'étendaient autrefois sur les lisières des forêts constituaient un revenu appréciable pour les habitants de Sévrier, tandis que des prés- vergers entouraient la plupart des villages. Plus haut, près de Saint-Eustache, La Chapelle-Saint-Maurice ou Seythenex, les prairies apportaient le fourrage insuffisant en bas tandis que le bétail paissait dans les alpages des communes de Leschaux, Entrevernes, Lathuile, Doussard, Chevaline, Faverges et Seythenex. Enfin, les importantes forêts du Semnoz, de la Combe d'Ire et du vallon de Saint-Ruph fournissaient du travail aux nombreux bûcherons et charbonniers du territoire. Considérée comme une forêt vierge jusqu'au XIXe s., la Combe d'Ire fut aussi le dernier refuge de l'ours en Haute-Savoie et dans les Bauges. Faverges, véritable bourg industriel dès le Moyen Age, tirait sa prospérité des ressources en eau et du minerai de fer exploité par les moines de Tamié dans la montagne de la Sambuy, tandis qu'au XIXe s., une mine de lignite était exploitée à Entrevernes. Le développement de l'industrie à Faverges au cours du XIXe s, et surtout du tourisme au début du XXe s., sur les rives du lac d'Annecy, modifia considérablement ce territoire proche d'Annecy et soumis à une forte pression foncière. -

Vues Nouvelles Sur La Structure Des Massifs Des Bornes Et Des Bauges Orientales
Géologie Alpine, 1996, t. 72, p. 35-59 Vues nouvelles sur la structure des massifs des Bornes et des Bauges orientales par Maurice GIDON * RÉSUMÉ. — Les failles de l'Arcalod (dans les Bauges) et du Charvin (dans les Bornes orientales), d'une part, et (plus hypothétiquement) l'accident médian de Belledonne, d'autre part, ne constituent qu'une seule et même grande cassure. Apparue en faille extensive au Nummulitique elle a ensuite été reprise en coulissement (comme prolongement du grand cisaillement dextre Simplon-Rhône), puis finalement déformée par enroulement lors de la surrection de l'antiforme des massifs cristallins externes. Le synclinal de Serraval - Arclusaz est l'un des responsables de cette déformation posthume. Au sens strict il ne représente que le tronçon intéressant les massifs des Bornes et des Bauges d'un grand "synclinal bordier des massifs cristallins externes" qui s'est formé après la phase de plissement général des massifs subalpins septentrionaux et en recoupe les virgations. La géométrie des autres failles du massif témoigne également d'une tectonique polyphasée analogue à celle antérieurement reconnue à la latitude de Grenoble. Ces conclusions permettent de mieux préciser la chronologie des étapes de déformation des massifs subalpins septentrionaux. Elles contredisent beaucoup des arguments avancés en faveur de l'hypothèse d'un éventuel chevauchement profond des massifs cristallins externes des Alpes septentrionales françaises et conduisent à envisager d'autres schémas explicatifs pour les rapports de ces derniers avec les chaînes subalpines septentrionales. MOTS CLÉS. — Bauges, Bornes, Décrochement, Chevauchement, Plis, Failles, Tectonique polyphasée Tectonics of the Bornes and eastern Bauges massifs (french external Alps, Haute-Savoie, France) : new data and their régional significance ABSTRACT. -

Réseau Interurbain Pays D'alby
Galbert Collège Chef Lieu Buisson Vers La Clusaz, ta D14 63 r Chorus Albigny ifs Le Grand-Bornand Poisy Ré Parmelan gion 62 63 Petit Port Chavoires A UR 32 Lycée Baudelaire A 32 RÉSEAU INTERURBAINtar 02/09ie A ifs R avo Église des Bressis Hôtel de ville Chavoires UR umil de S 2019 n A ly Terre Veyrier-du-Lac égio PAYS D’ALBY Marché tarifs R Lycée Marquisats Téléphérique D16 G. Fauré ZI Cézardes D Collège Cordeliers GARE ROUTIÈRE Chavanod Le Semnoz Régina Chef Lieu Arcal’Oz PÔLE D’ÉCHANGE ie Stade Z.I. o v Césardes Costa Letraz Charmettes a 1 2 3 4 S 33 e de Beauregard 5 6 7 9 d Le Crêt Crozette 62 erre Centre T commercial 10 14 15 31 Col de Bluffy y Buvette ll i 40 41 42 80 D909 m Val Semnoz u Mairie R 81 82 Proxibus Croix Bluffy fs Semnoz ri Semnoz Guerres Montpellaz 33 ta Glières Le Treige Menthon- 42 Riant Port 21 22 32 33 Presles Saint-Bernard RUMILLY Gare 51 51 52 61 62 41 Chef Lieu Montagny- Les Puisots 63 T72 T73 D1201 Echarvines 52 31 32 33 les-Lanches 40 Lac D909A61 1 2 3 Muret 31 L.P. Roselières Les Granges D1508 d’Annecy Charny Proxibus Les Chapelles Ecoles Vouchy Chef Lieu Sevrier Le Brouillet Mairie tar ifs Chaux-Balmont hors G Chapeiry Gendarmerie ra TALLOIRES-MONTMIN nd Quintal Cessenaz Collège A St-Sylvestre Tuileries Angon nn Chez RUMILLY e Marcelette Vésine Station Epagny c Crochet 51 Chez Daviet Martenex y du Semnoz 61 Les Chataigniers 33 Rochers Blancs 52 DUINGT ALBY-SUR-CHÉRAN Le Pissieux Pont de Monnetier Église Chède Pelevoz Croix Stade Chez Gardet 51 52 31 40 Alby-sur- d’Hère Chéran La Chiésaz Les Alpages Pécoeur Lotissement Fergy tarifs Région AURA Talloires-Montmin Crêt Vial Semnoz42 Le Villard Chez Ruffier Blanly 41 La Combe Croix de Filly Le Bulloz Zone Espace Leaders Chef Lieu Saint-Jorioz Chef Lieu Duingt Croix Rouge Viuz-la-Chiésaz P+R Alby D5 51 Saint- Collège Champ du Loup René Long Mûres Félix Z.A.C. -

Programme Et Bl Inscription
CLUB SIMCA FRANCE Equipe d’animation Rhône-Alpes : [email protected] AIN-ARDECHE ISERE-DROME : RHONE-LOIRE : SAVOIE-HAUTE-SAVOIE : Cécilia PONCET Marcel et Eliane CUAZ Alain MENCIEUX Alain et Christine VARET 213 lotissement Le Morencin 4 route de Romanèche 39 côte Rousset 880 avenue Jean Falconnier Lieu-dit Jailleux 38110 Rochetoirin 69540 Irigny 01350 Culoz 01120 Montluel 06 84 08 94 68 06 19 87 03 52 06 12 45 50 55 06 12 26 70 86 / 06 82 82 05 96 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Samedi 3 octobre Cher(e) adhérent(e), En route pour le musée de la cloche Paccard au bord du Lac d’Annecy …par des routes de traverse ! Programme de la journée : Accueil dès 9h30 sur le parking du supermarché Carrefour à Seyssel. Départ à 10h00 au plus tard. Notre itinéraire pour rejoindre La Ferme de Charbonnière où nous déjeunerons. (www.restaurant-a-la-ferme.fr ) passera par Droisy, Clermont, Mannecy, Chilly, Sallenôves, Cercier, Pont de la Caille (nous y ferrons une pause), Allonzier, Villy-le-Pelloux, Charvonnex, Villaz, Nâves-Parmelan, Alex, Col de Bluffy . Menu : Reblochonnade Pommes de terre Charcuterie assortie Beurre et cornichons Salade Glace fermière Café Après ce repas, nous reprendrons la route pour nous rendre de l’autre côté du Lac d’Annecy à Sevrier où nous visiterons le musée de la Cloche Paccard en passant par Route de Bluffy, Talloires, route du bord du Lac jusqu’à Sevrier . Après cette visite, nous repartirons en traversant Les Bauges pour rejoindre notre point de départ, Seyssel, en traversant Saint-Eustache, La Chapelle-Saint Maurice, Col de Leschaux, Cusy, Héry-sur-Alby, Rumilly, Vallières, le Val de Fier . -

Inventaire Départemental Des Cavités Souterraines Hors Mines —R De La Haute-Savoie ' Rapport Final Convention MEDD N° CV04000065
•••, «> i, Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines —r de la Haute-Savoie ' Rapport final Convention MEDD n° CV04000065 ^ BRGM/RP-54130-FR V..,L , Septembre 2006 \ \ ' - - • :'11 ' "".. /^/ " -•/•..•'' F.9 3740/c-.t -615 5 l* íiwlii. RÉriJSLIQUt F brgGéosciencesm pour une Terre durable JÖ» Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines de la Haute-Savoie Rapport final Convention MEDD n° CV04000065 BRGM/RP-54130-FR Septembre 2006 Étude réalisée dans le cadre des projets de Service public du BRGM 2005 PSP04RHA06 O. Renault Avec la collaboration de D. Clairet Vérificateur : Approbateur : Nom : C. Lembezat Nom : F. Deverly Date : 12/10/06 Date : 14/11/06 Signature : Signature : Le système de management de la qualité du BRGM est certifié AFAQ ISO 9001:2000. BRGM Geosciences pour une lene durable 2 0 DEC. 2006 BIBLIOTHEQUE brgm Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines de la Haute-Savoie Mots clés : base de données, inventaire, département de la Haute-Savoie, cavités souterraines, cavités naturelles, carrières souterraines abandonnées, ouvrages civils et militaires En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante : O. Renault avec la collaboration de D. Clairet (2006) - Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines de la Haute-Savoie. Rapport final. BRGM/RP-54130-FR, 47 p., 27 ill., 3 ann., 1 carte hors texte ® BRGM, 2006, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l'autorisation expresse du BRGM. BRGM/RP-54130-FR - Rapport final Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines de la Haute-Savoie Synthèse Dans le cadre de la constitution d'une base de données nationale des cavités souterraines, le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable (MEDD), a chargé le BRGM de réaliser l'inventaire des cavités souterraines abandonnées hors mines dans le département de la Haute-Savoie (Convention MEDD n° CV04000065). -
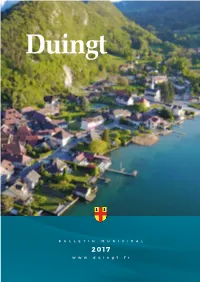
BULLETIN MUNICIPAL 2017 Un Instant Gourmand Dans Un Cadre Unique
Duingt BULLETIN MUNICIPAL 2017 www.duingt.fr Un instant gourmand dans un cadre unique MENU DU JOUR 14 € Le chef Alexandre vous propose une cuisine élaborée à base de produits frais, de saison et labellisés. Route du Port 74410 Saint-Jorioz ● 04 50 68 69 92 www.restaurant-lacetmontagne.com Lac d’Annecy 410 Allée de la Plage - 74410 Duingt 259, route d’Annecy 74410 DUINGT Tél. : 33 (0)4 50 68 14 10 [email protected] 04 50 68 68 79 www.closmarcel.com 251, Route d’Annecy - 74410 Duingt Tél. 04 50 68 67 23 2 BULLETIN MUNICIPAL DUINGT - 2017 BULLETIN MUNICIPAL DUINGT - 2017 1 Sommaire Le mot du maire ...........................................................2 LOISIRS Takaplonger ............................................................... 23 VIE DE LA COMMUNE Sécurité ...............................................................................3 RÉTROSPECTIVE ........................................ 24/25 Finances .........................................................................4/5 Travaux..........................................................................6/9 Eclairage public VIE ASSOCIATIVE l Enfouissement des lignes Comité des Fêtes de Duingt .....................26/27 Conduites eau potable Le Sou des Ecoles .................................................... 28 BULLETIN MUNICIPAL Marmottons (fin des travaux) Les Bouchons 74 ...................................................... 29 DUINGT 2017 Fibre optique Chœur de l'Eau Vive ......................................30/31 Directeur de la publication : Rond-point de la -

Publication of the Amended Single Document Following the Approval Of
16.3.2021 EN Offi cial Jour nal of the European Union C 89/19 Publication of the amended single document following the approval of a minor amendment pursuant to the second subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 (2021/C 89/08) The European Commission has approved this minor amendment in accordance with the third subparagraph of Article 6(2) of Commission Delegated Regulation (EU) No 664/2014 (1). The application for approval of this minor amendment can be consulted in the Commission’s eAmbrosia database. SINGLE DOCUMENT ‘REBLOCHON’/’REBLOCHON DE SAVOIE’ EU No: PDO-FR-0130-AM01 – 3.9.2020 PDO (X) PGI ( ) 1. Name(s) ‘Reblochon’/‘Reblochon de Savoie’ 2. Member State or third country France 3. Description of the agricultural product or foodstuff 3.1. Type of product Class 1.3. Cheeses 3.2. Description of the product to which the name in (1) applies ‘Reblochon’/‘Reblochon de Savoie’ is an uncooked cheese made from raw, whole cow’s milk, pressed in the form of a flattened, slightly tapered cylinder approximately 14 cm in diameter, 3,5 cm in height and 450 to 550 g in weight. It contains a minimum of 45 g of fat per 100 g after total desiccation and its dry matter must not be less than 45 g per 100 g of cheese. It has a fine, regular and uniform rind, which is washed during the maturing process. The rind is yellow to orangey- yellow in colour and may be fully or partly covered in a fine, short white bloom.