L'etude Sur La Gestion Des Forets Classees Dans La
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Partielles Du 23 Fevrier 2014
PARTIELLES DU 23 FEVRIER 2014 Etat des bureaux de vote de l'arrondissement 4 de Ouagadougou et des communes concernées par les élections partielles du 23 Février 2014 N° REGION PROVINCE COMMUNE ARRONDISSEMENT SECTEUR_VILLAGE LIEU EMPLACEMENT BV NB 1 CASCADES COMOE SOUBAKANIEDOUGOU BADARA ECOLE ECOLE BV1 126 2 CASCADES COMOE SOUBAKANIEDOUGOU DAMANA PROJET RIZ PROJET RIZ BV1 455 3 CASCADES COMOE SOUBAKANIEDOUGOU DOUGOUDIOULAMA CFJA CFJA BV1 127 4 CASCADES COMOE SOUBAKANIEDOUGOU FORNOFESSO MAGASIN GPC MAGASIN GPC BV1 175 5 CASCADES COMOE SOUBAKANIEDOUGOU GOUERA ECOLE ECOLE BV1 539 6 CASCADES COMOE SOUBAKANIEDOUGOU GOUINDOUGOUBA DABLASSO ECOLE BV1 204 7 CASCADES COMOE SOUBAKANIEDOUGOU GOUINDOUGOUBA ECOLE CENTRE ECOLE CENTRE BV1 287 8 CASCADES COMOE SOUBAKANIEDOUGOU GOUINDOUGOUNI SERIBABOUGOU ECOLE BV1 243 9 CASCADES COMOE SOUBAKANIEDOUGOU GOUINDOUGOUNI ECOLE ECOLE BV1 423 10 CASCADES COMOE SOUBAKANIEDOUGOU KATIERLA ECOLE CEBNF ECOLE CEBNF BV1 298 11 CASCADES COMOE SOUBAKANIEDOUGOU LETIEFESSO MAGASIN MAGASIN BV1 454 12 CASCADES COMOE SOUBAKANIEDOUGOU MAMBIRE MAGASIN GPC MAGASIN GPC BV1 170 13 CASCADES COMOE SOUBAKANIEDOUGOU NAFONA BRAMAVOGO MAGASIN BV1 102 14 CASCADES COMOE SOUBAKANIEDOUGOU NAFONA CFJA CFJA BV1 231 15 CASCADES COMOE SOUBAKANIEDOUGOU PANGA CFJA CFJA BV1 308 16 CASCADES COMOE SOUBAKANIEDOUGOU SOUBAKANIEDOUGOU BAGNAGARA ECOLE BV1 167 17 CASCADES COMOE SOUBAKANIEDOUGOU SOUBAKANIEDOUGOU ECOLE ECOLE BV1 260 18 CASCADES COMOE SOUBAKANIEDOUGOU SOUBAKANIEDOUGOU ECOLE BOUGAMA ECOLE BOUGAMA BV1 496 19 CASCADES COMOE SOUBAKANIEDOUGOU -
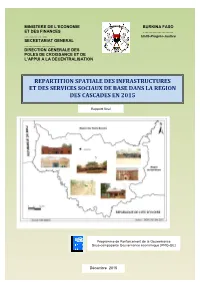
Repartition Spatiale Des Infrastructures Et Des Services Sociaux De Base Dans La Region Des Cascades En 2015
MINISTERE DE L’ECONOMIE BURKINA FASO ET DES FINANCES ………..………... …..……….... Unité-Progrès-Justice SECRETARIAT GENERAL ………..……….... DIRECTION GENERALE DES POLES DE CROISSANCE ET DE L’APPUI A LA DECENTRALISATION REPARTITION SPATIALE DES INFRASTRUCTURES ET DES SERVICES SOCIAUX DE BASE DANS LA REGION DES CASCADES EN 2015 Rapport final Programme de Renforcement de la Gouvernance Sous-composante Gouvernance économique (PRG-GE) Décembre 2015 TABLE DES MATIERES AVANT-PROPOS ................................................................................................................... III LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS ............................................................................... IV RESUME .............................................................................................................................. VIII INTRODUCTION ..................................................................................................................... 1 PREMIERE PARTIE: CADRE GENERAL ................................................................................ 2 I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE ................................................................... 2 II- OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS ......................................................................... 3 III- METHODOLOGIE DE TRAVAIL ........................................................................................ 4 III-1- Collecte des données secondaires .................................................................................. 4 III-2- -

Vrs - Burkina Faso
VRS - BURKINA FASO Ouagadougou, le 27/10/2012BAGASSIBALE STATISTIQUES DES BUREAUX DE VOTES PAR COMMUNES \ ARRONDISSEMENTS REGION BOUCLE DU MOUHOUN PROVINCE BALE COMMUNE BAGASSI Secteur/Village Emplacement Bureau de vote Inscrits ASSIO ASSIO II\ECOLE Bureau de vote 1 219 BADIE ECOLE Bureau de vote 1 177 BAGASSI ECOLE Bureau de vote 1 542 BAGASSI TINIEYIO\ECOLE Bureau de vote 1 470 BANDIO ECOLE Bureau de vote 1 253 BANOU ECOLE Bureau de vote 1 191 BASSOUAN ECOLE Bureau de vote 1 201 BOUNOU ECOLE1 Bureau de vote 1 246 BOUNOU ECOLE2\ECOLE1 Bureau de vote 1 233 DOUSSI ECOLE B Bureau de vote 1 206 HAHO CENTRE\CENTRE ALPHABETISATION Bureau de vote 1 177 KAHIN ECOLE Bureau de vote 1 258 KAHO ECOLE Bureau de vote 1 273 KANA ECOLE Bureau de vote 1 269 KAYIO ECOLE Bureau de vote 1 220 KOUSSARO ECOLE Bureau de vote 1 305 MANA ECOLE Bureau de vote 1 495 MANA ECOLE Bureau de vote 2 264 MANZOULE HANGAR Bureau de vote 1 132 MOKO HANGAR Bureau de vote 1 308 NIAGA HANGAR Bureau de vote 1 128 NIAKONGO ECOLE Bureau de vote 1 293 OUANGA HANGAR Bureau de vote 1 98 PAHIN ECOLE Bureau de vote 1 278 SAYARO ECOLE Bureau de vote 1 400 SIPOHIN ECOLE Bureau de vote 1 249 SOKOURA ECOLE Bureau de vote 1 152 VY ECOLE1 Bureau de vote 1 360 VY ECOLE2\ECOLE1 Bureau de vote 1 369 VYRWE MAGASIN Bureau de vote 1 127 YARO ECOLE Bureau de vote 1 327 Nombre de bureaux de la commune 31 Nombre d'inscrits de la commune 8 220 2 REGION BOUCLE DU MOUHOUN PROVINCE BALE COMMUNE BANA Secteur/Village Emplacement Bureau de vote Inscrits BANA KOKOBE\PREFECTURE Bureau de vote 1 353 BANA -

Ceni - Burkina Faso
CENI - BURKINA FASO ELECTIONS COUPLEES PRESIDENTIELLE / LEGISLATIVES DU 22/11/2020 STATISTIQUES DES BUREAUX DE VOTE PAR COMMUNE / ARRONDISSEMENTS LISTE DEFINITIVE REGION : AFRIQUE PROVINCE : AFRIQUE DU SUD COMMUNE : PRETORIA AMBASSADE PRETORIA SECTEUR / VILLAGE LIEU EMPLACEMENT BUREAU DE VOTE NB_INSCRITS PRETORIA PRETORIA AMBASSADE Bureau de vote 1 85 Nombre de bureau de vote PRETORIA/AMBASSADE PRETORIA : 1 Nombre d'inscrits de la commune de PRETORIA/AMBASSADE PRETORIA :85 REGION : AFRIQUE PROVINCE : BENIN COMMUNE : COTONOU CONSULAT COTONOU SECTEUR / VILLAGE LIEU EMPLACEMENT BUREAU DE VOTE NB_INSCRITS COTONOU COTONOU CONSULAT Bureau de vote 1 494 COTONOU COTONOU CONSULAT Bureau de vote 2 286 Nombre de bureau de vote COTONOU/CONSULAT COTONOU : 2 Nombre d'inscrits de la commune de COTONOU/CONSULAT COTONOU :780 REGION : AFRIQUE PROVINCE : COTE D'IVOIRE COMMUNE : ABIDJAN AMBASSADE ABIDJAN SECTEUR / VILLAGE LIEU EMPLACEMENT BUREAU DE VOTE NB_INSCRITS ABIDJAN AMB ABIDJAN Ambassade1 Bureau de vote 1 294 ABIDJAN AMB ABIDJAN Ambassade1 Bureau de vote 2 294 ABIDJAN AMB ABIDJAN Ambassade2 Bureau de vote 1 418 ABIDJAN AMB ABIDJAN Ambassade4 Bureau de vote 1 299 ABIDJAN AMB ABIDJAN Ambassade4 Bureau de vote 2 299 ABIDJAN AMB ABIDJAN Ambassade5 Bureau de vote 1 355 Nombre de bureau de vote ABIDJAN/AMBASSADE ABIDJAN : 6 Nombre d'inscrits de la commune de ABIDJAN/AMBASSADE ABIDJAN :1.959 REGION : AFRIQUE PROVINCE : COTE D'IVOIRE COMMUNE : ABIDJAN CONSULAT ABIDJAN SECTEUR / VILLAGE LIEU EMPLACEMENT BUREAU DE VOTE NB_INSCRITS ABIDJAN ABIDJAN CONSULAT2 -

Burkina Faso
CENI - BURKINA FASO ELECTIONS COUPLEES PRESIDENTIELLE/LEGISLATIVES DU 29/11/2015 STATISTIQUES DES BUREAUX DE VOTE PAR COMMUNES \ ARRONDISSEMENTS LISTE DEFINITIVE CENI 29/11/2015 REGION : BOUCLE DU MOUHOUN PROVINCE : BALE COMMUNE : BAGASSI Secteur/Village Emplacement Bureau de vote Inscrits ASSIO ASSIO II\ECOLE Bureau de vote 1 348 BADIE ECOLE Bureau de vote 1 239 BAGASSI ECOLE Bureau de vote 1 441 BAGASSI ECOLE Bureau de vote 2 393 BAGASSI TINIEYIO\ECOLE Bureau de vote 2 202 BAGASSI TINIEYIO\ECOLE Bureau de vote 1 439 BANDIO ECOLE Bureau de vote 1 325 BANOU ECOLE Bureau de vote 1 314 BASSOUAN ECOLE Bureau de vote 1 252 BOUNOU ECOLE1 Bureau de vote 1 353 BOUNOU ECOLE2\ECOLE1 Bureau de vote 1 329 DOUSSI ECOLE B Bureau de vote 1 369 HAHO CENTRE\CENTRE ALPHABETISATION Bureau de vote 1 212 KAHIN ECOLE Bureau de vote 1 390 KAHO ECOLE Bureau de vote 1 347 KANA ECOLE Bureau de vote 1 322 KAYIO ECOLE Bureau de vote 1 301 KOUSSARO ECOLE Bureau de vote 1 415 MANA ECOLE Bureau de vote 1 458 MANA ECOLE Bureau de vote 2 443 MANZOULE MANZOULE\ECOLE Bureau de vote 1 166 MOKO HANGAR Bureau de vote 1 393 NIAGA NIAGA\ECOLE Bureau de vote 1 196 NIAKONGO ECOLE Bureau de vote 1 357 OUANGA OUANGA\ECOLE Bureau de vote 1 164 PAHIN ECOLE Bureau de vote 1 375 SAYARO ECOLE Bureau de vote 1 461 SIPOHIN ECOLE Bureau de vote 1 322 SOKOURA ECOLE Bureau de vote 1 184 VY ECOLE1 Bureau de vote 1 531 VY ECOLE2\ECOLE1 Bureau de vote 1 451 VYRWA VIRWA\ECOLE Bureau de vote 1 141 YARO ECOLE Bureau de vote 1 476 Nombre de bureaux de la commune 33 Nombre d'inscrits de la commune 11 109 CENI/ Liste definitive des Bureaux de Vote 29 - Nov. -

Burkina Faso
CENI - BURKINA FASO ELECTIONS MUNICIPALES DU 22/05/2016 STATISTIQUES DES BUREAUX DE VOTE PAR COMMUNES \ ARRONDISSEMENTS LISTE DEFINITIVE CENI 22/05/2016 REGION : BOUCLE DU MOUHOUN PROVINCE : BALE COMMUNE : BAGASSI Secteur/Village Emplacement Bureau de vote Inscrits ASSIO ASSIO II\ECOLE Bureau de vote 1 355 BADIE ECOLE Bureau de vote 1 243 BAGASSI ECOLE Bureau de vote 1 440 BAGASSI ECOLE Bureau de vote 2 403 BAGASSI TINIEYIO\ECOLE Bureau de vote 2 204 BAGASSI TINIEYIO\ECOLE Bureau de vote 1 439 BANDIO ECOLE Bureau de vote 1 331 BANOU ECOLE Bureau de vote 1 320 BASSOUAN ECOLE Bureau de vote 1 252 BOUNOU ECOLE1 Bureau de vote 1 358 BOUNOU ECOLE2\ECOLE1 Bureau de vote 1 331 DOUSSI ECOLE B Bureau de vote 1 376 HAHO CENTRE\CENTRE ALPHABETISATION Bureau de vote 1 217 KAHIN ECOLE Bureau de vote 1 395 KAHO ECOLE Bureau de vote 1 349 KANA ECOLE Bureau de vote 1 323 KAYIO ECOLE Bureau de vote 1 303 KOUSSARO ECOLE Bureau de vote 1 419 MANA ECOLE Bureau de vote 1 458 MANA ECOLE Bureau de vote 2 451 MANZOULE MANZOULE\ECOLE Bureau de vote 1 166 MOKO HANGAR Bureau de vote 1 395 NIAGA NIAGA\ECOLE Bureau de vote 1 198 NIAKONGO ECOLE Bureau de vote 1 357 OUANGA OUANGA\ECOLE Bureau de vote 1 164 PAHIN ECOLE Bureau de vote 1 378 SAYARO ECOLE Bureau de vote 1 465 SIPOHIN ECOLE Bureau de vote 1 324 SOKOURA ECOLE Bureau de vote 1 184 VY ECOLE1 Bureau de vote 1 534 VY ECOLE2\ECOLE1 Bureau de vote 1 453 VYRWA VIRWA\ECOLE Bureau de vote 1 141 YARO ECOLE Bureau de vote 1 481 Nombre de bureaux de la commune 33 Nombre d'inscrits de la commune 11 207 CENI/ Liste definitive -

Etudes Physiques Préliminaires À L'aménagement Rizicole Du Bas
MINISTRKE DES ENSEIGNEMENTS BURKINA FASO S1:I:ONDAlRfi, SIJPERIHUR ET DE:. 1.a Patrie ou la Mort, Nous Vaincrons ! i a A KECII i3KC:Ii ii SC1I:NY J FI QUI3 UNIVEKSITE DE OUAGADOUGOU ~. - _- -- INSTITUT DES SCIENCES HlJMhINES ET SOCIALES - INSHUS -. DKPAKT'EMENT DE GEUGKAPHIE MEMûlRE POUR L'OBTENTION DU DIPLBME üE MAITRISE Septembre 1498 ff " DEDICACE A TOUTE MA FAMILLE, A MA FAMILLE ADOPTIVE, A MES AMIS(ES) Tables des matiéres Pages Avant -Propos 1 1 rttroduction 2 Ière Partie : GENERALITES. -.Chapitre. __. 1 : Théories et rxuble.mati-gucs sur les bas-fonds. 1 - Qu'est-ce-qu'uii 13as-fmd 7 2 - Ccm iiieiit choisit-oii uii k)aç-rcuid T 2.1 - Les facteurs physiques. 2.1,l - La tc>pc)grapliie 2.1.2 -. La dispmiibilité en terre. 2.1 ..3.-- L 1iyiri;)icigie ct la disponibilité eii eau. 2.2.- Ler facteur5 s~~i~)-éc~iioiiiiqueç. 2.2.1 ,- Les traditions locales des payraiiz. 2.2.2.-Les prob1èiiier fonciers et Iiuniaiiir. - (,)ueiies soiit les tecliiiiyues d'a iiiétiagetiietit d'uii bas-foiid 7 10 .. .i.1 .- Les principes ci'iiii aménageaient de bas-f oiid. 10 -3 2.- Ouelques ouvrages et leurs rfiles. 10 4, - t.) u e 1y ues t J-pe s d'a 111éii ag e 111e nt cf e b as -hiJ , 12 4.1, - L'ameiiageiiieiit simple 12 4.2.- L'ûtiiéiiagemeiit aiiiéiicire : L'aménagement avec petite retenue 13 Chapitre 2 : Le bassin-versant de Darnana : Une pénéplaine monotone 1 - Ouelles snrit le? caractéristiques physiques du bassin-versant 7 19 1,11- La topograpliie 19 1 2.- Sa ïc)riiiatioti gecilogiyiie : Le graiiito-gneiss n 1 ..?.- Sa gCotiiorpliologie. -

11-Taux De Fonctionnalité Des Forages En 2017 Par Village
11_Taux de fonctionnalité des forages en 2017 par village NOM_REGION NOM_PROVINCE NOM_COMMUNE BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BAGASSI BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BANA BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE BOROMO BOUCLE DU MOUHOUN BALE -

The Study on the Management of Forest Reserves in the Province of Comoe
No. Japan International Cooperation Agency (JICA) Ministry of Environment and Habitat Burkina Faso The Study on the Management of Forest Reserves in the Province of Comoe BURKINA FASO FINAL REPORT July 2005 INTERNATIONAL DEVELOPMENT CENTER OF JAPAN TAIYO CONSULTANTS CO., LTD. GE JR 05-033 Exchange Rate 1FCFA=JP¥0.2130 (May 2005) Preface In response to a request of the Government of Burkina Faso, the Government of Japan decided to conduct the study on the Management of Forest Reserves in the Province of Comoe and entrusted to the study to the Japan International Cooperation Agency (JICA). JICA selected and dispatched the study team headed by Dr. Junichi WATANABE of International Development Center of Japan and consists of International Development Center of Japan and Taiyo Consultants Co., LTD. between Sep 2002 and Jun 2005. The team held discussions with the officials concerned of the Government of Burkina Faso and conducted field surveys at the study area. Upon returning to Japan, the team conducted further studies and prepared this final report. I hope that this report will contribute to the promotion of this project and to the enhancement of friendly relationship between our two countries. Finally, I wish to express my sincere appreciation to the officials concerned of the Government of Burkina Faso for their close cooperation extended to the study. July 2005 Etsuo KITAHARA, Vice President Japan International Cooperation Agency Letter of Transmittance Mr. Etsuo Kitahara Vice president Japan International Cooperation Agency July, 2005 Dear Mr. Kitahara, The Study for Forest Management Plan for Comoe Province in Burkina Faso has now been completed and the Final Report for the Study is submitted herewith. -

BURKINA FASO a La Date Du 06 Juillet 2020
- Carte de référence de la région de Cascades BURKINA FASO A la date du 06 juillet 2020 5°0'W 4°0'W Karangasso - Sambla Djigouera TUY Koloko Koumbia Bobo-Dioulasso Gouassa 11°0'N 11°0'N Kangala Outiela KENEDOUGOU Orodara Bondigui Kourinion Ko Fine HAUTS-BASSINS Orodara Karangasso - Vigue HOUET Pelignan Plateau du Tagouara Sebon Sarkandiala Toussiana Samogohiri Peni Dolo Oueleni Foloni Oueleni Nalera Mondon Zangokala BOUGOURIBA Sanankoro Kinga Moussobadougou Nianguelekogo Kapere Diomou Daramandougou Iripe Luniongo Moussodougou Dionso Kondaya Kokora Kankalaba Kaniagara Kolokolo Tagbaladougou Badara Bougoula MALI Nianbougouzi Tourni Seri Mozonon Monon Labi Beregadougou Tino Tena Bolante Dolofa Diali Boui Dousso Youkoa Konbili Beregadougou Dalena Niankadougou Sinasigbe Deregboue Talisoukoa Niantono Daniera Nofin Dinaoro Sindou Kolana Koba Serefedougou Konsan Kongbelegban Iolonioro Kadougou Lafa Lougou Kobe Kolessi Nierinteno Diurmanko Tarfila Kononiarako Degue Degue Bougoura Irikourounko Sikongo Nioro Tiankoura Fobole Gogo Louara Tioulankoulo Naaka Wolokonto Karfiguela Guibe Wolopekaha Sindoukouroni Noussou Waouro KokoulouNabe Wolonkonto Lafigue Nafouna Panapra Kameledala Leraba Sindou Kangouena Klani Chion Niofila Tengrela Bounouna Tanga Sideradougou Bougousso Koko NiegueniKanno Tamassari Mpogona Tinba Mossona Kiribina Tatana Kongan Kongouko Kanhozi Douna Nianbogo Kourou Mpara Ko Kawara Badini Alana Oulmane Toumousseni Tiekouna Tangoura Tieforo Loumana Lafode Kanvara Wattara Ko Labola Outourou Faniagara Douna Mou Ninkana Banfora Yakranyimasso -

Chapitre4 Situation Actuelle De La Forêt Classée De Toumousséni
Chapitre4 Situation actuelle de la Forêt Classée de Toumousséni 4. Situation actuelle de la Forêt Classée de Toumousséni 4.1. Forêt Classée de Toumousséni 4.1.1. Historique de la Forêt Classée de Toumousséni et la gestion de ses limites Le Tableau 4.1 fait une présentation sommaire de la Forêt Classée de Toumousséni. Cette forêt a été déclarée forêt classée en 1954 avant les indépendances suivant l’Arrêté N° 2.875/SE/F. La raison de cette décision n’a pas été mentionnée dans l’Arrêté, toutefois, on considère de nos jours que l’objectif de la forêt classée est l’approvisionnement de la ville de Banfora en bois de chauffe (source: Direction Régionale de l’Environnement et du Cadre de Vie des Cascades). Tableau 4.1 Aperçu sommaire de la Forêt Classée de Toumousséni Date de classement Superficie Lieu de la N° de l’Arrêté Situation des limites ** (ha)* Déclaration Les limites matérialisées avec des N° 2.500 12 Avr. 1954 Dakar bornes. 2.875/SE/F (2.523) Les limites ont été levées. *. Le premier chiffre indique la zone mentionnée dans le décret. Les chiffres ont été calculés à partir des données SIG **: La date d’établissement du décret est présentée comme la date de la déclaration. Conformément à l’Arrêté, certains droits d’usage des ressources de la forêt sont accordés aux communautés locales par l’article 14 de l’ancienne loi en matière de foresterie à savoir, le droit à la collecte du bois mort, des fruits, des plantes comestibles et médicinales. Par contre, l’interdiction de la chasse est décrite dans un autre article du décret. -

La Répartition Des Glossines En Haute-Volta, Plus De Détails Qu'on Ne L'avait Fait Jusqu'ici
A. CHALLIER C. LAVEISSIERE NOTICE EXPLICATIVE No 69 LA REPARTITION DES GLOSSINES Elù HAUTE-VOLTA càtteà 1/2000000 OFFICE OE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER J IIIIl PARIS 197-I I NOTICE EXPLICATIVE No 69 LA REPARTITION DES GLOSSINES l EN HAUTE-VOLTA Carte à 1/2 O00 O00 A. CHALLIER * C. LAVEISSIERE * ORSTOM PARIS 1977 . I OORSTOM 1977 ISBN 2 - 7099 - 0403 - 9 i I INTRODUCTION Aucune carte derépartition des glossines en Haute-Volta n'a jusqu'ici été publiée ; il existe seulement plusieurs cartesà petite échelle pour l'ensemble de l'Afrique Occidentale. Dans son article sur "Les mouches tsétsés en Afrique Occidentale Française", ROUBAUD (1920) présente la première carte de répartition des glossines dans I'an- cienne fédération, dressée à la suite des "Missions BOUET-ROUBAUD, 1906-1916". Pour la Haute-Volta, les espèces sont signalées le long de la Volta noire, de la Volta blanche et de la Volta rouge ainsi que dans les régions de Diébougou, Gaoua, Tenkodogo. Glossina palpalis (auct.) est mentionnée à Dori, en zone sahélienne. A partir de 1939, date de la création du "Service autonome de la Maladie du Sommeil", est lancée, sous la direction de H. GASCHEN, une vaste campagne de capture et d'identification des glossines sur tout le territoire de l'ancienne fédé- ration d'A.0.F. Après 9 ans de prospection, une première mise au point sur la répartition des glossines en Afrique Occidentale francophone est publiée, suivie d'une carte, en deux feuilles au 1/3 O00 OOOe (VILAIN, 1948-1949). Plus tard, POTTS (19531, chargé de réunir en une carte au 1/5 O00 OOOe en trois feuilles, les données disponibles dans toute l'Afrique reprend les données de VILAIN ; mais, en ce qui concerne G.