La Dynamique Du Peuplement Sereer : Les Sereer Du Sine
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Fatick 2005 Corrigé
REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES -------------------- AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE ----------------- SERVICE REGIONAL DE FATICK SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE DE LA REGION DE FATICK EDITION 2005 Juin 2006 SOMMAIRE Pages AVANT - PROPOS 3 0. PRESENTATION 4 – 6 I. DEMOGRAPHIE 7 – 14 II. EDUCATION 15 – 19 III. SANTE 20 – 26 IV. AGRICULTURE 27 – 35 V. ELEVAGE 36 – 48 VI. PECHE 49 – 51 VII. EAUX ET FORETS 52 – 60 VIII. TOURISME 61 – 64 IX. TRANSPORT 65 - 67 X. HYDRAULIQUE 68 – 71 XI. ARTISANAT 72 – 74 2 AVANT - PROPOS Cette présente édition de la situation économique met à la disposition des utilisateurs des informations sur la plupart des activités socio-économiques de la région de Fatick. Elle fournit une base de données actualisées, riches et détaillées, accompagnées d’analyses. Un remerciement très sincère est adressé à l’ensemble de nos collaborateurs aux niveaux régional et départemental pour nous avoir facilité les travaux de collecte de statistiques, en répondant favorablement à la demande de données qui leur a été soumise. Nous demandons à nos chers lecteurs de bien vouloir nous envoyer leurs critiques et suggestions pour nous permettre d’améliorer nos productions futures. 3 I. PRESENTATION DE LA REGION 1. Aspects physiques et administratifs La région de Fatick, avec une superficie de 7535 km², est limitée au Nord et Nord - Est par les régions de Thiès, Diourbel et Louga, au Sud par la République de Gambie, à l’Est par la région de Kaolack et à l’Ouest par l’océan atlantique. Elle compte 3 départements, 10 arrondissements, 33 communautés rurales, 7 communes, 890 villages officiels et 971 hameaux. -

SEN FRA REP2 1999.Pdf
REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE L’AGRICULTURE Projet GCP/SEN/048/NET Recensement National de l’Agriculture et Système Permanent de Statistiques Agricoles RECENSEMENT NATIONAL DE L’AGRICULTURE 1998-99 Volume 2 Répertoire des villages d’après le pré-recensement de l’agriculture 1997-98 Août 1999 ___________________________________________________________________________ ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO) Sommaire Données récapitulatives par unité administrative ……………………………………….… 9 Données individuelles relatives à la région de Dakar …………………………………….. 35 Données individuelles relatives à la région de Diourbel …………………………………. 41 Données individuelles relatives à la région de Saint-Louis ………………………….….. 105 Données individuelles relatives à la région de Tambacounda …………………………... 157 Données individuelles relatives à la région de Kaolack …………………………………. 237 Données individuelles relatives à la région de Thiès ……………………………………. 347 Données individuelles relatives à la région de Louga …………………………………… 427 Données individuelles relatives à la région de Fatick …………………………………… 557 Données individuelles relatives à la région de Kolda …………………………………… 617 Carte administrative du Sénégal ………………………………………………………… 727 3 Avant-propos Ce volume 2 des publications sur le pré-recensement de l’agriculture 1997-98 est consacré à la publication d’un répertoire des villages construit à partir des données issues des opérations de collecte du pré-recensement qui ont consisté en une opération de cartographie censitaire et en une enquête sur les ménages ruraux. Le répertoire des villages publié dans ce volume 2 est simplement la liste exhaustive des villages, avec pour chaque village, les valeurs de plusieurs paramètres de taille. A titre d’exemple, l’effectif des concessions rurales, l’effectif des ménages ruraux et l’effectif des ménages ruraux agricoles sont trois variables de taille du village dont les valeurs figurent dans ce répertoire des villages. -

Report on Language Mapping in the Regions of Fatick, Kaffrine and Kaolack Lecture Pour Tous
REPORT ON LANGUAGE MAPPING IN THE REGIONS OF FATICK, KAFFRINE AND KAOLACK LECTURE POUR TOUS Submitted: November 15, 2017 Revised: February 14, 2018 Contract Number: AID-OAA-I-14-00055/AID-685-TO-16-00003 Activity Start and End Date: October 26, 2016 to July 10, 2021 Total Award Amount: $71,097,573.00 Contract Officer’s Representative: Kadiatou Cisse Abbassi Submitted by: Chemonics International Sacre Coeur Pyrotechnie Lot No. 73, Cite Keur Gorgui Tel: 221 78585 66 51 Email: [email protected] Lecture Pour Tous - Report on Language Mapping – February 2018 1 REPORT ON LANGUAGE MAPPING IN THE REGIONS OF FATICK, KAFFRINE AND KAOLACK Contracted under AID-OAA-I-14-00055/AID-685-TO-16-00003 Lecture Pour Tous DISCLAIMER The author’s views expressed in this publicapublicationtion do not necessarily reflect the views of the United States AgenAgencycy for International Development or the United States Government. Lecture Pour Tous - Report on Language Mapping – February 2018 2 TABLE OF CONTENTS 1. EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................................................. 5 2. INTRODUCTION ........................................................................................................................ 12 3. STUDY OVERVIEW ...................................................................................................................... 14 3.1. Context of the study ............................................................................................................. 14 3.2. -

Le Sine Saloum
Le Sine Saloum Extrait du Au Senegal http://www.au-senegal.com/le-sine-saloum,025.html Sine Saloum Le Sine Saloum - Recherche - Découvrir le Sénégal, pays de la teranga - Les régions naturelles - Date de mise en ligne : lundi 28 octobre 2013 Description : Voir aussi • Le Delta du Saloum du Sénégal inscrit sur la Liste duAu patrimoine Senegal mondial de l'UNESCO • Le Sine Saloum en vidéo • Ecotourisme dans le Saloum • L'école de lutte Ambroise Sarr à Palmarin Copyright © Au Senegal Page 1/19 Le Sine Saloum D'une grande richesse historique et culturelle, la région naturelle du Sine Saloum, au sud de la Petite-Côte, correspond aux régions administratives de Kaolack et de Fatick. Sine Saloum Le Sine Saloum prend son nom du fleuve Saloum et de son principal affluent, le Sine. Elle constitue plus de 70 % du bassin arachidier. Elle abritait jadis les royaumes sérères du Sine (capitale Diakhao) et du Saloum (capitale Kahone). Cartes Carte touristique du Sine Saloum Le delta du Sine Saloum Le delta du Sine Saloum (parc national) est l'un des plus beaux sites du Sénégal. D'une superficie d'environ 180 000 hectares, c'est une zone constituée de mangroves, de lagunes, de forêts et de cordons sableux. La région de Kaolack Plan de Kaolack Elle est située au centre et au sud du bassin arachidier et présente une grande diversité d'écosystèmes naturels. Elle est arrosée par le fleuve Saloum, le Baobolong, un affluent du fleuve Gambie, le Niani Nja bolong, l'affluent de la Sandugou et le Miniminiyang bolong. -

Service Regional De Fatick Situation Economique Et Sociale De La Region
REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION DE LA PREVISION ET DE LA STATISTIQUE SERVICE REGIONAL DE FATICK SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE DE LA REGION DE FATICK EDITION 2004 Août 2005 TABLE DES MATIERES Pages AVANT - PROPOS 3 1. PRESENTATION 4 - 10 2. DEMOGRAPHIE 11 - 15 3. EDUCATION 16 - 23 4. SANTE 24 - 36 5. AGRICULTURE 37 - 46 6. ELEVAGE 47 - 50 7. PECHE 51 – 53 8. EAUX ET FORETS 54 - 68 9. TOURISME 69 - 71 10. TRANSPORT 72 - 75 2 AVANT - PROPOS Cette présente situation économique de la région de Fatick a pour objectif de mettre à la disposition des utilisateurs le panorama des activités socio-économiques de la région. Elle permet à ces derniers de disposer d’une base de données actualisées, riches et détaillées couvrant la plupart des secteurs d’activité allant du primaire au tertiaire. Un remerciement très sincère est adressé à l’ensemble de nos collègues des services déconcentrés (régionaux et départementaux) qui nous ont beaucoup facilité les travaux de collecte de statistiques, en réagissant de manière positive et spontanée à nos sollicitations. Certains ont même mis à notre disposition leurs rapports. D’autres ont répondu favorablement aux questionnaires qui leur ont été remis. Nous présentons toutes nos excuses à nos chers lecteurs et à tous ceux qui s’intéressent à nos publications pour ce léger retard accusé par cette publication. Et nous leur demandons de bien vouloir nous envoyer leurs critiques et suggestions pour nous aider à améliorer nos prochaines éditions. 3 I. PRESENTATION DE LA REGION 1. Aspects physiques Créée par la loi 84-22 du 22 février 1984 divisant l’ex - région du Sine - Saloum en deux entités distinctes, la région de Fatick couvre depuis 2002 une superficie de 7535 km², suite au retrait de deux communautés rurales que sont Sadio et Taïf et leur rattachement au département de Mbacké. -
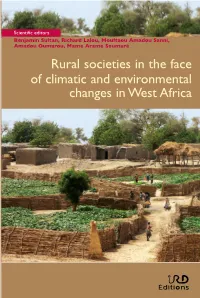
Rural Societies in the Face of Climatic and Environmental Changes in West
Couv anglaisok Page 1 Scientific editors Benjamin Sultan, Richard Lalou, Mouftaou Amadou Sanni, Amadou Oumarou, Mame Arame Soumaré Rural societies in the face Benjamin Sultan, Richard Lalou Mouftaou Amadou Sanni Amadou Oumarou Mame Arame Soumaré of climatic and environmental changes in West Africa The future of West Africa depends on the capacity of its agriculture to ensure the food security of the population, which should double in the next 20 years,while facing up to the new risks resulting from climate warming. Indeed, the changes in temperature and precipita- tions already operating and that should become more marked will have serious effects on agricultural production and water resources in this part of Africa in the near future. One of the keys to meeting this new challenge is the adaptation of rural societies to climate risks. To gain better knowledge of the potential, processes and barriers, this book analyses recent and ongoing trends in the climate and the environment and examines how rural societies perceive and integrate them: what are the impacts of these changes, what vulnerabilities are there but also what new opportunities do they bring? How do the populations adapt and what innovations do they implement—while the climate- induced effects interact with the social, political, economic and technical changes that are in motion in Africa? By associating French and African scientists (climatologists, IRD agronomists, hydrologists, ecologists, demographers, geogra- 44, bd de Dunkerque phers, anthropologists, sociologists and others) in a multidisci- 13572 Marseille cedex 02 plinary approach, the book makes a valuable contribution to Rural societies in the face of climatic [email protected] better anticipation of climatic risks and the evaluation of African www.editions.ird.fr societies to stand up to them. -

Photo Pleine Page
BOPI 04NC/2015 GENERALITES SOMMAIRE TITRE PAGES PREMIERE PARTIE : GENERALITES 2 Extrait de la norme ST3 de l’OMPI utilisée pour la représentation des pays et organisations internationales 3 Clarification du Règlement relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui 4 Adresses utiles 5 DEUXIEME PARTIE : NOMS COMMERCIAUX 6 Noms Commerciaux du N° 112800 au N° 113699 7 1 BOPI 04NC/2015 GENERALITES PREMIERE PARTIE GENERALITES 2 BOPI 04NC/2015 GENERALITES Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI Code normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation des pays ainsi que d’autres entités et des organisations internationales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle. Bénin BJ Burkina Faso BF Cameroun CM Centrafricaine,République CF Comores KM Congo CG Côte d’Ivoire CI Gabon GA Guinée GN Guinée-Bissau GW GuinéeEquatoriale GQ Mali ML Mauritanie MR Niger NE Sénégal SN Tchad TD Togo TG 3 BOPI 04NC/2015 GENERALITES CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI RESOLUTION N°47/32 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE Vu L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 Mars demande d’extension à cet effet auprès de l’Organisation suivant 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété les modalités fixées aux articles 6 à 18 ci-dessous. Intellectuelle et ses annexes ; Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait Vu Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement entraine Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ; une extension automatique des effets de la protection à l’ensemble du territoire OAPI». -

U,(~-~S-.G Qfo"2..40
ftv. {U,(~-~S-.G qfo"2..40 KNOWLEDGE, ATTITUDES, AND PRACTICES SURVEY OF TRADITIONAL HEALERS IN FATICK, SENEGAL: FINAL REPORT (USAID GRANT #685-0281-G-OO-1254-00) I. INTRODUCTION This report entails a detailed exposition of the recent Healers Knowledge, Attitudes, and Practices (RAP) Survey (USAID-Senegal Grant #685-0281-G-00-1254-00) in Fatick, Senegal. The preliminary report that has already been submitted described the history of the project up to the final meeting held June 27-28, 1992 at Le Centre Saidou Nourou Tall in Mbour. In this document, the relevant data will be reviewed and the applicability of this data to helping solve some of the health care problems of contemporary Senegal will be discussed. The report will be divided into four sections: (I.) Introduction, (II.) Healers Survey, (III.) Villagers Survey, and (IV.) Comment. The data base is voluminous and not all of the information can be covered by this report. However, the sa1 ient results will be highlighted and the print-out made available for those wishing to review the figures in detail. Much information still reposes in the mass of raw data gleaned from nearly 900 questionnaires (includes the healer and village surveys) and this constitutes a valuable repository that can be mined in the future to answer other questions. II. HEALERS SURVEY QUESTIONNAIRE The questionnaire contained 330 separate items in nine sections. Section VI, containing 21 questions concerning the diagnosis and treatment of specific illnesses could, theoretically, be repeated 50 times because there were 50 illnesses listed in the survey. This could Page Two Traditional Medicine Survey maximally give an additional 1,050 items. -
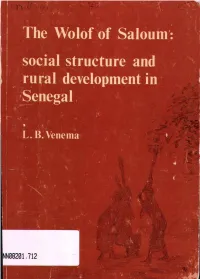
The Wolof of Saloum: Social Structure and Rural Development in Senegal Stellingen
The Wolof of Saloum: social structure and rural development in Senegal Stellingen 1. Ein van de voorwaarden voor succesvolle toepassing van ossetrekkracht in de landbouw is een passende bedrijfsgrootte. In vele samenlevingen in West-Afrika wordt aan deze voor- waarde niet voldaan, omdat de leden van de huishoudgroep niet gezamenlijk, maar afzonder- lijk een bedrijf beheren. Dit proefschrift. 2. De conclusie dat in niet-westerse gebieden de positie van de vrouw verslechtert door opname in de marktecanomie en modernisering van de landbouw, is niet van toepassing op de Wolof-samenleving. Door de verbouw van handelsgewassen werd haar rol in de landbouw be- langrijker en nam haar inkomen toe. De recente toepassing van dierlijke trekkracht ver- lichtte haar taak op haar eigen veld. Postel-Coster, E. & J. Schrijvers, 1976. Vrouwen op weg; ontwikkeling naar emanci- patie. Van Gorcum, Assen. Dit proefschrift. 3. Moore verklaart de deelname aan werkgroepen met een maaltijd als beloning ('festive labour') mede uit de afhankelijkheid van de deelnemers ten opzichte van de begunstigde. Hierbij wordt over het hoofd gezien dat het voorkomt dat slechts een persoon deelneemt vanwege zijn afhankelijkheid van de begunstigde en dat deze persoon de overige deelnemers rekruteert volgens de regels van reciprociteit. Moore, M.P., 1975. Co-operative labour in peasant agriculture. Journal of Peasant Studies 2(3): 270-291. Dit proefschrift. 4. De gebruikelijke definitie van een marabout als zijnde een heilige en religieus leider met erg veel invloed is niet van toepassing op de Wolof, omdat hier vele marabouts slechts lokale bekendheid genieten. Dit proefschrift. 5. Er wordt vaak geen rekening gehouden met het feit dat de materiele positie van de kleine boer in ontwikkelingslanden niet alleen bepaald wordt door zijn activiteit als pro- ducent, maar tevens door zijn activiteit als handelaar. -

Histoire Du Sine-Saloum (Sénégal)
Bullctin dc 1'I.F.A.N. T. 46. s5r. B. no' 3-1, IYS6-1YY7. 9j. Cartc 'ont pas i: donc ..l tout. Histoire du Sine-Saloum (Sénégal) par ALIOUNESARR (l) Introduction, bibliographie et notes par CHARLESBECKER (2) Rtsumt ct abstract ................................................... 211 Introduction.. ........................................................ 211 Bibliographic sur le Siin. le Saahon et le Bnrlibtr ........................ 216 HISTOIREDU SNE-SALOUM. Avant-propos. ....................................................... 225 I. L'histoire anciennc et les Gu6lnvnrs au Sine et au Saloun1 ......... 227 II. L'organisation socio-politique du Sine et du Saloum ............... 247 III. Histoire rhccntc du Sinc et du Saloum ........................... 251 IV. Anncscs ....................................................... 270 IIÉSUILIÉ La chronique d'A. SARRmnnifestc I'intirtt majeur dc In tradition orde pour la coniiiiIss;tncc de l'histoire africaine. Ekapporte dc nombrcuses informatioris originalcs sur deux forniations sociales de Sinigambie - le SiLr et le Snalro~- qui Ctaient comniandhes par la dynastie gchvaar. L'introduction et les notes fournisscnt des (II B.P. 114, Kookick, StnSgal. (1) B.P. 5598, Dakar-Fann. Sbntgal. .. a 212 ALIOUNE SARR IIISTOIRB DU SI”8-SALOUhl. 21 3 * rciiscigiiciiiciits co~iipltmciit;~ircs,ci1 particulicr dcs rcmarqucs critiqucs ci imc biblio- cclui-ci Ics partics iiianquaiitcs, i savoir Ics pagcs qui ont Ctt kgarécs, sclon gr;iphic, alors que IC docunictit d’A. SARRtltcrit wcc d6iails Ics origincs dcs tlcux dc succcssifs du documcnt dcs (( liistoricns )). royauiiics, leur orgmisation soci;ilc, ccriíiins rtgiics inarqualits ci surtout Ics 6vtnc- M. IMUODJ, lors prZts i iiicilts du XIX‘ sitclc. II appor1c aussi plusicurs ttmoignagcs 6crits iiitdits siir la coliquttc Sclon A. Slziu<, IC iiianuscrit a ktC mis au point vcrs 1930, ct il aurait kit fraiiçeisc ct Ics dtbuts dc le ptriotlc colonialc. -

Sous Officiers Directs Acceptes
LISTE DES CANDIDATS SELECTIONNES AU CONCOURS DIRECT DES SOUS- OFFICIERS APRES ETUDE DES DOSSIERS N° Date Inscripti Prenom Nom Lieu Naissance Naissance on 44824 BORIS ROLAND ADIOYE 06/05/1990 OUSSOUYE 35071 JULIUS COLES ADIOYE 23/03/1993 DAKAR 33278 PALLA ADJ 16/03/2000 THILMAKHA 33040 CHEIKH AHMADOU BAMBA AIDARA 15/02/1988 MBOUR 37581 CHEIKHOU AIDARA 20/01/1998 MISSIRAH DINE 40128 HAMET AIDARA 06/05/1992 BAKEL 45896 MAFOU AIDARA 10/03/1993 THIONCK-ESSYL SINTHIANG SAMBA 35340 SEKOUNA AIDARA 18/05/1991 COULIBALY 41583 ASTOU AÏDARA 03/06/1996 DIONGO 43324 BABA AÏDARA 03/07/1990 DAROU FALL 44307 MOUSSA AÏDARA 15/08/1999 TAGANITH 41887 YVES ALVARES 25/12/1989 ZIGUINCHOR 36440 ABDOU LAHAT AMAR 17/04/1995 MBACKE 44118 SEYNABOU AMAR 02/01/1997 RUFISQUE 32866 BA AMINATA 27/12/1999 VELINGARA 42350 KHALIFA ABABACAR ANNE 14/07/1995 PIKINE 36701 OUMAR AMADOU ANNE 22/05/1992 PÈTE 47297 AGUSTINO ANTONIO 13/04/1992 DIATTACOUNDA 2 47370 ALIDA ALINESSITEBOMAGNE ASSINE 12/04/1999 CABROUSSE 39896 CHRISTIAN GUILLABERT ASSINE 18/06/1992 OUKOUT 41513 DANIEL ALEXANDRE MALICK AVRIL 27/05/1994 PARCELLES ASSAINIES 33240 ABIB NIANG AW 25/04/1991 DAKAR 38541 ARONA AW 31/03/1999 KAOLACK 36165 MAMADOU AW 09/10/1994 KEUR MASSAR 38342 NDEYE COUMBA AW 07/04/1990 DIOURBEL 42916 OUSMANE AW 14/09/1989 PIKINE 34756 ABDOU BA 20/10/1994 MBOUR 36643 ABDOUKARIM BA 02/04/1990 SAINTLOUIS 42559 ABDOUL BA 31/01/1998 LINGUERE 30471 ABDOUL BA 05/01/1999 PODOR 38377 ABDOUL AZIZ BA 25/09/1991 PIKINE 33148 ABDOUL AZIZ BA 10/10/1991 SAINT LOUIS 46835 ABDOUL WAHAB BA 12/03/1991 GUEDIAWAYE -

African Archaeological Perspectives �� 1 François G
Materializing Colonial Encounters François G. Richard Editor Materializing Colonial Encounters Archaeologies of African Experience 1 3 Editor François G. Richard Anthropology University of Chicago Chicago, USA ISBN 978-1-4939-2632-9 ISBN 978-1-4939-2633-6 (eBook) DOI 10.1007/978-1-4939-2633-6 Library of Congress Control Number: 2015944091 Springer New York Heidelberg Dordrecht London © Springer Science+Business Media New York 2015 This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. The use of general descriptive names, registered names, trademarks, service marks, etc. in this publication does not imply, even in the absence of a specific statement, that such names are exempt from the relevant protective laws and regulations and therefore free for general use. The publisher, the authors and the editors are safe to assume that the advice and information in this book are believed to be true and accurate at the date of publication. Neither the publisher nor the authors or the editors give a warranty, express or implied, with respect to the material contained herein or for any errors or omissions that may have been made. Printed on acid-free paper Springer Science+Business Media LLC New York is part of Springer Science+Business Media (www.springer.com) Acknowledgments As textual artifacts, books have a tendency to camouflage the tracks of their genesis behind the orderly and coherent façade of the finished product.