L'histoire Du Canal De Saint-Quentin
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Commune De Cugny COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL Séance Du 19 Septembre 2019 Date De La Convocation : 12 Septembre 2019 Date D'affichage : 12 Septembre 2019
République Française Département de l'Aisne Arrondissement de SAINT-QUENTIN Commune de Cugny COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL Séance du 19 septembre 2019 Date de la convocation : 12 septembre 2019 Date d'affichage : 12 septembre 2019 L'an deux mil dix-neuf, le dix-neuf septembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de cette commune, dûment convoqué, s'est réuni sous la présidence de Michel BONO, Maire. Présents : Michel BONO, Daniel LOBBÉ, Jacques CLÉMENT, Lionel DOURNEL, Jean-François PRÊTRE, Régine SÉTIAUX, Ségolène DELHAYE, Marjorie BARALLE, Coralie MAILLOT, Gilles ERB, Bruno LETUPPE. Absents excusés : Rénaldo CAVALET, Jean Paul PARENT. Secrétaire : Coralie MAILLOT. Le compte-rendu de la séance du 19 juin 2019 est approuvé. Décision modificative n°02/2019 Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, Vu le budget de la commune de Cugny, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’autoriser la décision modificative suivante au budget de l’exercice 2019 : Section de fonctionnement– DEPENSES 60636 Vêtements de travail + 199.25 € 615221 Entretien bâtiments publics - 550.00 € 65732 Régions + 850.00 € 6811 Dotations aux amortissements + 0.75 € Section de fonctionnement - RECETTES 70311 Concessions dans les cimetières + 500.00 € Section d’investissement – DEPENSES 21318.0719 Travaux salle d’accueil périscolaire + 5 309.76 € Création salle des associations et jeux extérieurs (sur 2135.0819 + 13 835.08 € terrain communal) 2151.0217 Travaux de voirie Chemin Homblières - 72.25 € 2158.0318 Divers + 73.00 € Section d’investissement – RECETTES 10251 Dons 19 144.84 € 2804182 Amortissements 0.75 € Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, AUTORISE la décision modificative présentée par le Maire. -

Compte Rendu De Réunion
COMMISSION LOCALE DE L ’E AU SSAAGGEE DDEE LLAA HHAAUUTTEE--SSOOMMMMEE Compte-rendu de la réunion du 31 mars 2009 – Saint-Quentin – 14h30 Commission Thématique « Risques majeurs » Etaient présents (24) : Monsieur Gilbert SIMEON, Président de la Commission Thématique « Risques majeurs », Représentant de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin et Maire de Fontaine-Notre-Dame Monsieur Bernard LENGLET, Président de la Commission Locale de l’Eau Monsieur Jean-Pierre LEFEBVRE, Agence de l’Eau Artois-Picardie Mademoiselle Marie-Olivia ALLARD, Conseil Régional de Picardie Monsieur Thomas OBE, DREAL Picardie Monsieur Pierre MOROY, DISEMA de la Somme (DDAF Somme) Monsieur Emmanuel DU TERTRE, Chambre d’agriculture de la Somme - Somea Monsieur Laurent FLEUTRY, Chambre d’agriculture de l’Aisne – mission érosion Monsieur Francis CEDEYN, DDE Somme – unité Santerre Haute Somme Monsieur Benoît BRASILES, DDE Somme – prévention des risques et sécurité Madame Pascale CHARDON-LEYES, Sous-préfecture de Saint-Quentin Madame Sophie MARET, Communauté de Communes du Pays Noyonnais Monsieur Vincent REVEL, Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin (CASQ) – service environnement Monsieur Pierre-Yves CROENNE, CASQ – directeur des services techniques Madame Charlotte LHUILLIER, CASQ – direction de l’aménagement et du développement durable Monsieur Gilles TILHET, CASQ – direction de l’aménagement et du développement durable et représentant de la commune d’Omissy Monsieur Thomas CHARVEUX, CASQ - service urbanisme Madame Denise LEFEBVRE, CASQ – vice-présidente -

American Armies and Battlefields in Europe
Chapter v1 THE AMERICAN BATTLEFIELDS NORTH OF PARIS chapter gives brief accounts of areas and to all of the American ceme- all American fighting whi ch oc- teries and monuments. This route is Thiscurred on the battle front north of recommended for those who desire to Paris and complete information concern- make an extended automobile tour in the ing the American military cemeteries and region. Starting from Paris, it can be monuments in that general region. The completely covered in four days, allowing military operations which are treated are plenty of time to stop on the way. those of the American lst, 27th, 30th, The accounts of the different operations 33d, 37th, 80th and 91st Divisions and and the descriptions of the American the 6th and 11 th Engineer Regiments. cemeteries and monuments are given in Because of the great distances apart of the order they are reached when following So uthern Encr ance to cb e St. Quentin Can al Tunnel, Near Bellicourc, October 1, 1918 the areas where this fighting occurred no the suggested route. For tbis reason they itinerary is given. Every operation is do not appear in chronological order. described, however, by a brief account Many American units otber tban those illustrated by a sketch. The account and mentioned in this chapter, sucb as avia- sketch together give sufficient information tion, tank, medical, engineer and infantry, to enable the tourist to plan a trip through served behind this part of the front. Their any particular American combat area. services have not been recorded, however, The general map on the next page as the space limitations of tbis chapter indicates a route wbich takes the tourist required that it be limited to those Amer- either int o or cl ose to all of tbese combat ican organizations which actually engaged (371) 372 THE AMERICAN B ATTLEFIELD S NO R TH O F PARIS Suggested Tour of American Battlefields North of Paris __ Miles Ghent ( î 37th and 91st Divisions, Ypres-Lys '"offensive, October 30-November 11, 1918 \ ( N \ 1 80th Division, Somme 1918 Albert 33d Division. -

American Armies and Battlefields in Europe 533
Chapter xv MISCELLANEOUS HE American Battle Monuments The size or type of the map illustrating Commission was created by Con- any particular operation in no way indi- Tgress in 1923. In carrying out its cates the importance of the operation; task of commeroorating the services of the clearness was the only governing factor. American forces in Europe during the The 1, 200,000 maps at the ends of W or ld W ar the Commission erected a ppro- Chapters II, III, IV and V have been priate memorials abroad, improved the placed there with the idea that while the eight military cemeteries there and in this tourist is reading the text or following the volume records the vital part American tour of a chapter he will keep the map at soldiers and sailors played in bringing the the end unfolded, available for reference. war to an early and successful conclusion. As a general rule, only the locations of Ail dates which appear in this book are headquarters of corps and divisions from inclusive. For instance, when a period which active operations were directed is stated as November 7-9 it includes more than three days are mentioned in ail three days, i. e., November 7, 8 and 9. the text. Those who desire more com- The date giYen for the relief in the plete information on the subject can find front Jine of one division by another is it in the two volumes published officially that when the command of the sector by the Historical Section, Army W ar passed to the division entering the line. -

Les Continuités Ecologiques Régionales En Hauts-De-France
G MONT-D'ORIGNY MONT-D'ORIGNY PUISIEUX-ET-CLANLIEUPUISIEUX-ET-CLANLIEU Les Continuités Ecologiques HARLY HOMBLIERES SAVY SAINT-QUENTIN THENELLES Régionales en Hauts-de-France MESNIL-SAINT-LAURENT REGNY SAINS-RICHAUMONT DALLON ORIGNY-SAINTE-BENOITE GAUCHY A1 A2 A3 LE HERIE-LA-VIEVILLE NEUVILLE-SAINT-AMAND LANDIFAY-ET-BERTAIGNEMONT B1 B2 B3 B4 B5 SAINS-RICHAUMONT G C1 C2 C3 C4 C5 C6 GRUGIES D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 FONTAINEG-LES-CLERCS SISSY ITANCOURT G E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 CASTRES G F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 PLEINE-SELVE PARPEVILLE G1 G2 G3 G4 G5 G6 CHATILLON-SUR-OISE HOUSSET CONTESCOURT MEZIERES-SUR-OISE G H1 H2 H3 H4 H5 H6 URVILLERS G G RIBEMONT MONCEAU-LE-NEUF-ET-FAUCOUZY I1 I2 I3 I4 G G GG BERTHENICOURT G SERAUCOURT-LE-GRAND G ESSIGNY-LE-GRAND CONTINUITES ECOLOGIQUES G VILLERS-LE-SEC SONS-ET-RONCHERES Réservoirs de biodiversité ALAINCOURT G SERY-LES-MEZIERES CERIZY CHEVRESIS-MONCEAU Réservoirs de Biodiversité de la trame bleue ARTEMPS (cours d'eau de la liste 2 + réservoirs biologiques des Sdage) BENAY Réservoirs de Biodiversité de la trame verte G MOY-DE-L'AISNE CHATILLON-LES-SONS CLASTRES G G Corridors principaux SURFONTAINE HINACOURT G Corridors boisés BRISSY-HAMEGICOURT G Attention: les corridors écologiques, GIBERCOURT au contraire des réservoirs, ne sont BOIS-LES-PARGNY Corridors humides MONTESCOURT-LIZEROLLES pas localisés précisément par le RENANSART schéma. Ils doivent être compris LY-FONTAINE PARGNY-LES-BOIS Corridors littoraux comme des "fonctionnalités LA FERTE-CHEVRESIS écologiques", c'est-à-dire des Corridors ouverts caractéristiques à réunir entre FLAVY-LE-MARTEL deux réservoirs pour répondre FLAVY-LE-MARTEL BRISSAY-CHOIGNY aux besoins des espèces (faune VENDEUIL DERCY Corridors multitrames et flore) et faciliter leurs échanges REMIGNY génétiques et leur dispersion. -

Milton's War Trophy #9563
Milton’s War Trophy #9563 - The 3rd Canadian Infantry Battalion at the Canal du Nord in September 1918 By Richard Laughton Most Canadians, like me, probably thought that the armaments that adorn our local parks, cenotaphs and memorials are Canadian. While researching the background to our “Milton War Trophy”I asked numerous friends, Legion Comrades and Veterans about our Milton Victoria Park War Trophy. Only one person knew it was of German origin, captured during the Great War (WW1 1914-1919). Specifically, it was captured during the famous period of “Canada’s Hundred Days”, from August 8th to November 11th 1918. This is the incredible story of the capture of that gun by the 3rd Canadian Infantry Battalion on Friday September 27th 1918. Lt. G. V. Laughton, M.C. Bill Smy of the Canadian Expeditionary Force Study Group (CEFSG) has written an excellent summary of history of War Trophies in Canada. For further details on that document, please refer to Note 1. The Milton War Trophy was captured by the 3rd Canadian Infantry Battalion, 1st Brigade, 1st Canadian Division during “Canada’s Hundred Days” 1. During this period the Canadian Expeditionary Force advanced through the Hindenburg Line to Cambrai, ending the stalemate of “Trench Warfare”. Specifically the Canadians crossed the Canal du Nord and captured Bourlon Wood, and in doing so captured a German Field Gun #9563, Milton’s War Trophy. More pictures of Milton’s War Trophy On-Line The battles that were fought by the Canadians to end the First World War were not inconsequential. As Christie reported 2, the final 100 days of the Great War accounted for one-fifth (20 percent) of all Canadian casualties during the war. -
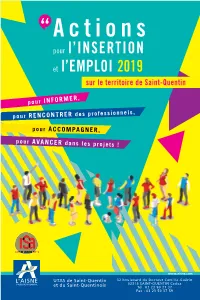
Actions Insertion -St Quentin 2019.Pdf
“ Actions pour l’InsertION et l’EMPLOI 2019 sur le territoire de Saint-Quentin , pour INFORMER pour RENCONTRER des professionnels, pour ACCOMPAGNER, pour AVANCER dans les projets ! www.aisne.com UTAS de Saint-Quentin 32 boulevard du Docteur Camille-Guérin 02315 SAINT-QUENTIN Cedex et du Saint-Quentinois Tél. 03 23 50 37 37 Fax : 03 23 50 37 59 L’UTAS de Saint-Quentin et du Saint-Quentinois propose aux bénéficiaires du RSA diverses actions d’insertion, selon leur profil et leurs objectifs. Pour travailler et préparer un projet professionnel è découvrez les chantiers d’insertion. AVES « Savoir-fer » : 6 rue Berthelot Travaux de repassage, de retouches et 02110 BOHAIN EN VERMANDOIS accueil clients, tenue de caisse, tournée de ramassage et livraison du linge. Encadrante : Mme TONNELIER 03 23 07 26 67 [email protected] ASP : Mme CUISINIER 03 23 07 15 75 [email protected] Devenir en Vermandois « Devenir en couleurs » : 6 rue Berthelot Métiers du bâtiment de second œuvre : 02110 BOHAIN EN VERMANDOIS réfection de monuments ou de bâtiments communaux. « Créa vert » : ASP : Entretien paysager, création végétale, Mme SIZAIRE maçonnerie paysagère. Accès au titre pro d’ouvrier du paysage. Encadrant technique : M. DELMOTTE Encadrants : 03 23 07 26 67 M. DUFOUR [email protected] ASP : M. DOLLE 03 23 07 26 67 [email protected] 2 AIPSQ « Cap vert » : 20 rue du Docteur Bourbier Entretien paysager, création végétale, 02100 SAINT-QUENTIN maçonnerie paysagère. Accès au titre pro « ouvrier du paysage » ou autre projet qualifiant. « Paniers verts » : Activités de maraîchage avec Encadrants : vente de paniers de légumes aux M. -

CC Du Pays Du Vermandois (Siren : 240200493)
Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC du Pays du Vermandois (Siren : 240200493) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Bellicourt Arrondissement Saint-Quentin Département Aisne Interdépartemental non Date de création Date de création 31/12/1993 Date d'effet 31/12/1993 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président M. Marcel LECLERE Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège Maison de pays Numéro et libellé dans la voie RN 44-RIQUEVAL Distribution spéciale Code postal - Ville 02420 BELLICOURT Téléphone 03 23 09 50 51 Fax 03 23 09 57 07 Courriel [email protected] Site internet Profil financier Mode de financement Fiscalité professionnelle unique Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) oui Autre redevance non Population Population totale regroupée 31 768 1/5 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Densité moyenne 70,39 Périmètre Nombre total de communes membres : 54 Dept Commune (N° SIREN) Population 02 Attilly (210200291) 371 02 Aubencheul-aux-Bois (210200309) 267 02 Beaurevoir (210200564) 1 433 02 Beauvois-en-Vermandois (210200598) 267 02 Becquigny (210200606) 255 02 Bellenglise (210200622) 387 02 Bellicourt (210200648) 611 02 Bohain-en-Vermandois (210200929) 5 758 02 Bony (210200978) 138 02 Brancourt-le-Grand (210201091) 571 02 Caulaincourt (210201315) 148 02 -

Appel a Candidature Pour La Fonction De Lieutenant De Louveterie Dans Le Département De L’Aisne Pour La Période 2021-2024
APPEL A CANDIDATURE POUR LA FONCTION DE LIEUTENANT DE LOUVETERIE DANS LE DÉPARTEMENT DE L’AISNE POUR LA PÉRIODE 2021-2024 La louveterie a été institutionnalisée en 813 par Charlemagne dans l’objectif de chasser le Loup. Depuis, ses missions ont sans cesse évolué, s’adaptant aux besoins de la société et aux enjeux liés à la gestion cynégétique et à la préservation du patrimoine naturel. Les lieutenants de louveterie sont nommés par le Préfet. Ils concourent notamment, sous le contrôle de l’autorité préfectorale, et dans les limites de leur circonscription, à la régulation et à la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. Ils sont assermentés et ont qualité pour constater les infractions à la police de la chasse. Ils sont les conseillers techniques de l’administration en ce qui concerne les problématiques de gestion de la faune sauvage. Les opérations de régulations administratives sont organisées sous leur contrôle et sous leur responsabilité technique. Leurs fonctions, exercées dans l’intérêt général, sont bénévoles. Dans le cadre de la nomination des lieutenants de louveterie dans le département de l’Aisne pour la période 2021-2024, un appel à candidature est lancé du 19 octobre au 15 novembre 2020. Cet appel porte sur 4 territoires (cf. cartographie et liste des communes en annexes) : – Territoire n°1 : unités de gestion – UG – du Vermandois (31) et de la Sambre (51) – Territoire n°2 : UG de Rozoy (27) et du Ton (53) – Territoire n°3 : UG du Tardenois (12) et de Marne-Est (13) – Territoire n°4 : UG de l’Omignon -

Téléchargez Le Règlement Intérieur DECLIC AGGLO
SERVICE DE TRANSPORT PUBLIC COLLECTIF A LA DEMANDE DE L’AGGLO DU SAINT-QUENTINOIS « DECLIC AGGLO » REGLEMENT INTERIEUR DE RESERVATION ET DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE Date d’entrée en vigueur : 1er mars 2021 CHAMP D’APPLICATION L’information En composant le numéro de téléphone 0 800 800 828, l’usager dispose d’un service d’information permettant d’être renseigné sur la prise en charge et le Les dispositions suivantes sont applicables sur le service « DECLIC AGGLO ». fonctionnement du service. Pastel se réserve le droit d’exclure temporairement ou définitivement toute personne ne respectant pas ces dispositions. De même, le conducteur a la possibilité de faire descendre du véhicule toute personne ne les respectant pas. Comportement Pastel dispose d’un système informatique destiné à traiter les informations concernant ses clients. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement Il convient de rester poli et cordial avec le personnel de réservation, les conducteurs et les autres passagers. En cas de non-respect de cette règle, Pastel informatique destiné à organiser au mieux la mobilité dans le cadre d’une délégation de service public. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » aura la possibilité d’exclure du service la personne fautive. du 6 janvier 1978 et au règlement transposé UE n°2016/679 du 27 avril 2016 dit « RGPD » portant sur la protection des données personnelles, les clients Tout acte de violence verbale ou physique à l’encontre du conducteur ou d’un passager est passible d’un procès-verbal établi par la Gendarmerie ou la Police bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent et qu’ils peuvent exercer en s’adressant à l’entreprise Pastel à l’adresse Nationale, conformément aux dispositions du code pénal. -

INFLUENZA Urif Isan
VOL. XXV ALEXANOftIA ONTARIO, FRIDAY, OCTOBER 11. 19)8 3S ing down the mountains, beautiful Previous loans made by our Domin* lotice of CSaimants Wanted Voters Auction Sale bushes climibing the aloptea and every- Ion leaders have been, tu practicalïy Interesting Trip tn Some thing looking so peaceful. Oh. Ir. was all cases, overaubscribed. Our peupla Farmers and others to get my Municipaiityof the Village nf .Vlaxville At L5—3th Kenyon, Wedr«es<iay, Oct all. grand. It really mad« one feel aa i have responded in a wonderful degree as Next-i-Klo prices an Resfrew Kerosene Bn^net, 23rd. 1916, farm stock, implements though he wag only In. a land of ' to the call for dnanclai as^tistanco County 1 f Glengar'y In the jruttter ot the estate oî .^lea Renfrew Cream Separators, P,enftew etc., D. Î. îÆâcdoaell, Auctioneer, dreams, and afraid to wake up .and both IroQi patriotic motives and .from McDonell, ieceased, late of the Scales, Gilson Gasoline Engines, Oil- >Je:l MacDonald, proprietor. find everything vaiiishltig. from him. ' the standpoint of a gound buaine.sB son IWo Silos, Gilson Ensilage Cut- -Volice is hereby given hhic 1 nave Now'there waa something else that in vestment. They realised that their City of Vaacouver, in the “?to*^mce transmitted or deUvered to the per- iateregted me a. lot, 'that being the • 3ecurit,y was the peoiple o.C Canada of British C'ulimbia. 'tets, Giisoa Threshers, Tractor», Cli- sons mentioned r. Section ;) o: the , cnlar Saws, Drag Saws, Grinders, Lost I .grerit tiumber of tunnels which w-e j and that with our well-nigh unlluiited Belting, Maple Leal Evaporators and Ontario Voters' Lists .Act, the o.opLss went CUrougii. -

Établissement Public De Sante Mentale Departemental De
eur ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DEPARTEMENTAL DE L’AISNE CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES MARCHE DES VERIFICATIONS ET DE LA MAINTENANCE ANNUELLES DES MOYENS DE SECOURS MAITRISE D’OUVRAGE : e.p.s.m.d. de l’Aisne 02320 PREMONTRE Tél : 03.23.23.66.51. Fax : 03.23.23.66.99 www.epsmd-aisne.fr 1) OBJET DU MARCHE Le présent marché a pour objet la vérification technique et la maintenance des moyens de secours sur le site de Prémontré et de ses structures extérieures. Le présent marché est composé d'un seul lot : - Annexe 1 les extincteurs portatifs 2) REFERENCE REGLEMENTAIRE Les vérifications techniques et la maintenance devront être effectuées selon : - l'arrêté du 25/06/80 modifié, article MS 73. - l'arrêté du 22/06/90 modifié, article PE4. - les normes en vigueur, - le guide pour la maintenance et la gestion d'un parc d'extincteurs mobiles C.N.M.I.S. 3) PLANNING D’INTERVENTION Les vérifications techniques et de maintenance se feront dès l'obtention du marché à l’issue d’un bon de commande, dressé par la Direction des Services Techniques. Les vérifications techniques et de maintenance devront se faire sur une période continue. Un planning devra nous être transmis 15 jours avant l’intervention afin de prévenir nos structures. 4) CONDITIONS D’EXECUTION DE LA MISSION Dès la mise en place du planning des interventions et en accord avec la Direction des Services Techniques, l’entreprise pourra réaliser sa mission. A l'issue de chaque intervention, le personnel de l'entreprise retenue sera tenue de consigner le registre de sécurité de chaque structure.