Octave Mirbeau, L'affaire Et L'ecriture De Combat
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Life and Works
Cambridge University Press 978-1-107-02189-1 - Marcel Proust in Context Edited by Adam Watt Excerpt More information part i Life and works © in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org Cambridge University Press 978-1-107-02189-1 - Marcel Proust in Context Edited by Adam Watt Excerpt More information © in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org Cambridge University Press 978-1-107-02189-1 - Marcel Proust in Context Edited by Adam Watt Excerpt More information chapter 1 Life William C. Carter On 10 July 1901, Marcel Proust called on his friend Léon Yeatman in his law office and announced: ‘Today I’m thirty years old, and I’ve achieved nothing!’ (Corr, ii, 32). Yeatman must have protested, but Marcel had good reason to be discouraged. Nearly all his friends had established themselves as writers or launched other successful careers. Although he held university degrees in literature, philosophy and law, he had never entered a profession. He had stubbornly rejected the advice of his father, Dr Adrien Proust, one of France’s most distinguished physicians and scientists. After one of their heated discussions about his failure to choose a career, Marcel wrote: ‘My dearest papa ...I still believe that anything I do other than literature and philosophy will be just so much wasted time’ (Corr, i, 237). Dr Proust was a self-made man from the little town of Illiers. His fortune had greatly increased when he married Jeanne Weil, the daughter of a wealthy Jewish family. Proust adored his mother, who, though modest and discreet, quoted with ease from the classics in several languages. -

The Theater in the Fiction of MARCEL PROUST Ïaywood Linn
The Theater in the Fiction of MARCEL PROUST - ^ ^ . n*^pp/.. ïaywood Linn The Theater in the Fiction of Marcel Proust JOHN GAYWOOD LINN That Marcel Proust and the theater of his time were not strangers to one another is evident to even the most casual reader of A la recherche du temps perdu. From Mr. Linn's thoroughgoing investigation, however, it is clear that the significance of this re markable abundance of theatrical and dra matic references, both in Proust's great novel and his other fiction, is far greater than has heretofore been suspected. For Mr. Linn uncovers a very definite pattern and a rigid control in Proust's deployment of theatrical metaphor and allusion, in his use of quotations from the drama, and in the parallels he draws between the actions of plays, events in real life, and the lives of his characters. Ultimately, Mr. Linn demonstrates, through Proust's constant use of theatrical reference as a means of delineating character and per sonality, building and destroying illusion, and depicting the setting for a bit of action, that life and art in his writings become so closely interwoven, so intimately interrelated, that one is scarcely discernible from the other as they subtly merge and then separate again. Art, for Proust, remains the constant stand arc! against which life is to be measured; and (Continued on back flap) /fie Çffîècfeeti tff $o/in Copyright © 1966 by the Ohio State University Press All Rights Reserved Library of Congress Catalogue Card Number: 65-24374 All quotations from Marcel Proust's Du côté de chez Swann, A l'ombre des jeunes filles en fleurs, Le Côté de Guermantes, Soâome et Gomorrhc, La Prisonnière, La Fugitive, and Le Temps retrouvé are from the 1954 Gallimard edition of A la recherche du temps perdu in the "Bibliothèque de la Pléiade." Copyright © 1913, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, and 1927 by Editions Gallimard and used by permission of the publisher. -

Simply-Proust-1596556548
Simply Proust Simply Proust JACK JORDAN SIMPLY CHARLY NEW YORK Copyright © 2020 by Jack Jordan Cover Illustration by José Ramos Cover Design by Scarlett Rugers All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, write to the publisher at the address below. [email protected] ISBN: 978-1-943657-44-5 Brought to you by http://simplycharly.com This book was produced with Pressbooks (https://pressbooks.com) and rendered with Prince. Contents Other Great Lives vii Series Editor's Foreword viii Preface ix À la recherche ́ du temps perdu (In Search of Lost xvi Time) Marcel Proust xvii 1. Marcel Proust's Early Days 1 2. Out and about 13 3. In Search of Lost Time 21 4. Final Years 35 5. The Narrator: Travels in the Space-Time 42 Continuum 6. A Search for Certainty 51 7. Immobile Means of Transportation 61 8. Proust and the Human Sciences 75 9. Proust the naturalist 84 10. Three types of observation 90 11. The Reader: Riding the Proust Wave 103 Sources 111 Suggested Reading 112 About the Author 115 A Word from the Publisher 116 Other Great Lives Simply Austen by Joan Klingel Ray Simply Beckett by Katherine Weiss Simply Beethoven by Leon Plantinga Simply Chekhov by Carol Apollonio Simply Chomsky by Raphael Salkie Simply Chopin by William Smialek Simply Darwin by Michael Ruse Simply Descartes by Kurt Smith Simply Dickens by Paul Schlicke Simply Dirac by Helge Kragh Simply Einstein by Jimena Canales Simply Eliot by Joseph Maddrey Simply Euler by Robert E. -

Albaret, Céleste and Marcel Proust 155, 165, 177 Comments On
Index Albaret, Céleste letters to Alexandrine Halévy 39 and Marcel Proust 155, 165, 177 letters to Valentine Halévy 40 comments on Geneviève Straus 11 misunderstanding with mother 46 contacts with Geneviève Straus 165 pregnancy of 50 Alsace and Lorraine reconciliation with mother 65 and Franco-Prussian War 47, 152, 156 relationship with mother 29, 42–43, 50 Anti-Dreyfusard 10 travels of 63 anti-Semitism trip to Bordeaux 43 during Dreyfus Affair 71, 78, 89, 90–92, widowhood of 62 97–98, 113, 136 Bizet, Georges Armingaud, Jules 41–42 Geneviève de Paris 60 Auteuil 51 Grisélidis 36 Jeux d’enfants 52 Baignières, Jacques 83–84 L’Arlésienne 52 Balard, Françoise and Léonie Halévy 42, 49, 57 biography of Geneviève Straus 12 and Opéra-Comique 50 Barrès, Maurice appearance of 29 during Dreyfus Affair 98, 112 as piano teacher 55 Baudelaire, Charles 81–82 critical acclaim for works 53 Belle Époque 56, 95, 116, 154, 162–163, 174, death of 61 180–182 depression and anxiety of 29n, 30, 32, and cross-fertilization of artists 7, 181 34–36 and social inequality 181 deterioration of health 61 prosperity and peace 6 early relationship with Geneviève 28 Benda, Julien 99, 106, 164–165, 182–183 early works 28 La Trahison des clercs 106 letters to Ernest Guiraud 41 La Jeunesse d’un clerc 164 letters to Hippolyte Rodrigues 37 observations about Geneviève’s letters to mother 31 salon 164 marriage 31 Bernhardt, Sarah 9, 73 named chevalier of Legion of Honor Billot, Jean-Baptiste. See Dreyfus Affair 59 Bischoff, Chantal National Guard duty 39 biography of Geneviève -
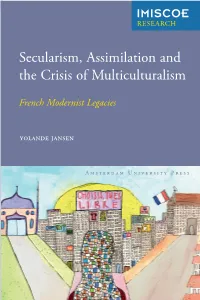
Secularism, Assimilation and the Crisis of Multiculturalism It Is Meant to Overcome
IMISCOE Jansen This remarkable book develops a political theoretical critique of contemporary RESEarcH discourses on secularism and assimilation. Jansen argues that the perspective of assimilating distinct ethno-religious minorities by incorporating them into a secular and supposedly neutral public sphere can generate and perpetuate the very distinctions of Multiculturalism Assimilation and the Crisis Secularism, it is meant to overcome. To flesh out this insight she borrows from the literature on the paradoxes of assimilation as experienced by the French Jews in the late 19th century, through a contextualised reading of Marcel Proust’s In Search of Lost Time. Secularism, Assimilation and Jansen offers a dynamic, critical multiculturalism as an alternative to discourses focusing on secularism, assimilation and integration. the Crisis of Multiculturalism Yolande Jansen is a senior researcher at the Amsterdam Center for Globalisation Studies, University of Amsterdam. She is also a Socrates professor of humanism in relation to religion and secularity at the VU University Amsterdam. French Modernist Legacies “[A] brilliant and thorough philosophical reading of current writings on assimilation, multiculturalism and secularism, weaving together a rereading of Proust on Jewish experiences of the paradoxes of assimilation with current debates about the situation of Muslims in Europe.” John R. Bowen, Dunbar-Van Cleve Professor in Arts & Sciences, Washington University in St. Louis Yolande Jansen “Jansen’s brilliant and insightful analysis draws on a variety of fields and lucidly shows how the crisis is a crisis in modernity.” Brian Klug, Philosophy, University of Oxford “Jansen’s work is a hard-hitting and back to basics reminder of multiculturalism fundamentals. It also offers a brilliant, pragmatic and insightful analysis of what secularism makes invisible about the position of Muslims in France today.” Rim-Sarah Alouane, Université Toulouse I-Capitole Amsterdam University Press 978 90 8964 596 8 · . -

Photography, Text, and the Limits of Representation in Marcel Proust’S in Search of Lost Time and Roland Barthes’S Camera Lucida
PHOTOGRAPHY, TEXT, AND THE LIMITS OF REPRESENTATION IN MARCEL PROUST’S IN SEARCH OF LOST TIME AND ROLAND BARTHES’S CAMERA LUCIDA by Annie Counter A thesis submitted to the Faculty of the University of Delaware in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Art History Spring 2006 Copyright 2006 Annie Counter All Rights Reserved UMI Number: 1435857 UMI Microform 1435857 Copyright 2006 by ProQuest Information and Learning Company. All rights reserved. This microform edition is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest Information and Learning Company 300 North Zeeb Road P.O. Box 1346 Ann Arbor, MI 48106-1346 PHOTOGRAPHY, TEXT, AND THE LIMITS OF REPRESENTATION IN MARCEL PROUST’S IN SEARCH OF LOST TIME AND ROLAND BARTHES’S CAMERA LUCIDA by Annie Counter Approved: _____________________________________________________ Margaret Werth, Ph.D. Professor in charge of thesis on behalf of the Advisory Committee Approved: _____________________________________________________ Ann Eden Gibson, Ph.D. Professor in charge of thesis on behalf of the Advisory Committee Approved: _____________________________________________________ Nina M. Athanassoglou-Kallmyer, Ph.D. Chair of the Department of Art History Approved: _____________________________________________________ Tom Apple, Ph.D. Dean of the College of Arts & Sciences Approved: _____________________________________________________ Conrado M. Gempesaw II, Ph.D. Vice Provost for Academic and International Programs ACKNOWLEDGMENTS I would like to express my gratitude towards my advisor, Margaret Werth, for all of her comments and ideas for this paper, as well as for her encouragement to complete it. I would also like to thank Ann Gibson, William Homer, Catherine Walsh, and Corina Weindigger for reading drafts.