L-Omnibus-De-Corinthe.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

3 July 2019 Royal Holloway, University of London
60th Annual Conference 1 - 3 July 2019 Royal Holloway, University of London Welcome and acknowledgments On behalf of the Society for French Studies, I am delighted to welcome all of you to our Annual Conference, this year hosted by Royal Holloway, University of London. Today's Royal Holloway is formed from two colleges, founded by two social pioneers, Elizabeth Jesser Reid and Thomas Holloway. We might note with some pleasure that they were among the first places in Britain where women could access higher education. Bedford College, in London, opened its doors in 1849, and Royal Holloway College's stunning Founder's Building was unveiled by Queen Victoria in 1886 – it’s still the focal point of the campus, and we shall gather there for a reception on Tuesday evening. In 1900, the colleges became part of the University of London and in 1985 they merged to form what is now known as Royal Holloway. We hope that this year’s offerings celebrate the full range of French Studies, and pay tribute to the contribution that is made more widely to Arts and Humanities research by the community of students and scholars who make up our discipline. We are especially pleased to welcome delegates attending the Society’s conference for the first time, as well as the many postgraduate students who will be offering papers and posters and colleagues from around the world. We are very excited to be welcoming the following keynote speakers to this year's conference: Kate Conley (Dean of the Faculty of Arts & Sciences, Professor of French and Francophone Studies, William and Mary); David McCallam (Reader in French Eighteenth-Century Studies, University of Sheffield); Pap NDiaye (Professeur des universités à l'Institut d'études politiques de Paris, Histoire nord-américaine, Sciences-Po); and Mairéad Hanrahan (Professor of French, University College London and former President of SFS). -

How Many French Desserts Can You Name?
How Coming from This nutty French sandwich cookie is the area in its chewy, crunchy and perfect for a one- many 6 name, which bite snack. What is it? French dessert is filled with Macaron French sweet jam and Macaroon covered in a Éclair pretty lattice Madeleine Bichon au citron pattern? desserts Tarte des Alpes Chouquette 1 Puits d’amour Named after Which French dessert gets its name can you the mold it’s because it looks like a leaf but is popu- baked in, which larly called an elephant ear? puff-pastry name? dessert is filled Croissant with sweet Palmier almond cream? Financier 7 Tuile Merveilleux The French are known for their unique flavors, history and complicated techniques when it comes to food. But Pithivier when you really break it down, a lot of the processes they Dariole 2 use are the same that are used anywhere else. It comes Charlotte down to the amount of care put into the baking of a des- sert and the quality of ingredients. The art of pastry was This is a popular layer cake made with basically invented in France, and there are plenty of culi- almond and hazelnut meringue instead nary and pastry schools that primarily teach French cui- The name is a of a sponge. Can you name it? sine and technique. It’s no wonder that the most delicious and fancy desserts do come from France! combination of When you think of a traditional bakery case, it could be the main 8 Kouign-amann filled with heaping mounds of cream or frosting, but in component and Pain d’épices Canelé France, the shelves are filled with small pastries and des- serts that are uniform in size and shape and mesmerize the caramel sauce Floating Island Dacquoise you with how perfect they are. -

Observatoire Météo- Roldgique Agricole. —
Phot. J. Boyer. UN COIN D'UNE OASIS TUNISIENNE. asis . — Espace qui, au milieu des déserts, offre hauteur si possible, et l'on dispose les divers instruments, dont le premier de la végétation. est le baromètre; il doit être à l'abri des intempéries. Le second, le ther- L'existence des oasis est toujours liée à la pré- momètre, sera placé au N., à l'abri du soleil, à lm,30 du sol. La girouette sence de l'eau, amenée soit par des rivières des- doit être placée à l'extrémité d'un mât de 4 à 5 mètres de hauteur; elle est cendues des montagnes, soit par des puits — sou- constituée par une flèche indicatrice et une palette ou gouvernail ; on re- vent artésiens — qui vont chercher l'eau dans les commande la palette double, beaucoup plus stable. En dessous de la gi- nappes souterraines. De là la disposition générale rouette, on place une règle de bois horizontale, mobile, tournant sur son des oasis, que l'on trouve réparties en chapelets centre et dont l'axe est la tige verticale de la girouette ; deux cordes aident le long des vallées asséchées des déserts ou bien en à faire pivoter cette règle. Lorsqu'on veut établir la direction du vent supé- couronnes sur le rebord montagneux des dépres- rieur, on se place au pied du mât, en dessous de la règle, et on la fait coïn- sions désertiques. L'arbre essentiel des oasis est cider en la manœuvrant avec le mouvement du nuage. Une aiguille indi- le palmier-dattier, à l'ombre duquel les autres quant la direction N.-S., il est facile de voir par la directon de l'aiguille de arbres fruitiers (abricotier, figuier, grenadier, etc.), et même la canne à la girouette le courant inférieur et, par la règle orientée dans la direc- sucre, l'orge, la luzerne, etc., trouvent souvent des conditions favorables tion de la marche des nuages, le courant supérieur ; c'est celui dont on de végétation. -

L-G-0000349753-0002315416.Pdf
Gauguin Page 4: Self-Portrait with a Palette, c.1894 oil on canvas, 92 x 73 cm Private Collection Designed by: Baseline Co. Ltd, 61A-63A Vo Van Tan Street 4th Floor District 3, Ho Chi Minh City Vietnam ISBN 978-1-78042-211-4 © Parkstone International © Confidential Concepts, worldwide, New York, USA All rights reserved No part of this publication may be reproduced or adapted without the permission of the copyright holder, throughout the world. Unless otherwise specified, copyrights on the works reproduced lies with the respective photographers. Despite intensive research, it has not always been possible to establish copyright ownership. Where this is the case we would appreciate notification 2 “In art, one idea is as good as another. If one takes the idea of trembling, for instance, all of a sudden most art starts to tremble. Michelangelo starts to tremble. El Greco starts to tremble. All the Impressionists start to tremble.” – Paul Gauguin 3 Biography 1848 Paul Gauguin born in Paris, on June 7. 1849 The family left France for Peru; his father died at sea. 1855–1861 Returned to France after a five-year stay in Lima. Lived in Orleans, his father’s native town. Studied at the Petit Seminaire. 1861(?)–1865 Moved with his mother to Paris. Attended high school. 1865 Entered the merchant marine as a cabin-boy. 1868–1871 Served in the navy after the disbandment of the French army and navy settled in Paris. 1871–1873 Worked as a stockbrocker in the banking office of Bertin. In the house of his sister’s guardian, Gustave Arosa, began to take interest in art. -

Métissage Et Narrativité Dans Trois Fictions Francophones L'enfant De Sable De Tahar BEN JELLOUN Solibo Magnifique De Patric
UNIVERSITÉ D’ORAN FACULTÉ DES LETTRES, LANGUES & ARTS ÉCOLE DOCTORALE DE FRANÇAIS Doctorat en sciences des textes littéraires Auteur : BOUTERFAS Bélabbas Métissage et Narrativité dans trois fictions francophones L’Enfant de sable de Tahar BEN JELLOUN Solibo Magnifique de Patrick CHAMOISEAU Le Diable en personne de Robert LALONDE Thèse dirigée par : me Directrice de thèse : M Christiane CHAULET-ACHOUR – Université Cergy- Pontoise – Co-directrice de thèse : Mme Nadia OUHIBI – Université d’Oran – Jury : Présidente de jury : Mme Fouzia BENJELLID – Université d’Oran – Examinateur : M. Hadj MILIANI – Université de Mostaganem – Examinateur : M. Bruno GELAS – Université Lyon II Examinateur : M. MEBARKI – Université d’Oran me Rapporteur : M Christiane CHAULET-ACHOUR Université Cergy-Pontoise Rapporteur : Mme Bahia OUHIBI – Université d’Oran – – Décembre 2008 – 1 Remerciements Une thèse de doctorat n’aboutit jamais sans l’aide scientifique, logistique et amicale de nombreuses personnes. Par ces remerciements, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à ceux et celles qui m’ont aidé à réaliser ce travail de recherche. Leur disponibilité et leurs conseils m’ont été précieux. Que Madame Christiane CHAULET-ACHOUR trouve ici l’expression de ma sincère gratitude pour la confiance qu’elle m’a accordée dans la réalisation de ce travail, pour sa patience à suivre mes recherches et pour toute la rigueur qu’elle a su me transmettre à travers ses remarques. Mes remerciements vont aussi à Madame Ouhibi Nadia pour la compréhension qu’elle a manifestée et aux membres du jury : Mesdames Fouzia BENJELLID, Monsieur Hadj MILIANI, Je n’oublierai pas de remercier de tout cœur mes amis, ma famille, mes frères et ma soeur Nacéra, dont la présence à mes côtés a été d’un grand réconfort durant toutes ces années. -

PDF Du Livre
Femmes à l’œuvre dans la construction des savoirs Paradoxes de la visibilité et de l’invisibilité Caroline Trotot, Claire Delahaye et Isabelle Mornat (dir.) Éditeur : LISAA éditeur Lieu d'édition : Champs sur Marne Année d'édition : 2020 Date de mise en ligne : 18 septembre 2020 Collection : Savoirs en Texte ISBN électronique : 9782956648062 http://books.openedition.org Édition imprimée Nombre de pages : 340 Référence électronique TROTOT, Caroline (dir.) ; DELAHAYE, Claire (dir.) ; et MORNAT, Isabelle (dir.). Femmes à l’œuvre dans la construction des savoirs : Paradoxes de la visibilité et de l’invisibilité. Nouvelle édition [en ligne]. Champs sur Marne : LISAA éditeur, 2020 (généré le 18 septembre 2020). Disponible sur Internet : <http:// books.openedition.org/lisaa/1162>. ISBN : 9782956648062. © LISAA éditeur, 2020 Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540 Sous la direction de Caroline Trotot, Claire Delahaye, Isabelle Mornat Femmes à l’œuvre dans la construction des savoirs Paradoxes de la visibilité et de l’invisibilité Savoirs en texte Femmes à l’oeuvre dans la construction des savoirs Sous la direction de Savoirs en texte Caroline Trotot, Claire Delahaye, Isabelle Mornat Née du désir d’offrir un espace de publication entièrement numérique, ouvert à l’ensemble de la communauté scientifique, la collection « Savoirs en texte » publie des ouvrages collectifs ou des monographies soigneusement sélectionnés grâce à un processus d’expertise. Ses ouvrages abordent le savoir des textes, l’utilisation et la transformation de connaissances, de représentations, de modèles de pensée qu’ils soient issus des sciences humaines (histoire, sociologie, économie…) ou de domaines différents comme la physique, la biologie, la chimie… La collection est ouverte à des travaux qui mettent en œuvre des méthodes d’analyses diverses, soit pour étudier la genèse des représentations, l’intertextualité et le contexte culturel ou la poétique des textes. -

Cézanne and Provence: the Painter in His Culture by Nina Maria Athanassoglou-Kallmyer
Charles Stuckey book review of Cézanne and Provence: The Painter in His Culture by Nina Maria Athanassoglou-Kallmyer Nineteenth-Century Art Worldwide 5, no. 1 (Spring 2006) Citation: Charles Stuckey, book review of “Cézanne and Provence: The Painter in His Culture by Nina Maria Athanassoglou-Kallmyer,” Nineteenth-Century Art Worldwide 5, no. 1 (Spring 2006), http://www.19thc-artworldwide.org/spring06/167-cezanne-and-provence-the-painter- in-his-culture-by-nina-maria-athanassoglou-kallmyer. Published by: Association of Historians of Nineteenth-Century Art Notes: This PDF is provided for reference purposes only and may not contain all the functionality or features of the original, online publication. ©2006 Nineteenth-Century Art Worldwide Stuckey: Cézanne and Provence: The Painter in His Culture Nineteenth-Century Art Worldwide 5, no. 1 (Spring 2006) Cézanne and Provence: The Painter in His Culture Nina Maria Athanassoglou-Kallmyer Chicago: University of Chicago Press, 2003 323 pp; 216 illustrations, many in color. ISBN: 0226423085 Indexed $65.00 (hardcover) "What has erased the sea and soil of Provence from your heart? What fate has abducted the sparkling sunshine of your childhood? In your sadness, recall somehow what joy shined on you there and what peace can shine on you there yet again." So at the beginning of the second act of Verdi's La Traviata, 1853, does Germont console his wayward son Alfredo, trying to rescue him from the urban vices of Paris. The following year, 1854, a group of Provençal poets formed the Félibrige, an association for the appreciation and preservation of local language and customs of France's most southeastern region. -

Journal Officiel De La République Française
o Quarante-troisième année. – N 112 B ISSN 0298-2978 Samedi 13 et dimanche 14 juin 2009 BODACCBULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES CIVILES ET COMMERCIALES ANNEXÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Standard......................................... 01-40-58-75-00 DIRECTION DES JOURNAUX OFFICIELS Annonces....................................... 01-40-58-77-56 Renseignements documentaires 01-40-58-79-79 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15 Abonnements................................. 01-40-58-79-20 www.journal-officiel.gouv.fr (8h30à 12h30) www.bodacc.fr Télécopie........................................ 01-40-58-77-57 BODACC “B” Modifications diverses - Radiations Avis aux lecteurs Les autres catégories d’insertions sont publiées dans deux autres éditions séparées selon la répartition suivante Ventes et cessions .......................................... Créations d’établissements ............................ @ Procédures collectives .................................... ! BODACC “A” Procédures de rétablissement personnel .... Avis relatifs aux successions ......................... * Avis de dépôt des comptes des sociétés .... BODACC “C” Banque de données BODACC servie par les sociétés : Altares-D&B, EDD, Experian, Optima on Line, Groupe Sévigné-Payelle, Questel, Tessi Informatique, Jurismedia, Pouey International, Scores et Décisions, Les Echos, Creditsafe, Coface services et Cartegie. Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 17 mai 1984 relatif à la constitution et à la commercialisation d’une banque de données télématique des informations contenues dans le BODACC, le droit d’accès prévu par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès de la Direction des Journaux officiels. Le numéro : 2,50 € Abonnement. − Un an (arrêté du 21 novembre 2008 publié au Journal officiel du 27 novembre 2008) : France : 367,70 €. Pour l’expédition par voie aérienne (outre-mer) ou pour l’étranger : paiement d’un supplément modulé selon la zone de destination ; tarif sur demande Paiement à réception de facture. -
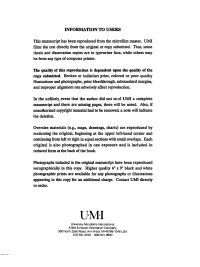
Information to Users
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not se^d UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note wiU indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6" x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this co^r for an additional charge. Contact UMI directly to order. UMI University Microfilms International A Bell & Howell Information Com pany 300 North Zeeb Road. Ann Arbor. Ml 48106-1346 USA 313/761-4700 800/521-0600 Order Nimiber 9505207 E v a Gouzalès (1849— 1.883): A n examination of the artist’s style and subject matter. -

Auvers-Sur-Oise Village D'artistes
AUVERS-SUR-OISE VILLAGE D’ARTISTES PRESS RELEASE THE 2015 CULTURAL SEASON Press Release “In the footsteps of Van Gogh” Auvers-sur-Oise // 4 April – 20 September 2015 THE 2015 CULTURAL SEASON IN AUVERS-SUR-OISE IS DEDICATED TO VINCENT VAN GOGH In 2015 a great number of European places and institutions will be organizing a variety of exhibitions, experiences and events to commemorate the 125th anniversary of the death of Vincent van Gogh on 29th July 1890. In a short life of just 37 years the artist had no fewer than 38 different addresses in The Netherlands, Belgium, the United Kingdom and finally France. It was in France, his adoptive country, that Van Gogh in just under five years painted all the pictures that were to make him famous. It was also in France, in the village of Auvers-sur-Oise, that his doom-haunted existence came to an end. This was where he breathed his last in tragic circumstances that are destined forever to be veiled in mystery. Should it be regarded as the culmination of a yearning for the infinite, or the brutal rupture of a mythic destiny? Van Gogh carried the answer with him to his tomb… Today Auvers-sur-Oise is a veritable open-air museum where there is a kind of emotional truth that counts for more than historical fact. Auvers-sur-Oise is where one comes to meditate at the twin tombs of the Van Gogh brothers and commune with their occupants. Just a few feet away, over the cemetery wall, the communicant can see and hear the wind whistling in the fields of wheat, all the while listening to the tolling of the bells in the church immortalized by Vincent. -

Mcnay ART MUSEUM 2013 | 2015 Annual Report Visitors Enjoy a Free Family John and Peg Emley with Bill Chiego at the Margaritaville at the Day at the Mcnay
McNAY ART MUSEUM 2013 | 2015 Annual Report Visitors enjoy a free family John and Peg Emley with Bill Chiego at the Margaritaville at the day at the McNay. McNay Spring Party. Lesley Dill and René Paul Barilleaux, Chief Curator/Curator of Contemporary Art, at the Opening of Lesley Dill: Performance as Art. McNay Second Thursday band plays indie tunes on the Brown Sculpture Terrace. Visitors enjoy a free family day at the McNay. Emma and Toby Calvert at the 60th Sarah E. Harte and John Gutzler at the 60th Anniversary Celebration Anniversary Celebration Visitor enjoys field day activities during a free A local food truck serves up delicious dishes at McNay Second Suhail Arastu at the McNay Gala Hollywood Visions: Dressing the Part. family day at the McNay. Thursdays. Table of Contents Board of Trustees As of December 31, 2015 Letter from the President ................................................................................4 Tom Frost, Chairman Sarah E. Harte, President Letter from the Director ...................................................................................5 Connie McCombs McNab, Vice President Museum Highlights ...........................................................................................6 Lucille Oppenheimer Travis, Secretary Barbie O’Connor, Treasurer Notable Staff Accomplishments ...................................................................10 Toby Calvert Acquisitions ..........................................................................................................13 John W. Feik -

Impressionism Post-Impressionism and Fauvism
• This lecture provides a quick introduction to Impressionism, the Post- Impressionists, particularly Paul Cézanne, Divisionism/Pointillism, the Fauves and Matisse • The lecture ends with the exhibition held by Roger Fry in 1910 called Manet and the Post-Impressionists. This is regarded as a turning point and the time when developments that had taken place in France over the previous 20 years were seen in England. Although made fun of by the critics it changed the way many artists worked. Notes • The following are not covered as they were covered in the course last year. • Introduce the influence on England Whistler, English Impressionists • New English Art Club • Camille Pissarro (1830-1903) is the only artist to have shown his work at all eight Paris Impressionist exhibitions, from 1874 to 1886. He ‘acted as a father figure not only to the Impressionists’ but to all four of the major Post-Impressionists, including Georges Seurat (1859-1891), Paul Cézanne (1839-1906), Vincent van Gogh (1853-1890, died aged 37)) and Paul Gauguin (1848-1903). • Roger Fry 1 • Created the name Post-Impressionist, started the Omega Workshop (Fitzroy Square), curator Metropolitan Museum, ‘discovered’ Paul Cezanne, Slade Professor • Wrote An Essay in Aesthetics • Organised the 1910 ‘Manet and the Post-Impressionists’ Exhibition, Grafton Galleries. ‘On or about December 1910 human character changed’ Vanessa Bell. • Organised the 1912 ‘Second Post-Impressionist Exhibition’. References • The main sources of information are the Tate website, Wikipedia, The Art Story and the Oxford Dictionary of National Biography. Verbatim quotations are enclosed in quotation marks. If it is not one of the references just mentioned then it is listed at the bottom of the relevant page.