Article-Doro Vers.Finale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Globalna Strategija Ohranjanja Rastlinskih
GLOBALNA STRATEGIJA OHRANJANJA RASTLINSKIH VRST (TOČKA 8) UNIVERSITY BOTANIC GARDENS LJUBLJANA AND GSPC TARGET 8 HORTUS BOTANICUS UNIVERSITATIS LABACENSIS, SLOVENIA INDEX SEMINUM ANNO 2017 COLLECTORUM GLOBALNA STRATEGIJA OHRANJANJA RASTLINSKIH VRST (TOČKA 8) UNIVERSITY BOTANIC GARDENS LJUBLJANA AND GSPC TARGET 8 Recenzenti / Reviewers: Dr. sc. Sanja Kovačić, stručna savjetnica Botanički vrt Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu muz. svet./ museum councilor/ dr. Nada Praprotnik Naslovnica / Front cover: Semeska banka / Seed bank Foto / Photo: J. Bavcon Foto / Photo: Jože Bavcon, Blanka Ravnjak Urednika / Editors: Jože Bavcon, Blanka Ravnjak Tehnični urednik / Tehnical editor: D. Bavcon Prevod / Translation: GRENS-TIM d.o.o. Elektronska izdaja / E-version Leto izdaje / Year of publication: 2018 Kraj izdaje / Place of publication: Ljubljana Izdal / Published by: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta UL Ižanska cesta 15, SI-1000 Ljubljana, Slovenija tel.: +386(0) 1 427-12-80, www.botanicni-vrt.si, [email protected] Zanj: znan. svet. dr. Jože Bavcon Botanični vrt je del mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov © Botanični vrt Univerze v Ljubljani / University Botanic Gardens Ljubljana ----------------------------------- Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani COBISS.SI-ID=297076224 ISBN 978-961-6822-51-0 (pdf) ----------------------------------- 1 Kazalo / Index Globalna strategija ohranjanja rastlinskih vrst (točka 8) -

Piano Di Gestione Del Sic/Zps It3310001 “Dolomiti Friulane”
Piano di Gestione del SIC/ZPS IT 3310001 “Dolomiti Friulane” – ALLEGATO 2 PIANO DI GESTIONE DEL SIC/ZPS IT3310001 “DOLOMITI FRIULANE” ALLEGATO 2 ELENCO DELLE SPECIE FLORISTICHE E SCHEDE DESCRITTIVE DELLE SPECIE DI IMPORTANZA COMUNITARIA Agosto 2012 Responsabile del Piano : Ing. Alessandro Bardi Temi Srl Piano di Gestione del SIC/ZPS IT 3310001 “Dolomiti Friulane” – ALLEGATO 2 Classe Sottoclasse Ordine Famiglia Specie 1 Lycopsida Lycopodiatae Lycopodiales Lycopodiaceae Huperzia selago (L.)Schrank & Mart. subsp. selago 2 Lycopsida Lycopodiatae Lycopodiales Lycopodiaceae Diphasium complanatum (L.) Holub subsp. complanatum 3 Lycopsida Lycopodiatae Lycopodiales Lycopodiaceae Lycopodium annotinum L. 4 Lycopsida Lycopodiatae Lycopodiales Lycopodiaceae Lycopodium clavatum L. subsp. clavatum 5 Equisetopsida Equisetatae Equisetales Equisetaceae Equisetum arvense L. 6 Equisetopsida Equisetatae Equisetales Equisetaceae Equisetum hyemale L. 7 Equisetopsida Equisetatae Equisetales Equisetaceae Equisetum palustre L. 8 Equisetopsida Equisetatae Equisetales Equisetaceae Equisetum ramosissimum Desf. 9 Equisetopsida Equisetatae Equisetales Equisetaceae Equisetum telmateia Ehrh. 10 Equisetopsida Equisetatae Equisetales Equisetaceae Equisetum variegatum Schleich. ex Weber & Mohr 11 Polypodiopsida Polypodiidae Polypodiales Adiantaceae Adiantum capillus-veneris L. 12 Polypodiopsida Polypodiidae Polypodiales Hypolepidaceae Pteridium aquilinum (L.)Kuhn subsp. aquilinum 13 Polypodiopsida Polypodiidae Polypodiales Cryptogrammaceae Phegopteris connectilis (Michx.)Watt -

The Rock Garden 136 the Ro
January 2016 January 2016 THE ROCK GARDEN 136 THE ROCK GARDEN 136 January 2016 THE ROCK GARDEN Volume XXXIV Part 3 - 136 January 2016 THE ROCK GARDEN Volume XXXIV Part 3 - 136 PostalPostal Subscriptions Subscriptions from from 1st October, 1st October, 2015 2015 Postal subscriptionsPostal subscriptions are payable are payable annually annually by October by October and provide and provide membership membership of the of the SRGC untilSRGC 30 thuntil September 30th September of the following of the following year. year. SubscriptionSubscription Rates Rates UK UK OverseasOverseas Single annualSingle annual £18 £18 £23 £23 Junior Junior £3 £3 £7 £7 (under 18(under on 1 18st Oct) on 1st Oct) Family Family £21 £21 £25 £25 (Two adults(Two andadults up and to two up childrento two children under 18 under on 1 18st Oct) on 1st Oct) Three yearThree subscriptions year subscriptions are available are available at three at times three the times above the aboveannual annualrates. Renewals rates. Renewals for threefor year three subscriptions year subscriptions may only may be only made be atmade the end at the of endthe three of the year three period. year period. All subscriptionAll subscription payments payments to the club to the must club be must made be inmade GB Pounds in GB Pounds Sterling. Sterling. ChequesCheques should shouldbe made be payablemade payable to ‘The Scottishto ‘The Scottish Rock Garden Rock Garden Club’ and Club’ must and be must be drawn ondrawn a UK on bank. a UK bank. SubscriptionSubscription payments payments may be may made be throughmade through the post the by post Visa byor MastercardVisa or Mastercard providingproviding the following the following information information is sent: is sent: The longThe number long number on the cardon the card The nameThe ofname the cardholder of the cardholder as shown as onshown the cardon the card The cardThe expiry card date expiry date The cv2The 3 digit cv2 number3 digit number (from back (from of back the card) of the card) The cardholder’sThe cardholder’s signature. -

A R N I C a M O N T a N A
A R N I C A M O N T A N A L. Species Plantarum 2: 884 (1753). NOMS POPULARS Alemany: Arnica / Berg-wohlverleih / Bergdotterblume / Bergwegebreit / Bergwohlverleih / Bergwurz / Bergwurzelblumen / Blutblumen / Bluttrieb / Christwurz / Donnerblume / Echte arnika / Engelblume / Engelblumen / Engelkraut / Fallkraut / Fallkrautblumen / Färberblume / Gamsblumen / Gemswurz / Johannisblume / Kraftrose / Kraftwurz / Kraftwurzel / Leopardenwürger / Mitterwurz / Mönchskappe / St. Lucienkraut / Stichkraut / Stichwurzel / Verfangkraut / Wohlverlei / Wohlverleih / Wohlverleihblüten / Wolferley / Wolffelei / Wolfsbann / Wolfsblume / Wolfsdistel / Wundkraut Alt-aragonès: árnica. Anglès: Arnica / Cure all / European arnica / Fallherb / Golden-fleece / Lambskin / Mountain arnica / Mountain daisy / Mountain tobacco / Sneezewort / Tumblers / Wolf's bane Aragonès: árnica (2), tabaco de montaña. Bable: árnica, arnicón, estornudadera. Castellà: árnica, estornudadera, flor de tabaco, hierba de las caídas, hierba santa, tabaco borde, tabaco de montaña, tabaco del diablo, talpa, talpica, dorónico de Alemania, estabaco, estornudadera, rabo de gato, tabaco, tabaco borde, tabaco de la montaña, tabaco de montaña, talpica. Català: alop, àrnica, herba capital, esternudera, flor de tabac, herba de les caigudes, tabac de muntanya, tabac de pastor, talpa, talpica. Danès: Arnica / Arnika / Arnikablomst / Bjerg-guldblomme / Bjergvolverlej / Gammelmand / Volverlejblomst Eslovè: Arnika horská Euskera: arnika, usin-belar, árnika. Francès: Plantain des Alpes, Herbes aux chutes, -

Vol. 5 2011 Contents
Vol. 5 2011 01 November 2011 Print version Contents: Günter Gottschlich, Jean-Marc Tison, Valéry Malecot & Thomas Rouillard Typification of names in genus Hieracium based on original herbarium material of Alexis Jordan and Alexandre Boreau pp 1 - 107 DOI 10.3264/FG.2011.0301 www.forum-geobotanicum.net FG ISSN 1867-9315 www.forum-geobotanicum.net Board of Editors: Prof. Dr. Lenz Meierott, Editor-in-Chief Am Happach 43 D-97218 Gerbrunn [email protected] Tel. +49 (0)931 706052 Prof. Dr. Detlev Drenckhahn, Publisher Würzburg [email protected] Dr. Franz G. Dunkel Karlstadt Prof. Dr. Jörg Ewald Weihenstephan Dr. Franz Schuhwerk München © Forum Geobotanicum. All rights reserved Preface: Forum geobotanicum is an electronic journal devoted to disseminate information concerning geographical distribution, ecology, morphology, taxonomy and conservation of vascular plants in the European Union with a main focus on middle Europe. It covers from molecular biology to environmental aspects. The focus is to publish original papers, reviews and announcements for the educated generalist as well as the specialist in this broad field. Forum geobotanicum does not aim to supplant existing paper journals, but will be much more flexible in format, publication time and world-wide distribution than paper journals. Many important studies are being currently published in local journals and booklets and some of them are published privately. Hence, these studies will become aware to only a limited readership. Forum geobotanicum will encourage authors of such papers to submit them as special issues of the journal. Moreover, the journal is planning to build up an E-mail-address section to support communication between geobotanists in Europe. -

A Guide to Frequent and Typical Plant Communities of the European Alps
- Alpine Ecology and Environments A guide to frequent and typical plant communities of the European Alps Guide to the virtual excursion in lesson B1 (Alpine plant biodiversity) Peter M. Kammer and Adrian Möhl (illustrations) – Alpine Ecology and Environments B1 – Alpine plant biodiversity Preface This guide provides an overview over the most frequent, widely distributed, and characteristic plant communities of the European Alps; each of them occurring under different growth conditions. It serves as the basic document for the virtual excursion offered in lesson B1 (Alpine plant biodiversity) of the ALPECOLe course. Naturally, the guide can also be helpful for a real excursion in the field! By following the road map, that begins on page 3, you can determine the plant community you are looking at. Communities you have to know for the final test are indicated with bold frames in the road maps. On the portrait sheets you will find a short description of each plant community. Here, the names of communities you should know are underlined. The portrait sheets are structured as follows: • After the English name of the community the corresponding phytosociological units are in- dicated, i.e. the association (Ass.) and/or the alliance (All.). The names of the units follow El- lenberg (1996) and Grabherr & Mucina (1993). • The paragraph “site characteristics” provides information on the altitudinal occurrence of the community, its topographical situation, the types of substrata, specific climate conditions, the duration of snow-cover, as well as on the nature of the soil. Where appropriate, specifications on the agricultural management form are given. • In the section “stand characteristics” the horizontal and vertical structure of the community is described. -

Opération De Réaménagement Du Bâtiment Allard - Arboretum De La Maulévrie D’Angers
DOSSIER DE PRESSE Opération de réaménagement du bâtiment Allard - Arboretum de la Maulévrie d’Angers Responsable des relations presse Ville d’Angers Corine Busson-Benhammou 02 41 05 40 33 – 06 12 52 64 98 [email protected] 1 L’Opération de réaménagement du Bâtiment Allard En 2008, un diagnostic du Bâtiment Allard a été commandé par la Ville dans le cadre du suivi des bâtiments dont elle est propriétaire. Il a révélé un défaut de solidité lié à la surcharge du 1er étage due principalement au stockage des herbiers du département Botanique et des bibliothèques des associations. Ce sont alors présentées deux options à la Ville : - Soit fermer le bâtiment au public et donc voir les associations obligées d’exercer leurs activités dans un autre lieu ; - Soit réaliser des travaux afin de sécuriser le bâtiment. Afin de rationaliser au maximum le coût de l’opération, plutôt que transformer et dénaturer le bâtiment par de lourds travaux, il a été choisi de modifier la distribution des espaces afin que les charges trop lourdes pour le 1er étage soient descendues au rez-de- chaussée. Ainsi, compte tenu des besoins différents des structures hébergées, l’affectation des salles a été revue : - La SHA et l’herbier du Département botanique sont passés du 1er au rez-de- chaussée ; - LA SESA est elle montée à l’étage. L’essentiel de cette opération débutée en décembre 2011, s’est achevé en juin 2012. Grâce à cette opération, le bâtiment peut continuer à recevoir du public et les associations peuvent reprendre leurs activités. -

Interpretation Manual of European Union Habitats - EUR27 Is a Scientific Reference Document
INTERPRETATION MANUAL OF EUROPEAN UNION HABITATS EUR 27 July 2007 EUROPEAN COMMISSION DG ENVIRONMENT Nature and biodiversity The Interpretation Manual of European Union Habitats - EUR27 is a scientific reference document. It is based on the version for EUR15, which was adopted by the Habitats Committee on 4. October 1999 and consolidated with the new and amended habitat types for the 10 accession countries as adopted by the Habitats Committee on 14 March 2002 with additional changes for the accession of Bulgaria and Romania as adopted by the Habitats Committee on 13 April 2007 and for marine habitats to follow the descriptions given in “Guidelines for the establishment of the Natura 2000 network in the marine environment. Application of the Habitats and Birds Directives” published in May 2007 by the Commission services. A small amendment to Habitat type 91D0 was adopted by the Habitats Committee in its meeting on 14th October 2003. TABLE OF CONTENTS WHY THIS MANUAL? 3 HISTORICAL REVIEW 3 THE MANUAL 4 THE EUR15 VERSION 5 THE EUR25 VERSION 5 THE EUR27 VERSION 6 EXPLANATORY NOTES 7 COASTAL AND HALOPHYTIC HABITATS 8 OPEN SEA AND TIDAL AREAS 8 SEA CLIFFS AND SHINGLE OR STONY BEACHES 17 ATLANTIC AND CONTINENTAL SALT MARSHES AND SALT MEADOWS 20 MEDITERRANEAN AND THERMO-ATLANTIC SALTMARSHES AND SALT MEADOWS 22 SALT AND GYPSUM INLAND STEPPES 24 BOREAL BALTIC ARCHIPELAGO, COASTAL AND LANDUPHEAVAL AREAS 26 COASTAL SAND DUNES AND INLAND DUNES 29 SEA DUNES OF THE ATLANTIC, NORTH SEA AND BALTIC COASTS 29 SEA DUNES OF THE MEDITERRANEAN COAST 35 INLAND -

Samenkatalog Graz 2019 End.Pdf
SAMENTAUSCHVERZEICHNIS Index Seminum Seed list Catalogue de graines Botanischer Garten der Karl-Franzens-Universität Graz Ernte / Harvest / Récolte 2019 Herausgegeben von Christian BERG, Kurt MARQUART, Thomas GALIK & Jonathan WILFLING ebgconsortiumindexseminum2012 Institut für Biology, Januar 2020 Botanical Garden, Institute of Biology, Karl-Franzens-Universität Graz 2 Botanischer Garten Institut für Biologie Karl-Franzens-Universität Graz Holteigasse 6 A - 8010 Graz, Austria Fax: ++43-316-380-9883 Email- und Telefonkontakt: [email protected], Tel.: ++43-316-380-5651 [email protected], Tel.: ++43-316-380-5747 Webseite: http://garten.uni-graz.at/ Zitiervorschlag : BERG, C., MARQUART, K., GALIK, T. & Wilfling, J. (2020): Samentauschverzeichnis – Index Seminum – des Botanischen Gartens der Karl-Franzens-Universität Graz, Samenernte 2019. – 44 S., Karl-Franzens-Universität Graz. Personalstand des Botanischen Gartens Graz: Institutsleiter: Univ.-Prof. Dr. Christian STURMBAUER Wissenschaftlicher Gartenleiter: Dr. Christian BERG Technischer Gartenleiter: Jonathan WILFLING, B. Sc. GärtnerInnen: Doris ADAM-LACKNER Viola BONGERS Thomas GALIK Margarete HIDEN Kurt MARQUART Franz STIEBER Ulrike STRAUSSBERGER Monika GABER René MICHALSKI Techn. MitarbeiterInnen: Oliver KROPIWNICKI Martina THALHAMMER Gärtnerlehrlinge: Sophia DAMBRICH (3. Lehrjahr) Wanja WIRTL-MÖLBACH (3. Lehrjahr) Jean KERSCHBAUMER (3. Lehrjahr) 3 Inhaltsverzeichnis / Contents / Table des matières Abkürzungen / List of abbreviations / Abréviations ................................................. -

Doronicum Grandiflorum Lam
Doronicum grandiforum Lam. Asteraceae – Helenieae Syn.: Arnica scorpioides Jacq., Aronicum barcense Simonk., A. latifolium Rchb., Do- ronicum ambiguum Rouy, D. gracile Schur, D. halleri Tausch, D. portae Chabert, D. vis- cosum (Freyn & Gaut.) Nyman Description: Perennial herbs, 10–40 cm tall, glandular hairy, stems erect, un- branched, basal leaves long petiolate, ovate to subcordate, margins coarsely dentate, cauline leaves sessile, capitula yel- low, 4–6 cm across, terminal, single. Distribution: Europe (Alps, Pyrenees, N Balkans). Habitat: Rocky debris, screes; on limestone. CC0 1.0 duct Rhizome with a diameter of 3–4 mm. Xy- duct lem to bark ratio 1:1. Rings indistinct. Very large pith. Analyzed: 4 individuals. vab Xylem Transverse section Diffuse-porous. Ring boundaries, if recog- nizable, marked by a slight difference in ph latewood and earlywood vessel diameters. Large vessels with a diameter of 50–80 µm. Vessels lignifed, thin- to thick-walled, soli- tary or in small tangential groups. Vessel xy outline angular. Fibers and fber tracheids absent. Parenchyma paratracheal, perva- sive. Shape of vascular bundles remaining over several years. Vascular bundles sur- rounded by an endodermis-like row of oval cells. Crystals absent. 500 µm 250 µm Tangential section co xyph pith Rays absent within vascular bundles. Large rays between bundles 6- to >10-seriate, unlignifed, confuent with the axial tissue. Radial section Perforation plates simple. Intervessel pits scalariform. Vessel length 100–120 µm. In- terfascicular zones with upright cells. Bark With large ducts. Sieve elements in small groups. Phellem consisting of very few si rectangular cells. Pith Very large. 50 µm 25 µm v Features according to IAWA and Crivellaro and Schweingruber 2015 Xylem 1 - 5 - 9 - 12 - 13 - 22 - 41 - 50.2 - 52.3 - 60.1 - 79 - 79.1 - 99 - 99.1 - 100.1 - 100.2 - 105 © The Editor(s) (if applicable) and The Author(s), under exclusive license to Springer Nature Switzerland AG 2020 82 F. -

Altitudinal Differences in Flower Traits and Reproductive Allocation
Published in "Flora 199: 70–81, 2004" which should be cited to reference this work Altitudinal differences in flower traits and reproductive allocation Thomas Fabbro1,*, Christian Körner1 1 Institute of Botany, University of Basel, Schönbeinstrasse 6, CH-4056 Basel, Switzerland Submitted: Jun 10, 2003 · Accepted: Aug 1, 2003 Summary We tested whether alpine plants increase their effort to attract pollinators to compensate for assumed pollinator scarcity at high altitude. A three times larger fraction of the shoot was allocated to flowers in alpine plants (30 species, 2700 m asl) compared to lowland plants (20 species, 600 m asl), while leaf mass fraction did not differ between the altitudes. At high elevation, a three times smaller fraction of the shoot was allocated to stems, which was accompanied by a change in its function from leaf support for pho- tosynthesis at low altitude to support for flowers at high altitude. Although shoot mass is massively reduced at high altitudes, dis- play area and biomass of individual flowers were remarkably similar at both altitudes. All flowers together attracted pollinators with about the same total display area relative to overall plants size, but generally alpine plants maintain their flowers longer. To- gether with decreased plant height this leads to an increased self-shading which is likely to cause reductions in carbon gain in alpine plants. The results of this field survey emphasize the importance of outcrossing in alpine plants and its priority over growth. Key words: alpine plant ecology, biomass, biometry, allometry, flower longevity, Swiss Alps Introduction Pollinator preference for larger flowers or inflores- cences has been demonstrated in a number of species The reduction in overall plant size is the most conspi- belonging to a wide range of families and growing in cuous structural alteration in plants observed along different habitats (e.g. -
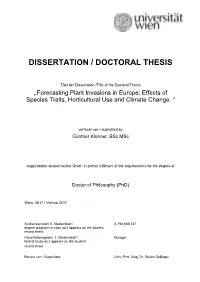
Dissertation / Doctoral Thesis
DISSERTATION / DOCTORAL THESIS Titel der Dissertation /Title of the Doctoral Thesis „ Forecasting Plant Invasions in Europe: Effects of Species Traits, Horticultural Use and Climate Change. “ verfasst von / submitted by Günther Klonner, BSc MSc angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) Wien, 2017 / Vienna 2017 Studienkennzahl lt. Studienblatt / A 794 685 437 degree programme code as it appears on the student record sheet: Dissertationsgebiet lt. Studienblatt / Biologie field of study as it appears on the student record sheet: Betreut von / Supervisor: Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Dullinger “Whatever makes the past, the distant, or the future, predominate over the present, advances us in the dignity of thinking beings.” Samuel Johnson (1791) “In the 1950s, the planet still had isolated islands, in both geographical and cultural terms - lands of unique mysteries, societies, and resources. By the end of the 20th century, expanding numbers of people, powerful technology, and economic demands had linked Earth’s formerly isolated, relatively non-industrialized places with highly developed ones into an expansive and complex network of ideas, materials, and wealth.” Lutz Warren and Kieffer (2010) ACKNOWLEDGEMENT As for many others, the last few years have been an up and down, however, I made it through thanks to my family, friends and colleagues without whom this wouldn’t have been possible. To the love of my life, my wife Christine Schönberger: because you are my support, advice and courage. Because we share the same dreams. Many Thanks! My brother and one of my best friends, Dietmar, who provided me through emotional support in many situations and shares my love to mountains and sports: Thank you! I am also grateful to my other family members, especially my parents Ingeborg and Martin, who were always keen to know what I was doing and how I was proceeding.