Les Différents Modèles Économique Du Logiciel Libre
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Unix Open 02
ISSN 0943-8416 B 30674 E 02 2/2000 2/2000 Februar 4 398040 609007 DM 9.00; NIX Ös 68,–; Sfr 9,00 NIX OPEN OPEN Die Zeitschrift für Unix- und Linux-Profis U U Programmieren im Baukastensystem Objektorientierte Vergleichstest: Redhat Techniken 6.1 und Suse 6.3 • OO-Datenbanksysteme: Marktführer unter sich Renaissance dank XML Modulare Software-Architektur Im Trend: grafische • Installations-Tools als Basis für flexible Anwendungen Einfache Programmie- Cluster rung mit der “bash” • Serienstart: garantierte Dateien schützen Hochverfügbarkeit Wiederherstellungsoption per Shellscript Netzwerktechnik Der direkte Weg Test: IDE-Bandlaufwerk unter Linux zu 10 GBit/s 30 GByte aufs Band Marktübersicht Low-cost-Lösung für Backup- den kleinen Geldbeutel Cluster-Lexikon • Übersicht:Cluster-Lexikon • Unix-News Techniken • Objektorientierte • Neue Bücher Backup-Laufwerke Laufwerke NIX www.linux-open.de UOPEN www.unix-open.de EDITORIAL Im Assistenten- Zeitalter Mit Redhat 6.1 und Suse 6.3 sind die neuesten Linux-Versionen zum Test bei uns eingetroffen. Und siehe da, was uns die schöne bunte Windows-Welt schon seit langem vormacht, hält nun auch im Linux-Universum Einzug: Die Rede ist hier nicht von wirklich wichtigen Features oder exorbitanten Performance-Verbesse- rungen – nein, der Punkt “Installation” zieht im modernen grafischen Gewand die Aufmerksamkeit auf sich. Wie schon in der Windows-Welt üblich, sollen grafische Werkzeuge die Last der ersten Stunden lindern helfen. Ob der Linux-Insider diese Tools braucht, muss die Praxis zeigen. Einfacher wird aber die Aufgabe damit nicht. In der Windows-Welt gaukeln einem diverse Assistenten vor, dass viele systemnahe und auch normalerweise kritische Operationen sich ganz einfach ausführen lassen. -
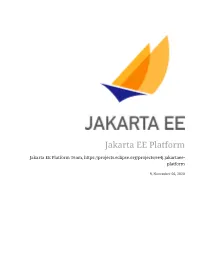
Jakarta EE Platform 9 Specification Document
Jakarta EE Platform Jakarta EE Platform Team, https://projects.eclipse.org/projects/ee4j.jakartaee- platform 9, November 06, 2020 Table of Contents Copyright. 2 Eclipse Foundation Specification License . 3 Disclaimers. 3 1. Introduction . 6 1.1. Acknowledgements for the Initial Version of Java EE . 6 1.2. Acknowledgements for Java EE Version 1.3 . 7 1.3. Acknowledgements for Java EE Version 1.4 . 7 1.4. Acknowledgements for Java EE Version 5 . 7 1.5. Acknowledgements for Java EE Version 6 . 8 1.6. Acknowledgements for Java EE Version 7 . 8 1.7. Acknowledgements for Java EE Version 8 . 8 1.8. Acknowledgements for Jakarta EE 8 . 9 1.9. Acknowledgements for Jakarta EE 9 . 9 2. Platform Overview. 10 2.1. Architecture . 10 2.2. Profiles. 11 2.3. Application Components. 13 2.3.1. Jakarta EE Server Support for Application Components. 13 2.4. Containers. 14 2.4.1. Container Requirements . 14 2.4.2. Jakarta EE Servers. 14 2.5. Resource Adapters . 15 2.6. Database . 15 2.7. Jakarta EE Standard Services. 15 2.7.1. HTTP. 15 2.7.2. HTTPS. 15 2.7.3. Jakarta Transaction API (JTA) . 15 2.7.4. RMI-IIOP (Optional) . 16 2.7.5. Java IDL (Optional) . 16 2.7.6. JDBC™ API . 16 2.7.7. Jakarta Persistence API . 16 2.7.8. Jakarta™ Messaging . 16 2.7.9. Java Naming and Directory Interface™ (JNDI). 16 2.7.10. Jakarta™ Mail. 17 2.7.11. Jakarta Activation Framework (JAF) . 17 2.7.12. XML Processing . 17 2.7.13. -

Enhydra XMLC Java Presentation Development Is Written for Computer
Enhydra XMLC™ Java™ Presentation Development By David H. Young Publisher : Sams Publishing Pub Date : January 15, 2002 ISBN : 0-672-32211-0 Table of Contents Pages : 504 Enhydra XMLC Java Presentation Development is written for computer professionals, with a special focus on application architects, Java Web application developers, and those who are just ramping up on Java and are excited about immersing themselves into Web application development. Taking a task view wherever possible, this book is written to support those seeking a more elegant, maintainable, and flexible mechanism for building Web application presentations. While we spend some time introducing the Enhydra application server for those who are new to the topic of application server development, this book is focused primarily on the topic of Enhydra XMLC and how to use it to improve the lifecycle requirements of your Web application. Brought to you by ownSky!! Table of Content Table of Content .................................................................................................................. i Copyright............................................................................................................................. vi Copyright ©2002 by Sams Publishing ....................................................................... vi Trademarks.................................................................................................................... vi Warning and Disclaimer.............................................................................................. -

Platform-Spec-8.Pdf
Jakarta EE Platform Jakarta EE Platform Team, https://projects.eclipse.org/projects/ee4j.jakartaee- platform 8, August 26, 2019 Table of Contents Copyright. 1 Eclipse Foundation Specification License . 1 Disclaimers. 2 1. Introduction . 3 1.1. Acknowledgements for the Initial Version of Java EE . 3 1.2. Acknowledgements for Java EE Version 1.3 . 4 1.3. Acknowledgements for Java EE Version 1.4 . 4 1.4. Acknowledgements for Java EE Version 5 . 4 1.5. Acknowledgements for Java EE Version 6 . 5 1.6. Acknowledgements for Java EE Version 7 . 5 1.7. Acknowledgements for Java EE Version 8 . 5 1.8. Acknowledgements for Jakarta EE 8 . 6 2. Platform Overview . 7 2.1. Architecture . 7 2.2. Profiles. 8 2.3. Application Components. 10 2.3.1. Jakarta EE Server Support for Application Components. 10 2.4. Containers. 11 2.4.1. Container Requirements . 11 2.4.2. Jakarta EE Servers. 11 2.5. Resource Adapters . 12 2.6. Database . 12 2.7. Jakarta EE Standard Services. 12 2.7.1. HTTP. 12 2.7.2. HTTPS. 12 2.7.3. Jakarta Transaction API (JTA) . 12 2.7.4. RMI-IIOP (Proposed Optional) . 13 2.7.5. Java IDL (Proposed Optional). 13 2.7.6. JDBC™ API . 13 2.7.7. Jakarta Persistence API . 13 2.7.8. Jakarta™ Messaging . 14 2.7.9. Java Naming and Directory Interface™ (JNDI). 14 2.7.10. Jakarta™ Mail. 14 2.7.11. JavaBeans™ Activation Framework (JAF) . 14 2.7.12. XML Processing . 14 2.7.13. Jakarta Connector Architecture. 14 2.7.14. -

Zbwleibniz-Informationszentrum
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Giuri, Paola; Rocchetti, Gaia; Torrisi, Salvatore Working Paper Open source software: From open science to new marketing models. An enquiry into the economics and management of open source software LEM Working Paper Series, No. 2002/23 Provided in Cooperation with: Laboratory of Economics and Management (LEM), Sant'Anna School of Advanced Studies Suggested Citation: Giuri, Paola; Rocchetti, Gaia; Torrisi, Salvatore (2002) : Open source software: From open science to new marketing models. An enquiry into the economics and management of open source software, LEM Working Paper Series, No. 2002/23, Scuola Superiore Sant'Anna, Laboratory of Economics and Management (LEM), Pisa This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/89477 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.