PDF Du Livre
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Uva-DARE (Digital Academic Repository)
UvA-DARE (Digital Academic Repository) Compulsory religion education and religious minorities in Turkey Müftügil, A.S. Publication date 2011 Link to publication Citation for published version (APA): Müftügil, A. S. (2011). Compulsory religion education and religious minorities in Turkey. General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl) Download date:28 Sep 2021 Chapter 1 Introduction On 19th January 2007, Hrant Dink, a prominent and widely admired Armenian journalist and intellectual, was shot and killed outside his newspaper's office in Istanbul. Grief turned quickly to public anger, especially among young educated students who took part in the huge protests at Dink’s funeral. A Turkish journalist of Armenian origin, Dink had worked strenuously to improve relations between Turks and Armenians. -

Tateos Ministry Update 2019
Ministry Update Tateos and Milena Nigohosyan 3 days ago… Praising God for the BAPTISM we had in the church this Sunday 8:30 in the morning. 13 born-again believers. This is the sixth baptism for this year. 3 were outside in the river and 3 in the church J We had baptism of a French speaking converted from Africa. Last 6 years we had more than 100 exchange students with changed lives. Every year we have new groups coming in our church. After a blessed church service we had FAMILY PARTY. Time for Family seminar, discussions and games. This year we had 7 weddings! Praying for more and more young families to come to Christ! Our prayers and future goals are to reach the next generation. Todays young familyes and the youth. Please, join us in prayer. We need new and working strategies and guidance from the Lord. Most of all we need the work of the Holly Spirit in the lifes of young people to have hunger for knowing Christ and repentance and faith. NEXT page – going to Turkey because of the murder of a Korean pastor-evangelist, to preach on gathering, support and encourage local believers, Korean missionaries, and the future work in this unreached country… Tomorrow and the next 3 days! I am going to Turkey for gathering of about 400-500 Christian pastors and leaders because of the murder of Korean pastor, missionary and evangelist. I will have 30 min to preach and share God’s heart for salvation of the muslim. Jinwook Kim, 41, was stabbed three times on the street in the Turkish city of Diyarbakir on November 19. -

What Criminal Trials Do and Don't Reveal
FORUM 18 NEWS SERVICE, Oslo, Norway http://www.forum18.org/ The right to believe, to worship and witness The right to change one's belief or religion The right to join together and express one's belief This article was published by F18News on: 22 April 2010 TURKEY: What criminal trials do and don't reveal By Güzide Ceyhan It was expected that Turkey's trial of those accused of murdering three Malatya Protestants would end last week, Güzide Ceyhan notes in a commentary for Forum 18 News Service <http://www.forum18.org>. But an indictment related to Operation Cage - an alleged Navy plan targeting Turkey's non-Muslim communities - has been added to the case file but not yet merged with the case. The murders of journalist Hrant Dink, Catholic priest Fr Andrea Santoro and the three Malatya Protestants - Necati Aydin, Tillman Geske and Ugur Yüksel - are expressly identified as helping Cage realise its purposes. This Operation aimed to destabilise the AKP government by both targeting non-Muslims and encouraging protests about their targeting. But what have the criminal trials - very important as they are - really revealed? The tragic irony is that even if Cage is fictitious, freedom of religion or belief for all in Turkey is both limited and under threat. The government has focused on the issues which can most damage the AKP, i.e. possibly Ergenekon-related violent attacks on non-Muslim individuals. But Turkey's many other serious challenges to freedom of religion or belief have not been resolved. The government needs to take action now on those challenges, whether or not they feature in trial proceedings. -

Xenophilia, Difference, and Indifference Benoît Fliche, John Angell
Xenophilia, Difference, and Indifference Benoît Fliche, John Angell To cite this version: Benoît Fliche, John Angell. Xenophilia, Difference, and Indifference. Common Knowledge, Duke University Press, 2018, 24 (2), pp.218-233. 10.1215/0961754x-4362421. hal-01989777 HAL Id: hal-01989777 https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-01989777 Submitted on 22 Jan 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Distributed under a Creative Commons Attribution| 4.0 International License XENOPHILIA A Symposium on Xenophobia’s Contrary Part 4 Benoît Fliche, Jeffrey M. Perl, Paul Fenton, John Tolan, Francis X. Clooney, Caroline Walker Bynum Xenophilia, Difference, and Indifference: Dialogical Introduction I In his introduction to the third installment of this symposium, Jeffrey Perl writes of a Muslim student who visits the confessional at a Roman Catholic church in Akko, among other instances of interreligious behavior that fulfill, to one degree or another, the terms in which exopraxis is usually defined.1 Perl naturally writes of exopraxis in the context of xenophilia, and no doubt his student likes and admires the priests to whom he confesses, but my own experience as a scholar of Muslim exopraxis leaves me hesitant to characterize the student’s feelings toward Christianity or the Catholic Church as loving. -
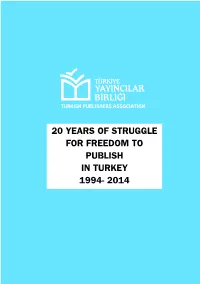
20 Years of Struggle for Freedom to Publish In
20 YEARS OF STRUGGLE FOR FREEDOM TO PUBLISH IN TURKEY 1994- 2014 20 YEARS OF STRUGGLE 20 YEARS OF STRUGGLE FOR FREEDOM TO PUBLISH IN TURKEY Freedom of Thought and Expression Awards and Freedom to Publish Reports FOR FREEDOM TO PUBLISH 1994 - 2014 IN TURKEY 1. EDITION İSTANBUL, SEPTEMBER 2014 ISBN 978-975-365-017-5 Freedom of Thought and Expression Awards All rights reserved. @TURKIYE YAYINCILAR VE YAYIN DAGITIMCILARI BIRLIGI DERNEGI and Freedom to Publish Reports Inonu Caddesi Opera Palas Apt. No: 55 D:2 34437 Gumussuyu, Beyoglu / ISTANBUL 1994 - 2014 T: 0 212 512 56 02 F: 0 212 511 77 94 E: [email protected] TRANSLATION Ali Ottoman, Funda Soysal, Deniz İnal EDITING Yonca Cingöz PROOF READING Sara Whyatt GRAPHIC DESIGN Elif Rifat TYPESETTING Nevruz Kıran Öksüz PRINTED AND BOUND IN Umut Matbaası 3 CONTENTS Foreword.........................................................................................................................................5 FOREWORD Freedom to Publish Report 1994.....................................................................................................8 Every year since 1995, the Turkish Publishers Association prepares Freedom Freedom of Thought and Expression Awards 1995........................................................................16 to Publish Report and hands out an award to a writer, a publisher and a booksell- er. This year the writer’s award goes to Tonguç Ok, an exceptionally productive Freedom of Thought and Expression Awards 1996........................................................................18 -

Turkey's Christians Under Siege
Turkey’s Christians under Siege by John Eibner he brutal murder of the head of Turkey’s Catholic Church, Bishop Luigi Padovese, on June 3, 2010, has rattled the country’s small, diverse, and hard- T pressed Christian community.1 The 62-year-old bishop, who spearheaded the Vatican’s efforts to improve Muslim-Christian relations in Turkey, was stabbed re- peatedly at his Iskenderun home by his driver and bodyguard Murat Altun, who con- cluded the slaughter by decapitating Padovese and shouting, “I killed the Great Satan. Allahu Akhbar!” He then told the police that he had acted in obedience to a “com- mand from God.”2 Though bearing all the hallmarks of a jihadist execution, the murder was met by denials and obfuscation—not only by the Turkish authorities but also by Western gov- ernments and the Vatican. This is not wholly surprising. In the post-9/11 era, it has become commonplace to deny connections between Islam and acts of violence despite much evidence to the contrary.3 But while this denial has undoubtedly sought to win the hearts and minds of Muslims, as opposed to Christians, Jews, or any other religious group, it has served to encourage Islamist terrorism and to exacerbate the persecution of non-Muslim minorities even in the most secularized Muslim states. For all President Barack Obama’s high praise for its “strong, vibrant, secular democracy,”4 and Prime Minister Recep Tayyip Erdoðan’s “Alliance of Civilizations” rhetoric, Turkey is very much entrenched in the clash of civilizations paradigm. Unless Ankara is prepared to combat the widespread “Christophobia” that fuels violence and other forms of repres- sion, the country’s Christians are doomed to remain an oppressed and discriminated against minority, and Turkey’s aspirations of democratic transformation and full integra- tion with Europe will remain stillborn. -

Suffering Persecution and Martyrdom in Turkey CONNECTIONS: the Journal of the WEA Mission Commission, 03 Issue, Article
Suffering Persecution and Martyrdom in Turkey CONNECTIONS: The Journal of the WEA Mission Commission, 03 issue, Article By Carlos Madrigal, Turkey (Translated by Marion Dawn Lewis) On April 18, 2007, some terrible news shook and changed the course of the missionary movement in Turkey forever. I was driving my car to the service of the funeral of a dear brother’s father when I got the call. It is not advisable to answer such a call when one is driving. Just after the incident occurred, this brother, A.S., was telling me, “Three of our brothers from Malatya have been killed, ¡they have been slashed by the throat!” More calls followed, “Are you sure? Who are they? But, how? Misinterpretations rose, “Four were killed, not five; no, they are not dead; yes, they are all dead, but one…” One of the first persons I called was the pastor from our church in Izmit, brother in law to one of the victims. From the vague news, I tried to comfort him, reassuring him that he was still alive. But, the fatal truth was about to come… The media were already there by the time I arrived to the church I headed to. They wanted to know our reaction. However, we did not count on precise information. The only words that I could say in front of TV cameras were: “We do not have accurate facts of what happened. We have little to say. However, it is extremely alarming that Christians in this country live fearing to get killed.” After the hideous killings of our brothers, Necati Aydin, Ugur Yucel and Tilman Geske, three questions came to our minds: Why did God allow this? What is the Lord going to do? In addition, how should we react? After the assassination of Armenian journalist and believer, Hrant Dink last January, we began to expect the worst to happen. -

Information Censorship: a Comparative Analysis of Newspaper Coverage of The
INFORMATION CENSORSHIP: A COMPARATIVE ANALYSIS OF NEWSPAPER COVERAGE OF THE JYLLANDS-POSTEN EDITORIAL CARICATURES IN CROSS-CULTURAL SETTINGS Julie George Thomas, B.A., M.S. Dissertation Prepared for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF NORTH TEXAS August 2010 APPROVED: Brian C. O’Connor, Major Professor F. Mitchell Land, Co-Major Professor Jacqueline Lambiase, Minor Professor Linda Schamber, Program Coordinator, Interdisciplinary Information Science PhD Program Herman L. Totten, Dean of the College of Information James D. Meernik, Acting Dean of the Robert B. Toulouse School of Graduate Studies Thomas, Julie George. Information censorship: A comparative analysis of newspaper coverage of the Jyllands-Posten editorial caricatures in cross-cultural settings. Doctor of Philosophy (Information Science), August 2010, 122 pp., 1 table, 2 illustrations, references, 98 titles. The identification and examination of cultural information strategies and censorship patterns used to propagate the controversial issue of the caricatures in two separate cultural contexts was the aim of this dissertation. It explored discourse used for the coverage of this topic by one newspaper in a restrictive information context and two newspapers in a liberal information context. Message propagation in a restrictive information environment was analyzed using the English daily Kuwait Times from the Middle East; the liberal information environment of the US was analyzed using two major dailies, the New York Times and the Philadelphia Inquirer. The study also concurrently identifies and elaborates on the themes and frames through which discourse was presented exposing the cultural ideologies and premises they represent. The topic was approached with an interdisciplinary position with the support and applicability testing of Chatman’s insider-outsider theory within information science and Noelle-Neumann’s spiral of silence theory and Herman and Chomsky’s propaganda model based in the area of mass communication. -

Notes and Documents A
NOTES AND DOCUMENTS 1 (1975) – 46 (2020) A AFGHANISTAN – A Barnabite: “The fatwa of the ulema against terrorism: historical step for the country” (7 June 2018), 44 (2018) 283 – Appel du Supérieur de la Missio sui iuris d’Afghanistan en faveur d’une paix « sans retour en arrière » dans le pays (28 mars 2019), 45 (2019) 246 – In the “School of Peace”, Afghan children learn about peace and mutual acceptance (5 July 2019), 45 (2019) 246 – From Prague to Kabul, a fundraiser for the needy, a sign of spiritual communion of the Church (4 July 2020), 46 (2020) 325 AFRIQUE / AFRICA – L’Exhortation Apostolique post-synodale « Ecclesia in Africa » (septembre 1995), 22 (1996) 197 – Symposium de Yaoundé (Cameroun) : « Pour une culture chrétienne de la paix » en Afrique (11 avril 2000), 26 (2000) 174 – In Abuja (Nigeria), African Council of Religious Leaders (10-12 June 2003), 29 (2003) 206 – DOSSIER « SYNODE DES EVÊQUES POUR L’AFRIQUE » (4-25 October 2009), 35 (2009) 297-321 – The wishes of the Catholic Church in Africa to the Muslim faithful for the feast of Aid El Adha (15 October 2013), 39 (2013) 198 – L’islam en Afrique de l’Ouest : méconnaissance ou simple oubli ? (11 août 2015), 41 (2015) 195 – Interfaith action plays key role in addressing Africa’s challenges. Virtual meeting of religious leaders (27 August 2020), 46 (2020) 325 AFRIQUE DE L’OUEST / WEST AFRICA – West African Church leaders vow to join forces against terrorism (16 May 2019), 45 (2019) 248 AFRIQUE DU NORD / NORTH AFRICA – Les Evêques de la Conférence Episcopale Régionale du Nord -

25 06 07 Alan Johnston.Pdf
ALAN JOHNSTON PETITION BBC News website users around the world have written in their thousands to demand the release of BBC Gaza correspondent Alan Johnston. An online petition was started on Monday, 2 April. It said: “We, the undersigned, demand the immediate release of BBC Gaza correspondent Alan Johnston. We ask again that everyone with influence on this situation increase their efforts, to ensure that Alan is freed quickly and unharmed.” More than 180,000 have signed. The latest names to be added are published below. A Boratto Waterloo Canada A. Hassadi Dubai - UAE A Cox Melbourne, Australia A. J. Allen Austin, TX, USA A Gibb Mitlon Keynes, United a. korporaal wassenaar, Kingdom netherlands A J F Wyatt Crickhowell, Wales A. Overbeeke The Hague, The a jabbar ali hassan manama Netherlands A Jan Bedfordshire, UK A. R. Dyer Camberley, United A Krisztian Copenhagen - Kingdom Denmark A. R. Parsons Porthcawl a m chittenden llidiartywaen A. Radwan Edison, New Jersey, A Matthews Maroubra, Australia USA A Neal Hampshire, UK A. Ross Aberdeen Scotland A Newell USA A. Small Geneva, Switzerland A Nithyanand New Delhi, India A. Smiers Amsterdam, The A Rowe London, UK Netherlands A Saravanan belfast A. Swaysland Cambridge, UK A Thompson Portsmouth UK A.Gervasi Reggio Emilia Italy A. Bailey caernarfon, Wales a.hafeez barqawi amman A. dos Santos Honeydew South A.J. Northcott Dhaka, Bangladesh Africa A.KHALIL uk/Manchester A.M.Weaver-Croezen Ede ABDUL AZIZ NAREJO Karachi, Netherlands Pakistan A.S. Zijlstra-Bakker Zwolle, The Abdul Basit Newcastle, UK Netherlands ABDUL HAKIM Abu Dhabi / AAA jeddah, saudi arabia U.A.E Aamina Ahmad Woking, Surrey Abdul Ismail Osterley, Middlesex, UK UK Aaron Edlington Sarnia, Ontario, Abdul Rehman Peshkar Mumbai, CANADA India. -

Colorado Department of Transportation Launches Open Data Site
Second-quarter newsletter for the Denver Regional No images? Click here Data Consortium. The data consortium consists of Denver Regional Council of Governments members and regional partners with an interest in geospatial data and collaboration. The data consortium newsletter improves communication among local geographic information systems professionals and features updates from all levels of government as they relate to data and geospatial initiatives in our region. This newsletter is published quarterly. Colorado Department of Transportation launches open data site Article submitted by Shelley Broadway, geographic information systems analyst at CDOT. Shelley can be reached at 303-757-9285 or [email protected]. The Colorado Department of Transportation has launched a public open data website that gives users the ability to explore and download CDOT’s authoritative geospatial data. Open data encourages information sharing, promotes transparency, and enhances engagement with the public. To check out the site, visit data-cdot.opendata.arcgis.com. From the Online Transportation Information System click the "Open Data" tile. Navigating from the main page, visitors can use the search bar to find data by keyword, use the predefined categories to browse data, or click "Data Catalog" in the top right to see all available datasets. Once a user has selected a dataset, they can see a brief description, preview the data on a map, and see associated attributes and tabular data. The search bar in the map window allows visitors to filter records by value, analyze by field, or zoom to a current location. One of the most powerful features of the site is that it provides users a self-service tool to download data in various formats. -
July to September 2006
July - September 2006 Volume 32, Nos. 7 - 9 Among Ourselves Reign of Faith and Reason?? xIn this issue of INFO, we look at two controversies Byzantine Christian Emperor, Manuel II Paleologus, was an that have been a source of great concern to people of all faiths, integral part of this philosophical discourse which attempted especially in the relationship between Muslims and Christians. to make the point that reason cannot justify violence. The We begin with the controversy surrounding the speech argument of the Emperor was that violence is incompatible of Pope Benedict XVI entitled ‘Faith, Reason and the with the nature of God and the nature of the soul. The most University: Memories and Reflections’. It may not have been important question that each believer has to ask is: How many strange that initial media reports and reactions drew varied Christians and Muslims today really believe that violence by responses from both Muslims and Christians alike. There are its very nature is not in keeping with the plan of the Divine? many unanswered questions that can only be found by looking Many of us would like to believe that the Pope in quoting at the full text of the speech bearing in mind both the context this text is not only condemning the use of violence by some in which the ideas that were developed in this philosophical Muslims today, but is also challenging and confronting anyone discourse, as well as the intent of the speaker. who engages in violence. This has to bring one to the We next look at the Danish Cartoon controversy where realisation that one ceases being a believer, be s/he Christian, we have included a number of articles that would enable us Hindu or Muslim, when one promotes violence, as this goes to obtain a more holistic picture of the issues related to this against Reason and God, who is the source of Reason.