Trafics D'enfants
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
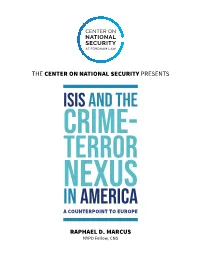
ISIS and the Crime-Terror Nexus in America Executive Summary
CENTER ON NATIONAL SECURITY AT FORDHAM LAW THE CENTER ON NATIONAL SECURITY PRESENTS ISIS and the Crime- Terror Nexus in America A COUNTERPOINT TO EUROPE RAPHAEL D. MARCUS NYPD Fellow, CNS Acknowledgements About the Author I would like to thank the executive lead- Raphael D. Marcus is a supervisory intel- ership of the NYPD Intelligence Bureau for ligence research specialist at the NYPD the opportunity to conduct this research Intelligence Bureau, where he oversees a project. I would like to thank Dr. Karen team of analysts that support counterter- Greenberg and Julia Tedesco of the Center rorism investigations which focus primarily on National Security at Fordham Law for on the Middle East and South Asia. He was graciously hosting me at the center and for the inaugural NYPD Visiting Fellow at the their assistance throughout the research Center on National Security at Fordham and publication process. I am indebted to University School of Law (2019-20), which Ravi Satkalmi for his guidance, support, enabled him to undertake this research and patience throughout all stages of this study. He is also a nonresident Research project. I am deeply appreciative of his con- Fellow in the Department of War Studies at structive and detailed feedback on earlier King’s College London, where he received his versions of this study, and for facilitating PhD. His research interests include Middle this fellowship opportunity. Thanks also East security issues, terrorism, military af- to all my colleagues at the NYPD, as well as fairs, and organizational learning. He is the Cody Zoschak and Dr. Hugo Micheron, for author of Israel’s Long War with Hezbollah: sharing their insightful comments. -

Southeastern Europe
U.S. ONLINE TRAINING FOR OSCE, INCLUDING REACT Module 5. Southeastern Europe This module introduces you to southeastern Europe and the OSCE’s work in: • Croatia (The OSCE Office in Zagreb was closed in 2012) • Macedonia • Bosnia-Herzegovina • Serbia • Kosovo • Montenegro • Albania . 1 Table of Contents Overview. 3 Geography. 4 People. 6 Former Yugoslavia. 10 World War I. 11 World War II. 12 Federal People’s Republic of Yugoslavia. 14 Post-Tito. 15 Federal Republic of Yugoslavia. 17 Croatia. 18 Key information. 19 Historical background. 20 During Tito. 21 After Tito. 22 War of independence. 23 Domestic politics. 25 Macedonia. 35 Key information. 36 Historical background. 38 19th and early 20th centuries. 39 During Tito. 41 Independence. 43 Domestic politics. 44 Prospects and challenges. 67 Bosnia-Herzegovina (BiH). 72 Key information. 73 Historical background. 75 During the Tito era. 76 The Bosnian war: 1992-1995. 79 Disunity of international community. 81 The Dayton Peace Accords, 1995. 84 Politics since Dayton. 87 Challenges and pressures. 95 Serbia. 99 Key information. 100 Introduction. 101 Contemporary Serbia. 102 Miloševi?'s rise. 104 Domestic resistance and state oppression. 106 Consequences of Kosovo. 109 The short-lived Kosovo Verification Mission. 110 MODULE 5. Southeastern Europe 2 Regime repression intensifies. 112 Struggle for Serbia’s political direction. 115 Nikolic wins 2012 presidential election. 122 Serbia's identity and its vision for the future. 124 Montenegro. 131 Key information. 132 Contemporary Montenegro. 133 Politics in Montenegro. 134 Other issues. 140 Kosovo. 142 Key information. 143 Historical background of Kosovo. 144 Organized non-violence. 145 After Dayton. 147 UNMIK established. -

Introduction Definition of Key Terms
Committee: Economic and Social Committee Issue: Disrupting organized criminal networks through intelligence and financial investigations Student Officer: Eirini Panagiotopoulou Position: Deputy President Introduction In our days, criminal activities are becoming more and more widespread. The issue of organised crimes is causing the death, physical and psychological injury of numerous people all over the world and thus it is a problem of great concern. Intelligence agencies and financial investigations, conducted by several organisations, are trying to combat this issue and to restore peace and human security around the globe. Definition of Key Terms Organised Crime Any group that is partaking in organized crime has some manner of formalized structure and whose main aim is to gain money through illegal activities. Criminal Enterprise Figure 1. “International Organised Crime Networks A group of individuals with 1 comparable structure or identified hierarchy, engaged in significant criminal activities. (These two terms of Organised Crime and Criminal Enterprise are similar and sometimes are used synonymously, but several federal criminal statutes specifically define the qualifications an enterprise needs to fulfil in order to convict individuals or groups.) Transnational Organized Crime (TOC) It is a form of organised crime. Its criminal networks forge bonds across national borders as well as overcome cultural and linguistic differences, involving groups or networks of individuals to plan and execute illegal business ventures. Intelligence -

Covering Diversity: a Resource and Training Manual for African Journalists I 3 Nigeria Reporting Diversity Working Group
ceived injustices made the renegotia- the amalgamation of the southernnationalism and have been a feature of politi- of the union a persistent question. northern protectorates in 1914.cal life The for uni most- of the century, op p o s i t i o n to racism is deeply embedded in journal- S TOR ICAL OV E RV I EW fication of this territory reflected the DIVE RSITY IN NIGERIA ism. But the use of journalists to provide form and manner by whichpolitical the British propaganda means media can still eria’s formal identity was forged with came to conquer, consolidate,become weaponsand of intolerance. amalgamation of the southern and administer the various peoples included The outbreak of war in 1992 in the hern protectorates in 1914. The uni- in the Nigerian state. The processBalkans, of sub- genocide in Rwanda in 1994, on of this territory reflected the form jugation and incorporationand of thesimmering more conflicts on every conti- manner by which the British came to than 250 ethnolinguisticnent groups demonstrate in that laws, journalistic quer, consolidate, and administer the codes, and good intentions are of little con- ous peoples included in the Nigerian Nigeria was protracted, piecemeal, and sequence in the face of ruthless political e. The process of subjugation and uneven. In 1914, three large groups pre- leaders bent upon waging war. rporation of the more than 250 eth- dominated: the Muslim Hausa Fulani of nguistic groups in Nigeria was pro- the north, the predominantlyIt is Christiannot unusual in war to find mass media ted, piecemeal, and uneven. -

Freedom of the Press 2004
FREEDOM OF THE PRESS 2004 FREEDOM OF THE PRESS 2004 A Global Survey of Media Independence Edited by Karin Deutsch Karlekar WITH ESSAYS BY BRIAN KATULIS, JEREMY DRUKER AND DEAN COX, AND RONALD KOVEN FREEDOM HOUSE NEW YORK WASHINGTON, D.C. ROWMAN & LITTLEFIELD PUBLISHERS, INC. LANHAM BOULDER NEW YORK TORONTO OXFORD ROWMAN & LITTLEFIELD PUBLISHERS, INC. Published in the United States of America by Rowman & Littlefield Publishers, Inc. A wholly owned subsidiary of The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc. 4501 Forbes Boulevard, Suite 200, Lanham, MD 20706 www.rowmanlittlefield.com P.O. Box 317, Oxford OX2 9RU, United Kingdom Copyright © 2004 by Freedom House All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of the publisher. ISSN 1551-9163 ISBN 0-7425-3648-3 (cloth : alk. paper) ISBN 0-7425-3649-1 (pbk. : alk. paper) Printed in the United States of America The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences—Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI/NISO Z39.48-1992. Table of Contents Acknowledgments, vii Survey Methodology, ix Press Freedom in 2003, 1 Karin Deutsch Karlekar Global and Regional Tables, 9 Liberated and Occupied Iraq: New Beginnings and Challenges for Press Freedom, 17 Brian Katulis Under Assault: Ukraine’s News Media and the 2004 Presidential Elections, 29 Jeremy Druker and Dean Cox In Defiance of Common Sense: The Practical Effects of International Press Restrictions, 41 Ronald Koven Country Reports and Ratings, 49 Freedom House Board of Trustees, 195 About Freedom House, 197 Acknowledgments Freedom of the Press 2004 could not have been completed without the contributions of numerous Freedom House staff and consultants. -

Mental Health Newstm
MENTAL HEALTH NEWS TM YOUR TRUSTED SOURCE OF INFORMATION, EDUCATION, ADVOCACY AND RESOURCES FALL 2010 FROM THE LOCAL, STATE, AND NATIONAL NEWS SCENE VOL. 12 NO. 4 Mental Health Services for Children and Adolescents By The National Institute or health care provider. Keep in mind that of Mental Health (NIMH) every child is different. Even normal de- velopment, such as when children develop language, motor, and social skills, varies esearch shows that half of all from child to child. Ask if your child lifetime cases of mental illness needs further evaluation by a specialist begin by age 14.1 Scientists are with experience in child behavioral discovering that changes in the problems. Specialists may include psy- Rbody leading to mental illness may start chiatrists, psychologists, social workers, much earlier, before any symptoms appear. psychiatric nurses, and behavioral thera- Through greater understanding of pists. Educators may also help evaluate when and how fast specific areas of chil- your child. dren's brains develop, we are learning If you take your child to a specialist, more about the early stages of a wide ask, "Do you have experience treating the range of mental illnesses that appear later problems I see in my child?" Don't be in life. Helping young children and their afraid to interview more than one special- parents manage difficulties early in life ist to find the right fit. Continue to learn may prevent the development of disor- everything you can about the problem or ders. Once mental illness develops, it diagnosis. The more you learn, the better becomes a regular part of your child's you can work with your child's doctor and behavior and more difficult to treat. -

The New Gangs of New York
The new gangs Latin Kings Like many gangs, the Kings were EDENWALD born in state prison in the eighties of new York and, along with the Bloods, are KINGS- considered the most powerful BRIDGEBEDFORD gang on Rikers Island. Despite PARK maintaining a violent reputation, TheY’re they assume a lower public profile Younger, Bloods in the streets. recent IncIdents: Though considered the city’s largest PELHAM harder To BELMONT In late June, eighteen alleged gang, the Bloods actually comprise WASHINGTON PARKWAY HEIGHTS Kings were arrested for using caTch, and dozens of unrelated cliques Molotov cocktails to firebomb two adopting various identifiers. Bloods MS-13 houses belonging to the mother quicker no longer “flag” their presence and girlfriend of a member with red bandannas, opting for Started by Salvadoran laborers wanting to protect themselves who wanted out of the gang. In To violence. less visible “crates”—bracelets with July, investigators in the Bronx red and black beads. Many crew from other gangs, MS-13 is now so SCHUYLER- dangerous that the FBI developed busted an alleged Kings clique for who holds leaders run street operations from MORNINGSIDE VILLE running a $40,000-a-day heroin Rikers Island and prisons upstate. HEIGHTS SOUNDVIEW its own national task force to track it. Most of its estimated 10,000 operation in Bedford Park. swaY where. recent IncIdent: members live along the Mexican A war raged throughout the border, where they run illegal- summer in Spanish Harlem HARLEM alien-smuggling rings. In the city, between two Bloods-aligned MS-13 members are found in sects: the Flow Boyz and the Cash Jackson Heights and Elmhurst, Money Brothers. -

Arsovska-And-Michilli
SGOC STUDYING GROUP ON ORGANISED CRIME https://sgocnet.org Perceptions of Ethnic Albanians in New York City and the Role of Stereotypes in Fostering Social Exclusion and Criminality Original article Perceptions of Ethnic Albanians in New York City and the Role of Stereotypes in Fostering Social Exclusion and Criminality Jane Arsovska and Adriana Michilli* Abstract: In many European Union countries, law enforcement agencies and popular media have depicted ethnic Albanians as “brutal criminals” and a “dangerous breed”. Scholars have claimed that these labeling practices have hindered the social inclusion of Albanians in Western societies, and have fostered Albanian criminality. This research examines whether New York’s media also catalyzes processes of social isolation and deviancy amongst its Albanian migrant population by labeling them as criminals. The conclusions are based on newspaper analysis (1990-2014), focusing on depictions of Albanians in New York newspapers; interviews with non-Albanian population in New York City (N=85); and interviews with ethnic Albanian immigrants, including offenders, in New York City (N=88). Findings revealed that New York’s media is not necessarily influencing Albanian criminality. Keywords: Albanian criminality – organized crime – labelling theory – media – New York – social exclusion – signal crimes *Jana Arsovska is an Assistant Professor at the Sociology Department, John Jay College of Criminal Justice. E-mail: [email protected] Adriana E. Michilli is a Research Assistant at the Sociology Department, John Jay College of Criminal Justice. E-mail: [email protected] The European Review of Organised Crime 2(1), 2015, 24-48 ISSN: 2312-1653 © ECPR Standing Group of Organised Crime. 1 / 23 For permissions please email [email protected] Introduction The role that ethnicity and culture play in shaping American organized crime has long been at the centre of a heated debate among criminologists, sociologists and political scientists. -
The Unheard Voices: an Exploration of the Engagement and Disengagement Experiences Of
The unheard voices: An exploration of the engagement and disengagement experiences of black ex-youth gang members by Anthony Mpiani A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Department of Sociology University of Alberta © Anthony Mpiani, 2020 Abstract Youth gangs and the criminal activities they engage in remain a major problem in Canada. Recent media and law enforcement reports suggest that some black youth have been involved with gangs. However, experiences of black ex-youth gang members in Canada have received relatively limited scholarly engagements. Based on data from semi-structured in-depth interviews with 16 black ex-youth gang members, this study investigates why black youth join gangs, why some desist from gangs and how they construe their experiences with the Canadian criminal justice system. Discursive accounts of participants suggest that black youth gang involvement results from a reciprocal relationship between individual and socio-structural factors. Specifically, some black youth join gangs due to adverse experiences at home, school, communities, influences of deviant peers, and their quests for money, respect, status and friendship. The study demonstrates that black youth gang membership tends to be temporary, and some black youth gang members desist because of actual or threat of violence (to self, family members or gang members), disillusionment, fear of incarceration, police harassment, committed relationships, advice from influential others and religious awakening. The study reports three key findings on black youth gang members’ experiences with the criminal justice system. First, the interactions between black youth gang members and police are mostly marked by physical and verbal abuse, harassment and disrespect with few encounters characterised by fairness and respect. -
The London School of Economics and Political Science
The London School of Economics and Political Science Children of Immigrants in Central Athens at the Turn of the 21st Century: A study of inferiorisation, ethnicised conflict, criminalisation, and substance misuse Pericles Papandreou A thesis submitted to the Department of Social Policy of the London School of Economics for the degree of Doctor of Philosophy, London, June 2009 UMI Number: U615964 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. Dissertation Publishing UMI U615964 Published by ProQuest LLC 2014. Copyright in the Dissertation held by the Author. Microform Edition © ProQuest LLC. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 end? Declaration I certify that the thesis I have presented for examination for the MPhil/PhD degree of the London School of Economics and Political Science is solely my own work other than where I have clearly indicated that it is the work of others (in which case the extent of any work carried out jointly by me and any other person is clearly identified in it). The copyright of this thesis rests with the author. Quotation from it is permitted, provided that full acknowledgement is made. This thesis may not be reproduced without the prior written consent of the author. -

Alimehmeti Defense Sentencing Memo.Pdf
Case 1:16-cr-00398-PAE Document 127 Filed 11/21/19 Page 1 of 51 UNITED STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK ---------------------------------------------------------X No. 16 Cr. 398 (PAE) UNITED STATES OF AMERICA -against- SAJMIR ALIMEHMETI Defendant. ---------------------------------------------------------X MEMORANDUM IN AID OF SENTENCING ON BEHALF OF DEFENDANT SAJMIR ALIMEHMETI Susan G. Kellman Sarah Kunstler Carlos Santiago Attorneys for Sajmir Alimehmeti 25 Eighth Avenue Brooklyn, NY 11217 (718) 783-8200 [email protected] Case 1:16-cr-00398-PAE Document 127 Filed 11/21/19 Page 2 of 51 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION ......................................................................................................................... 1 THE OFFENSE CONDUCT ........................................................................................................ 1 THE PIMENTEL LETTER .......................................................................................................... 2 OBJECTIONS TO THE PRE-SENTENCE INVESTIGATION REPORT .................................. 3 THE APPROPRIATE SENTENCE FOR MR. ALIMEHMETI ................................................... 3 1. The History and Characteristics of the Defendant .......................................................... 7 a. Mr. Alimehmeti’s Early Childhood .............................................................................. 8 b. Immigration to the United States ................................................................................. -

Emerging Nationalism 09
1 The Challenge of Self-determination and Emerging Nationalism The Evolution of the International Community’s Normative Responses to State Fragmentation James Robert Mills Submitted for examination for the PhD degree Department of International Relations London School of Economics and Political Science July 2009 2 Table of Contents Abstract 4 Acknowledgements 5 Introduction 6 Part I Theory Chapter 1 Identity, emerging nationalism and self-determination 17 (i) Self-determination and the liberal democratic political tradition 18 (ii) Primary Identity Forming Groups and ‘emerging nationalism’ 28 (iii) Human rights, groups rights and self-determination 32 Chapter 2 Sovereignty, state fragmentation and the limits of political 37 obligation (i) Sovereign statehood and self-determination 38 (ii) The internal aspect of sovereignty and humane governance 43 (iii) Secession 48 (iv) Implications for international norms 61 Part II History Chapter 3 From ‘concept’ to ‘principle’ – The birth of nationalism, the 64 construction of international society and the Paris Peace Conference (i) Early reactions to self-determination and emerging nationalism 65 (ii) The nineteenth century: the creation of normative responses 76 (iii) The Paris Peace Conference and the interwar period 86 Chapter 4 From ‘principle’ to ‘right’ - The UN system, the Cold War 103 and the ‘special case’ of decolonisation (i) The United Nations system and self-determination 104 (ii) The Cold War and self-determination 142 (iii) The ‘special case’ of decolonisation 149 Part III Post-Cold