Études Photographiques, 35 | Printemps 2017 Falling Soldier 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

La Sombra Del Iceberg: Un Documental De Investigación En Primera Persona Sobre La Fotografía El Miliciano Muerto De Capa
LA SOMBRA DEL ICEBERG: UN DOCUMENTAL DE INVESTIGACIÓN EN PRIMERA PERSONA SOBRE LA FOTOGRAFÍA EL MILICIANO MUERTO DE CAPA THE SHADOW OF THE ICEBERG: INVESTIGATION DOCUMENTARY IN THE FIRST PERSON ABOUT THE PHOTOGRAPHY THE FALLING SOLDIER BY CAPA Nekane PAREJO Universidad de Málaga [email protected] Resumen: En el siglo XXI se producen 4 documentales sobre el reportero Robert Capa: Robert Capa. En el amor y en la guerra, Los héroes nunca mueren, La maleta mexicana y La sombra del iceberg. Este artículo se centrará en este último, donde sus directores ejecutan un estudio minucioso de la polémica fotografía El miliciano muerto con la intención de demostrar que se trata de una puesta en escena. Para ello llevarán a cabo una investigación basada en las 6 W´s de la escuela de periodismo norteamericano, sin desechar otros métodos menos asépticos como la reconstrucción de diversos contextos y la implicación en primera persona. Abstract: In the 21st century four documentaries take place on the reporter Robert Capa: In love and war, Heroes Never Die, Mexican suitcase and The shadow of the iceberg. This article will center on the latter one, where the directors execute a meticulous study of the polemic photography The Falling Soldier with the intention of demonstrating that it is a question of staging. To get it, they will carry out a scrupulous investigation based on the 6 W’s of the school of the North American journalism, without rejecting other less aseptic methods such as the reconstruction of diverse contexts and involvement in first person. Palabras clave: Documental. -
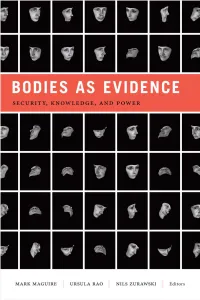
Bodies As Evidence Global Insecurities
BODIES AS EVIDENCE GLOBAL INSECURITIES A SERIES EDITED BY CATHERINE BESTEMAN AND DANIEL M. GOLDSTEIN BODIES AS EVIDENCE Security, Knowledge, and Power Mark Maguire, Ursula Rao, and Nils Zurawski, editors Duke University Press Durham and London 2018 © 2018 Duke University Press All rights reserved Printed in the United States of America on acid- free paper ∞ Designed by Matthew Tauch Typeset in Minion Pro by Copperline Books Library of Congress Cataloging- in- Publication Data Names: Maguire, Mark, [date] editor. | Rao, Ursula, [date] editor. | Zurawski, Nils, [date] editor. Title: Bodies as evidence : security, knowledge, and power / Mark Maguire, Ursula Rao, and Nils Zurawski, editors. Description: Durham : Duke University Press, 2018. | Series: Global insecurities | Includes bibliographical references and index. Identifiers:lccn 2018015847 (print) lccn 2018019863 (ebook) isbn 9781478004301 (ebook) isbn 9781478001690 (hardcover : alk. paper) isbn 9781478002949 (pbk. : alk. paper) Subjects: lcsh: Human body. | Biometric identification. | Crime prevention. | Border security. | Terrorism — Prevention. Classification:lcc hm636 (ebook) | lcc hm636 .b543 2018 (print) | ddc 364.4 — dc23 lc record available at https://lccn.loc.gov/2018015847 Cover art: Spirit is a bone, 2013. © Broomberg and Chanarin. Courtesy of Lisson Gallery, London and New York. CONTENTS 1 Introduction: Bodies as Evidence Mark Maguire and Ursula Rao 1 24 The Truth of the Error: Making Identity and Security through Biometric Discrimination Elida K. U. Jacobsen and Ursula Rao 2 43 Injured by the Border: Security Buildup, Migrant Bodies, and Emergency Response in Southern Arizona Ieva Jusionyte 3 67 E- Terrify: Securitized Immigration and Biometric Surveillance in the Workplace Daniel M. Goldstein and Carolina Alonso- Bejarano 4 89 “Dead- Bodies- at- the- Border”: Distributed Evidence and Emerging Forensic Infrastructure for Identification Amade M’charek 5 110 The Transitional Lives of Crimes against Humanity: Forensic Evidence under Changing Political Circumstances Antonius C. -

La Sombra Del Iceberg: Un Documental De Investigación En Primera Persona Sobre La Fotografía El Miliciano Muerto De Capa
LA SOMBRA DEL ICEBERG: UN DOCUMENTAL DE INVESTIGACIÓN EN PRIMERA PERSONA SOBRE LA FOTOGRAFÍA EL MILICIANO MUERTO DE CAPA THE SHADOW OF THE ICEBERG: INVESTIGATION DOCUMENTARY IN THE FIRST PERSON ABOUT THE PHOTOGRAPHY THE FALLING SOLDIER BY CAPA Nekane PAREJO Universidad de Málaga [email protected] Resumen: En el siglo XXI se producen 4 documentales sobre el reportero Robert Capa: Robert Capa. En el amor y en la guerra, Los héroes nunca mueren, La maleta mexicana y La sombra del iceberg. Este artículo se centrará en este último, donde sus directores ejecutan un estudio minucioso de la polémica fotografía El miliciano muerto con la intención de demostrar que se trata de una puesta en escena. Para ello llevarán a cabo una investigación basada en las 6 W´s de la escuela de periodismo norteamericano, sin desechar otros métodos menos asépticos como la reconstrucción de diversos contextos y la implicación en primera persona. Abstract: In the 21st century four documentaries take place on the reporter Robert Capa: In love and war, Heroes Never Die, Mexican suitcase and The shadow of the iceberg. This article will center on the latter one, where the directors execute a meticulous study of the polemic photography The Falling Soldier with the intention of demonstrating that it is a question of staging. To get it, they will carry out a scrupulous investigation based on the 6 W’s of the school of the North American journalism, without rejecting other less aseptic methods such as the reconstruction of diverse contexts and involvement in first person. Palabras clave: Documental. -

La Sombra Del Iceberg’ Una Autopsia De La Mítica Fotografía De Robert Capa ‘El Miliciano Muerto’
LLaa ssoommbbrraa ddeell iicceebbeerrgg Una autopsia de la mítica fotografía de Robert Capa ‘El miliciano muerto’ Una película documental de Hugo Doménech y Raúl M. Riebenbauer ‘La sombra del iceberg’ Una autopsia de la mítica fotografía de Robert Capa ‘El miliciano muerto’ El documental ‘La sombra del iceberg’ demuestra la errónea identificación como Federico Borrell El miliciano de Capa vuelve a ser anónimo Fernando Verdú, forense: “Son dos hombres diferentes” 1.-LA ‘VERDAD’ OFICIAL El periodista Lorenzo Milá cerró su informativo de la noche de TVE del 5 de septiembre de 2006 diciendo: “El 5 de septiembre de 1936 Robert Capa hizo una fotografía en Cerro Muriano, Córdoba. Supuestamente, fotografió la muerte del miliciano Federico Borrell, más conocido como ‘Taino’.” La instantánea, conocida como El miliciano muerto , se había convertido en uno de los iconos del siglo XX. Fue hace 33 años, en 1975, cuando nació una polémica acerca de la posibilidad de que fuera una puesta en escena. El periodista de ‘Le Monde’, Michel Lefebvre, experto en Capa y su obra, sentencia en La sombra del iceberg sobre esa identificación: “Al encontrar el nombre y el apellido de este miliciano, las polémicas deben acabarse.” Para Lefebvre y también para el biógrafo oficial de Capa, Richard Whelan, darle al icono la identidad de un miliciano muerto, la del anarquista alcoyano Federico Borrell (1912-1936), implicaba cerrar la controversia: desde ese momento, era irrefutable que la imagen captaba realmente la muerte. Pero, ¿cómo se descubrió esa identidad? Todo empezó casi sesenta años después de la Guerra Civil. Empar Borrell, sobrina de Federico Borrell (su madre, ya fallecida, estaba casada con el hermano de ‘Taino’, también muerto) recuerda en el documental: “En 1995 vino Mario Brotons y nos dijo que mirásemos unos clichés del miliciano. -

Fotografia E Alistamentos Científicos: Em Torno De Uma Controvérsia Sobre Autenticidade
Fotografia e alistamentos científicos: em torno de uma controvérsia sobre autenticidade Jorge Ventura de Morais Doutor em Sociologia (London School of Economics) Professor da Universidade Federal de Pernambuco. Recife, Brasil [email protected] Rosane Alencar Doutora em Sociologia (Universidade Federal de Pernambuco) Professora da Universidade Federal de Pernambuco. Recife, Brasil. [email protected] Paulo Marcondes Soares Doutor em Sociologia (Universidade Federal de Pernambuco) Professor da Universidade Federal de Pernambuco Recife, Brasil. [email protected] Resumo Analisamos as controvérsias em torno da fotografia intitulada “Morte do Miliciano”, de Robert Capa, à luz da sociologia das associações de Bruno Latour. Acompanhamos o desenrolar dos debates entre duas posições antagônicas (a que diz que a foto teria sido posada e a outra, que Capa teria realmente fotografado alguém no momento mesmo da sua morte) através da utilização de um documentário em que a ciência e seus artefatos são alistados para defender uma determinada posição. Concluímos mostrando que, longe de tentar resolver sociologicamente a controvérsia, a sociologia das associações nos permite ter um entendimento dos diversos argumentos postos à prova pelas partes em disputa. Palavras-chave: Fotografia; Robert Capa; Ciência; Instrumentos Científicos; Sociologia das Associações. Introdução HEIO DE SIMPATIAS pelas forças republicanas da Espanha em C1936 – assim como diversos intelectuais e artistas daquela época –, Capa (2010) começou a fotografar a Guerra Civil na frente de batalha registrando-a de dentro de túneis, trincheiras, cidades etc. Foi dessa forma – ou, pelo menos, assim se acreditou durante certo tempo – que ele tirou a foto (Figura 1) que o imortalizou para sempre entre os maiores fotógrafos do século XX e como “criador” do foto- jornalismo de guerra. -

Estudo De Caso Sobre Morte De Um Miliciano
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS ESCOLA DE COMUNICAÇÃO JORNALISMO ESTUDO DE CASO SOBRE MORTE DE UM MILICIANO: O FOTOJORNALISMO ENTRE HISTÓRIA E VERDADE PATRICIA DE CARVALHO RODRIGUES Rio de Janeiro 2010 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS ESCOLA DE COMUNICAÇÃO JORNALISMO ESTUDO DE CASO SOBRE MORTE DE UM MILICIANO: O FOTOJORNALISMO ENTRE HISTÓRIA E VERDADE Monografia submetida à Banca de Graduação como requisito para obtenção do diploma de Comunicação Social – Jornalismo. PATRICIA DE CARVALHO RODRIGUES Orientador: Professor Dante Gastaldoni Rio de Janeiro 2010 FICHA CATALOGRÁFICA RODRIGUES, Patricia de Carvalho. Estudo de caso sobre morte de um miliciano: o fotojornalismo entre história e verdade. Rio de Janeiro, 2010. Monografia (Graduação em Comunicação Social – Jornalismo) – Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Escola de Comunicação – ECO. Orientador: Dante Gastaldoni RODRIGUES, Patricia de Carvalho. Estudo de caso sobre morte de um miliciano: o fotojornalismo entre história e verdade. Orientador: Dante Gastaldoni. Rio de Janeiro: UFRJ/ECO. Monografia em Jornalismo. RESUMO Neste trabalho pretende-se fazer uma análise da fotografia símbolo da Guerra Civil espanhola, tirada por Robert Capa em 1936 e que passou a ser conhecida como Morte de um miliciano. A imagem se destacou por retratar, pela primeira vez, o exato momento da morte, e seu autor se tornou rapidamente referência em cobertura fotojornalística de guerra. Após anos de sua produção e publicação, a foto começou a ter sua autenticidade questionada em diversos sentidos e surgiu a crença de que ela não passava de uma encenação. A análise da cronologia desta polêmica, dos principais argumentos de contestação e de defesa se torna indispensável para a tentativa de refletir sobre as influências do fotojornalismo e os efeitos que pode causar a veiculação de inverdades imagéticas. -

Universidade Federal De Pernambuco Centro De Artes E Comunicação Programa De Pós-Graduação Em Comunicação Doutorado Em Comunicação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO DOUTORADO EM COMUNICAÇÃO Juliana Andrade Leitão FOTOJORNALISMO DISRUPTIVO: ESPAÇOS DE DISPUTA, PROCESSOS DE RUPTURA E A REPRESENTAÇÃO VISUAL DOS ACONTECIMENTOS NO WORLD PRESS PHOTO RECIFE 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO DOUTORADO EM COMUNICAÇÃO FOTOJORNALISMO DISRUPTIVO: ESPAÇOS DE DISPUTA, PROCESSOS DE RUPTURA E A REPRESENTAÇÃO VISUAL DOS ACONTECIMENTOS NO WORLD PRESS PHOTO Tese apresentada à Coordenação do Programa de Pós- Graduação em Comunicação, da Universidade Federal de Pernambuco, para a obtenção do grau de doutor em Comunicação, sob orientação do Prof. Dr. Alfredo Eurico Vizeu Pereira Junior. RECIFE 2016 Catalogação na fonte Bibliotecário Jonas Lucas Vieira, CRB4-1204 L533f Leitão, Juliana Andrade Fotojornalismo disruptivo: espaços de disputa, processos de ruptura e a representação visual dos acontecimentos no World Press Photo / Juliana Andrade Leitão. – 2016. 256 f.: il., fig. Orientador: Alfredo Eurico Vizeu Pereira Júnior. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Artes e Comunicação. Comunicação, 2016. Inclui referências. 1. Comunicação. 2. Fotojornalismo. 3. Imagens como recursos de informação. 4. Prêmios. 5. Fotografias. I. Pereira Júnior, Alfredo Eurico Vizeu (Orientador). II. Título. 302.23 CDD (22.ed.) UFPE (CAC 2016-104) Juliana Andrade Leitão TÍTULO DO TRABALHO: “ FOTOJORNALISMO FOTOJORNALISMO DISRUPTIVO: ESPAÇOS DE DISPUTA, PROCESSOS DE RUPTURA E A REPRESENTAÇÃO VISUAL DOS ACONTECIMENTOS NO WORLD PRESS PHOTO” Tese apresentada ao programa de Pós- Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Comunicação. Aprovada em: 26/02/2016 BANCA EXAMINADORA _______________________________________ Prof. -

Redalyc.Fotografia E Alistamentos Científicos: Em Torno De Uma
Sociedade e Cultura ISSN: 1415-8566 [email protected] Universidade Federal de Goiás Brasil Ventura de Morais, Jorge; Alencar, Rosane; Marcondes Soares, Paulo Fotografia e alistamentos científicos: em torno de uma controvérsia sobre autenticidade Sociedade e Cultura, vol. 18, núm. 1, enero-junio, 2015, pp. 139-152 Universidade Federal de Goiás Goiania, Brasil Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70344885013 Como citar este artigo Número completo Sistema de Informação Científica Mais artigos Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal Home da revista no Redalyc Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto Fotografia e alistamentos científicos: em torno de uma controvérsia sobre autenticidade Jorge Ventura de Morais Doutor em Sociologia (London School of Economics) Professor da Universidade Federal de Pernambuco. Recife, Brasil [email protected] Rosane Alencar Doutora em Sociologia (Universidade Federal de Pernambuco) Professora da Universidade Federal de Pernambuco. Recife, Brasil. [email protected] Paulo Marcondes Soares Doutor em Sociologia (Universidade Federal de Pernambuco) Professor da Universidade Federal de Pernambuco Recife, Brasil. [email protected] Resumo Analisamos as controvérsias em torno da fotografia intitulada “Morte do Miliciano”, de Robert Capa, à luz da sociologia das associações de Bruno Latour. Acompanhamos o desenrolar dos debates entre duas posições antagônicas (a que diz que a foto teria sido posada e a outra, que Capa teria realmente fotografado alguém no momento mesmo da sua morte) através da utilização de um documentário em que a ciência e seus artefatos são alistados para defender uma determinada posição. Concluímos mostrando que, longe de tentar resolver sociologicamente a controvérsia, a sociologia das associações nos permite ter um entendimento dos diversos argumentos postos à prova pelas partes em disputa.