Rapport De Présentation Dossier D
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
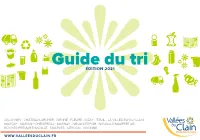
Guide Du Tri ÉDITION 2021
Guide du tri ÉDITION 2021 ASLONNES . CHÂTEAU-LARCHER . DIENNÉ . FLEURÉ . GIZAY . ITEUIL . LA VILLEDIEU-DU-CLAIN . MARÇAY . MARIGNY-CHÉMEREAU . MARNAY . NIEUIL-L’ESPOIR . NOUAILLÉ-MAUPERTUIS . ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ . SMARVES . VERNON . VIVONNE WWW.VALLEESDUCLAIN.FR Le sommaire M. Beaujaneau, Président de la Communauté de P 3 _____ ZÉRO DÉCHET Communes des Vallées du Clain Le guide du tri 2021 des Vallées du Clain vous donne toutes les clés P 4 _____ LE B.A. BA DU BAC pour mieux trier et réduire vos déchets au quotidien. Vous y trouverez les consignes de tri détaillées et les informations pratiques pour trier, P 5 _____ LES JOURS DE COLLECTE chez vous, dans les bornes et dans les déchèteries. Notre geste de tri reste indispensable pour protéger notre environne- P 6-7 ___ LE TRI À LA MAISON ment. Mais au vu des quantités très importantes de déchets produits, et des coûts en hausse pour les traiter, réduire nos déchets devient un P 8-9 ____ LE TRI DANS LES BORNES véritable enjeu ! Simple à mettre en place au quotidien, réduire ses dé- chets, c’est tout simplement éviter de les produire. Le meilleur déchet est celui que l’on ne fait pas ! P 10-11 ___ LE TRI EN DÉCHÈTERIE La Communauté de communes des Vallées du Clain qui a la com- P 12-13 __ LA VALORISATION DES DÉCHETS pétence « gestion et traitement des déchets » conduit une politique environnementale ambitieuse. Elle dotera bientôt le territoire d’une nouvelle déchèterie plus performante avec de nouvelles filières de re- P 14-15 __ LES INFOS PRATIQUES cyclage pour valoriser un maximum de déchets. -

L'accompagnement De Vos Territoires
L’accompagnement de vos territoires RELATION ADHÉRENTS ARCHITECTURE/PAYSAGE/URBANISME SERVICES NUMÉRIQUES SERVICE JURIDIQUE/AMF86/FORMATION DES ÉLUS Architecte Julien Secheresse AJSA -Photographe : Maud Piderit, Focalpix adriers - amberre - anche - angles-sur-l’anglin - angliers - antigny - an- tran - arcay - archigny - aslonnes - asnieres-sur-blour - asnois - aulnay - availles limouzine - availles-en-chatellerault - avan- ton - ayron - basses - beaumont saint cyr - bellefonds - berrie - ber- the- gon - beruges - bethines - beuxes - biard - bignoux - blanzay - boivre-la-vallee - bonnes - bonneuil-matours - bouresse - bourg-archambault - bournand - brigueil-le-chantre - brion - brux - buxerolles - buxeuil - ceaux-en-loudun - celle-l’evescault - cenon- sur-vienne - cernay - chabournay - chalais - chalandray - champagne- le-sec - champagne-saint-hilaire - champigny en rochereau - champniers - charroux - chasseneuil-du-poitou - chatain - chateau-garnier - chateau-larcher - chatellerault - chaunay - chauvigny - chenevelles - cherves - chire-en-montreuil - chouppes - cisse - civaux - civray - cloue - colombiers - valence-en-poitou - cou- lombiers - coulonges - coussay - coussay-les-bois - craon - croutelle - cuhon - cur- cay-sur-dive - curzay sur vonne - dange-saint-romain - derce - dienne - dissay - doussay - fleix - fleure - fontaine-le-comte - frozes - gencay - genouille - gizay - glenouze - gouex - guesnes - haims - ingrandes - iteuil - jardres - jaunay-marigny - jazeneuil - jouhet - journet - jousse - la bussiere - la chapelle viviers -

Préfecture De La Vienne
Préfecture de la Vienne ARRETE N° 2015- DDT- 830 Direction Départementale des Territoires Arrêté portant classement des de la Vienne infrastructures de transports terrestres du département de la Vienne déterminant l'isolement acoustique des bâtiments La Préfète de la Région Poitou-Charentes d'habitation dans les secteurs affectés par le Préfète de la Vienne bruit Chevalier de l'Ordre National du Mérite Vu le code de l'environnement , et notamment l'article L.571-10 , R571-32 à R571-43 Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R 111-4-1 ; R111-23-1 à R111-23-3 ; Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles R123-13, R123-14 et R123-22 Vu l’arrêté interministériel du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ; Vu l'arrêté du 03/09/2013 illustrant par des schémas et des exemples les articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 mai 1996 modifié relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ; Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article L 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements . -

Classement Féminin Ordre Nom Prénom Age Ville Temps 1 Coutant Malika 32 Ans POITIERS 0H30m43s 2 MALKA CLAIRE 46 Ans POITIERS 0
Classement Féminin Ordre Nom Prénom Age Ville Temps 1 Coutant Malika 32 ans POITIERS 0h30m43s 2 MALKA CLAIRE 46 ans POITIERS 0h30m51s 3 Vincent Dominique 44 ans Ligugé 0h32m54s 4 Moreira Dasilva Estelle 23 ans Ligugé 0h33m36s 5 Cerisier Stéphanie 34 ans Chartres 0h34m8s 6 Jolly Patricia 48 ans Saint-Benoît 0h34m29s 7 Vincent Roselyne 44 ans Ligugé 0h34m59s 8 Venereux Karine 33 ans Cisse 0h35m35s 9 Negrier Sylvie 38 ans St Cyr 0h36m52s 10 Brousse Martine 54 ans Poitiers 0h37m17s 11 Morera Dasilva Francoise 45 ans Ligugé 0h37m42s 12 Bernard Marie France 50 ans Poitiers 0h39m7s 13 Martineau Patricia 42 ans Saint Georges lès Baillargeaux 0h39m12s 14 Roulon Martine 40 ans Saint Georges lès Baillargeaux 0h39m29s 15 Falaise Ramel Béatrice 48 ans Les Roches Prémaries 0h39m36s 16 Brousse Isabelle 30 ans Poitiers 0h39m57s 17 GREAULT CHRISTINE 49 ans TERCE 0h40m4s 18 COLLAS ANAIS 18 ans SMARVES 0h40m5s 19 Chabanne Sophie 34 ans Smarves 0h40m5s 20 Samson Caroline 39 ans Saint Secondin 0h40m6s 21 Frappier Blandine 23 ans poitiers 0h40m9s 22 BASSET ANNE 26 ans MIGNE AUXANCES 0h40m30s 23 Morisseau Danielle 38 ans Mirbeau 0h40m30s 24 Rocheron Magalie 31 ans St Genest d'Aubière 0h40m31s 25 Martineau Lydie 43 ans Montamisé 0h40m36s 26 TEXEREAU CATHERINE 40 ans CELLE L'EVESCAULT 0h40m56s 27 POIRIER ST2PHANIE 25 ans ITEUIL 0h41m51s 28 MERCIER MARYVONNE 47 ans LIGUGE 0h41m52s 29 DUGUE Manuella 30 ans QUINCAY 0h41m52s 30 Bernot Stéphanie 30 ans Poitiers 0h42m5s 31 Mauvais Martine 45 ans Saint Georges lès Baillargeaux 0h42m14s 32 Mornet Agnès 51 ans Bignoux -

LUSIGNAN Mercredi 24 Juillet À Partir De 18 H Possibilité De Manger Sur Place (Apportez Vos Couverts)
été à la ferme DUDU 0303 JUILLETJUILLET AUAU 2929 AOÛTAOÛT 20192019 MarchésMarchés dede producteursproducteurs LUSIGNAN MercrediÀ partir de 2418 h juillet Possibilité de manger sur place (apportez vos couverts) Création : Chambre d’agriculture de la Vienne - Crédit photo : CA86 & Bienvenue à la ferme Mai 2019 Ne pas jeter sur voie publique Création : Chambre d’agriculture de la Vienne RENCONTREZ NOS AGRICULTEURS LORS D’UN MOMENT CONVIVIAL ET FESTIF EN VIENNE été RENCONTREZ NOS AGRICULTEURS LORS à la ferme D’UN MOMENT CONVIVIAL ET FESTIF DEE REDÉCOUVRIRnvie LE BON 12 GOÛT DES PRODUITS FERMIERS DE LA VIENNE ? 5 NOUS SOMMES PLUS DE 50 AGRICULTEURS 9 BIENVENUE À LA FERME 13 19 EN VIENNE prêts à vous faire découvrir nos produits et la passion de 16 notre métier. Notre engagement : vous permettre de manger quotidiennement de bons produits locaux et de saison. Derrière chacun de nos produits, un 20 agriculteur engagé a plaisir à partager 3 son savoir-faire. 21 Nous vous accueillons tout l’été sur les 1 Marchés de producteurs Bienvenue à la ferme. 22 4 8 15 6 10 2 11 14 7 18 17 PROGRAMME 2019 À partir de 18 heures 1 VOUILLÉ 9 MONTS-SUR- 17 COUHÉ MERCREDI 3 JUILLET Valence-en-poitou Place du Boulodrome GUESNES MERCREDI 14 AOÛT VENDREDI 19 JUILLET Les Halles 2 ROUILLÉ Place du Château 18 JEUDI 4 JUILLET 10 GENCAY Place de l’Eglise LUSIGNAN MERCREDI 21 AOÛT MERCREDI 24 JUILLET Champ de Foire 3 ST-GEORGES- Les Promenades 19 LÈS-BAILLARGEAUX 11 MONTMORILLON INGRANDES- JEUDI 4 JUILLET JEUDI 25 JUILLET SUR-VIENNE Mail des Sablières Place de la Victoire -

The Battle of Tours
THE BATTLE OF TOURS BRYAN C. ROSS SEMINAR 1 INTRODUCTION TO MILITARY HISTORY DR. JOHN VOTAW FEBRUARY 24, 2007 2 According to the tenth addition of Merriam Webster’s Collegiate Dictionary the term watershed carries two primary meanings. First, the word carries a geographic meaning dealing with “a region or area bounded peripherally by a divide and draining ultimately to a particular watercourse or body of water.” 1 A second use of the term watershed defines “a crucial dividing point, line, or factor, i.e. a turning point.” 2 History is full of watershed events, moments that change not only the direction of history’s flow but establish its future course for years to come. In the minds of many historians the Battle of Tours, also known as the Battle of Poitiers, fought October 10, 732 A.D., stands out as a watershed event which redirected the follow of history. 3 Previous to Tours, the Muslim armies had enjoyed one hundred years of conquest controlling territory bordering China in the East and extending across the entirety of North Africa and the Straits of Gibraltar into modern day Spain in the West.4 The Battle Tours, in the minds of many, serves as the high water mark for Islam’s advance into Europe and is credited with saving Christianity and Western Civilization from forced Muslim occupation.5 In addition, the Muslim defeat at Poitiers and the resulting Frankish victory is credited with establishing “the Franks as the dominant population in Western Europe, establishing the dynasty that led to Charlemagne.” 6 Historians such as Edward Gibbon and Leopold von Ranke, among others, “felt that Poitiers was the turning point of 1 Merriam Webster, Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, 10th Ed. -

Le Risque Mouvement De Terrain, Consulter
LES RISQUES NATURELS i LE RISQUE MOUVEMENT h DE TERRAIN 1- DÉFINITION Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels d'origines très diverses. Annuellement, ils provoquent en moyenne la mort de 800 à 1 000 personnes dans le monde et occasionnent des préjudices économiques et des dommages très importants. Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu sont compris entre quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour). 2- LES DIFFÉRENTS MOUVEMENTS DE TERRAIN . Le glissement de terrain : Il correspond au déplacement de terrains meubles ou rocheux le long d'une surface de rupture. Les chutes de blocs et éboulements : Les éboulements sont des phénomènes rapides ou événementiels mobilisant des éléments rocheux plus ou moins homogènes avec peu de déformation préalable d'une pente abrupte jusqu'à une zone de dépôt. Les effondrements : Un effondrement est un désordre créé par la rupture du toit d'une cavité souterraine (dissolution, mine, carrière...). Il existe 2 types de cavités : Cavités naturelles les karsts, gouffres, grottes, etc. ; les cavités de suffosion. (cavités liées à des phénomènes d'érosion interne générées par des circulations d'eau souterraines). Cavités anthropiques les carrières ; les marnières ; les caves ; les habitations troglodytiques ; les ouvrages civils ; les ouvrages militaires. 1 . Les tassements par retrait-gonflement des argiles : Les variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et des tassements (période sèche) et peuvent avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles. -

Page 1/32 Page 2/32 Page 3/32 ADRIERS AMBERRE ANCHE Tél Mairie : 05 49 50 53 40 Tél Mairie : 05 49 42 77 Tél Mairie : 05-49-48-73-06
Page 1/32 Page 2/32 Page 3/32 ADRIERS AMBERRE ANCHE Tél mairie : 05 49 50 53 40 Tél mairie : 05 49 42 77 Tél mairie : 05-49-48-73-06 M. ROSE Philippe M. COLLAS Michel Mme MOUSSERION Martine ANGLES-SUR-L ANGLIN ANGLIERS ANTIGNY Tél mairie : 05 49 48 61 20 Tél mairie : 05 49 98 19 10 Tél mairie : 05 49 48 04 M. LECAMP Jean-François M. GIRARD René Mme DAGONAT Pascale ANTRAN ARCAY ARCHIGNY Tél mairie : 05 49 02 64 47 Tél mairie : 05 49 98 18 08 Tél mairie : 05 49 85 31 26 M. PICHON Alain M. NOE Alain M. PINNEAU Jean-Claude ASLONNES ASNIERES-SUR-BLOUR ASNOIS Tél mairie : 05 49 42 52 07 Tél mairie : 05 49 48 74 17 Tél mairie : 05 49 87 51 43 M. BOUCHET Roland Mme LEGRAND Maryse M. NEEL Thierry Page 4/32 AULNAY AVAILLES-EN-CHATELLERAULT AVAILLES-LIMOUZINE Tél mairie : 05 49 22 75 13 Tél mairie : 05 49 93 60 09 Tél mairie : 05 49 48 50 16 M. HERAULT Gérard M. ARNAULT François M. FAUGEROUX Joël AVANTON AYRON BASSES Tél mairie : 05 49 51 63 46 Tél mairie : 05 49 60 11 72 Tél mairie : 05 49 98 18 63 M. COUILLAULT Jean-Luc Mme GUERIN Fabienne Mme VIVION Monique BEAUMONT BELLEFONDS BENASSAY Tél mairie : 05 49 85 50 55 Tél mairie : 05 49 85 23 22 Tél mairie : 05 49 57 87 04 M. REVEILLAULT Nicolas M. HENEAU Bernard M. GUICHARD Rémi BERRIE BERTHEGON BERUGES Tél mairie : 05 49 22 94 25 Tél mairie : 05 49 22 80 64 Tél mairie : 05 49 53 32 54 M. -

Sortir En Vallées Du Clain
Vendredi 14 décembre • Nieuil-l’Espoir • Gizay Dimanche 27 janvier Nieuil-l’Espoir Voeux du maire - 11h Soirée adhérents • Château-Larcher ANIMATIONS AUTOUR Concours de belote • Roches-Pémarie-Andillé Salle des fêtes - GAG Loto - 14h - Salle des fêtes DU 11 NOVEMBRE 2018 C’est ma 13h30 - Salle JANVIER 2019 Loto - Salle polyvalente du Clos • Nieuil-l’Espoir APE Les Marcassous polyvalente - La Gaule Nieuiloise USRV Loto - 20h - Salle polyvalente • Iteuil Organisé par le Collectif cantonnal Samedi 15 décembre • Smarves JSNE (Football) Loto - 14h - Salle des fêtes du pour la sauvegarde de la mémoire • Aslonnes Jeudi 3 janvier Concours de tir à l’arc • Roches-Prémarie-Andillé complexe sportif - Club de judo de la 1ère guerre mondiale Roches-Pémarie-Andillé Vœux du maire - 11h Repas du Club de l’Amitié - 12h qualificatif pour les • Nieuil-l’Espoir Agenda des manifestations de la Communauté de communes Salle des fêtes - Club de l’Amitié Collecte de sang championnats de France Dimanche 20 janvier Théâtre - 14h30 - Salle ACCÈS GRATUIT sortieN° 10 - NOVEMBRE 2018 / JANVIER 2019 Aslonnes De 15h à 19h - Salle polyvalente les 12 & 13 janvier - Halles • Vernon polyvalente - Les Compagnons du Clos - Les donneurs de sang • Nieuil-l’Espoir sportives M. Bernard - La Flèche Vœux du maire - 11h - Salle socio du Miosson Jeudi 8 novembre Assemblée générale - Salle de Samedi 5 janvier Pictave • Vivonne • Smarves Nouaillé-Maupertuis jonction - Les Pétoires de l’Espoir • Château-Larcher • Vivonne Thé dansant Repas des Anciens La Passerelle - 14h - 18h • Vivonne -

Carte Cotisations NSA 04-06-2018.Ai
Service Cotisations Exploitants au 04/06/2018 CN 01 CN 14 Emilie Cambourieu Franck Liège 05.49.44.87.36 05.49.44.54.67 SAIX CN 04 Mélanie Gegaden RASLAY ROIFFÉ MORTON 05.49.44.54.78 ST-MARTIN- CN 08 BOUILLE-LORETZ POUANÇAY VÉZIÈRES BEUXES DE-SANZAY SAINT-LÉGER- Marie-Claire Rebeyrat DE-MONTBRILLAIS LES TROIS BOURNAND CN 07 ARGENTON- BERRIE MOUTIERS 05.49.44.56.22 L’EGLISE BRION- ST-CYR- GENNETON PRES- LA-LANDE Jérémy Brignone THOUET TOURTENAY BASSES ST-MAURICE ETUSSON VAL EN VIGNES TERNAY SAMMARÇOLLES ST-MARTIN- 05.49.44.89.44 LOUZY CEAUX- DE-MACON EN-LOUDUN STE-VERGE CURÇAY- GLÉNOUZE SUR-DIVE LOUDUN POUANT MESSEMÉ ST-PIERRE-DES- STE RANTON RADEGONDE ST-LEGER-DE- ECHAUBROGNES MONTBRUN MOUTERRE- PORT-DE-PILES ARGENTONAY MAUZE- ST- THOUARS SILLY THOUARSAIS JACQUES- PAS-DE-JEU DE- SAINT- CHALAIS NUEIL- THOUARS LA ROCHE- SOUS-FAYE ST- LAON RIGAULT MAULAY JEAN- MISSE BUXEUIL DE LES MAULEON THOUARS ARÇAY ORMES OIRON NUEL-LES-AUBIERS ST-AUBIN-DU- COULONGES- ANGLIERS VOULMENTIN DERCÉ PLAIN THOUARSAIS LUZAY MONDION TAIZE-MAULAIS VELLÈCHES PRINÇAY SAINT-RÉMY- SAINT- BRIE MARTAIZÉ SÉRIGNY SUR-CREUSE CN 12 LUCHE CHRISTOPHE DANGÉ- LA PETITE- THOUARSSAIS MONTS-SUR- LEIGNÉ- SAINT-ROMAIN ST-AMAND- BOISSIERE GUESNES STE-GEMME AULNAY GUESNES SUR-USSEAU VAUX-SUR- SUR-SEVRE ST-VARENT BERTHEGON VIENNE ST-JOUIN- MONCONTOUR Solène Autesseres LE PIN BRETIGNOLLES SAINT-GERVAIS- DE-MARNES LES-TROIS-CLOCHERS LEUGNY ST-GENEROUX SAINT- LA CHAUSSÉE SAIRES ORCHES COMBRAND IRAIS CLAIR USSEAU INGRANDES 05.49.44.89.52 GEAY PIERREFITTE ANTRAN BRESSUIRE VERRUE SAVIGNY- -

Consultation Du Public Préfecture De La Vienne Direction Départementale Des Territoires De La Vienne SPRAT Plan De Prévention Du Bruit Dans L'environnement
Consultation du public Préfecture de la Vienne Direction départementale des territoires de la Vienne SPRAT Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement Voie ferrée : ligne Paris – Bordeaux Réseau routier national concédé et non concédé : A10 , RN10, RN147, et RN 149 Votre avis nous intéresse ! La Préfecture de la Vienne met à la disposition du public le projet de plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) du réseau routier national de la Vienne durant 2 mois pour recueillir vos avis sur les actions de prévention et de protection contre le bruit envisagées dans les années à venir. L'objectif est de protéger la population actuellement exposée à de fortes nuisances sonores à proximité immédiate des routes nationales . Les communes concernées : – RN 10 : Poitiers, Fontaine Le Comte, Croutelle, Ligugé, Iteuil, Marçay, Vivonne, Payré, Châtillon, Couhé, Brux, Chaunay, Champagné-le-Sec, Linazay – RN 147 :Lathus St Rémy, Plaisance, Moulismes, Persac, Lussac Les Châteaux, Mazerolles, Civaux, Lhommaizé, Fleuré, Nieuil l'Espoir, Nouaillé Maupertuis, Mignaloux-Beauvoir, Poitiers, Buxerolles, Montamisé, Migné-Auxances – RN 149 : Migné-Auxances, Cissé, Quinçay, Vouillé, Frozes, Chiré en Montreuil, Ayron, Chalandray. – A10 : Rouillé, Curzay Sur Vonne, Jazeneuil, Lavausseau, La Chapelle Montreuil, Coulombiers, Fontaine Le Comte, Béruges, Vouneuil Sous Biard, Biard, Poitiers, Migné-Auxances, Chasseneuil du Poitou, Jaunay-Clan, Marigny-Brizay, Beaumont, Naintré, Châtellerault, Antran, Usseau, Vellèches. – Voie ferrée : Port de Piles, Les Ormes, Dangé St Romain, Ingrandes, Antran, Châtellerault, Naintré, Beaumont, Saint Cyr, Dissay, Jaunay Clan, Saint Georges Les Baillargeaux, Chasseneuil du Poitou, Buxerolles, Poitiers, St Benoît, Ligugé, Iteuil, Smarves, Aslonnes, Vivonne, Château Larcher, Voulon, Anché, Ceaux en Couhé, Vaux, Brux, Blanzay, Saint Pierre d'Excideuil, Saint Saviol, Saint Macoux, Voulême. -

Chapitre B. Projet De La Cooperative
SCAGE CLOUERE D EMANDE D ' AUTORISATION UNIQUE DE CREATION ET D ' EXPLOITATION DE 8 RESERVES DE SUBSTITUTION CHAPITRE B. PROJET DE LA COOPERATIVE 08/2016 TOME 2 ETUDE D'IMPACT – CHAPITRE B. LE PROJET DE LA COOPERATIVE Page B1 SCAGE CLOUERE D EMANDE D ' AUTORISATION UNIQUE DE CREATION ET D ' EXPLOITATION DE 8 RESERVES DE SUBSTITUTION - En périoDe printanière et estivale en Direct, B.1. PLACE DE L'IRRIGATION - En périoDe hivernale pour le remplissage D’une retenue De substitution à Château- DANS LE BASSIN CLOUERE Larcher (ASA De la Clouère), • Sur Des prélèvements en eau souterraine en périoDe printanière et estivale par Des forages L'activité agricole Du bassin versant De la Clouère recourt pour partie à l'irrigation. D’irrigation. Les prélèvements en rivière concernent la masse D’eau superfcielle « FRGR0395, la Clouère et ses Le projet De la coopérative SCAGE Clouère s'inscrit Dans cette organisation Des pratiques qui permet affuents Depuis sa source jusqu’à la confuence avec le Clain ». Ils sont gérés par l’inDicateur De un gain qualitatif Des proDuctions agricoles et une valeur économique renforcée. L’encaDrement De Château-Larcher à la station limnimétrique Du Rozeau et par l’inDicateur De la Douce à l’exutoire De cette pratique et notamment la voie De la substitution, concourt à une valorisation optimale De la la source De Fontjoise. ressource tout en concourant à l’atteinte Des objectifs quantitatifs voir qualitatifs De la nécessaire gestion De l’eau Dans le secteur. La caractérisation et l'appréciation De place De l'irrigation Dans le Les prélèvements en eau souterraine sont réalisés Dans la masse D’eau souterraine « FRGG063, bassin De la Clouère s'appuie sur les étuDes suivantes : calcaires et marnes Du Dogger Du bassin versant Du Clain ».