Setrad Poursuite Exploitation De L'isdnd Gizay
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
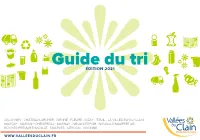
Guide Du Tri ÉDITION 2021
Guide du tri ÉDITION 2021 ASLONNES . CHÂTEAU-LARCHER . DIENNÉ . FLEURÉ . GIZAY . ITEUIL . LA VILLEDIEU-DU-CLAIN . MARÇAY . MARIGNY-CHÉMEREAU . MARNAY . NIEUIL-L’ESPOIR . NOUAILLÉ-MAUPERTUIS . ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ . SMARVES . VERNON . VIVONNE WWW.VALLEESDUCLAIN.FR Le sommaire M. Beaujaneau, Président de la Communauté de P 3 _____ ZÉRO DÉCHET Communes des Vallées du Clain Le guide du tri 2021 des Vallées du Clain vous donne toutes les clés P 4 _____ LE B.A. BA DU BAC pour mieux trier et réduire vos déchets au quotidien. Vous y trouverez les consignes de tri détaillées et les informations pratiques pour trier, P 5 _____ LES JOURS DE COLLECTE chez vous, dans les bornes et dans les déchèteries. Notre geste de tri reste indispensable pour protéger notre environne- P 6-7 ___ LE TRI À LA MAISON ment. Mais au vu des quantités très importantes de déchets produits, et des coûts en hausse pour les traiter, réduire nos déchets devient un P 8-9 ____ LE TRI DANS LES BORNES véritable enjeu ! Simple à mettre en place au quotidien, réduire ses dé- chets, c’est tout simplement éviter de les produire. Le meilleur déchet est celui que l’on ne fait pas ! P 10-11 ___ LE TRI EN DÉCHÈTERIE La Communauté de communes des Vallées du Clain qui a la com- P 12-13 __ LA VALORISATION DES DÉCHETS pétence « gestion et traitement des déchets » conduit une politique environnementale ambitieuse. Elle dotera bientôt le territoire d’une nouvelle déchèterie plus performante avec de nouvelles filières de re- P 14-15 __ LES INFOS PRATIQUES cyclage pour valoriser un maximum de déchets. -

L'accompagnement De Vos Territoires
L’accompagnement de vos territoires RELATION ADHÉRENTS ARCHITECTURE/PAYSAGE/URBANISME SERVICES NUMÉRIQUES SERVICE JURIDIQUE/AMF86/FORMATION DES ÉLUS Architecte Julien Secheresse AJSA -Photographe : Maud Piderit, Focalpix adriers - amberre - anche - angles-sur-l’anglin - angliers - antigny - an- tran - arcay - archigny - aslonnes - asnieres-sur-blour - asnois - aulnay - availles limouzine - availles-en-chatellerault - avan- ton - ayron - basses - beaumont saint cyr - bellefonds - berrie - ber- the- gon - beruges - bethines - beuxes - biard - bignoux - blanzay - boivre-la-vallee - bonnes - bonneuil-matours - bouresse - bourg-archambault - bournand - brigueil-le-chantre - brion - brux - buxerolles - buxeuil - ceaux-en-loudun - celle-l’evescault - cenon- sur-vienne - cernay - chabournay - chalais - chalandray - champagne- le-sec - champagne-saint-hilaire - champigny en rochereau - champniers - charroux - chasseneuil-du-poitou - chatain - chateau-garnier - chateau-larcher - chatellerault - chaunay - chauvigny - chenevelles - cherves - chire-en-montreuil - chouppes - cisse - civaux - civray - cloue - colombiers - valence-en-poitou - cou- lombiers - coulonges - coussay - coussay-les-bois - craon - croutelle - cuhon - cur- cay-sur-dive - curzay sur vonne - dange-saint-romain - derce - dienne - dissay - doussay - fleix - fleure - fontaine-le-comte - frozes - gencay - genouille - gizay - glenouze - gouex - guesnes - haims - ingrandes - iteuil - jardres - jaunay-marigny - jazeneuil - jouhet - journet - jousse - la bussiere - la chapelle viviers -

Préfecture De La Vienne
Préfecture de la Vienne ARRETE N° 2015- DDT- 830 Direction Départementale des Territoires Arrêté portant classement des de la Vienne infrastructures de transports terrestres du département de la Vienne déterminant l'isolement acoustique des bâtiments La Préfète de la Région Poitou-Charentes d'habitation dans les secteurs affectés par le Préfète de la Vienne bruit Chevalier de l'Ordre National du Mérite Vu le code de l'environnement , et notamment l'article L.571-10 , R571-32 à R571-43 Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R 111-4-1 ; R111-23-1 à R111-23-3 ; Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles R123-13, R123-14 et R123-22 Vu l’arrêté interministériel du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ; Vu l'arrêté du 03/09/2013 illustrant par des schémas et des exemples les articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 mai 1996 modifié relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ; Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article L 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements . -

Classement Féminin Ordre Nom Prénom Age Ville Temps 1 Coutant Malika 32 Ans POITIERS 0H30m43s 2 MALKA CLAIRE 46 Ans POITIERS 0
Classement Féminin Ordre Nom Prénom Age Ville Temps 1 Coutant Malika 32 ans POITIERS 0h30m43s 2 MALKA CLAIRE 46 ans POITIERS 0h30m51s 3 Vincent Dominique 44 ans Ligugé 0h32m54s 4 Moreira Dasilva Estelle 23 ans Ligugé 0h33m36s 5 Cerisier Stéphanie 34 ans Chartres 0h34m8s 6 Jolly Patricia 48 ans Saint-Benoît 0h34m29s 7 Vincent Roselyne 44 ans Ligugé 0h34m59s 8 Venereux Karine 33 ans Cisse 0h35m35s 9 Negrier Sylvie 38 ans St Cyr 0h36m52s 10 Brousse Martine 54 ans Poitiers 0h37m17s 11 Morera Dasilva Francoise 45 ans Ligugé 0h37m42s 12 Bernard Marie France 50 ans Poitiers 0h39m7s 13 Martineau Patricia 42 ans Saint Georges lès Baillargeaux 0h39m12s 14 Roulon Martine 40 ans Saint Georges lès Baillargeaux 0h39m29s 15 Falaise Ramel Béatrice 48 ans Les Roches Prémaries 0h39m36s 16 Brousse Isabelle 30 ans Poitiers 0h39m57s 17 GREAULT CHRISTINE 49 ans TERCE 0h40m4s 18 COLLAS ANAIS 18 ans SMARVES 0h40m5s 19 Chabanne Sophie 34 ans Smarves 0h40m5s 20 Samson Caroline 39 ans Saint Secondin 0h40m6s 21 Frappier Blandine 23 ans poitiers 0h40m9s 22 BASSET ANNE 26 ans MIGNE AUXANCES 0h40m30s 23 Morisseau Danielle 38 ans Mirbeau 0h40m30s 24 Rocheron Magalie 31 ans St Genest d'Aubière 0h40m31s 25 Martineau Lydie 43 ans Montamisé 0h40m36s 26 TEXEREAU CATHERINE 40 ans CELLE L'EVESCAULT 0h40m56s 27 POIRIER ST2PHANIE 25 ans ITEUIL 0h41m51s 28 MERCIER MARYVONNE 47 ans LIGUGE 0h41m52s 29 DUGUE Manuella 30 ans QUINCAY 0h41m52s 30 Bernot Stéphanie 30 ans Poitiers 0h42m5s 31 Mauvais Martine 45 ans Saint Georges lès Baillargeaux 0h42m14s 32 Mornet Agnès 51 ans Bignoux -

Circonscription De Poitiers Sud
Circonscription de Poitiers Sud IEN : Agnès CASTEL Référents DDEN : Dominique LEBLANC - Geneviève RIVAUD COMMUNE NOM DE L'ECOLE TYPE NOM - PRENOM ASLONNES "Paul Baudrin" PRIM BLONDE Philippe BRUX PRIM CELLE - LEVESCAULT "Perle d'eau" [RPI Celle - Levescault / Cloué] RPI CHAMPAGNE - SAINT - HILAIRE PRIM GUIGNARD Florence CHÂTEAU - LARCHER Château - Larcher / Marnay RPI GRECK Nicole CHAUNAY MAT SERRE Patrick CHAUNAY "Francine Poitevin" ELEM SERRE Patrick CLOUE "Du Moulin à Vent" [RPI Cloué / Celle - Levescault] RPI BARRIÈRE Thérèse COULOMBIERS MAT VENEAU François COULOMBIERS ELEM VENEAU François CURZAY - SUR - VONNE Curzay - Sur - Vonne / Sanxay RPI BONNIN Reine GENCAY MAT GENCAY ELEM GIZAY Gizay / Vernon RPI MONNET René ITEUIL MAT LEBLANC Dominique (*) ITEUIL ELEM LEBLANC Dominique JAZENEUIL PRIM LUSIGNAN "Léodile Bera" MAT LUSIGNAN ELEM MAGNE PRIM CHEVRIER Marie-Claire MARCAY "Mariette et Henri Gauthier" PRIM MARNAY Marnay / Château - Larcher RPI GRECK Nicole NOUAILLE-MAUPERTUIS MAT RIVAUD Geneviève NOUAILLE-MAUPERTUIS ELEM RIVAUD Geneviève POITIERS "Jacques Brel " MAT COURTOIS Marie - Josèphe POITIERS "Jacques Brel" ELEM COURTOIS Marie - Josèphe POITIERS "Tony Lainé " MAT COSSON Philippe POITIERS "Tony Lainé" ELEM AURIAULT Claudine ROCHES - PRÉMARIE - ANDILLÉ MAT CORNUAULT Rose ROCHES - PRÉMARIE - ANDILLÉ ELEM CORNUAULT Rose ROMAGNE PRIM COIRIER-SENAMAUD Mireille ROUILLE MAT CHAUVIÈRE Françoise ROUILLE ELEM CHAUVIÈRE Françoise SANXAY Sanxay / Curzay - Sur - Vonne RPI SOMMIERES - DU - CLAIN PRIM SAINT - MAURICE - LA - CLOUERE PRIM ARLOT Pierrette SAINT - SAUVANT PRIM SAINT - SECONDIN PRIM VALENCE - EN - POITOU "Raoul Bonnet" - Couhé MAT GABORIT Bernard VALENCE - EN - POITOU "Jacques Lafond" - Couhé ELEM GABORIT Bernard VALENCE - EN - POITOU "Des Iles" - Payré PRIM GABORIT Bernard VERNON Vernon / Gizay RPI MONNET René VILLEDIEU - DU - CLAIN (LA) "La Girouette" MAT MOUSSET Michel VILLEDIEU - DU - CLAIN (LA) ELEM MOUSSET Michel VIVONNE MAT VIVONNE "Langevin - Wallon" ELEM VOULON PRIM . -

Procès-Verbal 15 Septembre 2020 Salle Du Conseil Communautaire La Villedieu-Du-Clain
Procès-Verbal 15 septembre 2020 Salle du conseil communautaire La Villedieu-du-Clain PV du conseil communautaire du mardi 15 septembre 2020 - 1 - Nombre de titulaires en exercice : 41 Quorum de l’assemblée : 21 Nombre de membres présents (titulaires et suppléants) : 35 Nombre de pouvoirs : 6 Nombre de votants : 41 CONSEIL COMMUNAUTAIRE Séance du mardi 15 septembre 2020 L’an deux mille vingt, le mardi 15 septembre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire se sont réunis au siège de la Communauté de communes à La Villedieu-du-Clain, sur la convocation qui leur a été adressée par le Président M. Gilbert BEAUJANEAU. Date d’envoi de la convocation du conseil communautaire : mercredi 9 septembre 2020. Date de transmission des délibérations en Préfecture : jeudi 17 septembre 2020. Date d’affichage : jeudi 17 septembre 2020. Présents : ASLONNES M. BOUCHET et Mme SICARD ; CHATEAU-LARCHER M. GARGOUIL ; DIENNÉ M. MAMES ; FLEURÉ M. PERROCHES et Mme TUCHOSKI ; GIZAY M. GRASSIEN ; ITEUIL Mmes MICAULT, MOUSSERION, MM. BOISSEAU et CINQUABRE ; LA VILLEDIEU-DU-CLAIN M. DUCHATEAU et Mme BOUTILLET ; MARÇAY Mme GIRARD et M. CHARGELÈGUE ; MARIGNY-CHÉMEREAU Mme NORESKAL (arrivée à la délibération 2020/104) ; MARNAY M. CHAPLAIN (arrivé à la délibération 2020/104) ; NIEUIL-L’ESPOIR M. BEAUJANEAU, Mmes AVRIL et GERMANEAU ; NOUAILLE-MAUPERTUIS MM. BUGNET, PICHON et Mme BRUNET ; ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ MM. MARCHADIER, et LOISEAU ; SMARVES MM. BARRAULT, GODET et Mme PAIN-DEGUEULE ; VERNON M. REVERDY ; VIVONNE Mmes BERTAUD, GREMILLON, PROUTEAU, MM. BARBOTIN, GUILLON, et QUINTARD. Excusés et représentés : CHATEAU-LARCHER Mme PEIGNAULT a donné pouvoir à M. GARGOUIL ; NIEUIL-L’ESPOIR M. -

Répar on Des Agences Territoriales Et Des Centres D'exploita
Répar��on des Agences Territoriales et des Centres d'Exploita�on Agence de Neuville-de-Poitou Centre de Loudun Viennopôle 29 rue des Aubuies 86200 Loudun Saix Centre de Vaux-sur-Vienne Pouançay Roiffé [email protected] Raslay 37 Godet Morton Tel. 05 49 22 96 84 Vézières Beuxes Saint-Léger 86220 Vaux-sur-Vienne de Mbr. Marçay Les Trois Bournand (37) [email protected] Berrie Mou�ers Agence de Châtellerault Basses Tel. 05 49 93 04 48 Ternay Sammarçolles Ceaux-en Loudun Curçay Glénouze Pouant Loudun Messemé Ranton Mouterre Silly Port-de-Piles Centre de Châtellerault Nueil Saint Chalais Maulay Laon La Roche sous-Faye Rigault 8 rue Marcel Dassault Arçay Buxeuil 86100 Châtellerault Angliers Les Ormes Dercé Mondion Vellèches Martaizé Prinçay Saint-Rémy Sérigny Saint [email protected] Monts-sur Christophe Dangé sur-Creuse Leigné Guesnes Guesnes Saint-Romain Aulnay sur-Usseau Tel. 05 49 93 31 16 Berthegon Saint-Gervais Vaux Moncontour les-Trois-Clochers Saint-Clair La Chaussée Saires Leugny Orches Ingrandes Usseau Verrue Savigny Antran Marnes sous-Faye 79 (79) Sossay Oyré Doussay Mairé Centre de Saint-Savin Saint Saint-Jean-de-Sauves Coussay Chartres Cernay Saint-Genest Thuré Lésigny d'Ambière Châtellerault Route de Béthines La Grimaudière Chouppes Scorbé Coussay-les-Bois 86310 Saint-Germain Mazeuil Lencloître Clairvaux Mirebeau Senillé [email protected] Craon Thurageau Centre de Amberre Ouzilly Colombiers Saint-Sauveur Cuhon Naintré La Roche Tel. 05 49 48 16 48 Posay Massognes Availles Leigné Neuville-de-Poitou Cenon en-Ch. les-Bois Maisonneuve Saint-Mar�n-La-Pallu Beaumont Monthoiron Pleumar�n 11 rue de l'Outarde canepe�ère Champigny Saint-Cyr en-Rochereau Chenevelles Vicq-sur-Gartempe Vouzailles Vouneuil-sur-Vienne 86170 Neuville-de-Poitou Chabournay Cherves Neuville-de-P. -

Le Risque Mouvement De Terrain, Consulter
LES RISQUES NATURELS i LE RISQUE MOUVEMENT h DE TERRAIN 1- DÉFINITION Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels d'origines très diverses. Annuellement, ils provoquent en moyenne la mort de 800 à 1 000 personnes dans le monde et occasionnent des préjudices économiques et des dommages très importants. Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu sont compris entre quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour). 2- LES DIFFÉRENTS MOUVEMENTS DE TERRAIN . Le glissement de terrain : Il correspond au déplacement de terrains meubles ou rocheux le long d'une surface de rupture. Les chutes de blocs et éboulements : Les éboulements sont des phénomènes rapides ou événementiels mobilisant des éléments rocheux plus ou moins homogènes avec peu de déformation préalable d'une pente abrupte jusqu'à une zone de dépôt. Les effondrements : Un effondrement est un désordre créé par la rupture du toit d'une cavité souterraine (dissolution, mine, carrière...). Il existe 2 types de cavités : Cavités naturelles les karsts, gouffres, grottes, etc. ; les cavités de suffosion. (cavités liées à des phénomènes d'érosion interne générées par des circulations d'eau souterraines). Cavités anthropiques les carrières ; les marnières ; les caves ; les habitations troglodytiques ; les ouvrages civils ; les ouvrages militaires. 1 . Les tassements par retrait-gonflement des argiles : Les variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et des tassements (période sèche) et peuvent avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles. -

Page 1/32 Page 2/32 Page 3/32 ADRIERS AMBERRE ANCHE Tél Mairie : 05 49 50 53 40 Tél Mairie : 05 49 42 77 Tél Mairie : 05-49-48-73-06
Page 1/32 Page 2/32 Page 3/32 ADRIERS AMBERRE ANCHE Tél mairie : 05 49 50 53 40 Tél mairie : 05 49 42 77 Tél mairie : 05-49-48-73-06 M. ROSE Philippe M. COLLAS Michel Mme MOUSSERION Martine ANGLES-SUR-L ANGLIN ANGLIERS ANTIGNY Tél mairie : 05 49 48 61 20 Tél mairie : 05 49 98 19 10 Tél mairie : 05 49 48 04 M. LECAMP Jean-François M. GIRARD René Mme DAGONAT Pascale ANTRAN ARCAY ARCHIGNY Tél mairie : 05 49 02 64 47 Tél mairie : 05 49 98 18 08 Tél mairie : 05 49 85 31 26 M. PICHON Alain M. NOE Alain M. PINNEAU Jean-Claude ASLONNES ASNIERES-SUR-BLOUR ASNOIS Tél mairie : 05 49 42 52 07 Tél mairie : 05 49 48 74 17 Tél mairie : 05 49 87 51 43 M. BOUCHET Roland Mme LEGRAND Maryse M. NEEL Thierry Page 4/32 AULNAY AVAILLES-EN-CHATELLERAULT AVAILLES-LIMOUZINE Tél mairie : 05 49 22 75 13 Tél mairie : 05 49 93 60 09 Tél mairie : 05 49 48 50 16 M. HERAULT Gérard M. ARNAULT François M. FAUGEROUX Joël AVANTON AYRON BASSES Tél mairie : 05 49 51 63 46 Tél mairie : 05 49 60 11 72 Tél mairie : 05 49 98 18 63 M. COUILLAULT Jean-Luc Mme GUERIN Fabienne Mme VIVION Monique BEAUMONT BELLEFONDS BENASSAY Tél mairie : 05 49 85 50 55 Tél mairie : 05 49 85 23 22 Tél mairie : 05 49 57 87 04 M. REVEILLAULT Nicolas M. HENEAU Bernard M. GUICHARD Rémi BERRIE BERTHEGON BERUGES Tél mairie : 05 49 22 94 25 Tél mairie : 05 49 22 80 64 Tél mairie : 05 49 53 32 54 M. -

Affiliés USEP Vienne 2017-2018
Affiliés USEP Vienne Saix 2017-2018 Roiffé Raslay Morton Pouançay St Léger Vézières Communes sans école de Montbrillais Loudunais Beuxes Berrie Les Bournand Trois Moutiers Ceaux. Communes non affiliées Ternay BassesSammarçolles en Curçay Loudun sur GlénouzeMouterre-Silly Dive Loudun Messemé Pouant Ranton Port-de-Piles Saint La Nueil-sous-Faye Laon Chalais Roche Les Ormes Rigault Maulay Buxeuil Arçay Angliers Dercé Guesnes Mondion Saint-Rémy Prinçay Vellèches Monts Sérigny Leigné Dangé-Saint sur-Creuse Martaizé sur Romain Les Portes Aulnay sur Saint Saint Guesnes Usseau Vaux Berthegon ChristopheGervais sur La Saires Vienne . du Poitou Saint lesTrois Leugny Moncontour Clair Chaussée Orches Clochers Usseau Verrue Savigny sous Sossais Antran Oyré Saint Jean Faye Ingrandes Pays Doussay Saint Mairé de Sauves Coussay Thuré MoncontourLa Grimaudière Cernay Genest Lésigny Châtelleraudais d'Ambière . Saint-Sauveur Chouppes Scorbé Châtellerault Coussay-les-Bois Lencloître Mazeuil Clairvaux La Roche-Posay Mirebeau Craon Thurageau Ouzilly Colombiers Amberre Senillé Vals de Gartempe Cuhon Varennes Naintré Availles Leigné Marigny Cenon en les & Creuse Massognes Cheneché . Brizay Châtellerault Bois Pleumartin Champigny Vendeuvre Beaumont Maisonneuve Blaslay le-Sec du-Poitou Saint Vouneuil Chabournay Chenevelles Vicq-sur-Gartempe Vouzailles Cyr sur-Vienne Monthoiron Charrais Cherves Le Rochereau Dissay Neuville Jaunay-Clan Angles-sur-l'Anglin Maillé Saint-Pierre-de-Maillé Villiers de-Poitou Bonneuil-Matours Chalandray Frozes Yversay Saint-Georges Archigny -

Sortir En Vallées Du Clain
Vendredi 14 décembre • Nieuil-l’Espoir • Gizay Dimanche 27 janvier Nieuil-l’Espoir Voeux du maire - 11h Soirée adhérents • Château-Larcher ANIMATIONS AUTOUR Concours de belote • Roches-Pémarie-Andillé Salle des fêtes - GAG Loto - 14h - Salle des fêtes DU 11 NOVEMBRE 2018 C’est ma 13h30 - Salle JANVIER 2019 Loto - Salle polyvalente du Clos • Nieuil-l’Espoir APE Les Marcassous polyvalente - La Gaule Nieuiloise USRV Loto - 20h - Salle polyvalente • Iteuil Organisé par le Collectif cantonnal Samedi 15 décembre • Smarves JSNE (Football) Loto - 14h - Salle des fêtes du pour la sauvegarde de la mémoire • Aslonnes Jeudi 3 janvier Concours de tir à l’arc • Roches-Prémarie-Andillé complexe sportif - Club de judo de la 1ère guerre mondiale Roches-Pémarie-Andillé Vœux du maire - 11h Repas du Club de l’Amitié - 12h qualificatif pour les • Nieuil-l’Espoir Agenda des manifestations de la Communauté de communes Salle des fêtes - Club de l’Amitié Collecte de sang championnats de France Dimanche 20 janvier Théâtre - 14h30 - Salle ACCÈS GRATUIT sortieN° 10 - NOVEMBRE 2018 / JANVIER 2019 Aslonnes De 15h à 19h - Salle polyvalente les 12 & 13 janvier - Halles • Vernon polyvalente - Les Compagnons du Clos - Les donneurs de sang • Nieuil-l’Espoir sportives M. Bernard - La Flèche Vœux du maire - 11h - Salle socio du Miosson Jeudi 8 novembre Assemblée générale - Salle de Samedi 5 janvier Pictave • Vivonne • Smarves Nouaillé-Maupertuis jonction - Les Pétoires de l’Espoir • Château-Larcher • Vivonne Thé dansant Repas des Anciens La Passerelle - 14h - 18h • Vivonne -

Carte Cotisations NSA 04-06-2018.Ai
Service Cotisations Exploitants au 04/06/2018 CN 01 CN 14 Emilie Cambourieu Franck Liège 05.49.44.87.36 05.49.44.54.67 SAIX CN 04 Mélanie Gegaden RASLAY ROIFFÉ MORTON 05.49.44.54.78 ST-MARTIN- CN 08 BOUILLE-LORETZ POUANÇAY VÉZIÈRES BEUXES DE-SANZAY SAINT-LÉGER- Marie-Claire Rebeyrat DE-MONTBRILLAIS LES TROIS BOURNAND CN 07 ARGENTON- BERRIE MOUTIERS 05.49.44.56.22 L’EGLISE BRION- ST-CYR- GENNETON PRES- LA-LANDE Jérémy Brignone THOUET TOURTENAY BASSES ST-MAURICE ETUSSON VAL EN VIGNES TERNAY SAMMARÇOLLES ST-MARTIN- 05.49.44.89.44 LOUZY CEAUX- DE-MACON EN-LOUDUN STE-VERGE CURÇAY- GLÉNOUZE SUR-DIVE LOUDUN POUANT MESSEMÉ ST-PIERRE-DES- STE RANTON RADEGONDE ST-LEGER-DE- ECHAUBROGNES MONTBRUN MOUTERRE- PORT-DE-PILES ARGENTONAY MAUZE- ST- THOUARS SILLY THOUARSAIS JACQUES- PAS-DE-JEU DE- SAINT- CHALAIS NUEIL- THOUARS LA ROCHE- SOUS-FAYE ST- LAON RIGAULT MAULAY JEAN- MISSE BUXEUIL DE LES MAULEON THOUARS ARÇAY ORMES OIRON NUEL-LES-AUBIERS ST-AUBIN-DU- COULONGES- ANGLIERS VOULMENTIN DERCÉ PLAIN THOUARSAIS LUZAY MONDION TAIZE-MAULAIS VELLÈCHES PRINÇAY SAINT-RÉMY- SAINT- BRIE MARTAIZÉ SÉRIGNY SUR-CREUSE CN 12 LUCHE CHRISTOPHE DANGÉ- LA PETITE- THOUARSSAIS MONTS-SUR- LEIGNÉ- SAINT-ROMAIN ST-AMAND- BOISSIERE GUESNES STE-GEMME AULNAY GUESNES SUR-USSEAU VAUX-SUR- SUR-SEVRE ST-VARENT BERTHEGON VIENNE ST-JOUIN- MONCONTOUR Solène Autesseres LE PIN BRETIGNOLLES SAINT-GERVAIS- DE-MARNES LES-TROIS-CLOCHERS LEUGNY ST-GENEROUX SAINT- LA CHAUSSÉE SAIRES ORCHES COMBRAND IRAIS CLAIR USSEAU INGRANDES 05.49.44.89.52 GEAY PIERREFITTE ANTRAN BRESSUIRE VERRUE SAVIGNY-