J. BOURRILLY (Marguerittes, Gard) Et F
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Baignade Swimming Area
BAIGNADE SWIMMING AREA . BADEPLATZ ©Sonia Blin L’ Albagne Arrigas / Aumessas : D999 direction Alzon, prendre Aumessas tournez à droite au niveau des 3 ponts, rivière l’Albagne. Aire de loisirs pour enfants, jeux, baignade, pique-nique, eau potable, toilettes, analyses régulières. L’ Arre Avèze : sortie du Vigan direction Millau, à 1km tournez à gauche direction Avèze, prendre la 1re à droite camping du Pont Vieux, rivière l’Arre. Aire de pique-nique. Le Souls Molières-Cavaillac : D999 direction Alzon, traverser le village de Cavaillac direction la promenade du viaduc. A 200 m tournez à gauche sur le parking de la piste de BMX, chaussée du Mas Rouch. Bréau et Salagosse : direction D48 Mont Aigoual, suivre Intermarché en direction de Bréau, au carrefour prendre la direction de Salagosse sur 1km, le rieumage est là, la rivière la Souls. AU BORD DE L’eau AU Office de Tourisme Cévennes & Navacelles Bureau du Vigan Place du marché - 30120 LE VIGAN +33 (0)4 67 81 01 72 Bureau du Cirque de Navacelles Maison du Grand Site, Belvédères de Blandas - 30770 Blandas +33 (0)9 62 64 35 10 [email protected] www.tourismecevennesnavacelles.com La Vis Navacelles : descendre dans le cirque de Navacelles et garez-vous au parking. Rivière la Vis, très fraîche même en été ! Saint-Laurent-le-Minier : après le pont du Super U, prendre direction Saint-Bresson puis Saint-Laurent-le- Minier. La cascade de la Meuse, la rivière la Vis la plus fraîche et la plus revigorante... Parking aménagé et payant. La cascade est en partie privée sur sa rive gauche. -

Bibliographie
Bibliographie Agostini 1972 : P. Agostini, L’oppidum préromain des Baou de logìa anfòrica de la Punta del Nao (Càdiz, España), II Congresso Internazio- Saint-Marcel à Marseille (VIIe-IIe s.). Contribution à l’inventaire nale di Studi Fenici et Punici, Rome, 1987, Rome, 1991, 601-616. A archéologique de la Provence. Aix-en-Provence, univ. de Proven- Amann 1976 : A. Amann, Aperçu sur la céramique indigène de l’Age du ce, thèse, 3 vol., 145 p., 76 pl. h.t. (dactyl.). Fer, Sites de l’Age du Fer et gallo-romains de la région de Nice, UISPP, IXe Agostini 1978 : P. Agostini, F. Gantès et G. Rayssiguier, De la céramique congrès, Nice, 1976, 32-39. archaïque des Baou de Saint-Marcel à Marseille, RAN, 11, 1978, 1-18. Amann 1977 : A.-H. Amann, Le matériel archéologique préromain décou- Alaminos 1991 : A. Alaminos, M. Ojuel, J. Sanmarti et J. Santacana, Algunas vert au Mont-Garou (commune de Sanary, Var). Toulon, centre archéol., 2 observaciones sobre el commercio colonial en la costa central y meridional vol., 1977, 279 p. et 97 pl. h.t. (dactyl.). de Catalunya en época arcaica, La presencia de material etrusco en la Penín- Amo de la Hera 1970 : M. del Amo de la Hera, La ceramica campaniense sula Ibérica, Barcelone, 1991, 275-294. de importacion y las imitaciones de campaniense de Ibiza, Trabajos de Pre- Albore 1967 : C. Albore Livadie, L’épave étrusque du Cap d’Antibes, RSL, historia, 27, 1970, 201-256. 33, 1967, 300-326. Amouric à paraître : H. Amouric, G. Démians d’Archimbaud et M. -

PETITE HISTOIRE INSOLITE De Quelques Rues De CALVISSON
PETITE HISTOIRE INSOLITE de quelques rues de CALVISSON Certaines rues de notre village, en perpétuel développement, sont récentes. Mais d'autres sont -très- anciennes, déjà existantes au Moyen Âge. Elles portaient alors un autre nom. Les documents-sources de ces noms anciens sont, entr’autres, des actes notariés de la fin du Moyen Âge, ainsi que les registres consulaires de la fin du 16è siècle et les compoix (ancêtres du cadastre) des 16è et 17è siècles. Et deux documents plus récents sont aussi précieux : le plan cadastral « Napoléon » de 1834 et un projet d'alignement général établi en 1871, à l'époque où l'on se souciait déjà de circulation et de salubrité. Voici donc l'histoire de quelques unes d'entre elles. Toutes les origines, de celles- ci et d'autres absentes de cette liste, n'ont pu être retrouvées ; si vous avez des idées ou des indications, merci d'avance pour ce que vous pourrez apporter. rue du 8 mai 1945 En 1871, c’est le « chemin de Plaisance ». Elle marque la limite sud du « Quartier de Plaisance », un « village » archéologique romain, occupé du 1 er au 6è siècle. (voir rue Bourrély). Au cadastre Napoléon, c’est un « chemin de service ». Au compoix de 1664, c’est un chemin serpentant entre les jardins du « quartier de Baujac », quartier qui s’étendait depuis la rivière « Cagalaure » au sud jusqu’au « Valat de Paillet » au nord. avenue du 11 novembre 1918 C’était auparavant l’avenue de la Gare, aménagée en 1896 suite à la construction de la ligne de chemin de fer de Nîmes à Sommières. -

Essai De Minéralogie Du Département Du Gard
PIERRE DE BRUN. – MINÉRALOGIE DU DÉPARTEMENT DU GARD 1 Essai de Minéralogie du département du Gard Par PIERRE DE BRUN INTRODUCTION MESSIEURS, L'opuscule que je vous présente, sous le titre d'Essai de Minéralogie du département du Gard n'est pas à proprement parler un ouvrage original. C'est la refonte et la synthèse de tous les mémoires, articles, récits d'excursions, etc., que j'ai pu me procurer et qui ont trait à la Minéralogie de notre département. J'ai voulu condenser et mettre à la portée de tous ce qui, jusqu'à aujourd'hui, était disséminé dans une foule d'ouvrages et de Bulletins de sociétés savantes. J'ai visité la collection du Musée de Nîmes, comprenant les collections Séguier, Philippe Mingaud, etc., et plusieurs autres collections particulières (Sc. Pellet, Jeanjean, Lioure) ; quelques uns de collègues ont bien voulu m'aider de leurs lumières et ma donner de précieuses indications de gisements. A ces matériaux, j'ai ajouté toutes les observations nouvelles et les découvertes que j'ai pu faire pendant mes deux années de séjour dans ce beau pays des Cévennes. Le grand ouvrage d'Emilien Dumas, quoiqu'un peu ancien déjà, a été pour moi d'un grand secours ; c'est. du reste, une mine précieuse et inépuisable pour tous ceux qu'intéresse la géologie du Gard. J'ai modifié la classification démodée qu'il avait suivie dans sa Statistique. Celle qu'a créée M. de Lapparent, dans son Cours de minéralogie, m'a séduit par sa nouveauté, sa simplicité et l'union carotte qu'elle occasionne entre ces deux sciences jumelles, la géologie et la minéralogie. -

Mémoires Liacadémiede De Nimes
MÉMOIRES LIACADÉMIEDE DE NIMES VIlma SERIE TOME LIX Années 1974 1975 1976 - - NIMES IMPRIMERIE LE CASTELLUM 5, rue Frédéric Paulhan 1977 PROTOHISTOIRE DE LA VAUNAGE par M. Maurice ALIGER membre résidant En janvier 1972, il m'a été donné de vous entretenir de la Préhistoire de la Vaunage, que la Commission des Anciens Présidents a bien voulu, et je l'en remercie, retenir pour fi- gurer dans nos Mémoires. Au cours de cette communication, nous avions vu que seule la Préhistoire récente avait laissé des témoignages pro- bants Vaunage occupations discrètes au Néolithique moy- en ; marquée en et à l'Age du Bronze, présence humaine très au Chalcolithique. Je vous avais alors indiqué que ce n'était qu'aux « Champs final et le d'urnes », période de transition entre le Bronze Premier Age du Fer, que l'occupation de la Vaunage prenait une tournure nouvelle. C'est alors que débutait la période des oppidums dont l'im- portance est capitale pour notre région. Nimes y jouera un rôle important, puisqu'elle deviendra la métropole des Volques Arécomiques, métropole dont il reste peu de traces, la per- manence de vie sur le même emplacement en ayant effacé l'essentiel. En Vaunage, par contre, tout ou presque, est demeuré en place, et l'archéologue y trouve un champ d'expériences pra- tiquement vierge. D'ailleurs les deux territoires, limitrophes, ont été, de tous temps, intimement liés. Avec la période des oppidums commence une occupation hu- maine de notre contrée qui sera, et j'insiste là-dessus, inin- terrompue jusqu'à nos jours. -

Liste Des Points De Tri
LISTE DES POINTS DE TRI Commune Adresse Colonne Aigaliers La mairie Emballages Aigaliers La mairie Papier Aigaliers La mairie Verre Aigaliers La mairie Emballages Aigaliers La mairie Papier Aigaliers La mairie Verre Argilliers Place du jeu de boule Emballages Argilliers Place du jeu de boule Papier Argilliers Place du jeu de boule Verre Arpaillargues Salle polyvalente Emballages Arpaillargues Salle polyvalente Emballages Arpaillargues Salle polyvalente Papier Arpaillargues Salle polyvalente Verre Aureilhac Gabarit Emballages Aureilhac Gabarit Papier Aureilhac Gabarit Verre Bastide (la) Place de l'horloge Emballages Bastide (la) Place de l'horloge Papier Bastide (la) Place de l'horloge Verre Belvezet Cimetière Emballages Belvezet Cimetière Papier Belvezet Cimetière Verre Belvezet Place de l'église Emballages Belvezet Place de l'église Papier Belvezet Place de l'église Verre Bruguière (la) Parking cave coopérative Emballages Bruguière (la) Parking cave coopérative Papier Bruguière (la) Parking cave coopérative Verre Capelle (la) & Masmolène La Capelle-Rte uzès côté étang Emballages Capelle (la) & Masmolène La Capelle-Rte uzès côté étang Papier Capelle (la) & Masmolène La Capelle-Rte uzès côté étang Verre Masmolène Gabarit-Rte Flaux côté Capelle (la) & Masmolène Emballages stade Masmolène Gabarit-Rte Flaux côté Capelle (la) & Masmolène Papier stade Masmolène Gabarit-Rte Flaux côté Capelle (la) & Masmolène Verre stade Castillon Che des oliviers - près du cimetière Emballages Castillon Che des oliviers - près du cimetière Papier Castillon -

Magazine Offert Novembre 2018
38 exclusivités C i e c m s Magazine i Novembre o o i 106 s m biens c offert e 2018 i C 19 agences Beau terrain plat 89 000e Plat - Clôturé et tout à l’égout 99 000e Exclusivités Exclusivité Honoraires à la charge du vendeur Exclusivité Honoraires à la charge du vendeur Au nord d’Uzès, secteur St Laurent la Vernède, Terrain orienté Sud 1164 m² à 10 min. d’Uzès, en beau terrain plat et clôturé de 966 m². Viabilités bordure de village. Déjà clos sur 3 côtés, il dispose en bordure. Assainissement individuel. Etude d’un portail et de quelques beaux arbres. Vue sur de sol réalisée. Ref MIU 1196 le vieux village. Voir notre site. Ref MIU 1831 Présenté par Isabelle Brughera 06 18 21 92 85 Présenté par Eric et Véronique Roux 04 66 22 36 66 Au cœur du village de Collorgues 99 000e Résidence sécurisée avec piscine 112 800e Exclusivité Honoraires à la charge du vendeur Classe énergie NO Exclusivité Honoraires à la charge du vendeur Classe énergie D Maison de village de 200 m² utiles environ, à l’étage : séjour Uzès, appart. P3 ancien rénové de 43 m², 1er étage, cuisine + 4 chambres , en rdc : 80 m² de caves, joli terrasse très belle vue vers le Sud, parking, cave, et accès environ 20 m² + courette d’environ 25 m². Travaux à prévoir, piscine. Cuisine équipée, clim. Copropriété de 27 aucune nuisance, bonne exposition. Ref MIU 2501 lots, charges 80 €/mois. Voir site. Ref MIU 1849 Présenté par Johan Crave 06 27 12 90 45 Présenté par Eric et Véronique Roux 04 66 22 36 66 Uzès tous commerces 113 000e Un pied à terre à Lussan… 139 000e Made in Uzès Exclusivité Honoraires à la charge du vendeur Classe énergie D Exclusivité Honoraires à la charge du vendeur Classe énergie E Résidence avec ascenseur et parking privatif. -

Prefecture Du Gard
Nîmes, Vendredi 21 novembre 2014 Viticulture Dépôt des dossiers de demandes d’aides avant le 16 janvier 2015 pour les viticulteurs gardois touchés par les orages de grêle du 20 juillet 2014 Le Ministère de l’agriculture a mis en place deux mesures d’allégement des charges financières en faveur des viticulteurs des communes(1) listées dans l’arrêté préfectoral régional du 2 septembre 2014 autorisant l’achat de vendange fraîche. Ces allègements de charges prennent la forme de : prêts de trésorerie de 10 000 à 50 000 € avec prise en charge d’une partie des intérêts d’emprunts ; prise en charge partielle d’intérêts d’emprunts de l’annuité 2014 des prêts professionnels à long et moyen terme ; Le cofinancement de ces deux mesures est assuré par l’État, le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon et le Conseil Général du Gard. Pour pouvoir bénéficier de ces mesures, les viticulteurs concernés doivent notamment : l Être spécialisés dans la production viticole à hauteur de 70 % de leur chiffre d’affaires ; l Avoir subi suite à la grêle au moins 30 % de perte de récolte par rapport à la moyenne des 5 dernières années ; l Et s’engager à souscrire un contrat d’assurance multirisques climatiques en 2015. Où et quand déposer les dossiers de demandes d’aides ? Avant le 9 janvier 2015 : réalisation des prêts de trésorerie Avant le 16 janvier 2015 : dépôts des dossiers de demande d’aide à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard (DDTM 30) Toutes les infos, les formulaires de demandes d’aides, les modalités et les critères d’éligibilités -

Planning Ressourcerie Mobile 2021
PLANNING RESSOURCERIE MOBILE 2021 passage le lundi de 9h à 13h JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN 1 vendredi 1 lundi CAMPESTRE 1 lundi ALZON 1 jeudi 1 samedi 1 mardi 2 samedi 2 mardi 2 mardi 2 vendredi 2 dimanche 2 mercredi 22 3 dimanche 3 mercredi 5 3 mercredi 9 3 samedi 3 lundi ALZON 3 jeudi 4 lundi ALZON 4 jeudi 4 jeudi 4 dimanche 4 mardi 4 vendredi 5 mardi 5 vendredi 5 vendredi 5 lundi 5 mercredi 18 5 samedi 6 mercredi 1 6 samedi 6 samedi 6 mardi 6 jeudi 6 dimanche 7 jeudi 7 dimanche 7 dimanche 7 mercredi 14 7 vendredi 7 lundi ALZON ARRIGAS ROGUES 8 vendredi 8 lundi Aumessas 8 lundi Montdardier 8 jeudi 8 samedi 8 mardi 9 samedi 9 mardi 9 mardi 9 vendredi 9 dimanche 9 mercredi 23 6 10 ROGUES 10 dimanche 10 mercredi 10 mercredi 10 samedi 10 lundi Montdardier 10 jeudi ROGUES 11 lundi Montdardier 11 jeudi 11 jeudi 11 dimanche 11 mardi 11 vendredi ARRIGAS 19 12 mardi 12 vendredi 12 vendredi 12 lundi Aumessas 12 mercredi 12 samedi 13 mercredi 2 13 samedi 13 samedi 13 mardi 13 jeudi 13 dimanche 14 jeudi 14 dimanche 14 dimanche 14 mercredi 15 14 vendredi 14 lundi CAMPESTRE 15 vendredi 15 lundi 15 lundi VISSEC 15 jeudi 15 samedi 15 mardi 16 samedi 16 mardi 16 mardi 16 vendredi 16 dimanche 16 mercredi 24 17 dimanche 17 mercredi 7 17 mercredi 11 17 samedi 17 lundi VISSEC 17 jeudi 18 lundi VISSEC 18 jeudi 18 jeudi 18 dimanche 18 mardi 18 vendredi ST BRESSON 20 19 mardi 19 vendredi 19 vendredi 19 lundi Roquedur 19 mercredi 19 samedi 20 mercredi 3 20 samedi 20 samedi 20 mardi 20 jeudi 20 dimanche 16 ARRIGAS 21 jeudi 21 dimanche 21 dimanche 21 -

Enfant a L'ecole Elementaire
S.I.R.P. du Coutach - 48 place des arènes - 30260 QUISSAC Communes de Bragassargues, Gailhan, Liouc, Orthoux-Sérignac-Quilhan, Quissac et Sardan ENFANT A L’ECOLE ELEMENTAIRE - INSCRIPTIONS ALAE, RESTAURANT SCOLAIRE, NAP ET ETUDE 2015/2016 ENFANT Nom :………………………………… Prénom :……………………………… Garçon / Fille (entourez) Date de naissance : ____ ____ _______ Classe : ……… Bonjour, dans un souci de faciliter l’inscription de votre enfant au service périscolaire, vous pouvez dès à présent choisir l’une des 3 possibilités d’inscriptions (soit sur toute l’année scolaire, soit par période ou soit par mois). Si vous souhaitez faire des modifications concernant l’inscription de votre enfant, vous devrez prendre contact avec le SIRP dans les délais impartis (Cf. règlement intérieur périscolaire). Attention, pour cette nouvelle année, les horaires de l’école, de l’ALAE, des NAP et de l’étude surveillée évoluent, c’est une nouvelle organisation. Les heures changent entre les élèves de l’école maternelle et les élèves de l’école élémentaire. Les NAP seront les mardis et les vendredis, soit 2 fois 1h30 (au lieu de 4 fois une heure l’année dernière). Les places sont limitées en fonction de la capacité d’accueil déclarée et du nombre total d’inscrits. Les inscriptions seront validées dans la limite des places disponibles. Vous recevrez par email des informations durant l’année sur les projets d’animation, les activités, les menus, les dates importantes… Important : la facture est adressée aux familles en fin de mois par le SIRP. Le paiement s’effectue au Trésor Public, sur présentation des factures (ALAE et/ou restaurant scolaire et/ou NAP et/ou étude) dès réception de cette dernière ou sur Internet sur tipi.budget.gouv.fr OBLIGATOIRE : AUTORISATION DE MISE EN LIAISON CAF PRO Madame, Monsieur, Nous tenons à vous informer que la Caf du Gard met à notre disposition un service Internet à caractère professionnel qui nous permet de consulter directement les seuls éléments de votre dossier d’allocations familiales nécessaires à l’exercice de notre mission. -
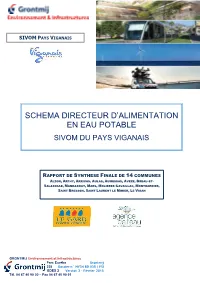
Rapport Synthèse SIVOM 27-01-15
SIVOM PAYS VIGANAIS SCHEMA DIRECTEUR D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE SIVOM DU PAYS VIGANAIS RAPPORT DE SYNTHESE FINALE DE 14 COMMUNES ALZON , ARPHY , ARRIGAS , AULAS , AUMESSAS , AVEZE , BREAU -ET - SALAGOSSE , MANDAGOUT , MARS , MOLIERES -CAVAILLAC , MONTDARDIER , SAINT BRESSON , SAINT LAURENT LE MINIER , LE VIGAN GRONTMIJ Environnement et Infrastructures Immeuble le Génésis – Parc Euréka Grontmij 97 rue de Freyr – CS 36038 Dossier n° HY34 BD 038 / FSI 34060 MONTPELLIER CEDEX 2 Version 2 – Février 2015 Tél. 04 67 40 90 00 – Fax 04 67 40 90 01 SIVOM du Pays Viganais Schéma directeur d’alimentation en eau potable Rapport de Synthèse Dossier GEI HY34 BD 038 /FSI – Février 2015 SIVOM du Pays Viganais Schéma directeur d’alimentation en eau potable Rapport de Synthèse SCHEMA DIRECTEUR D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE RAPPORT SYNTHESE N° de Date Rédigé par Validé par Modification Version HD34 B0038 Florent Rédaction du rapport de 26/01/2015 Nicolas LABBE Version 1 SIBENALER synthèse HD34 B0038 Florent Rédaction du rapport de 20/02/2015 Nicolas LABBE Version 2 SIBENALER synthèse GRONTMIJ Environnement et Infrastructures Immeuble le Génésis – Parc Euréka Grontmij 97 rue de Freyr – CS 36038 Dossier n° HY34 BD 038 / FSI 34060 MONTPELLIER CEDEX 2 Version 2 – Février 2015 Tél. 04 67 40Dossier 90 00 –GEI Fax HY34 04 67 BD 40 038 90 /FSI 01 – Février 2015 SIVOM du Pays Viganais Schéma directeur d’alimentation en eau potable Rapport de Synthèse Dossier GEI HY34 BD 038 /FSI – Février 2015 SIVOM du Pays Viganais Schéma directeur d’alimentation en eau potable Rapport de Synthèse Sommaire Introduction .................................................................................... 1 A. -

Balade Au Fil Du Temps
BERNADETTE VOISIN-ESCOFFIER MICHEL VOISIN VALLABRIX BALADE AU FIL DU TEMPS Guide pour promeneur COURADOU Décembre 2018 1 Bernadette Voisin-Escoffier 2018 LE REBOUSSIER, (LE NÎMOIS) MARQUÉ PAR LE POIDS DES INVASIONS ET LES INTERMINABLES GUERRES DE RELIGION, TIRE DU GREC SA SUBTILITÉ, DE L’ORIENTAL SA LANGUEUR, DU LATIN SON ÉQUILIBRE… » ( – Gazette de Nîmes 836) Sommaire : Avant-propos - P 13 Origine probable du nom de « Vallabrix » - P 17 Charles Martel, les Sarrasins et Vallabrix - P 20 Les Carrières - P 26 La citadelle et le château - P 39 La Tranchée - P 42 La Guerre de Cent Ans - P 48 Mathieu de Bargeton - P 53 L’Eglise - P 66 Le Presbytère - P 75 La Maison Ronde ou la première école et mairie - P 81 La Mairie actuelle et l’école de la République - P 87 La Façade Renaissance - P 102 La Fontaine- le Lavoir- la Canalette - P 110 Le Brigand de Valabris - P 115 Une école bien particulière - P 117 Un bien fâcheux évènement - P 118 quelques photos escalier du clocher, horloge 2 Bernadette Voisin-Escoffier 2018 Page blanche, passer à la suivante 3 Bernadette Voisin-Escoffier 2018 AVANT-PROPOS Les textes qui vont suivre sont une somme d’informations glanées depuis une dizaine d’années au cours des travaux historiques des auteurs. Ces écrits serviront à faire un voyage à pied au cœur de Vallabrix, pour le visiteur ou pour les guides occasionnels. Ceux-ci pourront picorer de ci de là dans ces pages, selon la durée de la promenade et des centres d’intérêt(s) des visiteurs. Dans chaque chapitre, des annexes, des informations pour répondre aux questions éventuelles qui ne manquent pas d’être posées par les visiteurs (chronologie, personnages du moment évoqués etc…).