Le Cas De Quelques Communes Du Sud Luxembourg Belge
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
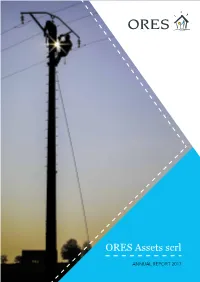
ORES Assets Scrl
ORES Assets scrl ANNUAL REPORT 2017 1 TABLE OF ORES Assets scrl ANNUAL REPORT 2017 CONTENTS I. Introductory message from the Chairman of the Board of Directors and the Chief Executive Officer p.4 II. ORES Assets consolidated management report p.6 Activity report and non-financial information p.6 True and fair view of the development of business, profits/losses and financial situation of the Group p.36 III. Annual financial statements p.54 Balance sheet p.54 Balance sheet by sector p.56 Profit and loss statement p.60 Profit and loss statement by sector p.61 Allocations and deductions p.69 Appendices p.70 List of contractors p.87 Valuation rules p.92 IV. Profit distribution p.96 V. Auditor’s report p.100 VI. ORES scrl - ORES Assets consolidated Name and form ORES. cooperative company with limited liability salaries report p.110 VII. Specific report on equity investments p.128 Registered office Avenue Jean Monnet 2, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium. VIII. Appendix 1 point 1 – List of shareholders updated on 31 December 2017 p.129 Incorporation Certificate of incorporation published in the appen- dix of the Moniteur belge [Belgian Official Journal] on 10 January 2014 under number 14012014. Memorandum and articles of association and their modifications The memorandum and articles of association were modified for the last time on 22 June 2017 and published in the appendix of the Moniteur belge on 18 July 2017 under number 2017-07-18/0104150. 2 3 networks. However, it also determining a strategy essen- Supported by a suitable training path, the setting up of a tially hinged around energy transition; several of our major "new world of work" within the company should also pro- business programmes and plans are in effect conducted to mote the creativity, agility and efficiency of all ORES’ active succeed in this challenge with the public authorities, other forces. -

Planning Nmaw 2020 - 2024
PLANNING NMAW 2020 - 2024 BEAUVECHAIN BASSENGE COMINES-WARNETON FLOBECQ GREZ-DOICEAU HELECINE VISE MOUSCRON MONT-DE-L'ENCLUS LA HULPE PLOMBIERES LA CALAMINE JODOIGNE OREYE OUPEYE DALHEM ELLEZELLES RIXENSART LINCENT JUPRELLE LESSINES WAVRE CRISNEE ESTAIMPUIS AUBEL CELLES WATERLOO BERLOZ WAREMME AWANS ORP-JAUCHE PECQ TUBIZE INCOURT REMICOURT HERSTAL LONTZEN FRASNES-LEZ-ANVAING ENGHIEN LASNE BLEGNY BRAINE-LE-CHATEAU CHAUMONT-GISTOUX ANS RAEREN REBECQ GEER THIMISTER-CLERMONT WELKENRAEDT OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE HANNUT FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER RAMILLIES HERVE BRAINE-L'ALLEUD DONCEEL ATH SILLY FAIMES SOUMAGNE ITTRE GRACE-HOLLOGNE MONT-SAINT-GUIBERT PERWEZ SAINT-NICOLAS LIEGE BEYNE-HEUSAY TOURNAI COURT-SAINT-ETIENNE WALHAIN WASSEIGES FLERON DISON LIMBOURG EUPEN BRAINE-LE-COMTE BRAIVES GENAPPE VERLAINE BRUGELETTE SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE OLNE LEUZE-EN-HAINAUT NIVELLES FLEMALLE VILLERS-LE-BOUILLET SERAING VERVIERS BAELEN EGHEZEE BURDINNE CHAUDFONTAINE CHASTRE PEPINSTER CHIEVRES LENS SOIGNIES TROOZ ANTOING ECAUSSINNES VILLERS-LA-VILLE ENGIS AMAY GEMBLOUX FERNELMONT WANZE RUMES SENEFFE NEUPRE HERON ESNEUX JALHAY BRUNEHAUT PERUWELZ BELOEIL JURBISE LES BONS VILLERS LA BRUYERE SPRIMONT HUY SOMBREFFE NANDRIN THEUX PONT-A-CELLES LE ROEULX SAINT-GHISLAIN MANAGE ANDENNE ANTHISNES FLEURUS COMBLAIN-AU-PONT TINLOT SPA BERNISSART MODAVE WAIMES LA LOUVIERE COURCELLES MARCHIN BUTGENBACH AYWAILLE CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT JEMEPPE-SUR-SAMBRE NAMUR MONS MORLANWELZ SAMBREVILLE OUFFET MALMEDY QUAREGNON HAMOIR HENSIES FARCIENNES FLOREFFE OHEY BOUSSU GESVES STAVELOT CHARLEROI -

ZONE DE POLICE DE GAUME Chiny, Etalle, Florenville, Meix-Devant-Virton, Rouvroy, Tintigny, Virton
Confidentiel Respect, Solidarité, Esprit de service ZONE DE POLICE DE GAUME Chiny, Etalle, Florenville, Meix-devant-Virton, Rouvroy, Tintigny, Virton FORMULAIRE DE DEMANDE DE SURVEILLANCE HABITATION EN CAS D’ABSENCE La surveillance des habitations est un service totalement gratuit, offert par la Zone de Police de Gaume. Chaque citoyen résidant sur ce territoire, a le droit d’en faire la demande. Bien que toute information sur votre absence nous soit utile en termes de prévention, nous ne garantissons pas une surveillance en dessous d’une absence de 5 jours et au-delà d’un mois. Nom : Prénom : Date de naissance : Adresse : Code Postal : Localité : Téléphone / GSM : Adresse mail : Type d’habitation : Autres endroits à surveiller (Magasin, hangar, atelier, abri de jardin…) : Date et heure de départ : vers heures Date et heure de retour : vers heures Possibilité de contact (adresse de votre destination et/ou numéro de téléphone) : Personne de contact (Nom et prénom) : Adresse : Code Postal : Localité : Téléphone : Dispose des clefs de la maison : OUI NON Dispose du code alarme : OUI NON Véhicule(s) dans le garage ou devant la maison : Description(s) : Installation d’un système d’alarme : OUI NON Modèle : Installateur : Minuterie à l’intérieur de l’habitation (déclenchant un éclairage) : OUI NON programmée à : Eclairage de sécurité ou éclairage dissuasif à l’extérieur : OUI NON Chien de garde ou autres animaux : OUI NON Caractéristiques : Je souhaite le passage à mon domicile du conseiller en prévention vol de la zone de Police : OUI NON Autres mesures de prévention ou de sécurité (gardes privés, objets de valeur enregistrés, coffres forts préalablement vidés, serrure supplémentaire à la porte extérieure, personne (voisin) pour tondre la pelouse ou relever le courrier ou soigner les animaux) : 1 DECLARATION DU DEMANDEUR Par ce formulaire, je souhaite obtenir une surveillance policière de mon habitation durant la période indiquée. -

Using Geographically Weighted Poisson Regression to Examine the Association Between Socioeconomic Factors and Hysterectomy Incidence in Wallonia, Belgium
Using Geographically Weighted Poisson Regression to Examine the Association Between Socioeconomic Factors and Hysterectomy Incidence in Wallonia, Belgium Aline Clara Poliart ( [email protected] ) ULB École de Santé Publique: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique https://orcid.org/0000-0003-1510-0648 Fati Kirakoya-Samadoulougou ULB École de Santé Publique: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Mady Ouédraogo ULB School of Public Health: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Philippe Collart ESP ULB: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Dominique Dubourg ESP ULB: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Sékou Samadoulougou ESP ULB: Universite Libre de Bruxelles Ecole de Sante Publique Research article Keywords: geographically weighted Poisson regression, Wallonia, hysterectomy, socioeconomic factors Posted Date: May 11th, 2021 DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-505108/v1 License: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Read Full License 1 Using geographically weighted Poisson regression to examine the 2 association between socioeconomic factors and hysterectomy 3 incidence in Wallonia, Belgium 4 Aline Poliart1, Fati Kirakoya-Samadoulougou1, Mady Ouédraogo1, Philippe Collart1,2, Dominique 5 Dubourg2, Sékou Samadoulougou 3,4 6 1 Centre de Recherche en Epidémiologie, Biostatistiques et Recherche Clinique, Ecole de Santé 7 Publique, Université Libre de Bruxelles, 1070 Brussels, Belgium; [email protected] (AP); 8 [email protected] (MO); [email protected] (PC) ; [email protected] (FKS) 9 2 Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ), 6061 Charleroi, Belgium ; [email protected] 10 (PC), [email protected] (DD) 11 3 Evaluation Platform on Obesity Prevention, Quebec Heart and Lung Institute, Quebec, QC, G1V 12 4G5, Canada; [email protected] (SS). -

Linkebeek 1.160
Indicateurs géographiques (basés sur le CENSUS 2011) La date de référence du census est le 01/01/2011. -

Liste PDF De Toutes Les Entreprises
Entreprises implantées sur les parcs d’activités économiques d’IDELUX 3F AUTO SERVICE Activités : Carrosserie, mécanique générale, reprogrammation AUBANGE - PED - LES 2 LUXEMBOURG Rue des 2 Luxembourg, 2 6791 ATHUS Nombre d'emplois : 2 4DIGITALES Activités : Agence publicitaire (graphismes, lettrages, enseignes), atelier de céramique, création de santons WELLIN Rue de Wellin, 38 6922 WELLIN Nombre d'emplois : 1 A.R.T.WORKS Activités : Entretien de grues de toitures LIBIN - LE CERISIER Z.I. Le Cerisier, 1 6890 LIBIN Nombre d'emplois : 2 AAC Activités : Import/Export de voitures ARLON - WEYLER Rue Claude Berg, 44 6700 ARLON Nombre d'emplois : 1 AAK BASTOGNE Activités : Centre de production de phospholipides extraits d##ufs BASTOGNE 1 Rue de la Fagne d#Hi, 43 6600 BASTOGNE Entreprises implantées sur les parcs d’activités économiques d’IDELUX ABRAHAM BENELUX Activités : Fabrication de salaisons LIBRAMONT - RECOGNE Rue de Saint-Hubert, 18 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY Nombre d'emplois : 14 ABSA ÉNERGIES Activités : Installations de chauffage, de sanitaire et d'électricité avec application des énergies renouvelables WELLIN Rue Jean Meunier, 1 6922 WELLIN Nombre d'emplois : 4 ACRC (ADAM CAR REPAIR CENTER) Activités : Atelier de carrosserie ARLON - WEYLER Rue Claude Berg, 28 bte 2 6700 ARLON Nombre d'emplois : 9 ADAM ET MENTEN Activités : Agence en douane AUBANGE - PED Rue du Terminal, 7 6791 ATHUS Nombre d'emplois : 2 ADAM RENÉ Activités : Pose caveaux, monuments funéraires DURBUY - BARVAUX Rue de l'industrie, 23 6940 BARVAUX-SUR-OURTHE Nombre d'emplois -

Programme Communal De Développement Rural D'étalle
Province de Luxembourg Commune d’Étalle PARTIE I Programme Communal de Développement Rural d’Étalle PARTIE I ANALYSE DES CARACTERISTIQUES DE LA COMMUNE D’ÉTALLE PCDR d’Étalle – Partie 1 – Analyse des caractéristiques de la commune d’Étalle Table des matières TERRITOIRE POLITIQUE ............................................................................................................ 6 DESCRIPTION & ANALYSE ................................................................................................................... 8 1. Géographie administrative et typologie ............................................................................. 8 a. Arrondissement ........................................................................................................................................... 8 b. Communes avoisinantes ............................................................................................................................ 11 c. Outils de développement des communes avoisinantes ............................................................................. 13 d. Appartenance typologique ........................................................................................................................ 14 2. Histoire .............................................................................................................................. 18 3. Commune .......................................................................................................................... 19 a. Instances politiques .................................................................................................................................. -

Les Entreprises Que Nous Avons Accompagnées (Au 31/12/2019)
2 Les entreprises que nous avons accompagnées (au 31/12/2019) Société Activité Localité LD LDE LDE2 ANQUETY Entretien, réparation et Gouvy x MOTORSPORT SPRL commerce de détail de motocycles APPTREE SPRL Développement de solutions Marche-en-Famenne x mobiles ARDENNE CONTAINER SPRL Récolte et traitement de déchets Gouvy x ARDENNE VOLAILLE SCRL Abattage de volailles Bertrix x ARDENNES SPRL Façonnage et commercialisation Vielsalm x de pierres à aiguiser x ARDENNES TOYS SA Fabrication de jeux et de jouets Fauvillers x x ARDENNES TRUCKS Commercialisation et Neufchâteau x EQUIPMENTS SPRL maintenance/réparation de poids lourds ATB THERAPEUTICS SRL Production de protéines Marche-en-Famenne x recombinantes BATIFER SPRL Construction générale Transinne x x BATISSEURS.BE SPRL Construction générale Saint-Léger x BE-HEMP SA Défibrage de chanvre Marche-en-Famenne x BELDICO SA Fabrication de disposables Marche-en-Famenne x médicaux BIO-SOURCING SA Plateforme de production de Marche-en-Famenne x molécules pour santé animale B.N.S. SPRL Études de sol Habay x BRASSERIE ATRIUM SA Micro-brasserie Marche-en-Famenne x x BRASSERIE D’EBLY SA Micro-brasserie Léglise x BRASSERIE GENGOULF SCRL Micro-brasserie Florenville x CADRALU SPRL Fabrication de menuiseries en Marche-en-Famenne x aluminium CENTRE ATIS SA Développement d’un réseau Saint-Hubert x social interentreprises x CINEXTRA SPRL Cinéma Bastogne x CLITEUR SPRL Distribution de souvenirs et Manhay x articles religieux CUISICENTER SA Cuisiniste pour promoteurs Marche-en-Famenne x immobiliers DEFROIDMONT, ARTISAN -

Registres Paroissiaux. Province Du Luxembourg. Arrondissements Arlon Et Neufchâteau
BE-A0521_711846_711278_FRE Inventaire des registres paroissiaux. Province du Luxembourg. Arrondissements Arlon et Neufchâteau. (digital) Het Rijksarchief in België Archives de l'État en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written in French. 2 Registres paroissiaux. Province du Luxembourg. Arrondissements Arlon et Neufchâteau. (digital) DESCRIPTION DU FONDS D'ARCHIVES:..............................................................37 DESCRIPTION DES SÉRIES ET DES ÉLÉMENTS.......................................................39 Aix-sur-Cloie (Aubange), paroisse Saint Michel..............................................39 Registres Paroissiaux. Actes.................................................................................39 Registres Paroissiaux. Actes mélangés.............................................................39 Registres Paroissiaux. Actes de baptêmes............................................................42 Registres Paroissiaux. Actes de baptêmes........................................................42 Registres Paroissiaux. Actes de décès / sépultures...............................................46 Registres Paroissiaux. Actes de décès / sépultures...........................................46 Registres Paroissiaux. Actes de mariages.............................................................48 Registres Paroissiaux. Actes de mariages.........................................................48 Registres Paroissiaux. Extra..................................................................................52 -

EN PROVINCE DE LUXEMBOURG 14 OPÉRATEURS De Formation Pour
Se former autrement Province de Liège Les Centres d’Insertion SocioProfessionnelle accompagnent des adultes faiblement scolarisés et demandeurs d’emploi Durbuy dans leurs apprentissages. Privilégiant une approche glo- Barvaux bale et personnalisée, les CISP permettent à chacun-e d’éla- borer son parcours d’orientation et d’insertion. En Wallonie, le secteur compte 157 opérateurs de formation agréés. En Province de Luxembourg, 14 centres épaulent, Hotton Vielsalm chaque année, quelque 1150 adultes* en formation et em- Bourdon ploient 152 travailleurs*. Le dénominateur commun aux CISP est le travail de formation Province de Namur Marche-en-Famenne déployé avec le stagiaire. Ce dernier est acteur de son projet. La finalité est plus large que le «simple» apprentissage Marloie du français, de la restauration, de la vente… . Le stagiaire travaille les différents champs (personnel, familial, social, économique, professionnel…), à son rythme, de manière à, progressivement, concrétiser son projet. Il apprend à iden- tifier ses ressources et compétences, à imaginer, à créer, à poser des choix, à apprendre autrement. Sainte-Ode Saint-Hubert Bastogne • Chiffres 2015 Les CISP sont régis par le décret du Gouvernement wallon adopté le 10 juillet 2013 Libramont-Chevigny Grand-Duché de Luxembourg EN PROVINCE DE LUXEMBOURG Paliseul Bertrix Neufchâteau Bouillon Lieu d’information sur l’offre de formation pour adultes 14 OPÉRATEURS de formation CEFO Marche Habay-la-Neuve Rue Victor Libert 1 Chiny Habay-la-Vieille 6900 Marche-en-Famenne pour ACCOMPAGNER Florenville -

PMG De BASTOGNE PMG De ARLON PMG De LIBRAMONT
PMG de PMG de PMG de PMG de PMG de PMG de PMG de RGN BASTOGNE ARLON LIBRAMONT TINTIGNY MARCHE BIEVRE DINANT NAMUR Adresse Chaussée Rue des déportés, Avenue Rue de France, 11 Avenue de Rue de la gare, 5 Rue Saint- Rue d’Houffalize, 1bis 137 d’Houffalize, 41 France, 6 Jacques, 500 Bourtonbourg, 6 Ville 6600 Bastogne 6700 Arlon 6800 Libramont 6730 Tintigny 6900 Marche 5555 Bièvre 5500 Dinant 5500 Namur Tel 1733 1733 1733 1733 1733 1733 1733 081/73.48.74 GSM Email Coordinateur.pmg@ Coordinateur.pmg@ Coordinateur.pmg@ Coordinateur.pmg@ Coordinateur.pmg@ Coordinateur.pmg@ Coordinateur.pmg@ gmail.com gmail.com gmail.com gmail.com gmail.com gmail.com gmail.com Contact Philippe Philippe Philippe Philippe Philippe Philippe Philippe Dominique Vanderlooven Vanderlooven Vanderlooven Vanderlooven Vanderlooven Vanderlooven Vanderlooven Henrion Tel 063/330.040 063/330.040 063/330.040 063/330.040 063/330.040 063/330.040 063/330.040 GSM 0479/680.750 0479/680.750 0479/680.750 0479/680.750 0479/680.750 0479/680.750 0479/680.750 0495/50.14.70 Email Coordinateur.pmg@ Coordinateur.pmg@ Coordinateur.pmg@ Coordinateur.pmg@ Coordinateur.pmg@ Coordinateur.pmg@ Coordinateur.pmg@ Domihenrion gmail.com gmail.com gmail.com gmail.com gmail.com gmail.com gmail.com @hotmail.com Fonction Coordinateur Coordinateur Coordinateur Coordinateur Coordinateur Coordinateur Coordinateur Vice-Président Zone Bastogne, Fauvillers, Arlon, Attert, Libramont, Saint- Florenville, Tintigny, Marche, Nassogne, Beauraing, Gedinne, Dinant, Hastière, Essentiellement le Vaux-Sur-Sure, Saint- -

(Tintigny). Dépôt 2011
BE-A0521_712672_712980_FRE Inventaire des archives de la commune de Tintigny. Dépôt 2011, 1806-1977 (1996) Het Rijksarchief in België Archives de l'État en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written in French. 2 Commune de Tintigny (Tintigny). Dépôt 2011 DESCRIPTION DU FONDS D'ARCHIVES:................................................................9 Consultation et utilisation..............................................................................10 Conditions d'accès.....................................................................................10 Conditions de reproduction........................................................................10 Histoire du producteur et des archives..........................................................11 Producteur d'archives................................................................................11 Nom........................................................................................................11 Historique...............................................................................................11 Compétences et activités.......................................................................12 Organisation...........................................................................................13 Archives.....................................................................................................13 Historique...............................................................................................13