Histoire Des Groupes Francs (MUR)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Special Operations Executive - Wikipedia
12/23/2018 Special Operations Executive - Wikipedia Special Operations Executive The Special Operations Executive (SOE) was a British World War II Special Operations Executive organisation. It was officially formed on 22 July 1940 under Minister of Economic Warfare Hugh Dalton, from the amalgamation of three existing Active 22 July 1940 – 15 secret organisations. Its purpose was to conduct espionage, sabotage and January 1946 reconnaissance in occupied Europe (and later, also in occupied Southeast Asia) Country United against the Axis powers, and to aid local resistance movements. Kingdom Allegiance Allies One of the organisations from which SOE was created was also involved in the formation of the Auxiliary Units, a top secret "stay-behind" resistance Role Espionage; organisation, which would have been activated in the event of a German irregular warfare invasion of Britain. (especially sabotage and Few people were aware of SOE's existence. Those who were part of it or liaised raiding operations); with it are sometimes referred to as the "Baker Street Irregulars", after the special location of its London headquarters. It was also known as "Churchill's Secret reconnaissance. Army" or the "Ministry of Ungentlemanly Warfare". Its various branches, and Size Approximately sometimes the organisation as a whole, were concealed for security purposes 13,000 behind names such as the "Joint Technical Board" or the "Inter-Service Nickname(s) The Baker Street Research Bureau", or fictitious branches of the Air Ministry, Admiralty or War Irregulars Office. Churchill's Secret SOE operated in all territories occupied or attacked by the Axis forces, except Army where demarcation lines were agreed with Britain's principal Allies (the United Ministry of States and the Soviet Union). -
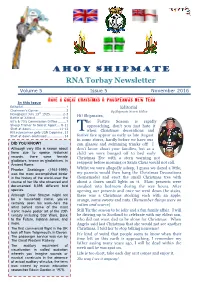
Ahoy Shipmate RNA Torbay Newsletter Volume 5 Issue 5 November 2016 Have a Great Christmas & Prosperous New Year in This Issue Editorial
Ahoy Shipmate RNA Torbay Newsletter Volume 5 Issue 5 November 2016 Have a great Christmas & Prosperous New Year In this issue Editorial ...................................... 1 Editorial Chairman’s Corner ........................ 2 By Shipmate Norrie Millen th Newspaper July 13 1925 ........... 2-3 Hi! Shipmates, Battle of Jutland ........................ 4-6 60’s & 70’s Commission Ditties ....... 7 he Festive Season is rapidly Sheep Framer to Secret Agent ... 8-11 approaching, don’t you just hate it Shot at dawn... ......................11-12 when Christmas decorations and RN submariner gets USN Dolphins . 13 T Shot at dawn continued ............... 14 festive fare appear as early as late August in some stores, hardly before we have our DID YOU KNOW? sun glasses and swimming trunks off! I Although very little is known about don’t know about your families, but as a them due to sparse historical child we were bunged off to bed early records, there were female Christmas Eve with a stern warning not gladiators, known as gladiatrices, in reappear before morning or Santa Claus would not call. Ancient Rome. Phoebe Snetsinger (1931-1999) Whilst we were allegedly asleep, I guess we dozed a little; was the most accomplished birder my parents would then hang the Christmas Decorations in the history of the world–over the (homemade) and erect the small Christmas tree with course of her life she observed and about a dozen small lights on it. Main presents were documented 8,398 different bird sneaked into bedroom during the wee hours. After species. opening our presents and once we went down the stairs, Although Drew Struzan might not there was a Christmas stocking each with an apple, be a household name, you’ve orange, some sweets and nuts. -

Women in a Man's War: the Employment of Female Agents in the Special Operations Executive, 1940-1946
Chapman University Chapman University Digital Commons War and Society (MA) Theses Dissertations and Theses Spring 5-2019 Women in a Man's War: The Employment of Female Agents in the Special Operations Executive, 1940-1946 Cameron Carlomagno Chapman University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.chapman.edu/war_and_society_theses Recommended Citation Carlomagno, Cameron. Women in a Man's War: The Employment of Female Agents in the Special Operations Executive, 1940-1946. 2019. Chapman University, MA Thesis. Chapman University Digital Commons, https://doi.org/10.36837/chapman.000075 This Thesis is brought to you for free and open access by the Dissertations and Theses at Chapman University Digital Commons. It has been accepted for inclusion in War and Society (MA) Theses by an authorized administrator of Chapman University Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. Women in a Man’s War: The Employment of Female Agents in the Special Operations Executive, 1940-1946 A Thesis by Cameron Davis Carlomagno Chapman University Orange, California Wilkinson College of Arts, Humanities, and Social Sciences Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Masters of Arts in War and Society May 2019 Committee in charge: Jennifer Keene, Ph.D., Chair Charissa Threat, Ph.D. Kathryn Statler, Ph.D. This thesis of Cameron Davis Carlomagno is approved. April 2019 Women in a Man’s War: The Employment of Female Agents in the Special Operations Executive, 1940-1946 Copyright © 2019 by Cameron Davis Carlomagno iii ACKNOWLEDGEMENTS This thesis has been the culmination of a few years of thought, research, and discussion, all of which would not have been possible without the support of my dedicated professors and friends. -

Le Pionnier Du Vercors Nouvelle Serie (N°1, Decembre 1972)
SOMMAIRE DES BULLETINS LE PIONNIER DU VERCORS NOUVELLE SERIE (N°1, DECEMBRE 1972) INVENTAIRE DES CONTENUS TRAITANT DE LA RESISTANCE EN VERCORS Etabli par Jean Jullien N° 1 décembre 1972 . Introduction à cette « reparution » du bulletin « Présentation du bulletin par la Commission » « Après une interruption de vingt-cinq ans (…) Le Pionnier du Vercors reparaît (…) ». Texte d’une page signé La commission du bulletin, p.2. Le texte présente de façon succincte mais précise comment le bulletin pourra être constitué, vivre et quel sera son rôle. Deux textes à propos du livre « Combattant du Vercors » « Le Vercors est une grande page d’histoire », Alain Le Ray, p. 3-4-5. Réaction critique au livre de Gilbert Joseph « Combattant du Vercors ». Reprise des grandes lignes des événements et point de vue de l’auteur de l’article en opposition au livre critiqué. « Justice doit être rendue aux combattants du Vercors et à leurs chefs », Pierre Tanant, p. 6. Réaction critique au livre de Gilbert Joseph. Article déjà paru dans « Peuple Libre » en opposition au livre critiqué. Décès, p.25-26. Michaud Henri. Chauve, docteur, Autrans. N° 2 avril 1973 . Décès, p. 25. Samuel Yvonne, épouse d’Eugène Samuel. Royer Georges. Da Silva Gilbert, ancien Pionnier. Blachier Henri, porte-drapeau. N° 3 juillet 1973 . François Huet « Notre chef : François Huet », Général M. Descour, p. 4. Biographie succincte et élogieuse. 1 . Odette Malossane Rubrique Pages d’histoire, pas de nom d’auteur, p. 26-27. Etty en Vercors puis en prison, puis en camp de concentration. La partie la plus importante porte sur le camp. -

'Passing Unnoticed in a French Crowd': the Passing Performances
National Identities ISSN: 1460-8944 (Print) 1469-9907 (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/cnid20 ‘Passing unnoticed in a French crowd’: The passing performances of British SOE agents in Occupied France Juliette Pattinson To cite this article: Juliette Pattinson (2010) ‘Passing unnoticed in a French crowd’: The passing performances of British SOE agents in Occupied France, National Identities, 12:3, 291-308, DOI: 10.1080/14608944.2010.500469 To link to this article: https://doi.org/10.1080/14608944.2010.500469 Published online: 06 Sep 2010. Submit your article to this journal Article views: 912 View related articles Citing articles: 1 View citing articles Full Terms & Conditions of access and use can be found at https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=cnid20 National Identities Vol. 12, No. 3, September 2010, 291Á308 ‘Passing unnoticed in a French crowd’: The passing performances of British SOE agents in Occupied France Juliette Pattinson* University of Strathclyde, UK This article examines the dissimulation, construction and assumption of national identities using as a case study male and female British agents who were infiltrated into Nazi-Occupied France during the Second World War. The British nationals recruited by the SOE’s F section had, as a result of their upbringing, developed a French ‘habitus’ (linguistic skills, mannerisms and knowledge of customs) that enabled them to conceal their British paramilitary identities and ‘pass’ as French civilians. The article examines the diverse ways in which individuals attempted to construct French identities linguistically (through accent and use of vocabulary, slang and swear words), visually (through their physical appearance and clothing) and performatively (by behaving in particular ways). -

HISTORY of WWII INFILTRATIONS INTO FRANCE-Rev62-06102013
Tentative of History of In/Exfiltrations into/from France during WWII from 1940 to 1945 (Parachutes, Plane & Sea Landings) Forewords This tentative of history of civilians and military agents (BCRA, Commandos, JEDBURGHS, OSS, SAS, SIS, SOE, SUSSEX/OSSEX, SUSSEX/BRISSEX & PROUST) infiltrated or exfiltrated during the WWII into France, by parachute, by plane landings and/or by sea landings. This document, which needs to be completed and corrected, has been prepared using the information available, not always reliable, on the following internet websites and books available: 1. The Order of the Liberation website : http://www.ordredelaliberation.fr/english/contenido1.php The Order of the Liberation is France's second national Order after the Legion of Honor, and was instituted by General De Gaulle, Leader of the "Français Libres" - the Free French movement - with Edict No. 7, signed in Brazzaville on November 16th, 1940. 2. History of Carpetbaggers (USAAF) partly available on Thomas Ensminger’s website addresses: ftp://www.801492.org/ (Need a user logging and password). It is not anymore possible to have access to this site since Thomas’ death on 03/05/2012. http://www.801492.org/MainMenu.htm http://www.801492.org/Air%20Crew/Crewz.htm I was informed that Thomas Ensminger passed away on the 03/05/2012. I like to underline the huge work performed as historian by Thomas to keep alive the memory the Carpetbaggers’ history and their famous B24 painted in black. RIP Thomas. The USAAF Carpetbagger's mission was that of delivering supplies and agents to resistance groups in the enemy occupied Western European nations. -

Dropzone Issue 2
VOLUME 4,ISSUE 2 THE DROPZONE SEPTEMBER 2006 INSIDE THIS ISSUE: WAR HEROINE, 93, GETS HER WINGS Pearl Witherington 1 AT LAST Flying Fortress 3 By John Harding Editorial 7 PEARL WITHERINGTON who was denied the Military Cross because she was a woman, sent back the MBE offered to her in recognition of her war- Obituary 8 time exploits in the SOE. Francis Cammaerts 9 A Resistance Story 10 Museum visitors 14 SPECIAL POINTS OF INTEREST: · Tom Reeves pays tribute to David Mace · Keith Taylor reviews the development of the B-17 Flying Fortress · Harold Watson recalls a mission to Denmark with a report from one of the recipients of the supplies Pearl Witherington as a young SOE operative Photo credits: Daily Telegraph During the war, the Nazis had placed a bounty of one million Francs on her head and a civilian honour was of no interest to a person who had com- manded 1,500 French resistance fighters. She was a real life Charlotte Gray* who risked all to serve her country and a small ceremony recently held *Charlotte Gray in France was a sign that it might never be too late to obtain a thank-you By Sebastian Faulks from ones country. A novel, set in Occupied Some 63 years after she had made what a parachute instructor called an France "almost recklessly low jump" from 300 feet into unfamiliar territory behind en- emy lines, she finally collected her parachute wings. Continued on page 2 PAGE 2 VOLUME 4,ISSUE 2 Pearl, now known as Pearl Cornioley, the Cornioley's long wait for her wings was over and widow of a resistance fighter she married after praised her outstanding bravery. -
SOE in France: an Account of the Work of the British Special Operations Executive in France: 1940–1944
ii SOE IN FRANCE WHITEHALL HISTORIES: GOVERNMENT OFFICIAL HISTORY SERIES ISSN: 1474-8398 The Government Official History series began in 1919 with wartime histories, and the peace- time series was inaugurated in 1966 by Harold Wilson. The aim of the series is to produce major histories in their own right, compiled by historians eminent in the field, who are afforded free access to all relevant material in the official archives. The Histories also provide a trusted secondary source for other historians and researchers while the official records are still closed under the 30-year rule laid down in the Public Records Act (PRA). The main criteria for selection of topics are that the histories should record important episodes or themes of British history while the official records can still be supplemented by the recollections of key players; and that they should be of general interest, and, preferably, involve the records of more than one government department. The United Kingdom and the European Community: Vol. I: The Rise and Fall of a National Strategy,1945–1963 Alan S. Milward Secret Flotillas Vol. I: Clandestine Sea Operations to Brittany,1940–1944 Vol. II: Clandestine Sea Operations in the Mediterranean,North Africa and the Adriatic,1940–1944 Sir Brooks Richards SOE in France M. R. D. Foot The Official History of the Falklands Campaign: Vol. I: The Origins of the Falklands Conflict Vol. II: The 1982 Falklands War and Its Aftermath Lawrence Freedman Defence Organisation since the War D. C. Watt SOE in France An Account of the Work of the British Special Operations Executive in France 1940–1944 M. -

Bulletin N°75, Nouvelle Série, Juin 1991
L PÎONNÎIQ DUVERCLI REVUE TRIMESTRIELLE DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES PIONNIERS ET COMBATTANTS VOLONTAIRES DU VERCORS N° 75 nouvelle série JUIN 1991 TRIMESTRIEL Revue trimestrielle de l'Association Nationale des Pionniers et « La différence entre un Combattant et un Combattant Volontaire, c'est que le Combattants Volontaires Combattant Volontaire ne se démobilise jamais. » du Vercors Reconnue d'utilité publique par décret du 19 juillet 1952 Maréchal KCENIG. (J.O. du 29 juillet 1952, page 7695) Siège social : VASSIEUX-EN-VERCORS (Drôme) Siège administratif : 26, rue Claude-Genin - 38100 GRENOBLE Tél. 76 54 44 95 - C. C. P. Grenoble 919-78 J COMITÉ DE RÉDACTION Le Président National Le Directeur de la Publication Anthelme CROIBIER-MUSCAT Lucien DASPRES Eugène CHAVANT dit " CLÉMENT " 1894-1969 Chef Civil du Maquis du Vercors Compagnon de la Libération PRÉSIDENT-FONDATEUR PRÉSIDENTS D'HONNEUR : SOMMAIRE N° 75 - Nouvelle série M. le Préfet de l'Isère Editorial 1 M. le Préfet de la Drôme Vie des sections 2 Général d'Armée Conseil d'administration du 4 juin 1991 5 Marcel DESCOUR (C.R.) Assemblée générale du 19 mai 1991 à Général de Corps d'Armée Vassieux : allocutions du Président, de Alain LE RAY (C.R.) M. le Préfet de la Drôme, motion, vote 6 Général de Corps d'Armée Compte rendu de l'assemblée générale 8 Roland COSTA DE BEAUREGARD (C.R.) Activités : Eugène SAMUEL (Jacques)t Voyage de la section de Grenoble - Colonel Louis BOUCHIERt Des Bavarois au Vercors 9 Le Chef de Corps du 6e B.C.A. Récits, témoignages : Les équipes d'urgence de Villard-de- VICE-PRÉSIDENT D'HONNEUR : Lans en juillet-août 1944 (suite) 11 Paul BRISAC Courrier des lecteurs 13 Informations 14 PRÉSIDENTS NATIONAUX HONORAIRES : Joies et peines 15 Abel DEMEURE Dons et soutiens 16 Georges RAVINET PRÉSIDENT NATIONAL : Georges FÉREYRE DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Photo de couverture : Paul JANSEN Le Mémorial de Saint-Nizier-du-Moucherotte. -

Expert's Statement Chatterley.Pdf
EXECUTIVE SUMMARY 1. Brief Description of item(s) Annotated Penguin paperback copy of D. H. Lawrence, Lady Chatterley’s Lover (LCL) in hand-stitched bag, with two folios of manuscript notes. Copy belonged to Sir Lawrence Byrne, Presiding Judge in the 1960 trial of LCL for obscenity. Annotations mainly by Dorothy Byrne, wife. Part of text block detached from spine; item otherwise in reasonable condition for its age. 2. Context Regina v Penguin Books took place at the Central Criminal Court, London, between 20 October and 2 November 1960. Penguin was accused of publishing an obscene article contrary to the 1959 Obscene Publications Act. D. H. Lawrence’s final novel, Lady Chatterley’s Lover, was first published in Florence in 1928 and Paris in 1929. It was not published unexpurgated in Britain for fear of prosecution. In 1960, Penguin decided to publish the unexpurgated work. Penguin’s chairman, Allen Lane, saw the publication as a test of the 1959 Act. The Act had been designed to protect literature while strengthening the law against pornography. Potentially obscene works had now to be considered in their entirety, and they could be defended in terms of their contribution to the public good. The trial attracted intense publicity. 35 defence witnesses (see Appendix 2) protested the book’s merit and refuted the prosecution’s suggestion that the work was no more than a string of sexual encounters between the two main characters. Penguin’s reputation as a publisher of high standing was also emphasised. The jury found Penguin not guilty. Within three months of publication, over three million copies of the book had been sold. -

View Their Women Agents, As Well As How The
Florida State University Libraries 2017 Setting Hollywood Ablaze: Remembering and Depicting Women Spies in Popular Media Haley McGuyre Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] McGuyre THE FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS & SCIENCES SETTING HOLLYWOOD ABLAZE: REMEMBERING AND DEPICTING WOMEN SPIES IN POPULAR MEDIA By HALEY McGUYRE A Thesis submitted to the Department of History in partial fulfillment of the requirements for graduation with Honors in the Major Degree Awarded: Spring, 2017 McGuyre The members of the Defense Committee approve the thesis of Haley McGuyre defended on April 24, 2017. Dr. G. Kun Piehler Thesis Director dec Outside Committee Member Dr. Charles Upchurch Committee Member McGuyre Acknowledgements This project began with a small idea brought hesitantly to several professors, all of whom very enthusiastically took me on. My research plans were early in their formation, and changed shape during the first few months of the process. My committee gave guidance and offered support in a variety of different ways. When this thesis was pushed a semester longer, they were very cooperative and understanding, as they were during the entire process. For all of this and more, I must first thank Dr. Kurt Piehler, Dr. Whitney Bendeck, and Dr. Charles Upchurch. I gained a fair amount of guidance through their research alone, and their personal advice provided the rest needed to finish this project. They gave me plenty of space to work at my own pace and their patience followed through, for which I am especially grateful. I also need to thank the Undergraduate Research Opportunities Program for giving me the experience and confidence to take on an Honors Thesis. -

The Polish Section of S.O.E. and Poland's 'Silent and Unseen' 1940 -1945
nd 2 INTERNATIONAL MILITARY HISTORY CONFERENCE The Polish Section of S.O.E. and Poland’s “Silent and Unseen” 1940-1945, “Cichociemni” - The Airborne Soldiers of the Polish Home Army A.K. THE POLISH SECTION OF S.O.E. AND POLAND’S ‘SILENT AND UNSEEN’ 1940 -1945 CONFERENCE PAPERS Saturday 11th June 2016 LONDON 2017 1 Conference date: Saturday 11th June 2016 Location: The Embassy of the Republic of Poland, London ISBN: 978-0-9957341-0-4 Conference Speakers: Dr Andrzej Suchcitz, Dr Paul Latawski, Dr Jeffrey Bines, Dr Bogdan Rowiński, Kris Havard, Colonel Mike Russell, General John Drewienkiewicz (DZ) Conference Executive Team: Dr Mark Stella-Sawicki MBE, Chris Januszewski, Michał Mazurek, Ines Czajczyńska Da Costa, Hanka Januszewska, Eugenia Maresch, Col Richard Ciąglinski Volume number: 01/2017 Editorial Advisory Board: Dr Mark Stella-Sawicki, Dr Andrzej Suchcitz, Dr Paul Latawski Published: 01 January 2017 The Polish Heritage Society UK relies on the generosity and support of our patrons, institutions, individual donors, charitable donations, charitable trusts, foundations and corporate or business partners. We are extremely grateful to our loyal supporters, http://www.polishheritage.co.uk/ Copyright MSS Consulting 2016, contact: [email protected] The Polish Heritage Society UK would like to thank The Embassy of the Republic of Poland for their generous support in the hosting of The Cicho Ciemni - Silent and Unseen Conference in 2016 and for all help rendered to make it possible. Unlimited and full text access to the Polish Heritage Society UK Conference Programmes is available on our official Internet website, http://www.polishheritage.co.uk/ 2 Table of Contents Foreword 4 Introduction - The Polish Section of S.O.E.