Autour D'une Création
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Grande Vente Aux Enchères Publiques D'affiches De
GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES D’AFFICHES DE CINÉMA À L’OMNIA MERCREDI 05 DÉCEMBRE 2018 à 18h30 200 lots d’affiches de collection mis en vente Sous le contrôle de Maître Bruno MARESCHAL, commissaire-priseur habilité EURL DEAUVILLE ENCHERES (agrément 056-2014) Siège social : 16, rue du Général Leclerc - 14800 DEAUVILLE - Tél : 02 31 88 42 91 - [email protected] ENTRÉE LIBRE (SALLE N°2 DE L’OMNIA) Paiement des lots d’affiches sur place (+ 22% TTC frais vente acheteurs en sus) Estimations en € "INDIANA JONES ET, LA DERNIÈRE CROISADE" (1989) de Steven Spielberg avec 1 Harrison Ford, Sean Connery. 40/80 Affiche 1,20 x 1,60. Dessin de Drew. "LES DIX COMMANDEMENTS" (1956) de Cecil B. de Mille avec Charlton Heston. 2 Affiche 1,20 x 1,60. Réédition. Films Paramount. 30/70 "VOYAGE À DEUX" (1967) de Stanley Donen avec Audrey Hepburn, Albert Finney. 3 Affiche 1,20 x 1,60. Dessin de Grinsson. 30/80 "HÔTEL DES AMÉRIQUES" (1981) de André Téchiné avec Catherine Deneuve, 4 Patrick Dewaere. 20/60 Affiche 1,20 x 1,60 de Ferracci. "ASTÉRIX ET LA SURPRISE DE CÉSAR" (1985) de Paul et, Gaetan Brizzi. 5 Dessin de Albert Uderzo. Affichette 0,80 x 0,60. 20/50 "BOEING BOEING" (1965) de John Rich avec Jerry Lewis, Tony Curtis, Dany Saval. 6 Affiche 1,20 x 1,60. Dessin de Landi. 40/80 "RAN" (1985) de Akira Kurosawa. 7 Affiches 1,20 x 1,60. 2 modèles par Benjamin Baltimore 30/80 "SUR UN ARBRE PERCHÉ" (1970) de Serge Korber avec Louis de Funès et, 8 Geraldine Chaplin. -
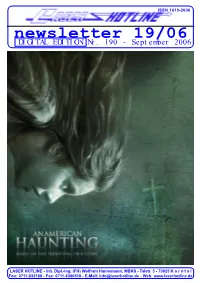
Newsletter 19/06 DIGITAL EDITION Nr
ISSN 1610-2606 ISSN 1610-2606 newsletter 19/06 DIGITAL EDITION Nr. 190 - September 2006 Michael J. Fox Christopher Lloyd LASER HOTLINE - Inh. Dipl.-Ing. (FH) Wolfram Hannemann, MBKS - Talstr. 3 - 70825 K o r n t a l Fon: 0711-832188 - Fax: 0711-8380518 - E-Mail: [email protected] - Web: www.laserhotline.de Newsletter 19/06 (Nr. 190) September 2006 editorial Hallo Laserdisc- und DVD-Fans, sein, mit der man alle Fans, die bereits ein lich zum 22. Bond-Film wird es bestimmt liebe Filmfreunde! Vorgängermodell teuer erworben haben, wieder ein nettes Köfferchen geben. Dann Was gibt es Neues aus Deutschland, den ärgern wird. Schick verpackt in einem ed- möglicherweise ja schon in komplett hoch- USA und Japan in Sachen DVD? Der vor- len Aktenkoffer präsentiert man alle 20 auflösender Form. Zur Stunde steht für den liegende Newsletter verrät es Ihnen. Wie offiziellen Bond-Abenteuer als jeweils 2- am 13. November 2006 in den Handel ge- versprochen haben wir in der neuen Ausga- DVD-Set mit bild- und tonmäßig komplett langenden Aktenkoffer noch kein Preis be wieder alle drei Länder untergebracht. restaurierten Fassungen. In der entspre- fest. Wer sich einen solchen sichern möch- Mit dem Nachteil, dass wieder einmal für chenden Presseerklärung heisst es dazu: te, der sollte aber nicht zögern und sein Grafiken kaum Platz ist. Dieses Mal ”Zweieinhalb Jahre arbeitete das MGM- Exemplar am besten noch heute vorbestel- mussten wir sogar auf Cover-Abbildungen Team unter Leitung von Filmrestaurateur len. Und wer nur an einzelnen Titeln inter- in der BRD-Sparte verzichten. Der John Lowry und anderen Visionären von essiert ist, den wird es freuen, dass es die Newsletter mag dadurch vielleicht etwas DTS Digital Images, dem Marktführer der Bond-Filme nicht nur als Komplettpaket ”trocken” wirken, bietet aber trotzdem den digitalen Filmrestauration, an der komplet- geben wird, sondern auch gleichzeitig als von unseren Lesern geschätzten ten Bildrestauration und peppte zudem alle einzeln erhältliche 2-DVD-Sets. -

Bobby Fischer Vit a Pasadena
LA CANTATRICE CHAUVE de Eugène Ionesco mise en scène Daniel Benoin SAISON 07-08 Mercredi 2 avril 19h00 Jeudi 3 avril 19h00 Vendredi 4 avril 20h45 représentation supplémentaire Samedi 5 avril 16h Samedi 5 avril 20h45 Durée : 1h30 Tarif général : 20€ Tarif réduit : 13€ (hors abonnement) Location – réservation 04 67 99 25 00 Photo © Fraicher-Matthey 2 / 5 avril 2008 – Théâtre de Grammont LA CANTATRICE CHAUVE de Eugène Ionesco mise en scène Daniel Benoin Décor Jean-Pierre Laporte Costumes Nathalie Bérard-Benoin Lumières Daniel Benoin Création vidéo Benoit Galera Assistante à la mise en scène Emmanuelle Duverger avec Paul Chariéras Monsieur Smith Christine Boisson Madame Smith Éric Prat Monsieur Martin Eva Darlan Madame Martin Frédéric de Goldfiem Le Capitaine des pompiers Raluca Paun Mary, la bonne Production Théâtre National de Nice, coréalisation Théâtre National Marin Sorescu de Craiova, Roumanie Spectacle créé au Théâtre National de Nice du 29 septembre au 21 octobre 2006. Rencontre avec l’équipe de création le jeudi 3 avril après la représentation Photo © Fraicher-Matthey En 1977, j'ai mis en scène La Cantatrice chauve. Cette pièce semblait alors coulée dans le marbre de ses représentations au Théâtre de la Huchette. En effet la pièce, créée en 1950 aux Noctambules, fut reprise en 1956 dans ce théâtre et se jouait depuis - et se joue toujours d’ailleurs - sans interruption. La première pièce d'Eugène Ionesco était alors le symbole même du théâtre de l'absurde. Lors de ma première mise en scène, qui fut magnifiquement reçue par la presse et le public, mais aussi par Ionesco lui-même, je souhaitais déjà rendre compte qu'un langage apparemment éloigné du réel et de la logique devenait vingt-sept ans après la création de la pièce beaucoup plus concret, comme si la décomposition établie des mots et leur déconnexion de la narration voulue par l'auteur se retournaient pour correspondre au langage de notre modernité. -

Contact Presse : Claudine Arignon
contact presse : Claudine Arignon tel : 04 67 99 25 11 / 06 76 48 36 40 / [email protected] \ mise en scène Gilbert Désveaux Théâtre de Grammont du 28 septembre au 14 octobre 2011 mer 28.09 20h30 adaptation Jean-Marie Besset jeu 29.09 19h © L’avant-scène théâtre ven 30.09 20h30 sam 1.10 19h mar 4.10 19h scénographie Annabel Vergne costumes Annabel Vergne et Marie Delphin mer 5.10 20h30 lumières Martine André jeu 6.10 19h images et son Serge Monségu ven 7.10 20h30 assistante à la mise en scène Mama Prassinos sam 8.10 19h mar 11.10 19h mer 12.10 20h30 jeu 13.10 19h avec ven 14.10 20h30 Christine Boisson, Miriam Robert Plagnol, Mark durée : 1h30 sous réserve Laurent d’Olce, Léonard Mathieu Lee, le Barman avec la participation de bureau de location Farida Remadna hall de l'Office de Tourisme Place de la Comédie - Montpellier tel : 04 67 99 25 00 production Théâtre des 13 vents CDN Languedoc-Roussillon Montpellier billetterie en ligne sur « TOKYO BAR is presented through special arrangement with the www.theatre-13vents.com University of the South, Sewanee,Tennessee ». L’Auteur est représenté dans les pays de langue française par l’Agence tarif général : 24€ MCR, Marie Cécile Renauld, Paris, en accord avec Casarotto Ramsay !"#X%& Ltd, London. EN TOURNÉE Théâtre de l’Archipel, Perpignan, le 18 octobre 2011 Le Théâtre Scène nationale de Narbonne, le 20 octobre 2011 Théâtres de Béziers, les 9 et 10 décembre 2011 Théâtre Jean-Alary, Carcassonne, le 13 décembre 2011 Le Carré Sainte-Maxime, le 25 février 2012 Théâtre de La Tempête, Paris, du 27 avril au 2 juin 2012 ARGUMENT "!RIVbF)H!!"I)!*"Hb)) peintre new-yorkais d'avant-garde, puise l'inspiration créatrice dans la drogue. -

Archives Audiovisuelles Du Théâtre National De Chaillot
Archives audiovisuelles du Théâtre National de Chaillot Répertoire numérique détaillé du versement 20160438 Justine Dilien, sous la direction de la Mission des archives du ministère de la Culture et de la communication. Sandrine Gill, Archives nationales, Département de l'archivage électronique et des archives audiovisuelles. Première édition électronique Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 2018 1 Mention de note éventuelle https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_055964 Cet instrument de recherche a été rédigé avec un logiciel de traitement de texte. Ce document est écrit en français. Conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales, il a reçu le visa du Service interministériel des Archives de France le ..... 2 Archives nationales (France) INTRODUCTION Niveau de description sous-fonds Intitulé Archives audiovisuelles du Théâtre National de Chaillot Date(s) extrême(s) 1966-2014 Nom du producteur • Théâtre national de Chaillot (Paris) Importance matérielle et support 1762 supports analogiques et numériques, 575 vidéos numériques. Localisation physique Fontainebleau Conditions d'accès Les archives, sous leur forme numérique, sont librement consultables, selon le règlement de la salle de lecture. Conditions d'utilisation Toute exploitation (reproduction, réutilisation) est soumise au droit de la propriété intellectuelle. Documents de substitution A l'Institut National de l'Audiovisuel (INA) DESCRIPTION Présentation du contenu Ce versement est constitué par des archives audiovisuelles produites ou reçues par le Théâtre National de Chaillot. Seuls quelques spectacles identifiés de ce versement datent du Théâtre National Populaire (à partir de 1971), la plupart ayant été produits sous l'égide du Théâtre National de Chaillot (après 1975). -

Claude Régy : Né Le 01/05/1923 À Nîmes (Gard)
Claude Régy : Né le 01/05/1923 à Nîmes (Gard). Études secondaires : Licence en droit Écoles d'Art Dramatique : Charles Dullin, Tania Balachova, Michel Vitold 1952 _________ DOÑA ROSITA de Federico Garcia Lorca (création en France) avec Pascale de Boysson, Silvia Monfort, Philippe Noiret, Clotilde Joanno Théâtre des Noctambules 1953 _________ LA VIE QUE JE T'AI DONNÉE de Luigi Pirandello (création en France) avec Tania Balachova, Catherine Sellers Théâtre de l'Atelier (1° Festival de Paris) Théâtre des Noctambules Théâtre des Mathurins 1954 _________ PENTHÉSILÉE de Heinrich von Kleist (création en France) avec Silvia Monfort, Michel Piccoli Théâtre Hébertot (2° Festival de Paris) 1957 _________ L'AUTRE ALEXANDRE de Marguerite Liberaki (première création) Théâtre de l'Alliance française 1963 _________ LES VIADUCS DE LA SEINE-ET-OISE de Marguerite Duras (première création) avec Katharina Renn, Paul Crauchet, Maurice Garrel, Étienne Bierry Théâtre de Poche - Montparnasse 1964/1965 ____ CET ANIMAL ÉTRANGE de Gabriel Arout d'après Tchekhov (première création) avec Delphine Seyrig, Jean Rochefort Théâtre Hébertot ______________ L'ACCUSATEUR PUBLIC de Fritz Hochwalder (création en France) avec Michel Bouquet Théâtre des Mathurins 1 sur 10 1965/1966 ____ L'AMANT - LA COLLECTION de Harold Pinter (création en France) avec Delphine Seyrig, Jean Rochefort, Michel Bouquet, Bernard Fresson Théâtre Hébertot 1966/1967 ____ LA PROCHAINE FOIS JE VOUS LE CHANTERAI de James Saunders (création en France) avec Delphine Seyrig, Jean Rochefort, Claude Pieplu, -

DP Homme Sans
DOSSIER DE PRESSE Homme sans but D’ARNE LYGRE MISE EN SCÈNE CLAUDE RÉGY TEXTE FRANÇAIS T ERJE S IN DI N G DU 16 AU 25 NOVEMBRE 2007 mardi, vendredi, samedi 20h mercredi, jeudi 19h dimanche 17h CONTACT Christine Ferrier Stéphanie Chassot + 41 / (0)22 809 60 83 + 41 / (0)22 809 60 73 [email protected] [email protected] www.comedie.ch Homme sans but d’Arne Lygre mise en scène Claude Régy texte français Terje Sinding scénographie Sallahdyn Khatir lumières Joël Hourbeigt Son Philippe Cachia avec par ordre d’apparition Jean-Quentin Chatelain Peter Redjep Mitrovitsa Frère Axel Bogousslavsky Propriétaire/assistant Bulle Ogier Femme Marion Coulon Fille Bénédicte Le Lamer Soeur production : Les Ateliers Contemporains, Odéon-Théâtre de l’Europe, Festival d’Automne à Paris,Théâtre National Populaire - Villeurbanne, Usine C (Centre de création et de diffusion pluridisciplinaire) – Montréal, avec la participation du Théâtre national de Bretagne – Rennes. Autour du spectacle… Dimanche 18 novembre 2007 Quel avenir pour le réel ? Brunch thématique autour d’ Homme sans but avec Claude Régy, metteur en scène, Michel Cassé, astrophysicien, ainsi toute l’équipe du spectacle débat animé par Michel Caspary, journaliste Horaires dès 11h30 Brunch Au Café du Théâtre de 12h30 à 14h Débat et discussion avec le public Animations pour les enfants avec la Bulle d’Air dès 12h30 Jeudi 22 novembre 2007 Les entretiens de Arielle Meyer MacLeod Du texte à la scène : passage à l'acte avec Claude Régy 12h30 au Studio entrée libre Derrière celle qui prétend avoir été ma femme. Qui es-tu ? À quoi tu penses ? Avec qui parles-tu ? Quelles sont tes raisons de vivre ? À part mon argent, je veux dire. -

Vente Aux Encheres Publiques Affiches De Cinema
jean-claude renard commissaire-priseur expert judiciaire VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES AFFICHES DE CINEMA Mercredi 28 janvier A 17 h 30 CINEMA « GRAND ACTION » 5 rue des Ecoles 75005 PARIS Frais de vente en sus des enchères : 25 % TTC Liste et photographies visibles sur www.interencheres.com/75022 Catalogues sur demande Jean-Claude Renard, maison de ventes aux enchères publiques s.a.s, Société agréée en date du 20 décembre 2001, n°2001-025 / 28 rue beaubourg 75003 paris Tél : 01-42-72-03-65 Nouveau Mail : [email protected] "LES NERFS À VIF" (1962) de Jack Lee Thompson avec Robert Mitchum, et, 1 (Cape Fear) Gregory Peck. 70/120 Affiche Universal International. "EXODUS" (1960) de Otto Preminger avec Paul Newman, Eva Marie Saint, Peter Lawford. 2 Affiche dessinée par Saül Bass. United Artists. 70/120 "LES SEPT MERCENAIRES" (1960) de John Sturges avec Yul Brynner, et, 3 Steve Mac Queen. 70/120 Affiche United Artists. "LOVE" (1970) de Ken Russell avec Oliver Reed, Glenda Jackson, Alan Bates. 4 Affichette de Peter Weevers. United Artists. 30/60 "BARBARELLA" (1968) de Roger Vadim avec Jane Fonda, John Philip Law. 5 Affiche Films Paramount. 100/160 "QUOI DE NEUF PUSSYCAT?" (1965) de Clive Donner avec Peter Sellers, 6 Romy Schneider, Woody Allen etc … 60/120 Affiche de Siry. United Artists. "LA DÉESSE DE FEU" (1965) de Robert Day avec Ursula Andress, Christopher Lee, 7 Peter Cushing. 70/90 Production Hammer. Films MGM. Affiche de G. Allard. "DU SANG POUR DRACULA" (1974) de Andy Warhol et, Paul Morrissey avec Udo Kier, 8 Joe Dallessandro. -

BULLETIN DE RESERVATION Viol D'après Titus Andronicus De William
Paris, le 19 septembre 2005 Madame, Monsieur, L’Odéon – Théâtre de l’Europe, en partenariat avec l’association des amis du Monde Diplomatique, est heureux de vous faire bénéficier d’un tarif réduit pour la création mondiale qui se tiendra aux Ateliers Berthier : > VIOL d’après Titus Andronicus de William Shakespeare du 6 octobre au 19 novembre 2005 , du mardi au samedi à 20h, le dimanche à 15h. à l’Odéon - Théâtre de l’Europe, aux Ateliers Berthier de BOTHO STRAUSS mise en scène LUC BONDY avec Renaud Bécard, Christine Boisson, Xavier Clion, Laurence Cordier, Marie-Laure Crochant, Gérard Desarthe, Marcial Di Fonzo Bo, Marina Foïs, Louis Garrel, Roch Leibovici, Dörte Lyssewski, Joseph Menant, William Nadylam, Jérôme Nicolin Comme un peintre composant une étude d'après le chef-d'oeuvre d'un maître ancien, Botho Strauss a puisé dans le Titus Andronicus de Shakespeare de quoi tracer, en dix-sept tableaux, un portrait au couteau du chaos contemporain. Luc Bondy a réuni une distribution exceptionnelle pour cette création où l'horreur et l'humour, la grandiloquence et le Grand-Guignol, célèbrent leurs énigmatiques noces de sang. Le tarif préférentiel, que nous vous proposons est de 22€ au lieu de 26€, pour les représentations du 6 au 16 octobre, dans la limite des places disponibles. Nous mettons tout en œuvre pour vous offrir le meilleur placement mais ne pouvons vous le garantir sur les dates de promotion proposées. Pour bénéficier de cette offre, il vous suffit de renvoyer le coupon de réservation ci-dessous ou de nous contacter au 01 44 85 40 37. -

Bible Du Spectacle
STfW avec d'après Titus Andronicus de William Shakespeare Renaud Bécard Bassian, frère de Saturnin de Botho Strauss mise en scène Luc Bondy Christine Boisson Tamora, reine des Goths Xavier Clion Un crieur, un soldat traduction Michel Vinaver et Barbara Grinberg adaptée pour cette mise en scène par Luc Bondy et Daniel Loayza Laurence Cordier Une jeune mère Marie-Laure Crochant Le garçon Lukas décor Lucio Fanti Gérard Desarthe Titus Andronicus, générai costumes Rudy Sabounghi lumières Dominique Bruguière Marcial Di Fonzo Bo Saturnin, fils aîné de feu l'empereur son André Serré Marina Foïs Monica / Metteur en scène collaborateur artistique Geoffrey Layton Louis Garrel Chiron, fils de Tamora assistante à la mise en scène Sophie Lecarpentier maquillage et perruques Cécile Kretschmar Roch Leibovici Un crieur, un soldat effets spéciaux de maquillage Dominique Colladant Dôrte Lyssewski Lavinia, fille de Titus Andronicus maître d'armes Patrice Camboni Joseph Menant Demetrius, fils de Tamora seconde assistante à la mise en scène Constance Meyer William Nadylam Aaron, amant de Tamora, un nègre assistant au casting Marc Paquien assistante aux décors Clémence Kazémi Jérôme Nicolin Un crieur assistante aux costumes Anne Autran O dé, assistant à la lumière Christophe Chaupin stagiaire costumes Alexandra Langlois et les équipes techniques de l'Odéon-Théâtre de l'Europe et le peuple romain Marine Billon Jerome Baubil Il\\®7 S/S/ Anthony Bruchet Anne Bussy-Henry Julien Girardet François Grosz Franck Micque Sylvain Letourneur coproduction Odéon-Théâtre de l'Europe, Wiener Festwochen, Ruhrfestspiele Recklinghausen 2006 représentations : Odéon-Théâtre de l'Europe aux Ateliers Berthier, Grande Salle, du jeudi 6 oct. -

Catalogue RDV 2008
10th Rendez-vous with French Cinema Paris, January 10-14th, 2008 Screenings Gaumont Opéra 1er 31, bd des Italiens 75002 Paris Gaumont Opéra Français 38, bd des Italiens 75009 Paris Market and Interviews Le Grand Hôtel 2, rue Scribe 75009 Paris Market : 1st Floor Interviews : 2nd Floor 6 Alma Films 8 Bac Films International 12 Carrere Group 14 Celluloid Dreams 18 Cinexport 20 Coach 14 22 Elle Driver 24 Eurociné 26 EuropaCorp 30 Films Distribution 34 Les Films du Losange 36 France Télévisions Distribution 38 Funny Balloons 40 Futurikon 42 Gaumont 46 Groupe Un 48 Memento Films 50 MK2 52 Onoma 54 Pangea World 56 Pathé Distribution 60 Pyramide International 64 Reines Sales 66 Rendez-vous Pictures 68 Rezo 70 Roissy Films 74 SND/M6 D.A 76 StudioCanal 80 TF1 International 84 The Coproduction Office 86 U Media 88 UGC International 92 Wide Management 96 Wild Bunch 102 Short Films Program 104 Your contacts at Unifrance President Founded in 1949 by the French state, Margaret Menegoz Unifrance is an association that assures the promotion of French films abroad. With the ongoing support of its General Manager Marc Piton 680 members, including French film producers, directors, actors, talent agents, and sales agents, Unifrance works to maximize French cinema’s cultural impact and enhance its economic growth abroad. Unifrance organizes its own events dedicated to French cinema, focusing on selections of films and artistic delegations traveling to promote their work abroad. Unifrance supports French films at the major international film festivals. Unifrance explores new territories with commercial potential and consolidates new markets by working closely with its partners abroad, and by accompanying the theatrical release of French films, among other activities. -

DOCUMENT RESUME ED 366 309 IR 016 505 TITLE Media Log: a Guide to Film, Television, and Radio Programs Supported by the National
DOCUMENT RESUME ED 366 309 IR 016 505 TITLE Media Log: A Guide to Film, Television, and Radio Programs Supported by the National Endowment for the Humanities, Division of Public Programs, Humanities Projects in Media. INSTITUTION National Endowment for the Humanities (NFAH), Washington, D.C. REPORT NO ISBN-0-16-038136-3 PUB DATE [92] NOTE 156p. AVAILABLE FROMU.S. Government Printing Office, Superintendent of Documents, Mail Stop: SSOP, Washington, DC 20402-9328. PUB TYPE Reference Materials Directories/Catalogs (132) Reports Descriptive (141) EDRS PRICE MF01/PC07 Plus Postage. DESCRIPTORS Childrens Television; *Educational Radio; *Educational Television; Films; *Humanities; Literature; *Mass Media; United States History IDENTIFIERS *National Endowment for the Humanities ABSTRACT This guide describes more than 800 film, television, and radio productions developed with the support of the National Endowment for the Humanities (NEH). NEH supports projects that convey significant scholarship to the general public and engage citizens in critical interpretation and analysis of the humanities. Film, video, and radio programs are listed in clphabetical order in one of the following eight sections: (1) United States History and American Studies;(2) Literature and Language;(3) World Culture and History; (4) History, Theory, and Criticism of the Arts; (5) Archaeology and Anthropology; (6) Philosophy, Religion, and Ethics; (7) Children's and Family Programming; and (8) General Humanities. Each program listing includes information about content, production credits, format, length, ancillary materials, awards, and current distribution agent (as of June 1992). All distributor addresses and phone numbers can be found in the back of the book.(TMK) *********************************************************************** Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made from the original document.