Mélanges Cécile Morrisson
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

SCEATTAS: the NEGLECTED SILVER COINAGE of EARLY ANGLO-SAXON ENGLAND- a COLLECTOR's PERSPECTIVE • PYTHAGORAS of SAMOS, CELATOR Lj Collection
T H E _ELATOlt Vol. 25, No. 11, NoveInber 2011 • SCEATTAS: THE NEGLECTED SILVER COINAGE OF EARLY ANGLO-SAXON ENGLAND- A COLLECTOR'S PERSPECTIVE • PYTHAGORAS OF SAMOS, CELATOR lJ CollectIon Pantikapaion Gold Stater Kyrene Tetradrachm A Classical Masterpiece Syracuse Dekadrachm Head of Zeus Ammon An Icon of Ancient Greek Coinage A MagisteriJIl Specimen The Majestic Art ot Coins Over 600 Spectacular and Historically Important Greek Coins To be auctioned at the Waldorf Astoria, NEW YORK, 4 January 2012 A collection of sublime quality, extreme rarity, supreme artistic beauty and of exceptional historical importance. It has been over 20 years since such a comprehensive collection of high quality ancient Greek coins has been offered for sale in one auction. Contact Paul Hill ([email protected]) or Seth Freeman ([email protected]) for a free brochure Vol. 25. No. 11 The Celator'" Inside The Celato ~ ... November 20 11 Consecutive Issue No. 293 Incorporating Romall Coins (llId G il/lire FEATURES PublisherfEditor Kerry K. WcUerstrom [email protected] 6 Scealtas: The Neglected Silver Coinage of Early Anglo-Saxon England- Associate Editors A Collector's Perspective Robert L_ Black by Tony Abramson Michael R. Mehalick Page 6 22 Pythagoras of Samos, Celator for Back Issues from by John Francisco 1987 (0 May 1999 contact: Wayne Sayles DEPARTMENTS [email protected] Art: Parnell Nelson 2 Editor'S Note Coming Next Month Maps & Graphic Art: 4 Letters to the Editor Page 22 Kenny Grady 33 CE LTIC NEWS by Chris Rudd P.O. BoJ; 10607 34 People in the News lancaster, PA 17605 TeVFax: 717-656-8557 f:lro(j[~s in illlll1isntlltics (Ofllce HourI: Noon to 6PM) Art and the Market For FedEx & UPS deliveries: 35 Kerry K. -
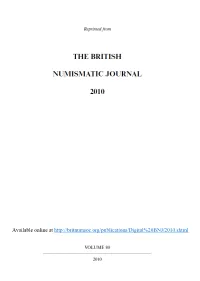
Available Online At
Available online at http://britnumsoc.org/publications/Digital%20BNJ/2010.shtml PROCEEDINGS OF THE BRITISH NUMISMATIC SOCIETY, 2009 PRESIDENTS OF THE SOCIETY 1903–08 P.W.P. Carlyon-Britton, DL, FSA 1909 W.J. Andrew, FSA 1910–14 P.W.P. Carlyon-Britton, DL, FSA 1915–19 Lt-Col H.W. Morrieson, RA, FSA 1920–21 F.A. Walters, FSA 1922 (until 22 June) J. Sanford Saltus 1922 (from 28 June) G.R. Francis, FSA 1923–25 G.R. Francis, FSA 1926–27 Major W.J. Freer, VD, DL, FSA 1928 (until 20 February) P.W.P. Carlyon-Britton, DL, FSA 1928 (from 22 February) Lt-Col H.W. Morrieson, RA, FSA 1929–32 Lt-Col H.W. Morrieson, RA, FSA 1933–37 V.B. Crowther-Beynon, MBE, MA, FSA 1938–45 H.W. Taffs, MBE 1946–50 C.E. Blunt, OBE, FSA 1951–54 E.J. Winstanley, LDS 1955–58 H.H. King, MA 1959–63 D.F. Allen, BA, FBA, FSA 1964–65 C.W. Peck, FPS, FSA 1966–70 C.S.S. Lyon, MA, FIA 1971–75 S.E. Rigold, MA, FSA 1976–80 P. Woodhead, FSA 1981–83 J.D. Brand, MA, FCA 1984–88 H.E. Pagan, MA, FSA 1989–93 C.E. Challis, BA, PhD, FSA, FRHistS 1994–98 G.P. Dyer, BSc(Econ), DGA 1999–2003 D.W. Dykes, MA, PhD, FSA, FRHistS 2004–08 M.A.S. Blackburn, PhD, FSA 2008– R.J. Eaglen, MA, LLM, PhD, FSA JOHN SANFORD SALTUS MEDAL 1938 W.C. Wells 1941 C.A. Whitton This medal is awarded triennially to ‘the person, being 1944 (not awarded) a member of the Society or not, who shall receive the 1947 R.C. -

The Control, Organization, Pro Ts and out Put of an Ecclesiastical Mint
Durham E-Theses The Durham mint: the control, organization, prots and out put of an ecclesiastical mint Allen, Martin Robert How to cite: Allen, Martin Robert (1999) The Durham mint: the control, organization, prots and out put of an ecclesiastical mint, Durham theses, Durham University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/4860/ Use policy The full-text may be used and/or reproduced, and given to third parties in any format or medium, without prior permission or charge, for personal research or study, educational, or not-for-prot purposes provided that: • a full bibliographic reference is made to the original source • a link is made to the metadata record in Durham E-Theses • the full-text is not changed in any way The full-text must not be sold in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. Please consult the full Durham E-Theses policy for further details. Academic Support Oce, Durham University, University Oce, Old Elvet, Durham DH1 3HP e-mail: [email protected] Tel: +44 0191 334 6107 http://etheses.dur.ac.uk 2 The Durham Mint: the Control, Organization, Profits and Output of an Ecclesiastical Mint Martin Robert Allen Submitted for the Doctorate of Philosophy at the University of Durham, in the Department of Archaeology 1999 The copyright of this thesis rests with the author. No quotation from it should be pubhshed without his prior written consent, and information derived from it should be acknowledged. This thesis is dedicated to the memory of VERA ADELAIDE ALLEN (nee HANN) (1924-1996) and GEORGE EDWARD ALLEN (1910-1997) Contents List of tables vi List of abbreviations vii Preface x Introduction 1 1. -

Report on the RNS Session 2012-2013
THE ROYAL NUMISMATIC SOCIETY REPORT ON THE SESSION OCTOBER 2012 – JUNE 2013 PATRON, OFFICERS AND COUNCIL PATRON Her Majesty Queen Elizabeth II PRESIDENT Nicholas Mayhew HON VICE PRESIDENT Andrew Burnett VICE-PRESIDENT(S) Roger Bland TREASURER John Morcom 24 Lawn Crescent, Kew, Richmond, Surrey TW9 3NS SECRETARIES Robert Bracey Helen Wang Richard Ashton (Foreign Secretary) c/o Dept of Coins and Medals, The British Museum, London WC1B 3DG [email protected] LIBRARIAN Robert Thompson c/o The Warburg Institute, Woburn Square, London WC1H 0AB WEBSITE http://royalnumismaticsociety.org EDITORS, THE NUMISMATIC CHRONICLE Richard Ashton c/o Dept of Coins and Medals, The British Museum, London WC1B 3DG Marcus Phillips PO Box 348, Biggleswade, Bedfordshire SG18 8EQ NON-OFFICIATING COUNCIL MEMBERS Richard Abdy, Jenni Adam, Martin Allen, Tom Eden, Sushma Jansari, Kris Lockyear, Philip Skingley, Philippa Walton THE ROYAL NUMISMATIC SOCIETY ORDINARY MEETINGS, OCT 2012 – JUNE 2013 (including lecture programme) 16 October 2012 – Presentation of the Medal LECTURE: Lucia Travaini, ‘Coins as Bread. Bread as Coins’ 20 November 2012 LECTURE: Dario Calomino, ‘Roman Provincial mints at the end of the Severan Age’ 18 December 2012 LECTURE: Alex Chengyu Fang, ‘The Study of Chinese Coin-Like Charms: Changes and Challenges’ 15 January 2013 LECTURE: Susan Tyler-Smith, ‘Pseudo-Sasanian coinage: How do you recognise it? Why was it struck?’ 19 February 2013 LECTURE: Chris Howgego, ‘The Monetization of Temperate Europe’ 19 March 2013 LECTURE: John Morcom, ‘The Small -

Philip Grierson Among Belgian Historians and Numismatists
Peter SPUFFORD PHILIP GRIERSON AMONG BELGIAN HISTORIANS AND NUMISMATISTS hilip grierson was born on 15 november 1910 and spent his early years in the countryside of southern Ireland, then part of the United P Kingdom, where his father, previously a government land-surveyor, was running a small farm. His rural childhood came to an end when his father, a trained accountant, moved to Dublin and embarked on a business career. Philip later regretted that so much of his life had been exclusively urban. Aer mediocre local schools in Ireland he was sent to Marlborough, a prestigious boarding school in southern England, and from there took the entrance examination to the University of Cambridge and secured a place at Gonville and Caius College, which was to be his home for the rest of his long life. He was a devout young man, brought up in a somewhat rigid protestant tradition of churchmanship, and regularly read the lessons in his home church, but at some point he was to lose his faith. When the young Philip Grierson arrived in Cambridge from Dublin in 1929 the work of compiling the Cambridge Medieval History was still in ﬔll swing. e final three volumes were to come out in 1929, 1932 and 1936, under the editorship of Charles Previté-Orton and Zachary Brooke, who were to hold the chair of Medieval History in turn, and were to be his men- tors in Cambidge, along with Michael Oakeshott and George Coulton. It was to be this vast multi-national compilation which provided the background to Philip Grierson’s encyclopaedic knowledge of the political history of medieval Europe. -
12 Obituary 1767
OBITUARY MARK BLACKBURN, LITTD, FSA (1953–2011) MARK Blackburn died peacefully on 1 September 2011 at the age of 58, surrounded by mem- bers of his family. His long battle with cancer began in the 1980s, when he was successfully treated, but the illness recurred in 2004 and again in 2010. However, a combination of superb medical care and his own great strength and determination sustained him for over a year after his terminal diagnosis. He will be remembered as a towering presence – physically and fi gura- tively – in numismatics: as a true leader of the fi eld worldwide, an undisputed master of his discipline and the congenial face of the Department of Coins and Medals at the Fitzwilliam Museum. Mark was born on 5 January 1953 at his family home in Camberley, Surrey, third son of Neil Blackburn and Joan Wallace Blackburn (née Marshall), who had met at the accounting fi rm Dixon Wilson in 1936. When Mark was 13 the family moved to Tunbridge Wells, where he attended the Skinners’ School, of which he later (in 2007) became a Foundation Governor. His time there established a long and happy association with the Worshipful Company of Skinners, which saw him elected a Freeman in 1981 and a Liveryman in 2008. After leaving school Mark read chemistry and later law at St Edmund Hall in the University of Oxford. He graduated in 1975, and entered pupillage at Middle Temple, where he subsequently practised as a barrister. In 1978 Mark left the law, taking up a position in the corporate fi nance department of the merchant banking fi rm Kleinwort Benson. -

Francia. Forschungen Zur Westeuropäischen Geschichte
&ƌĂŶĐŝĂ͘&ŽƌƐĐŚƵŶŐĞŶnjƵƌǁĞƐƚĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ,ĞƌĂƵƐŐĞŐĞďĞŶǀŽŵĞƵƚƐĐŚĞŶ,ŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶ/ŶƐƚŝƚƵƚWĂƌŝƐ ;/ŶƐƚŝƚƵƚŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞĂůůĞŵĂŶĚͿ ĂŶĚϭϳͬϭ;ϭϵϵϬͿ K/͗10.11588/fr.1990.1.53865 ZĞĐŚƚƐŚŝŶǁĞŝƐ ŝƚƚĞ ďĞĂĐŚƚĞŶ ^ŝĞ͕ ĚĂƐƐ ĚĂƐ ŝŐŝƚĂůŝƐĂƚ ƵƌŚĞďĞƌƌĞĐŚƚůŝĐŚ ŐĞƐĐŚƺƚnjƚ ŝƐƚ͘ ƌůĂƵďƚ ŝƐƚ ĂďĞƌ ĚĂƐ >ĞƐĞŶ͕ ĚĂƐ ƵƐĚƌƵĐŬĞŶ ĚĞƐ dĞdžƚĞƐ͕ ĚĂƐ ,ĞƌƵŶƚĞƌůĂĚĞŶ͕ ĚĂƐ ^ƉĞŝĐŚĞƌŶ ĚĞƌ ĂƚĞŶ ĂƵĨ ĞŝŶĞŵ ĞŝŐĞŶĞŶ ĂƚĞŶƚƌćŐĞƌ ƐŽǁĞŝƚ ĚŝĞ ǀŽƌŐĞŶĂŶŶƚĞŶ ,ĂŶĚůƵŶŐĞŶ ĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ njƵ ƉƌŝǀĂƚĞŶ ƵŶĚ ŶŝĐŚƚͲ ŬŽŵŵĞƌnjŝĞůůĞŶ ǁĞĐŬĞŶ ĞƌĨŽůŐĞŶ͘ ŝŶĞ ĚĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐŐĞŚĞŶĚĞ ƵŶĞƌůĂƵďƚĞ sĞƌǁĞŶĚƵŶŐ͕ ZĞƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶ ŽĚĞƌ tĞŝƚĞƌŐĂďĞ ĞŝŶnjĞůŶĞƌ /ŶŚĂůƚĞ ŽĚĞƌ ŝůĚĞƌ ŬƂŶŶĞŶ ƐŽǁŽŚů njŝǀŝůͲ ĂůƐ ĂƵĐŚ ƐƚƌĂĨƌĞĐŚƚůŝĐŚ ǀĞƌĨŽůŐƚǁĞƌĚĞŶ͘ Simon Coupland MONEY AND COINAGE UNDER LOUIS THE PIOUS (Plates I-IV) Introduction In the eyes of historians, the Emperor Louis the Pious (814-840) has always been overshadowed by his more illustrious father, Charlemagne (768-814). Even the Conference which was held in 1986 at Oxford to reconsider the achievements of Louis’s reign was entitled >Charlemagne’s Hein. While Charlemagne is usually perceived as the great architect of the Carolingian Empire, Louis tends to be portrayed as having lost control of his inheritance, thereby weakening the bonds of imperial unity and sowing the seeds of dissolution. In a typical attack, Jan Dhondt wrote: >Que Louis le Pieux ait ete un souverain incapable ne sera conteste par personne; que son imperitie et sa faiblesse aient precipite la ruine de l’empire, nous serons les demiers ä y contredire<1. Although there has recently been a willingness among historians to question these assumptions and to reassess Louis’s reign2, those who suggest that the Emperor was more powerful and successful than has hitherto been believed still face an uphill struggle3. Numismatists have contributed little to this discussion.