CHARENTE-Maritime SCIENTIFIQUE
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Liste Des Communes De Charente- Maritime THD Fourniture D’Informations Relatives Aux Déploiements FTTH De Charente-Maritime THD
Annexe 1 – Liste des communes de Charente- Maritime THD Fourniture d’informations relatives aux déploiements FTTH de Charente-Maritime THD Les communes de Charente-Maritime THD sont les suivantes (le nom de chaque commune est précédée de son code INSEE) : Code INSEE Communes couvertes par le CM THD commune 17002 AGUDELLE 17003 AIGREFEUILLE D'AUNIS 17005 ALLAS BOCAGE 17006 ALLAS CHAMPAGNE 17007 ANAIS 17008 ANDILLY 17009 ANGLIERS 17011 ANNEPONT 17012 ANNEZAY 17013 ANTEZANT LA CHAPELLE 17015 ARCES SUR GIRONDE 17016 ARCHIAC 17017 ARCHINGEAY 17018 ARDILLIERES 17019 ARS EN RE 17020 ARTHENAC 17021 ARVERT 17022 ASNIERES LA GIRAUD 17023 AUJAC 17024 AULNAY 17025 AUMAGNE 17026 AUTHON EBEON 17027 AVY 17029 BAGNIZEAU 17030 BALANZAC 17031 BALLANS 17032 BALLON 17033 LA BARDE 17034 BARZAN 17035 BAZAUGES 17036 BEAUGEAY 17037 BEAUVAIS SUR MATHA 17038 BEDENAC 17039 BELLUIRE 17040 LA BENATE 17041 BENON Fourniture d’informations relatives aux déploiements FTTH de CM THD annexe 1 – liste des communes - janvier 2018 2/12 17042 BERCLOUX 17043 BERNAY SAINT MARTIN 17044 BERNEUIL 17045 BEURLAY 17046 BIGNAY 17047 BIRON 17048 BLANZAC LES MATHA 17049 BLANZAY SUR BOUTONNE 17050 BOIS 17051 LE BOIS PLAGE EN RE 17052 BOISREDON 17053 BORDS 17054 BORESSE ET MARTRON 17055 BOSCAMNANT 17056 BOUGNEAU 17057 BOUHET 17058 BOURCEFRANC LE CHAPUS 17060 BOUTENAC TOUVENT 17061 BRAN 17062 BRESDON 17063 BREUIL LA REORTE 17064 BREUILLET 17066 BRIE SOUS ARCHIAC 17067 BRIE SOUS MATHA 17068 BRIE SOUS MORTAGNE 17069 BRIVES SUR CHARENTE 17070 BRIZAMBOURG 17071 LA BROUSSE 17072 BURIE 17074 -

Demande D'autorisation Environnementale Du Parc Éolien De Varzay (17) 2017
Décembre 2017 Demande d’autorisation environnementale du parc éolien de Varzay Compléments novembre 2018 Département : Charente-Maritime Commune : Varzay Maître d'ouvrage Réalisation et assemblage du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale Fichier n° 2 : ENCIS Environnement Note de présentation non Ester Technopole technique du projet 1, avenue d’Ester 87 069 LIMOGES Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale du parc éolien de Varzay (17) 2017 2 Porteur de projet : ABO Wind / Bureau d'études : ENCIS Environnement Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale du parc éolien de Varzay (17) 2017 Table des matières 1 Identité du demandeur ........................................................................................................... 5 Information pratique de la SAS Ferme éolienne de Varzay .............................................................. 5 2 Localisation de l’installation .................................................................................................. 6 3 Description du projet .............................................................................................................. 8 3.1 Un site présentant des atouts ................................................................................................ 8 3.2 Historique ................................................................................................................................ 8 3.3 Eléments techniques ............................................................................................................. -

Commissions 2018 Noms
Commissions mises en place en avril 2016 Présidents des commissions mises à jour en décembre 2016 et janvier 2018: TITRE Prénom NOM DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE Madame Céline VIOLLET ET ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Monsieur Pierre-Henri JALLAIS TOURISME Monsieur Pascal GILLARD EDUCATION ENFANCE JEUNESSE Monsieur Éric PANNAUD PETITE ENFANCE Monsieur Fabrice BARUSSEAU FINANCES Madame Eliane TRAIN RESSOURCES HUMAINES Madame Geneviève THOUARD DIALOGUE SOCIAL MOBILITÉ TRANSPORTS Monsieur Frédéric NEVEU ACCESSIBILITE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET HABITAT Monsieur Patrick SIMON DEVELOPPEMENT DURABLE Monsieur Alain MARGAT CADRE DE VIE NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE Monsieur Fabrice BARUSSEAU LA COMMUNICATION ACTION SOCIALE INSERTION Monsieur Christian FOUGERAT SANTE Monsieur Pierre-Henri JALLAIS POLITIQUE DE LA VILLE Monsieur Bruno DRAPRON GENS DU VOYAGE CISPD Monsieur Bruno DRAPRON FONCTIONNEMENT ET ANIMATION DES PISCINES Monsieur Bernard BERTRAND COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE TITRES PRENOMS NOMS CP/COMMUNE Madame Céline VIOLLET 17 100 SAINTES Monsieur Pierre-Henri JALLAIS 17 100 LA CHAPELLE DES POTS Monsieur Patrick ANTIER 17 770 BURIE Monsieur Christophe DOURTHE 17 100 BUSSAC SUR CHARENTE Monsieur Jean-Luc GRAVELLE 17 610 CHANIERS Madame Caroline QUÉRÉ-JELINEAU 17 610 CHANIERS Monsieur Jean-Paul COMPAIN 17 610 CHÉRAC Monsieur Christian GARRAUD 17 610 CHÉRAC Madame Chantal RIPOCHE 17 460 CHERMIGNAC Monsieur Jean-Pierre SAGOT 17 460 CHERMIGNAC Monsieur Martial MARMET 17 460 COLOMBIERS Monsieur -

Session on Post-Accident
Your logo here Main results from the French panel of Blayais Post-accident (D9.71) session Mélanie MAÎTRE, Pascal CROÜAIL, Eymeric LAFRANQUE, Thierry SCHNEIDER (CEPN) Sylvie CHARRON, Véronique LEROYER (IRSN) TERRITORIES Final Workshop 12-14 November 2019, Aix-en-Provence This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant agreement No 662287. Quick reminders about WP3 Your logo here ▌ FIRST STEPS Ref. Ares(2018)542785 - 30/01/2018 This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant ► agreement No 662287. Feedback analysis (post-Chernobyl, post-Fukushima) allowing to: EJP-CONCERT • European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Identify uncertainties and local concerns at stake in contaminated Research H2020 – 662287 D 9.65 – Decision processes/pathways TERRITORIES: Synthesis report of CONCERT sub-subtask 9.3.3.1 territories ; Lead Authors: Jérôme Guillevic (IRSN, France), Pascal Croüail, Mélanie Maître, Thierry Schneider (CEPN, France) • Develop a typology of uncertainties (deliverable D.9.65): With contributions from: Stéphane Baudé, Gilles Hériard Dubreuil (Mutadis, France), Tanja Perko, Bieke Abelshausen, Catrinel Turcanu (SCK•CEN, Belgium), Jelena Mrdakovic Popic, Lavrans Skuterud (NRPA, Norway), Danyl Perez, Roser Sala (CIEMAT, Spain), Andrei Goronovski, Rein Koch, Alan Tkaczyk (UT, Estonia) radiological characterization and impact assessment, zoning of affected Reviewer(s): CONCERT coordination team areas, feasibility and effectiveness of the remediation options, health consequences, socio-economic and financial aspects, quality of life in www.concert- the territories, social distrust. h2020.eu/en/Publications ▌ INTERACTIONS WITH STAKEHOLDERS ► Organization of panels, case studies, serious games: collect stakeholders' expectations and concerns to better consider the uncertainties in the management of contaminated territories. -
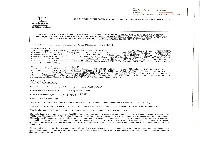
2017-91 Groupement De Commande Telecom
Envoyé en préfecture le 10/10/2017 Reçu en prêfecturs le 10/10/20! 7 Affiché le (..''."..'.;^ .'•::-.-'i 10:017-211704150-20170927-3096 2017 91-DE CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017 saintes Délibération 2017-9L CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES PUBLIQUES VILLE/CDÂ/CCAS/COMMUNES MEMBRES RELA1TOË AUX ACHATS DE TELECOMMUMCATIONS FDŒS, MOBILES ET INTERNET Président de scance : Monsieur Jean-Philippe MACHON Présents : 25 Jean-PhiIippe MACHON, Marie-Line CHEM1NADE, Jean-Piefre ROUDIER, Nelly VEILLBT, Bruno DRAPRON, Françoise BLEYNIE, Marcel GFNOUX, Céline VIOLLET, Dominique ARNAUD, Annie TENDRON, Christian SCHMITT, Fanny HERVE, Liliane ARNAUD, Dominique DEREN, Caroline AUDOUIN, Philippe CREACHCADEC, Danièle COMBY, Jacques LOUBIBRE, Matylise MOREAU, Aziz BACHOUR, Josette GROLEAU, François EHLINGER, Laurence HENRY, Renée BENCHIMOL-LAURIBE, Serge MAUPOUET. Excusés ayant donné pouvoir : 9 Frédéric NEVEU à Marie-Line CHEMINADE, Jeati-Ciaude LANDREAU à Jean-PhiIippe MACHON, Gérard DESRENTE à Liliane ARNAUD, Mélissa TROUVE à Dominique ARNAUD, Christian BERTHBLOT à Jean-Pien-e R.OUDIER, Jean ENGELKING à Nelly VEÏLLET, Claire CHATELAÏS à Françoise BLEYNIE, Philippe CALLAUD à François EHLINGER, Brigitte PAVREAU à Josette GROLEAU. Absent : l Nicolas GAZEAU. Secrétaire de séance : Madame Liiiane ARNAUD Date de la convocation : 21 septembre 2017 Date (Paffidiage : ^ ^ OCT. Le Conseil Municipal, Vu le Code Général des Collectivités Territoriates et notamment Particle l.. 2121-29, Vu ('article 28 del'or(îonnancen°2015"899du23jui]let2015 relative aux marchés publies^ Vu le décret n°20I6-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publies, Considérant qu'au vu des sunililudes des achats et des perspectives d'économies financières, la Ville de Saintes, le CCAS de Saintes, la CDA de Saintes et les communes de Bussac sur CharenÈe, Chaniers, Dompierre sur CharenÈe, Ecoyeux, Ecuraf, Fontcon verte. -

Règlement D'exploitation Allo'buss Juillet2018
REGLEMENT D’EXPLOITATION ET D’UTILISATION DU RESEAU DE TRANSPORTS A LA DEMANDE DE L’AGGLOMERATION DE SAINTES ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Les dispositions du présent règlement d'exploitation sont applicables au service de Transport à la Demande, dénommé « Allo’Buss », assurant la desserte des communes de : • D’une part des communes de Saintes, Chaniers, Fontcouverte, Bussac-sur-Charente, Ecurat, Saint- Georges-des-Coteaux, Pessines, Chermignac, Thénac, et Les Gonds pour le TAD péri urbain ; • D’autre part des communes de Le Seure, Migron, Villars-les-Bois, Burie, Saint-Bris-des-Bois, Saint- Césaire, Saint-Sauvant, Chérac, La Chapelle-des-Pots, Dompierre-sur-Charente, Saint-Sever-de- Saintonge, Rouffiac, Montils, Colombiers, Courcoury, Le Douhet, Saint-Vaize, Varzay, La Clisse, Corme Royal, La Jard, Pisany, Préguillac et Luchat, pour le TAD rural. Le présent règlement d’exploitation complète les textes légaux en vigueur. ARTICLE 2 - CONDITIONS D’ACCES 2.1 – Accès aux véhicules L’utilisation du service implique une inscription initiale et l’accord de la commission d’accessibilité. Les bénéficiaires du service Allo’Buss sont les habitants de la Communauté d’Agglomération de Saintes, étant entendu que toute personne pouvant rejoindre un arrêt du Transport à la Demande existant est en droit d’utiliser le service. Toute demande de transport d’adresse à adresse nécessite un agrément délivré par la Commission d’Accessibilité. Dans ce cas, les bénéficiaires sont les ayants droit et leurs accompagnants éventuels domiciliés dans une des 36 communes de la Communauté d’Agglomération de Saintes. Quand ces bénéficiaires ont moins de 15 ans, l’accompagnement par un adulte valide est obligatoire. -

Communaute D-Agglomeration De Saintes
aimes COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION COMMUNAUTE D-AGGLOMERATION CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE SAINTES Séance du 28 juin 2018 Date de convocation : 21 juin 2018 Délibération n°2018-160 Nomenclature 8.7 Nombre de membres : OBJET : Autorisation de signer une convention En exercice : 70 relative à l'organisation des transports entre la Présents : 38 Région Nouvelle Aquitaine et la Communauté i Votants : 54 d'Agglomération de Saintes sur Le ressort Dont un pouvoir de : territorial de la CDA. IM. Christian FOUGERÂT à M. Jean-Pierre SÂGOT l Mme Annie ROUBY à M. Pascal G1LLÂRD l Mme Anne-Marie FALLOURD à M. Alain MONJOU l M. Jean-Luc GRAVELLE à M. Eric PANNAUD |M. Jean-PauL COMPAIN à M. Gérard DESRENTE Mme Colette AIMON donne à Mme Eliane TRAIN l Mme Catherine BARBOTIN à M. Alain MARGAT IM. Christian LACOTTE à M. Pierre-Henri JALLAIS |M. Bernard COMBEAU à M. Michel CHANTEREÂU Mme Nelly VEILLET donne pouvoir à M. Jean ENGELK1NG l M. Bruno DRAPRON à Mme Geneviève THOUÂRD l M. Frédéric NEVEU à Mme Céline VIOLLET Mme Danièle COMBY à Mme Marie-Lme ICHEMINADE l Mme Mélissa TROUVE à Mme Françoise BLEYN1E l M. Philippe CALLAUD à M. François EHLINGER j Mme Sylvie MERC1ER à M. Jean-Claude CLASSIQUE Ne prend pas part au vote : 0 L'an deux mille dix-huit, le vingt-huit juin, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES, régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à l'Auditorium de ta Cité Entrepreneuriale à Saintes (17100), sous la présidence de Monsieur Jean-Ctaude CLASSIQUE, Président. Présents : 38 Mesdames et Messieurs Christophe DOURTHE, -

Cognac Or Eau-De-Vie De Cognac Or Eau-De-Vie Des Charentes Controlled Appellation of Origin, Officially Recognised by French Decree No
(translated from the French) Published in BO AGRI on 6 December 2018 Product specification for the Cognac or Eau-de-vie de Cognac or Eau-de-vie des Charentes controlled appellation of origin, officially recognised by French decree No. 2015-10 dated 7 January 2015 amended by the Order of 8 November 2018, as published in the Official Journal of the French Republic on 14 November 2018. PRODUCT SPECIFICATION FOR THE Cognac or Eau-de-vie de Cognac or Eau-de-vie des Charentes CONTROLLED APPELLATION OF ORIGIN Part 1 - Technical fact sheet A. ― Name of the controlled appellation of origin and spirit drink category 1. Geographical name Only wine spirits respecting the provisions detailed hereafter can legally lay claim to the Cognac or Eau- de-vie de Cognac or Eau-de-vie des Charentes controlled appellation of origin (hereafter referred to as Cognac), initially defined by French decrees dated 1 May 1909 and 15 May 1936. 2. Wine spirit category in keeping with Regulation (EC) no. 110/2008: The Cognac controlled appellation of origin corresponds to the “wine spirit” category defined in Annex II, point 4, Regulation (EC) No. 110/2008 of the European Parliament and the European Council dated 15 January 2008 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks. This is included in annex III of the above regulation. B. ― Description of the spirit drink 1. Production and ageing methods a) The Cognac controlled appellation of origin is restricted to aged wine spirit, except for quantities intended for industrial purposes or compound products, which do not necessarily need to be aged. -

Bulletin Municipal Pisany
Bulletin municipal Pisany Les infos Pisanéennes 02 juillet 2020 numéro 47 Le mot du Maire - Sommaire - Comptes rendus des conseils Mes chers concitoyens, . municipaux . Vie communale Le 15 mars 2020, vous m'avez apporté - ainsi qu'à l'équipe qui m'accompagne - votre confiance. Démarches administratives En mon nom personnel et au nom de toute . État civil l'équipe municipale, je vous remercie. Action sociale . Vie associative Je pense aussi à celles et ceux qui m'ont accompagné au cours des . Rappels importants précédents mandats et du fond du cœur, je les remercie pour tout le . Services utiles temps consacré à la vie communale et aux moments conviviaux que vous m'avez apportés. Depuis le 23 mai, le nouveau conseil est en place sur la base de trois mots qui me sont chers : l'écoute, la disponibilité et la simplicité. Nous allons donc, après cette période de confinement nous mettre au travail. Si le vote du budget est notre priorité, nous allons progressivement travailler sur nos projets de campagne ; la prise en compte de la bibliothèque, la facilitation dans l'extension du cabinet médical et la réalisation de la pharmacie sans oublier la construction de la nouvelle école. Je continuerai à vous rendre compte régulièrement des activités communales à travers le site Internet de la Mairie et le bulletin municipal. À toutes celles et ceux qui nous font l'honneur de choisir Pisany pour résidence, je leur souhaite la bienvenue. Mention particulière à Monsieur et Madame Dominique Rocheteau qui viennent aussi de se fixer sur notre commune. Nous pouvons être fiers de pouvoir croiser le couple. -

Consulter Le Trombinoscope Des Élus Des 27 Cantons, La Liste Des Vice
LA CHARENTE-MARITIME UN DÉPARTEMENT, 27 CANTONS LES ÉLUS DES 27 CANTONS Canton Canton Canton Canton 1 AYTRÉ 2 CHANIERS 3 CHÂTELAILLON-PLAGE 4 ÎLE-D’OLÉRON Guillaume Marie Fabrice Corinne Sylvie Stéphane Dominique Christophe KRABAL LIGONNIERE BARUSSEAU ETOURNEAU MARCILLY VILLAIN RABELLE SUEUR (Didier PROUST & Hélène RATA) (Jean-Luc MARCHAIS & Rose-May REYMOND-BURDIN) (Pascale LEYON & Didier ROBLIN) (Françoise JOUTEUX & Jean-Marie CLERGET) Canton Canton Canton Canton 5 ÎLE-DE-RÉ 6 LA JARRIE 7 JONZAC 8 LAGORD Patrice Véronique David Marie-Karine Christophe Chantal Brigitte Marc RAFFARIN RICHEZ-LEROUGE BAUDON DUCROCQ CABRI GUIMBERTEAU DESVEAUX MAIGNÉ (Didier COURTEMANCHE & Céline MAROTTE) (Frédéric PAIN & Marie-Laurence RAULT) (Didier LEFEVRE-FARCY & Marie-Hélène VALLIER) (Brigitte LACARRIERE & David LOUTREUIL) Canton Canton Canton Canton 9 MARANS 10 MARENNES 11 MATHA 12 PONS Valérie Jean-Pierre Anne Mickaël Stéphane Corinne Jacky Marie-Christine AMY-MOIE SERVANT BRACHET VALLET CHEDOUTEAUD IMBERT BOTTON BUREAU (Nadia BOIREAU & Jean-Marie BODIN) (Jacqueline PHILIPPE & Patrice BROUHARD) (Frédéric EMARD & Karen GENEAU) (Jean-Jacques PALLISSIER & Mylène ROBERT) Canton Canton Canton Canton 13 ROCHEFORT 14 LA ROCHELLE-1 15 LA ROCHELLE-2 16 LA ROCHELLE-3 Caroline Gérard Christophe Marylise Dominique Marie Marion Jean-Marc CAMPODARVE PONS BERTAUD FLEURET-PAGNOUX GUÉGO NÉDELLEC PICHOT SOUBESTE (Isabelle GIREAUD & Dimitri BUISSON) (Michel RAPHEL & Céline JACOB) (Carolyn CORLAY & Catherine PERRINEAU) (Eléonore BRATS & Eric PERRIN) Canton Canton Canton -

Un Projet D'envergure Pour Révéler Les Aqueducs
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINTES L'esprit Le magazine d’information HIVER 2020 - n°21 Jean-Louis Hillairet, Rosanna Pompa, archéologue en charge du projet sur les aqueducs à la CDA de Saintes PREMIER PLAN Un projet d’envergure pour révéler les aqueducs © Mathieu Vouzelaud agglo-saintes.fr grand angle PORTRAIT EN RAFALE Leroy Merlin souhaite Nicolas Moufflet, La zone d’activités de s'implanter à Saintes PDG de Lyspackaging La Sauzaie s’agrandit Édito 04 Panoramique JEAN-CLAUDE L’ESPRIT COMMUNAUTAIRE CLASSIQUE L’agglomération et les communes ont un destin commun. Elles ne vont pas l’une sans l’autre. Président de Voulions-nous dès lors continuer à penser la Communauté notre aménagement de manière séparée, voire d’Agglomération cloisonnée, quand d’autres le pensent déjà à de Saintes l’échelle de leur bassin de vie ? 06 À cette question, nos communes ont répondu qu’elles souhaitaient travailler ensemble. Elles ont en effet majoritairement approuvé en décembre le transfert à l’Agglomération de la compétence "Plan Local d’Urbanisme". Grand Angle Le "PLU" est un document de planification et d’organisation de l’espace. Le transfert permet de l’appliquer à une échelle plus large que celle de la commune pour tenir compte de l’ensemble de notre agglomération. Il devient alors un Plan Local 10 d’Urbanisme Intercommunal. Le PLUI est une démarche co-construite car c’est sa définition même que de répondre collectivement aux problématiques d’aménagement de nos terri- toires. Aujourd’hui les habitants s’affranchissent quotidiennement des limites administratives. Le PLUI doit ainsi adapter l’action politique locale aux évolutions majeures des modes de vie. -

Modifications Présents : 58 Votants : 63 Pouvoirs : M
Saintes COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE SAINTES Séance du 17 novembre 2020 Date de convocation : mardi 10 novembre 2020 Délibération n° CC_2020_205 Nomenclature : 5.3.5 Nombre de membres OBJET : Désignation des membres des En exercice : 64 commissions communautaires - modifications Présents : 58 Votants : 63 Pouvoirs : M. Thierry BARON à M. Ammar BERDAI, M. Charles DELCROIX à Mme Véronique CAMBON, Mme Céline VIOLLET à M. Jean-Phih'ppe MACHON, M. Pierre HERVE à M. David MUSSEAU, M. Patrick PAYET à M. Pierre-Henri JALLÂIS Ne prend pas part au vote : 0 L'an deux mille deux mille vingt, le 17 novembre 2020, le Conseil Communautaire de La Communauté d'AggLomération de SAINTES, régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à distance en visioconférence, sous La présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président. Présents : M. Bruno DRAPRON, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, M. Jean- Michel ROUGER, M. Jean-Claude DURRAT-SPRINGER, M. Alain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZINAUD, M. Pascal GILLARD, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, Mme Claudine BRUNETEÂU, M. Joseph DE MIN1AC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. Cyrille BLATTES, M. Alexandre GRENOT, M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Agnès POmER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEÂU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar BERDÂ1, Mme Florence BETIZEAU, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Li'ne CHEMINADE, M.