M Ontigny-Sur-L'ain
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Alésia À Chaux-Des-Crotenay (Jura) ? La Découverte D'andré Berthier
Alésia à Chaux-des-Crotenay (Jura) ? La découverte d'André Berthier. Historique, réalité et actualité Conférence de Jean MICHEL, secrétaire général d’ArchéoJuraSites 16 mars 2017 - PARIS 7ème - Maison des Associations Quelques échos et commentaires Michelle BONNEBAS Membre d’ArchéoJuraSites. Ce soir nos amis francs-comtois de Paris et d’Île de France redécouvrent les chemins parcourus par César, Vercingétorix, André Berthier et… ArchéoJuraSites. Tout s'éclaire, se met en place, le puzzle se complète. Jean Michel déroule sa conférence avec passion. César défait à Gergovie, se replie vers Langres, puis fuit vers Genève (la “Province”) à travers la Séquanie (il rendra compte de ces évènements de l’année 52 av. J.-C. dans ses Commentaires sur la Guerre des Gaules – le Bellum Gallicum -). Vercingétorix, grand stratège, va chercher à bloquer le romain avant que celui-ci ne parvienne à Genève. Cela commencera par une embuscade de cavalerie à Crotenay, au bord de l’Ain, mais défaite, l’armée gauloise va devoir se retirer dans la cité mandubienne d'Alésia (Chaux-des- Crotenay), jugée “imprenable”, empêchant ainsi César d’aller plus avant et espérant prendre ainsi en tenailles l’armée romaine grâce à une armée gauloise extérieure. André Berthier, depuis Constantine, établit un portrait-robot du site, à partir d’exigences tirées du Bellum Gallicum. Sur le papier, en 1962, il “invente” le site d’Alésia - Chaux des Crotenay sans être jamais venu auparavant dans le Jura. En 1963 il découvre la réalité du site et communique sur sa découverte. Il devra toutefois parcourir un chemin semé d'embûches et d'empêchements de fouilles jusqu'à son décès en décembre 2000. -

Journal De Crotenay 2016
Les Voies du Sel 2015 Départ de Crotenay (Août 2015) Photos : Nicolas Germain, Corentin et Jean-Pierre Chauville Bernard Plantard Éditorial Sommaire 3 - Éditorial 4 - Le mot du Maire ’est toujours avec grand plaisir que nous 5 - Infos diverses - Collectes déchets vous proposons une nouvelle édition du jour- 6 - Merci à Guy - Fleurissement Cnal de CROTENAY. Une fois encore, l’équipe 7 - Travaux à la salle des fêtes de bénévoles n’a pas ménagé ses efforts pour réaliser 8 - Point financier un support d’une grande qualité qui rend compte de la 9 - Etat civil 2015 vie de notre village, du dynamisme de ses associations, 10 - Une année à l’école primaire et des histoires des uns et des autres. 14 - Bibliothèque municipale 15 - Garderie - Cantine A l’heure où l’information va de plus en plus vite, 16 - Fête du village - 11 novembre 2015 sur des supports souvent dématérialisés et dans un en- 17 - Nettoyage de la forêt vironnement en perpétuelle évolution, avec une grande 18 - EREA La Moraine 19 - L’exposition-photos région, des intercommunalités aux contours fluctuants, 20 - Repas des ainés des fusions de communes... il est important de garder 21 - Halloween à Crotenay certains repères et de pouvoir témoigner des actions ré- 22 - Du côté des associations alisées par les diverses sociétés, associations qui ani- 23 - Calendrier des manifestations 2016 ment notre village, qui rythment le calendrier par leurs 24 - La société de musique manifestations et qui œuvrent pour le «vivre ensemble». - Le Club du «Montsaugeon» Comme à l’accoutumé, vous retrouverez les rubriques 25 - Société de pêche consacrées au mot du Maire, à l’état civil, et bien sûr, - Foyer Rural de Crotenay vos libres expressions et témoignages sur des événe- 26 - Association «L’Annie Bis» ments qui vous ont marqués. -

Assainissement Rapport Annuel Délégataire SYNTHESE
SYNTHÈSE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 Service public d’assainissement de Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura Le rappel du cadre de la délégation o Périmètre du service : ANDELOT EN MONTAGNE, ARDON, BIEF DU FOURG, BOURG DE SIROD, CENSEAU, CERNIEBAUD, CHAMPAGNOLE, CHAPOIS, CHARENCY, CHAUX DES CROTENAY, CIZE, CRANS, CROTENAY, CUVIER, DOYE, EQUEVILLON, FONCINE LE BAS, FONCINE LE HAUT, FRAROZ, GILLOIS, LA LATETTE, LE LARDERET, LE MOUTOUX, LE PASQUIER, LE VAUDIOUX, LENT, LOULLE, MIGNOVILLARD, MONNET LA VILLE, MONT SUR MONNET, MONTIGNY SUR L'AIN, MONTROND, MOURNANS CHARBONNY, NEY, NOZEROY, ONGLIERES, PILLEMOINE, PONT DU NAVOY, RIX TREBIEF, SAINT GERMAIN EN MONTAGNE, SAPOIS, SIROD, SUPT, SYAM, VALEMPOULIERES, VANNOZ, VERS EN MONTAGNE o Liste des avenants : Avenant N° Date d'effet Commentaire 4 01/01/2020 Intégration Saffloz, Marigny, Le Frasnois 3 01/01/2018 Intégration des ex-communes de la CC Nozeroy. 2 01/10/2015 Intégration nouveaux ouvrages et équipements 1 24/04/2012 Intégration nouveaux ouvrages Installations de dépollution Nombre de postes de 35 Réseau Déversoirs d’orage refoulement (hors pluvial) Capacité 38 648 éq. Hab. 34 251 km 84 Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura – 2019 2 CHIFFRES CLÉ DU SERVICE Assiette de la redevance Taux de conformité des rejets des stations d’épuration Habitants desservis 838 036 m3 (-0,8%) 21 553 92,4% 72 % en 2018 Volume traité par les stations d’épuration (A3) Taux d’évacuation des boues Abonnés suivant une filière conforme 9 655 (+0,7%) 2 126 513 m3 100% Communauté de Communes Champagnole -

Sirod En 1404
S IROD (39) Extrait du Dictionnaire GEOGRAPHIQUE, HISTORIQUE et STATISTIQUE Des communes de la Franche-Comté De A. ROUSSET Tome VI (1854) Situation : le village est situé sur la rive gauche d la rivière d’Ain, au fond d’un bassin très fertile qu’entoure un cirque de montagnes peu élevées, à travers lesquelles l’Ain s’est frayé un passage. Village de l’arrondissement de Poligny ; canton et perception et bureau de poste de Champagnole ; succursale dont dépendent Lent, Bourg-de-Sirod, Conte et Treffay; à 9 km de Champagnole, 31 km d’Arbois et 43 km de Lons-le-Saunier. Altitude 620 m. Il est traversé par les chemins vicinaux tirant à Crans, Treffay, Gillois, Conte, Charency, Lent, Champagnole, Nozeroy, Syam, et par le chemin de Trémont ; par la rivière d’Ain, les biefs des Cent- Tours et du Mouillet qui y prennent leurs sources, les biefs de Préyat et des Chaux. Communes limitrophes : au nord Conte, Charency et Lent ; au sud Syam, Crans et les Chalesmes ; à l’est Conte, Gillois, Treffay et les Chalesmes ; à l’ouest Lent et Bourg-de-Sirod. La Grange de la Chancelle, le moulin en ruines sur le bief de Préyat, la Scie, le Moulin, la Papeterie et la chapelle font partie de la commune. Les maisons sont groupée, bien bâties en pierres et couvertes en tavaillons ou ancelles, sauf quatre qui ont des toitures en tuiles. Population : en 1790 : 742 habitants ; en 1846, 834 ; en 1851, 833, dont 397 hommes et 436 femmes ; 73 maisons ; 213 ménages. En 2002 : 539 habitants, les « Sirotiers ». -
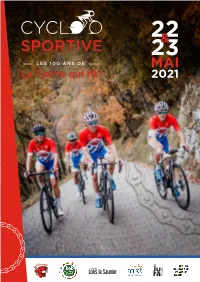
Cyclosportive-Vqr-Ok.Pdf
EDITO Évoquer La Vache qui rit®, c’est partager du partage et de l’innovation le socle de sa du rire et voir les visages s’illuminer partout pérennité. dans le monde. Cet évènement doit porter haut cette identité. C’est unique et c’est une chance formidable Il doit traduire l’énergie qui est la nôtre et que de cultiver et faire grandir une marque inviter chacun à rejoindre ce grand moment positive qui a su s’inscrire dans le quotidien de rire à partager ensemble, aujourd’hui et des familles en France depuis un siècle et pour les 100 ans à venir comme un bien dans plus de 130 pays. précieux qui doit être sauvegardé. Une fabuleuse ambition pour un groupe qui La Vache qui rit® est internationale, conserve ses racines tout en proposant des contemporaine, audacieuse et délicieuse. produits aimés Pour commémorer son anniversaire dans partout dans le le Jura, le Groupe Bel a souhaité proposer monde. un grand rassemblement populaire à Dole et à Lons-le-Saunier, à l’endroit même du premier atelier de la fromagerie là où Jean-Mary l’histoire a commencé pour ce fromage en POUPAT, portion, cette fameuse Vache qui rit®. Directeur du La volonté d’y associer les deux usines du Développement Jura et La Maison de La Vache qui rit® est des activités un marqueur de l’histoire familiale et du non alimentaires vivre ensemble. Mémoire d’une histoire industrielle, ces sites subliment l’ancrage historique de cette marque iconique pour incarner les valeurs de Bel. Un groupe familial qui a su préserver son identité et grandir en faisant de l’ouverture, de la responsabilité, BIEN PLUS QU’UNE 2 - ÉPREUVE CYCLISTE Quoi de plus enivrant que de pédaler l’organisation de cet sur les routes du Jura ? La Cyclosportive événement et de La Vache qui rit® réservera à ses placer le vélo comme participants, de tout âge, tout niveau outil populaire et et venus bien au-delà des frontières promotionnel du de la Région Bourgogne Franche- territoire. -

M Onnet-La-Ville (39)
M ONNET-LA-VILLE (39) Extrait du Dictionnaire GEOGRAPHIQUE, HISTORIQUE et STATISTIQUE Des communes de la Franche-Comté De A. ROUSSET Tome IV (1854) MONNET LA VILLE ( Molneth, Muneth, Mugnet, Mulnet, Munnet, Mulnez ) Village de l’arrondissement de Poligny, canton et bureau de poste de Champagnole, perception de Crotenay; succursale dont dépendent Montigny sur l’Ain et Pont du Navoy. A 10 km de Champagnole, 16 de Poligny, 25 d’Arbois et 27 de Lons le Saunier. Altitude : 506 m. Le territoire est limité au nord par Pont du Navoy, Champagnole et Ney ; au sud par Montigny et Mont sur Monnet ; à l’est par Ney et Mont sur Monnet ; à l’ouest par Pont du Navoy et Montigny. Le Vieux Bourg, Les Maisons du Bois, Barré, La Forge ou le Martine - Paillard, font partie de la commune. Il est traversé par la route départementale n° 2, de Chalon en Suisse ; par les chemins de grande communication n° 27, de Salins à Dortans et40 du Pont du Navoy au Pont de La Chaux des Crotenay ; par les chemins vicinaux tirant à Montigny, au Pont du Navoy à la route départementale n° 2, à la Buchille et de la Maison du Bois au Moulin des Anes ; par la rivière d’Ain, celle de Balerne, le ruisseau du Moulin du Tilleul et celui des Fosses. Le village est situé sur la rive gauche de l’Ain, dans une position agréable. Les maisons sont, les unes groupées, les autres isolées, construites en pierres et couvertes en tuiles ou tavaillons. Elles sont généralement mal bâties et composées d’un simple rez de chaussée. -
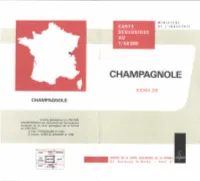
Notice Explicative
NOTICE EXPLICATIVE INTRODUCTION Deux régions naturelles du Jura central existent sur la feuille de Champagnole. Ce sont la zone des plateaux au Nord-Ouest et le Haut-Jura au Sud-Est. La zone des plateaux est largement représentée et comprend deux régions distinctes : les plateaux de Lons-le-Saunier — Champagnole (d'altitude moyenne 500 à 600 m envi ron) et de Châtelneuf — Nozeroy (d'altitude moyenne 750 à 800 m environ). Une partie du plateau de Lons-le-Saunier existe dans l'angle nord-ouest de la feuille. Elle est séparée du plateau de Champagnole par la chaîne de la forêt de l'Heute dont le relief souvent vigoureux est bien visible dans la morphologie. La vallée de l'Ain qui entaille le plateau de Champagnole depuis les Forges de Syam limite, sensiblement, vers le Nord le plateau de Châtelneuf. La butte du Mont Rivel forme, au nord de Champagnole, un témoin correspondant à ce plateau dont les bordures ouest et nord sont parfois profondément découpées par l'érosion (lacs de Chambly et de Chalain, Ferme de Balerne, Ney...). Le plateau de Nozeroy forme la partie nord-orientale de la feuille. Il est séparé des plateaux de Châtelneuf et de Champagnole par la chaîne du faisceau de Syam. Les reliefs parfois jeunes de cette chaîne sont orientés Nord-Sud. Au Sud cependant, ce faisceau, entaillé par les gouttières où sont logés les lacs de la région de Narlay, vient former la limite entre le plateau de Châtelneuf et le Haut-Jura. Le Haut-Jura n'est représenté que par les montagnes de la Haute-Joux et du Mont- Noir qui encadrent la grande dépression de Foncine. -

Promenades Jurassiennes
Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne, 4, 2006 – Société Botanique de Franche-Comté Promenades jurassiennes par Jean-François Prost Jean-François Prost, 16 rue du Revermont F-39230 Chaumergy n 2005, la Fédération des chas- ● Alopecurus rendlei Eig ● Bromus racemosus L. seurs du Jura décidait de recen- Plante typique encore fréquente Accompagne Alopecurus rendlei Eser les lieux humides du dépar- dans la vallée de la Brenne et de dans les vallées de la Brenne et de tement de moyenne superficie, entre ses affluents, de Vers-sous-Sellières ses affluents, de l’Orain et de la 1 000 et 10 000 m2, et non déjà réper- à Rye, puis en Saône-et-Loire. Paraît Grozonne avec la même répartition : toriées par la Direction Régionale de plus rare dans les autres vallées de abondant dans les premières, plus l’Environnement de Franche-Comté la Bresse. Vue à Villers-les-Bois le rare dans les autres. Noté à Villers- (DIREN). Elle engageait pour cela 15 mai 2006 et à Grozon le 16 mai les-Bois le 15 mai 2006 et à Grozon une stagiaire avec un double objec- 2006. le 16 mai 2006. Au 19e siècle, il était tif : d’abord, contacter les associa- confondu avec le précédent. tions locales pour porter ces zones ● Bidens frondosa L. sur des cartes au 1/25 000e ; ensuite, Les recherches en Dombes avec ● Bunias orientalis L. les parcourir pour dresser la liste des M. André et Y. Ferrez nous ont Après une période de rapide exten- espèces végétales reconnaissables montré que ce taxon nord-améri- sion dans les années 1970-1980, la lors de la visite. -

Nƒ 1 Janvier 2010
PREFECTURE DU JURA I.S.S.N. 0753 - 4787 8 RUE DE LA PREFECTURE - 39030 LONS LE SAUNIER CEDEX - : 03 84 86 84 00 - TELECOPIE : 03 84 43 42 86 - INTERNET : www.jura.pref.gouv.fr 2 CABINET....................................................................................................................................................................................4 Arrêté n° 002 du 1 er janvier 2010 - médaille d’honneur agricole.........................................................................................4 Arrêté n° 001 du 1 er janvier 2010 - médailles d’honneur régionale, départementale et communale ...................................5 Arrêté n° 003 du 1 er janvier 2010 - médaille d’honneur du travail ....................................................................................21 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES AFFAIRES JURIDIQUES ...........................................................51 Arrêté n° 20 du 7 janvier 2010 fixant la liste des agents affectés à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Jura.................................................................................................................................51 Arrêté n° 18 du 7 janvier 2010 portant DELEGATION DE SIGNATURE à Madame Sylvie HIRTZIG, directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations .......................................................................54 Arrêté n° 19 du 7 janvier 2010 portant délégation de signature au titre de l’article -

Crotenay De Besain Et Des Faisses, Et Par Le Pont-Du-Navoy
C ROTENAY (39) Extrait du Dictionnaire GEOGRAPHIQUE, HISTORIQUE et STATISTIQUE Des communes de la Franche-Comté De A. ROUSSET Tome II (1854) Crotonacum, Crotonay, Crothenay, Crotena, village de l'arrondissement de Poligny, canton et bureau de poste de Champagnole, chef-lieu de perception ; succursale ; à 10 km de Champagnole , 17 de Poligny, 28 d'Arbois et 26 de Lons-le-Saunier. Altitude : 553m. Le territoire est limité au nord par Besain, Montrond et Ardon, au sud par le Pont-du-Navoy et Champagnole, à l'est par Montrond, Ardon et Champagnole, à l'ouest par la montagne de l'Heute, qui sépare Crotenay de Besain et des Faisses, et par le Pont-du-Navoy. La Pratz et le Moulin font partie de la commune. Il est traversé par les chemins de grande communication n° 5, de Bletterans à Champagnole, et 27, de Salins à Dortans ; par les chemins vicinaux tirant au Pont-du-Navoy, à Montrond, à Ardon, au hameau de la Pratz, à la côte de l'Heute, à Champagnole, de la Pratz à Champagnole et à Ardon ; par le ruisseau du moulin. Les rivières d'Ain, et d'Angillon ne font que longer ce territoire au sud. Le village fait partie du bassin de l'Ain, et s'élève sur la rive droite de cette rivière. Il est entouré de montagnes de trois côtés. Les maisons sont généralement groupées et de chétive apparence. Elles sont bâties en pierre et couvertes en bardeaux. Les plus belles sont couvertes en tuiles. On y remarque la maison de M. le comte Moreau de Faverney, qui habite Versailles. -

Communauté De Communes Champagnole Nozeroy Jura Conseillers Communautaires Titulaires (T) Et Suppléants
Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura Conseillers communautaires titulaires (T) et suppléants (S) ANDELOT EN MONTAGNE Monsieur CHAMBAUD Rémi T Monsieur VOLPOET Pascal S ARDON Madame MARTIN Chantal T Monsieur DOLE Michel S ARSURE ARSURETTE Madame ROUSSET Catherine T Madame BAILLY Chantal S BIEF DES MAISONS Monsieur MATHIEU Daniel T Monsieur MIDOL Franck S BIEF DU FOURG Monsieur PARENT Claude T Monsieur LHOMME Denis S BILLECUL Monsieur COURVOISIER Gérald T Monsieur DEVOUGE Jack S BOURG DE SIROD Monsieur BREUIL Philippe T Monsieur THEVENIN Frédéric S CENSEAU Monsieur BREGAND Pierre T Monsieur BARTHELET Rachel S CERNIEBAUD Monsieur ALPY David T Monsieur CORDIER Bruno S CHALESMES (LES) Monsieur CLEMENT Didier T Madame SIMARD Fabienne S CHAMPAGNOLE Monsieur PERNOT Clément T Madame MARTIN Annelise T Monsieur DUSSOUILLEZ David T Madame BAILLY Arielle T Madame DELACROIX Véronique T Monsieur SAILLARD Guy T Madame BENOÎT Ghislaine T Monsieur GRENIER Pascal T Madame TBATOU Rahma T Monsieur BONJOUR Sébastien T Madame BADOR Sandrine T Monsieur BINDA Pierre T Madame DOUARD Catherine T Monsieur CUSENIER Alain T Madame ROUSSEAU DAVID Catherine T Monsieur VUILLEMIN Joël T Madame MILLET Laurence T Monsieur BERNARD Antoine T Monsieur DUPREZ Jean-Louis T Monsieur LENG Stéphane T Madame GUICHARDIERE Catherine T Monsieur TISSOT Pascal T Madame FILIPPI Brigitte T CHAPOIS Monsieur TRIBUT Jean-Noël T Monsieur MOUREY Gilles S CHARENCY Monsieur BOURGEOIS Fabrice T Monsieur DOLE Eric S CHATELNEUF Monsieur RAGOT Bruno T Monsieur BUFFARD Marc S CHAUX DES -

Jura Schéma Régional Eolien | Liste Des Communes Du Jura
Schéma Régional Éolien | Liste des communes du Jura Schéma Régional Eolien | Liste des communes du Jura Abergement-la-Ronce Les Chalesmes Crans Ivrey Montholier Pupillin Trenal Abergement-le-Grand Chambéria Crenans Jeurre Montigny-lès-Arsures Quintigny Uxelles Abergement-le-Petit Chamblay Cressia Jouhe Montigny-sur-l'Ain Rahon Vadans Abergement-lès-Thésy Chamole Crissey Lac-des-Rouges-Truites Montmarlon Rainans Val-d'Épy Aiglepierre Champagne-sur-Loue Crotenay Ladoye-sur-Seille Montmirey-la-Ville Ranchot Valempoulières Alièze Champagney Les Crozets Lains Montmirey-le-Château Rans Valfin-sur-Valouse Amange Champagnole Cuisia Lajoux Montmorot Ravilloles Vannoz Andelot-en-Montagne Champdivers Cuttura Lamoura Montrevel Recanoz Varessia Andelot-Morval Champrougier Cuvier Le Larderet Montrond Reithouse Le Vaudioux Annoire Champvans Dammartin-Marpain Largillay-Marsonnay Mont-sous-Vaudrey Relans Vaudrey Arbois Chancia Damparis Larnaud Mont-sur-Monnet Les Repôts Vaux-lès-Saint-Claude Archelange La Chapelle-sur-Furieuse Dampierre Larrivoire Morbier Revigny Vaux-sur-Poligny Ardon Chapelle-Voland Darbonnay Le Latet Morez Rix Vercia Aresches Chapois Denezières La Latette Mouchard La Rixouse Verges Arinthod Charchilla Le Deschaux Lavancia-Epercy La Mouille Rochefort-sur-Nenon Véria Arlay Charcier Desnes Lavangeot Mournans-Charbonny Rogna Vernantois Aromas Charency Dessia Lavans-lès-Dole Les Moussières Romain Le Vernois Arsure-Arsurette Charézier Les Deux-Fays Lavans-lès-Saint-Claude Moutonne Romange Vers-en-Montagne Les Arsures La Charme Digna Lavans-sur-Valouse