La Chine En 2014 ❮ 19
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

P7int Layout 1
TUESDAY, JULY 5, 2016 UK Independence Fallujah victory takes on sectarian tones Party chief Nigel Farage quits Page 8 Page 10 GURGAON, India: Relatives and friends console the mother of Tarishi Jain, one of the victims of the attack on Dhaka’s Holey Artisan Bakery, as they take her for cremation on the outskirts of New Delhi yesterday. — AP Some B’desh hostages questioned Families of cafe victims take bodies home NEW DELHI: Some of the hostages rescued from backgrounds of the five people and questioning attacks to hit Bangladesh - has stunned the tradi- editorial. “What is not clear is whether, after such mats from Italy, Japan and other countries lay the weekend attack on an upscale restaurant in their family and friends. tionally moderate Muslim nation and raised glob- overwhelming evidence of their presence, the flower wreaths beside the coffins holding the Bangladesh’s capital were being questioned yes- It was not clear if all five were suspects, or if al concerns about whether it can cope with the official line will be one of denial?” three Bangladeshi victims. terday by investigators searching for clues about they were being held and questioned simply increasingly strident Islamist militants. That the Bangladesh police have said they are investi- The coffins were draped in the Bangladeshi the possible masterminds behind the gruesome because authorities thought they might offer attackers targeted a popular restaurant in the gating whether the attackers had links with the flag - a red disc on a green background. That of attack that left 28 dead, including many foreign- useful information in tracing the origins of the heart of the diplomatic quarter of Bangladesh’s extremist Sunni Muslim group based in Syria and Emory University student Abinta Kabir, a Miami ers. -
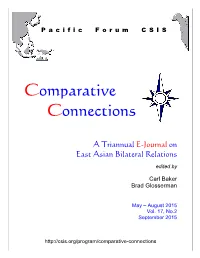
Comparative Connections, Volume 17, Number 2
Pacific Forum CSIS Comparative Connections A Triannual E-Journal on East Asian Bilateral Relations edited by Carl Baker Brad Glosserman May – August 2015 Vol. 17, No.2 September 2015 http://csis.org/program/comparative-connections Pacific Forum CSIS Based in Honolulu, Hawaii, the Pacific Forum CSIS operates as the autonomous Asia- Pacific arm of the Center for Strategic and International Studies in Washington, D.C. Founded in 1975, the thrust of the Forum’s work is to help develop cooperative policies in the Asia- Pacific region through debate and analyses undertaken with the region’s leaders in the academic, government, and corporate arenas. The Forum’s programs encompass current and emerging political, security, economic/business, and oceans policy issues. It collaborates with a network of more than 30 research institutes around the Pacific Rim, drawing on Asian perspectives and disseminating its projects’ findings and recommendations to opinion leaders, governments, and publics throughout the region. An international Board of Governors guides the Pacific Forum’s work. The Forum is funded by grants from foundations, corporations, individuals, and governments, the latter providing a small percentage of the forum’s annual budget. The Forum’s studies are objective and nonpartisan and it does not engage in classified or proprietary work. Comparative Connections A Triannual E-Journal on East Asian Bilateral Relations Edited by Carl Baker and Brad Glosserman Volume 17, Number 2 May – August 2015 Honolulu, Hawaii September 2015 Comparative Connections A Triannual Electronic Journal on East Asian Bilateral Relations Bilateral relationships in East Asia have long been important to regional peace and stability, but in the post-Cold War environment, these relationships have taken on a new strategic rationale as countries pursue multiple ties, beyond those with the US, to realize complex political, economic, and security interests. -

China's Political Ecology and the Fight Against Corruption
China’s Political Ecology and the Fight against Corruption Joseph Fewsmith Since the 18th Party Congress convened in November 2012, China has undertaken a wide-ranging campaign against corruption. The campaign has gone on longer, cut deeper, and affected more people than anyone might have imagined two years ago. The course of the campaign has exposed in considerable depth many of the ills of political life in China. Although it seems intended to break up many of the “small circles” that pervade China’s political life, there is no question that the campaign has focused particular attention on the networks around Zhou Yongkang, the former head of China’s security forces, and Ling Jihua, the former head of the General Office. China’s leadership has promised the campaign will continue, so there are likely to be more surprises; perhaps one or more new “tigers” will be exposed. China’s fight against corruption really began with the conviction of Bo Xilai (薄熙来), the former party secretary of Chongqing municipality and an apparent contender for a seat on the party’s powerful Politburo Standing Committee (PBSC). But since Bo’s case was concluded prior to the 18th Party Congress, he is not mentioned in the running tab the People’s Daily website has maintained of ministerial-level cadres who have been taken in for investigation, and he is rarely mentioned in media articles discussing corruption. Perhaps the relative silence surrounding the Bo Xilai case since the 18th Party Congress is intended to minimize the political nature of the current campaign, though the recent arrest of Zhou Yongkang (周永康), the retired former head of the security apparatus, inevitably raises questions about Bo and politics in general. -

China Meets UN Commitment to Poverty Relief
NATION: SHANGHAI STAMPEDE DEVASTATES P.26 | BUSINESS: E-BANKS CASH IN P.32 VOL.58 NO.3 January 15, 2015 WWW.BJREVIEW.COM FRUITFUL EFFORTS China meets UN commitment to poverty relief RMB6.00 USD1.70 AUD3.00 GBP1.20 CAD2.60 CHF2.60 JPY188 邮发代号2-922·国内统一刊号:CN11-1576/G2 VOL.58 NO.3 JANUARY 15, 2015 CONTENTS EDITOR’S DESK BUSINESS 02 China and the MDGs 34 The Market Calls the Shots China kicks off 2015 with price reform THIS WEEK 36 SOE Fast 14 State-owned enterprises are getting COVer StorY better, faster 18 A Developing Vision COVER StorY 38 Market Watch UN member states prepare new agenda CULTURE WORLD 42 ‘Marco Polo’ Rebooted 22 Is a Cyberwar Coming? Netflix goes international with new series Sony hacking raises concerns Rising Out of Poverty FORUM NATION China reaches UN-set goal 46 Should We Use Child Endorsers? 28 Better and Better Muslim Chinese keep the culture alive ESSAY 29 Rich in Tradition WORLD 48 Lessons From the Shanghai Stampede Islam factors into China today Tragedy calls to mind security’s P.20 | Positivity on the Peninsula importance Beijing-Seoul relations are on the rise nation P.26 | A New Year’s Nightmare Shanghai reels from New Year tragedy Cover Photo: A farmer rejoices in his full persimmon crop in Fuping County, northwest China’s Shaanxi Province, in November 2014 (TAO MING) BUSINESS P.32 | A Small Bank Makes a Big Difference ©2015 Beijing Review, all rights reserved. Internet banks see an auspicious future www.bjreview.com Follow us on BREAKING NEWS » SCAN ME » Using a QR code reader Beijing Review (ISSN 1000-9140) is published weekly for US$64.00 per year by Cypress Books, 360 Swift Avenue, Suite 48, South San Francisco, CA 94080, Periodical Postage Paid at South San Francisco, CA 94080. -

TIBET INSIGHT NEWS December 15-31, 2014
TIBET INSIGHT NEWS December 15-31, 2014 POLITICAL NEWS Sixth Plenary Meeting of TAR Party Committee December 31, 2014 The TAR Party Committee held its sixth plenary meeting in Lhasa on December 30. Those attending included TAR Party Secretary Chen Quanguo, TAR People‟s Government Chairman and Deputy Secretary of TAR Party Committee Lobsang Gyaltsen, Deputy Secretary of TAR Party Committee Wu Yingjie, Deputy Secretary of TAR Party Committee Deng Xiaogang and Members of the TAR Party Committee Standing Committee Choedak, Dong Yunhu, Wang Yongjun and Wan Ming. The meeting reviewed the Work Report for 2014 and discussed the implementation of the CCP CC‟s policies in the previous TAR plenary sessions. The Plenum reaffirmed the Party Committee‟s policies against separatist activities, holding high the banner of socialism with Chinese characteristics, thoroughly implementing General Secretary Xi Jinping‟s series of speeches, maintaining long term stability and winning over the hearts of the people in Tibet, to carry out the Party‟s Mass line campaign comprehensively. In his speech Chen Quanguo asked the Regional and Government organization leaders, members and cadres to take General Secretary Xi Jinping‟s speeches as the “guiding principle” and use it comprehensively to promote the rule of law. He stressed that economic development and a well off society are the fundamental requirement to achieve overall social stability. He urged everyone to develop all means to improve the livelihood of people in Tibet. China’s UFWD Minister under investigation for corruption December 22, 2014 China‟s Minister in the CCP CC‟s United Front Work Department (UFWD), which handles relations with non-party organizations and Tibet, is under investigation for corruption. -
2016 May Tibet Digest
Tibet Digest May 2016 FOUNDATION FOR NON-VIOLENT ALTERNATIVES Www.Fnvaworld.Org TIBET DIGEST, MAY 2016 ! !1 May 2016 1 China’s Minority Policies 9 New city inaugurated in Tibet 9 Rights abuse allega6ons in Tibet groundless: Chinese media 9 China Pouring Billions Into Majority Tibetan Ganzi Prefecture 10 Lhasa passes a law to protect ancient villages 11 Tibetans Protest Unsafe Condi6ons in Their Town in Draggo 12 China’s Centuries-long Secret War on MuslimsOZY.COM 12 Panchen Lama visits Jokhang Temple 13 Over 100,000 Tibetan an6ques digitally documented 13 China Pressures Europe to Stay Silent on Human Rights 14 Kardze Mine Work Halted Pending 'Resolu6on' of Community Concerns 15 China's Youth League Sends 4,500 Volunteers to Tibet in 13 Yrs 15 Detenon and Self-immolaon 16 Tibetan Former Prisoner Vanishes Into Custody Again 16 Over a Hundred Tibetans Launch New Protest Against Gold Mine in Gansu 16 Tibetans in Ngaba Warned Over An6-Mine Protests 17 Chinese Police Hold Herders Who Staged a Sit-in at Construc6on Site 17 China: Repression Expands Under ‘Stability Maintenance’ in Tibetan Areas 18 Tibetan Prisoner's Family Fears For His Health 20 China Holds Ac6vist Who Helped Lawyers' Son on 'Smuggling Charges' 20 Detained Tibetan Monk Had Photo Taken With Banned Na6onal Flag 21 Six Months On, No Sign of Repatriated Chinese Poli6cal Refugees 22 Death of Man in Police Custody Sparks Anger, Raises Doubts in Beijing 23 China Officially Jails Two Rights Ac6vists Ager Three Years of Unofficial Deten6on 24 Uyghur Given 7-Year Prison Term For Viewing -

KT 5-7-2016.Qxp Layout 1
SUBSCRIPTION TUESDAY, JULY 5, 2016 RAMADAN 30, 1437 AH www.kuwaittimes.net Accidents caused Director explains Fantastic France Rich kids who Ramadan TImings by cattle on the Community Police end Iceland Euro grew up to be Emsak: 03:09 rise in Kuwait responsibilities 2016 dream run Islamic militants Fajer: 03:19 Shrooq: 04:53 Dohr: 11:52 Asr: 15:26 Maghreb: 18:51 3 6 20 12 Eshaa: 20:22 Kuwait busts three IS Min 32º Max 47º cells plotting attacks High Tide 00:08 & 10:48 Low Tide 5 Kuwaitis arrested, including a policeman, woman arrested 05:20 & 18:31 40 PAGES NO: 16925 150 FILS KUWAIT: Kuwaiti security authorities have broken up three Islamic State cells plotting ‘terror’ attacks in the oil-rich Gulf state, the Interior Ministry said yesterday. Five Kuwaiti nationals were arrested, including a police- man and a woman, who all confessed to plotting attacks against a Shiite mosque and an Interior Ministry target, the Ministry said in a statement. All members of the three cells also confessed to being members of the Islamic State jihadist group. Kuwaiti police are still looking for a Gulf man and an Asian who assisted one of the cells, the Ministry said. The action against the Islamist cells comes a year after an IS-linked Saudi suicide bomber blew himself up in a Shiite mosque, killing 26 worshippers in the worst Hessa Abdullah Ali Mohammad Omar Talal Naif Raja attack in Kuwait. A court sentenced one man to death and jailed eight others for assisting the Saudi bomber. Among those arrested in the latest police action was 18-year-old Talal Raja who confessed to have been plot- ting a suicide attack against a Shiite mosque and an Interior Ministry installation by the end of the Muslim fasting month of Ramadan today, the ministry said. -
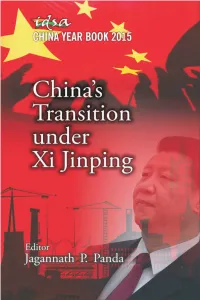
China's Transition Under Xi Jinping
CHINA’S TRANSITION UNDER XI JINPING CHINA’S TRANSITION UNDER XI JINPING Editor Jagannath P. Panda Foreword by Jayant Prasad Director General Institute for Defence Studies and Analyses INSTITUTE FOR DEFENCE STUDIES & ANALYSES NEW DELHI PENTAGON PRESS China’s Transition under Xi Jinping Editor: Jagannath P. Panda First Published in 2016 Copyright © Institute for Defence Studies and Analyses, New Delhi ISBN 978-81-8274-907-8 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without first obtaining written permission of the copyright owner. Disclaimer: The views expressed in this book are those of the authors and do not necessarily reflect those of the Institute for Defence Studies and Analyses, or the Government of India. Published by PENTAGON PRESS 206, Peacock Lane, Shahpur Jat, New Delhi-110049 Phones: 011-64706243, 26491568 Telefax: 011-26490600 email: [email protected] website: www.pentagonpress.in In association with Institute for Defence Studies and Analyses No. 1, Development Enclave, New Delhi-110010 Phone: +91-11-26717983 Website: www.idsa.in Printed at Avantika Printers Private Limited. Contents Foreword by Shri Jayant Prasad, Director General, IDSA ix Acknowledgement xi List of Contributors xiii 1. China in 2015: A Primer 1 Jagannath P. Panda I. POLITICS AND SECURITY 2. China’s Domestic Politics: Promises and Pitfalls 9 Avinash Godbole 3. Chinese Society: The ‘Story’ Continues 21 Gunjan Singh 4. China’s Approach to Terrorism, Separatism and Extremism 35 Neha Kohli 5. Reform and Restructuring: Chinese Military in Transition 51 M.S.