Plan Local D'urbanisme
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Collège G. POMPIDOU V.3
Collège G. POMPIDOU V.3 Circuits & Horaires du Collège d'Orgerus A partir du jeudi 1er septembre 2016 Les circuits spéciaux scolaires sont accessibles uniquement aux élèves munis de cartes de transport Optile Scolaire Circuits Spéciaux. Les formulaires de ces cartes sont disponibles dans chacune des mairies. Liste des communes desservies pour le Collège G. POMPIDOU d'Orgerus : BAZAINVILLE HARGEVILLE PRUNAY LE TEMPLE BEHOUST MULCENT SEPTEUIL COURGENT ORGERUS SAINT MARTIN DES CHAMPS FLEXANVILLE ORVILLIERS TACOIGNIERES GOUPILLIERES OSMOY ######## Pour rappel, votre carte Scol'R est obligatoire lors de Horaires consultables et téléchargeables sur : votre trajet sur les circuits scolaires Etablissement de Houdan ZAC de la Prévôté De plus, vous avez la possibilité de vous inscrire à l'alerte Route de Bû e-mail qui vous avertira lors de situations perturbées. 78550 HOUDAN V.3 Collège G. POMPIDOU Circuits & Horaires du Collège d'Orgerus A partir du jeudi 1er septembre 2016 Jours et périodes de fonctionnement en période scolaire uniquement, 1ères Entrées Matin Lundi au Vendredi (sauf jours fériés) Circuit 3801 Circuit 3804 Circuit 3807 BAZAINVILLE Grande Rue 07:42 SEPTEUIL St Wandrille 07:45 HARGEVILLE Arrêt des cars 07:40 BAZAINVILLE Guignonville 07:44 SEPTEUIL Mairie 07:50 GOUPILLIERES Car. Jumeauville 07:45 BAZAINVILLE La Pommeraie 07:45 OSMOY Mairie 08:00 GOUPILLIERES Vallée Penault 07:47 BAZAINVILLE Le Gassé 07:47 OSMOY Pré Clos 08:02 FLEXANVILLE Ferranville 07:51 LE FRANC-MOREAU 07:50 ORGERUS Collège 08:10 FLEXANVILLE Tessé 07:53 TACOIGNIERES -

Circonscriptions Législatives Des Yvelines
CIRCONSCRIPTIONS LÉGISLATIVES DES YVELINES Gommecourt Moisson Lainville Limetz Villez en Vexin Port Mousseaux Drocourt Villez Freneuse Montalet Bennecourt sur Seine le Bois Blaru Sailly St Martin Jambville Jeufosse La Garenne Fontenay Bonnières-sur-Seine St Père Brueil en Oinville sur Follainville Tessancourt Lar Villeneuve Vexin Montcient Chauffou Rolleboise Dennemont sur Aubette s BonnièreEns Chevrie Guernes Le Evecquemont Hardrcourt Vaux sur Seine Guitrancourt Mézy sur Meulan Seine Mantes-la- Limay Juziers Conflans Ste Lommoye Rosny sur Seine Maurecourt Honorine Jolie Gargenville Cravent Issou Les Mureaux Verneuil Triel Buchelay Andresy Sur Seine Sur St Illiers Perdreauville Achères Mantes SeineChanteloup La Ville Jouy Porcheville Flins la Ville Les Vignes Boissy Mauvoisin Magnanville Sur St Illiers Mauvoisin Seine Chapet Vernouillet Fontenay Epône Bouafle Le Bois Mézières Ménerville Mauvoisin Auffreville Guerville Sur Seine Soindres Aubergenville Médan Carrières Maisons Breval Brasseuil sous Ecquevilly Laffitte Le Tertre Favrieux Breuil Poissy Vert Bois Sartrouville St Denis x Boinville Villennes u Robert e Neauphlette Flacourt En Mantois Morainvilliers u Aulnay sur Bazemont Sur Seine q Villette r Longnes Mauldre u Houilles Poissy o Goussonville F - Boinvilliers Les Alluets e Dammartin y Montesson Le Roi Orgeval a en Serve Arnouville L Rosay - Carrières Les Mantes n Maule e Mondreville Jumeauville - sur Seine in Herbeville a Courgent m Aigremont r Chatou Flins Hargeville e Mareil sur G - Neuve Montchauvet Andelu Chambourcy t Le Vésinet -
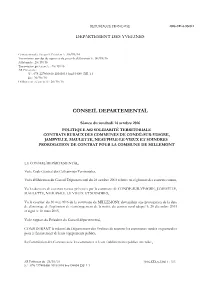
Délibération
REPUBLIQUE FRANÇAISE 2016-CD-6-5360.1 DEPARTEMENT DES YVELINES Convocation des élus par le Président le : 06/09/16 Transmission aux élus du rapport et du projet de délibération le : 30/09/16 Affichage le : 26/10/16 Transmission préfecture le : 26/10/16 AR Préfecture : N° : 078-227806460-20161014-lmc194004-DE-1-1 Du : 26/10/16 Délibération exécutoire le : 26/10/16 CONSEIL DEPARTEMENTAL Séance du vendredi 14 octobre 2016 POLITIQUE A02 SOLIDARITÉ TERRITORIALE CONTRATS RURAUX DES COMMUNES DE CONDÉ-SUR-VESGRE, JAMBVILLE, MAULETTE, NEAUPHLE-LE-VIEUX ET SOINDRES PROROGATION DE CONTRAT POUR LA COMMUNE DE MILLEMONT LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Vu la délibération du Conseil Départemental du 24 octobre 2003 relative au règlement des contrats ruraux, Vu les dossiers de contrats ruraux présentés par la commune de CONDE-SUR-VESGRE, JAMBVILLE, MAULETTE, NEAUPHLE-LE-VIEUX ET SOINDRES, Vu le courrier du 30 mai 2016 de la commune de MILLEMONT demandant une prorogation de la date de démarrage de l’opération de réaménagement de la mairie du contrat rural adopté le 20 décembre 2013 et signé le 10 mars 2015, Vu le rapport du Président du Conseil départemental, CONSIDERANT la volonté du Département des Yvelines de soutenir les communes rurales en particulier pour le financement de leurs équipements publics, Sa Commission des Contrats avec les communes et leurs établissements publics entendue, AR Préfecture du : 26/10/16 2016-CD-6-5360.1 : 1/3 N° : 078-227806460-20161014-lmc194004-DE-1-1 APRES EN AVOIR DELIBERE ACCORDE une subvention de 129 500 € au titre d’un contrat rural à la commune de CONDE-SUR- VESGRE en fixant sa participation financière selon le tableau figurant en annexe de la présente délibération. -

Le Dossier Départemental Des Risques Majeurs (DDRM) Recense, À Partir Des Travaux Réalisés Par L’Ensemble Des Services
Dossier Départemental sur les Risques Majeurs Edition 2015 SOMMAIRE Les Risques Majeurs et leur prévention P.5 Qu'est-ce qu'un risque majeur.........................................................................P.6 Contexte juridique.............................................................................................P.7 La prévention des risques majeurs..................................................................P.8 La vigilance météo......................................................................................P.9-11 La prise en compte des risques dans l'aménagement................................P.12 L'information des acquéreurs et des locataires (IAL).............................P.13-14 L'alerte des populations..................................................................................P.15 L'organisation de la sauvegarde et du secours......................................P.16-17 Les consignes individuelles de sécurité.........................................................P.18 Les catastrophes naturelles et technologiques.......................................P.19-20 Tableau des communes soumises aux risques........................................P.21-26 Les Risques Naturels P.27 Le risque Inondation.....................................................................................P.28-40 Le risque mouvement de terrain.................................................................P.41-54 Le risque sismique..............................................................................................P.55 -

Règlement Du Contrat De Développement De L'offre Résidentielle
Annexe Règlement du contrat de développement de l'offre résidentielle 1. La définition des contrats de développement de l'offre résidentielle Le contrat de développement de l'offre résidentielle est un dispositif exceptionnel qui vise sur la période 2006-2013 le développement de l'offre de logement dans le Département dans l'objectif de rattraper le niveau de construction historiquement bas des années 2000-2004 et de corriger le déséquilibre de la répartition de l'effort de construction qui a entraîné une diffusion mal maîtrisée en secteurs périurbain et rural et des soldes migratoires négatifs dans la partie dense des Yvelines. Le contrat de développement de l'offre résidentielle apporte une aide aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui s’engagent dans la production d'une offre nouvelle de logements diversifiée en terme de typologie et de conditions d'accès, dans le respect des objectifs poursuivis par le schéma départemental d’aménagement pour un développement équilibré dans les Yvelines (SDADEY). Il s'agit d'une aide globale qui doit aider la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à faire face aux conséquences de son développement, lui laissant le choix d'une mobilisation sur des investissements permettant d'équilibrer la sortie des opérations ou la réalisation d'équipements et d'espaces publics de proximité liés à ces projets. Négocié et conclu sur la base d'une analyse du marché local du logement, à l'échelle du bassin de vie dans lequel s'inscrit la commune, et des capacités effectives de développement de l'urbanisation, le contrat de développement de l'offre résidentielle fixe des objectifs de production de logements sur 3 à 6 ans déclinés par type en fonction des besoins du territoire, expose les objectifs poursuivis en matière de qualité urbaine et architecturale et précise l'engagement de la collectivité en matière d'urbanisme et d'action foncière pour atteindre ses objectifs. -

61 Secteur Houdan
Porier La Belle Godard Côte Lavoir Le Tertre-Saint-Denis 91 4 Vernon Saint-Adjutor 89 Bréval Bréval 91 89 91 Bréval 91 Magnanville Lycée L. S. Senghor Gare Routière de Mantes-la-Ville Gare routière Gare 61 89 91 88 60 78 Gare routière de Mantes-la-Ville Gare de Nézel Aulnay 13 Gare des Mureaux 18 Plan de réseau 91 Poissy Peugeot de Mantes-la-Ville de Mantes-la-Jolie 89 Le Tertre 90 Gare de Mantes-la-Jolie Place Saint-Denis Mantes-la-J. Grande Petite Auffreville Mareil-sur- Louise Henry Gamacherie Gare Routière de Mantes-la-Ville Auffreville- Gamacherie Démonderie 88 Poissy Peugeot Chapelle Saint Boinville- Secteur Houdan Église 89 Mauldre Saint-Illiers- Le Pelleray 91 Brasseuil Brasseuil Barthélemy en-Mantois le-Bois Place Mulottes Gare de Maule 4 Perdreauville Breuil- des Tilleuls Favrieux Novembre 2016 Transports en Île-de-France Ménerville Bois- Mairie Bossus D 114 Robert N 191 D148 D114 Devins Thiron Rue des Bossets Vert Gare13 de14 Beynes18 Route du Tertre Goussonville Boissy- Église Pré Rollet Scellée 89 01 13 Justice Bréval Butte 1 Mauvoisin Paul Barré 95 Abri bus Butte 2 90 Maule Hamel Abri bus Jumeauville 91 D 11 D 65 89 Le Tertre- 18 Neauphlette D 928 93 Vert D 110 Route de Boinvilliers D 170 Villette Maurice Chardonnière Église Saint-Denis D 983 Village Flacourt Cayen Maurice Cayen 75 D 89 Mairie 61 Clos Marquet 92 Pharmacie Gare de Bréval 88 4 D 11 94 89 90 91 TER Normandie 77 91 78 Place Collège Rue Saint-Martin du Tranchant Les Nénuphars 4 89 89 Église Gare de Mareil- La 91 Église sur-Mauldre Saint-Aignan Puce 89 91 78 Montainville -

VILLETTE Bulletin 16 Municipal
PISCICULTURE DE VILLETTE Bulletin 16 Municipal www.villette-en-yvelines.fr VILLETTE 78930 COURS DE KARATÉ YOSEIKAN BUDO À LA SALLE DES FÊTES DE VILLETTE TOUS LES MERCREDIS APRÈS-MIDI POUR ENFANTS ET ADULTES. HORAIRES DES COURS : • 5-9 ANS, DE 16:00 À 17:00 • 10-13 ANS, DE 17:00 À 18:00 • ADULTES (+14 ANS), DE 18:30 À 19:45. CONTACT PIERRE LEMAIRE 06 62 43 28 16 éditorial Avec cette nouvelle année qui commence, il est plus que jamais nécessaire de regarder vers l’avenir sans trop se focaliser sur le passé et SOMMAIRE ce qu’il peut avoir de négatif. - Éditorial __3 - Il n’est pas toujours facile de bien gérer les choses, tant au local qu’à Organisation administrative l’international, mais les raisons positives pour aller de l’avant ne & communale __4 manquent pas, tout en s’appuyant sur les expériences vécues, bonnes ou - mauvaises. Attributions associées __5 - Après des festivités communales modestes, mais réussies, avec un repas Un peu d’histoire __6 des Anciens toujours très chaleureux et un spectacle de Noël pour les - enfants attrayant et dynamique, nous allons reprendre le cours de nos Les 120 ans activités et continuer à œuvrer pour le bien de la commune et de ses de la pisciculture __11 habitants. - Plan de la commune __12 La réalisation progressive des travaux nécessaires (aménagement de - la mairie pour l’accès aux handicapés), l’embellissement de l’espace Journée voitures anciennes, à poursuivre (fleurissement diversifié), l’intégration croissante dans aquarelles et peintures __16 les actions collectives de la Communauté de Communes du Pays - Houdanais (collecte des déchets, fauchage différencié…) seront des L’Association Seconde Vie pour axes dominants de cette nouvelle année. -

Villette-En-Yvelines.Fr
Bulletin 17 Municipal www.villette-en-yvelines.fr VILLETTE 78930 éditorial L’année 2016 s’est écoulée avec son lot d’espoirs et de déceptions. Les conflits internationaux peinent à se réduire, et leurs soubresauts et SOMMAIRE traumatismes finissent par arriver à nos portes, par la violence de Nice à - Éditorial __3 Magnanville, par le dénuement des migrants issus des pays en guerre. - Ces périodes de fêtes sont aussi des moments pour penser à la Organisation administrative solidarité, et chacun peut choisir une cause pour laquelle faire un geste & communale __4 de partage, de quelque nature qu’il soit. - Nous pouvons dans l’ensemble nous considérer comme privilégiés Attributions associées __5 par rapport à beaucoup d’autres, même si les difficultés financières - progressent pour nombre de personnes, et que nous avons senti, en Un peu d’histoire __6 particulier dans notre département, que la pause dans les prélèvements - fiscaux n’allait pas se faire sentir à court terme. Microcrèches Haut comme trois Souhaitons que ces sommes collectées soient attribuées à des actions pommes __13 pour le bénéfice de tous, et que les disparités de richesse cessent - de progresser entre les couches les plus aisées et celles les moins Plan de la commune __14 favorisées de la population. - Des nouvelles de la Pour nous rapprocher maintenant de notre village, nous pouvons Communauté de Communes du évoquer les actions en cours destinées l’amélioration des conditions Pays Houdanais __16 de vie : la réhabilitation de chemins en cours de réalisation, finalisée - espérons-le pour le printemps, pour diversifier les promenades, Un nouveau syndicat de collecte l’aménagement de la mairie pour l’accès aux personnes handicapées, des déchets : le SIEED __18 qui commence à prendre forme dans le cadre d’un contrat rural, et - l’aménagement et rénovation de la place devant l’école, qui devra L’Association Seconde Vie pour concilier stationnement, verdure et circulation piétonnière sécurisée, en les Équidés __20 particulier pour les enfants. -

BASSIN VERSANT DE LA VESGRE ET BOCAGE D'adainville (Identifiant National : 110020351)
Date d'édition : 05/07/2018 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020351 BASSIN VERSANT DE LA VESGRE ET BOCAGE D'ADAINVILLE (Identifiant national : 110020351) (ZNIEFF Continentale de type 2) (Identifiant régional : 78263021) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : ATENA 78 (BAK Arnaurd, Alexandre MARI) 2016 / ECOSPHERE (GAULTIER Cyrille, BARANDE Serge) 2003, .- 110020351, BASSIN VERSANT DE LA VESGRE ET BOCAGE D'ADAINVILLE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 10P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020351.pdf Région en charge de la zone : Ile-de-France Rédacteur(s) :ATENA 78 (BAK Arnaurd, Alexandre MARI) 2016 / ECOSPHERE (GAULTIER Cyrille, BARANDE Serge) 2003 Centroïde calculé : 549131°-2417303° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 22/09/2016 Date actuelle d'avis CSRPN : 22/09/2016 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900 Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 4 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 4 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 5 6. HABITATS ..................................................................................................................................... -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°78-2019-002
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°78-2019-002 PREFECTURE DES PUBLIÉ LE 4 JANVIER 2019 YVELINES 1 Sommaire DDT 78 Service de l'éducation et de la sécurité routière - Bureau Education Routière 78-2018-12-10-008 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL et MUNICIPAL de réglementation du régime de priorité par la mise en place de feux tricolores au carrefour formé par la Route Départementale 10 (Avenue du Général de Gaulle) et la voie communale Avenue de Sceaux dans l’agglomération de Versailles. (3 pages) Page 4 Préfecture des Yvelines - Direction de la Réglementation et des Elections - BRG 78-2019-01-04-001 - arrêté portant dérogation au repos dominical des salariés - société BEP Europe pour Renault Guyancourt (2 pages) Page 8 Sous-préfecture de Mantes-la-Jolie 78-2019-01-02-081 - ARRÊTÉ portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Moisson (2 pages) Page 11 78-2019-01-02-082 - ARRÊTÉ portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Mondreville (2 pages) Page 14 78-2019-01-02-083 - ARRÊTÉ portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Montalet-le-Bois (2 pages) Page 17 78-2019-01-02-084 - ARRÊTÉ portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales de la commune de Montchauvet (2 pages) Page 20 78-2019-01-02-085 - ARRÊTÉ portant nomination des membres de la commission -

EAJE CD78 20201207Complet.Pdf
LesLes EtablissementsEtablissements d'Accueild'Accueil desdes JeunesJeunes EnfantsEnfants Edition : 21 décembre 2020 27 EURE Gommecourt Moisson Lainville- Notre- Limetz-Villez 95 Dame- en-Vexin Mousseaux- Jambville de-la-Mer Montalet- VAL-D'OISE Freneuse sur-Seine Drocourt Bennecourt !2 1 le- Blaru ! Saint- Sailly Bois Méricourt Martin-la- Garenne Fontenay- Oinville-sur- Bonnières- Gaillon- Follainville- Saint-Père Brueil- Montcient Chaufour- sur-Seine Rolleboise sur- La Villeneuve- Dennemont en-Vexin Tessancourt- lès- !1 Montcientsur-Aubette Bonnières !2 Guernes en-Chevrie Hardricourt Évecquemont Seine Aval Mézy- Meulan Vaux-sur-Seine 1 1 Mantes-la-Jolie Guitrancourt sur-Seine !! !1 Conflans- Lommoye Rosny- 1 1 7 7 Limay Juziers !2 Ste-Honorine sur-Seine !!!! Triel- Maurecourt Cravent Gargenville Les Mureaux 2 1 !1!3!3 sur-Seine !1!1!3!5 !! Buchelay Andrésy Issou !1!1!3!5 Verneuil- Saint- 1 1 Flins- !3!2 1 Perdreauville !! Mantes- sur-Seine ! Illiers-la- Jouy- sur- Chanteloup- Boissy- la-Ville Seine 2 3 Saint- Ville Mauvoisin Magnanville Porcheville !! les-Vignes Mauvoisin !1!1!5!2 !2 Bouafle Achères Illiers-le- Fontenay- !2 Chapet !1!2 Vernouillet !2 Bois Mauvoisin Aubergenville !1 Bréval Ménerville Auffreville- Mézières- 1 1 Maisons- 1 3 1 !! !1 Soindres Brasseuil sur-Seine Épône !!! Médan Boucle Laffitte !1!1 !2 Carrières- 4 6 1 Breuil- Guerville Nézel !!! Le Tertre- Favrieux Ecquevilly sous-Poissy de Seine Saint-Denis Vert Bois- La !1 Villennes- Sartrouville Robert !1!1 !1!1!3!4 Neauphlette Falaise sur-Seine !21!10 Flacourt 1 1 1 -

Yvelines Cartographie Thématique Départementale
Banthelu Frémécourt Grisy-les-Plâtres Le Perchay Nesles-la-Vallée Presles Genainville Guiry-en-Vexin Epiais-Rhus Chaussy Cormeilles-en-Vexin Amenucourt Parmain Us C A R T O G R A P H I E T H É M AT I Q U E D É PA RT E M E N TA L E Hérouville Maudétour-en-Vexin Livilliers L'Isle-Adam Valmondois Wy-dit-Joli-Village Gadancourt Chérence Arthies Génicourt 1 / 1 0 0 0 0 0 Théméricourt Nerville-la-Forêt Montgeroult Villers-en-Arthies Haute-Isle La Roche-Guyon Avernes Ableiges Boissy-l'Aillerie Butry-sur-Oise Vigny Auvers-sur-Oise Ennery Gommecourt Aincourt Mériel Moisson Courcelles-sur-Viosne Vienne-en-Arthies Frémainville Osny Villiers-Adam Limetz-Villez Vétheuil Lainville-en-Vexin Port-Villez Longuesse Puiseux-Pontoise LES GISEMENTS DE Saint-Cyr-en-Arthies Montalet-le-Bois Mousseaux-sur-Seine Drocourt Freneuse MATÉRIAUX DE Bennecourt Méry-sur-Oise Béthemont-la-Forêt Sagy Pontoise Jambville Frépillon Blaru Sailly CARRIÈRES Seraincourt Saint-Ouen-l'Aumône Méricourt Courdimanche Cergy Jeufosse Chauvry Saint-Martin-la-Garenne Condécourt Bessancourt Fontenay-Saint-Père Gaillon-sur-Montcient Vauréal Brueil-en-Vexin Menucourt Bonnières-sur-Seine Oinville-sur-Montcient Tessancourt-sur-Aubette - hors contraintes de fait, Taverny Rolleboise Chaufour-lès-Bonnières La Villeneuve-en-Chevrie Follainville-Dennemont Boisemont Eragny Guernes Pierrelaye Saint-Leu-la-Forêt Evecquemont Neuville-sur-Oise de type 1 et 1 bis - Beauchamp Hardricourt Jouy-le-Moutier Guitrancourt Meulan Vaux-sur-Seine Mézy-sur-Seine Saint-Prix Lommoye Rosny-sur-Seine Mantes-la-Jolie