Mise En Page 1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lire L'article De La Provence Du 24/07/2018 En
Mardi 24 Juillet 2018 3 www.laprovence.com Arles LE BILLET Picasso et Clergue entre amis On décide quand? Par Christophe VIAL Les 29 maires du pays d’Arles au Château des Baux étaient tous conviés, vendredi, à déjeuner avec le préfet de Ré- gion Pierre Dartout. On aurait Jusqu’au 28 octobre a lieu une exposition de photographies en plein air et en grand format pu penser que le sort du terri- toire, entre intégration à la mé- ’année prochaine il y aura tropole et indépendance alors 50 ans que Jean Cocteau que le Département est appelé L est venu aux Baux-de-Pro- à disparaître, serait scellé. Ou, vence pour tourner, au Val d’En- du moins, que les élus repartent fer, dans les carrières, son Testa- de ce repas avec de précieuses ment d’Orphée. Le poète y a indications sur l’avenir institu- mis en scène sa mort par balle, tionnel. Mais non, personne ne et sa résurrection, dans un sait, aujourd’hui encore, à monde peuplé d’imaginaires. quelle sauce le pays d’Arles va Avant l’anniversaire, ce sont les être mangé. Le préfet, "tout en amis d’Orphée, comme ils rondeur" selon un participant, étaient présentés dans le script : n’a rien annoncé. Ou plutôt, il a le matador Luis Miguel Domin- indiqué que rien n’était décidé. guin, Françoise Sagan ou en- Il serait vraiment temps, pour- core les Vadim, pour ne citer tant, de clarifier une situation qu’eux, qui retrouvent en qui commence à peser et à alté- quelque sorte, et jusqu’à la fin rer les relations entre élus lo- du mois d’octobre, les hauteurs caux, qui n’ont visiblement plus des Alpilles. -

Lucien Clergue – Poète Photographe Commissaire : Anne Clergue
PRESENTATION PRESSE EXPOSITION, pour diffusion immédiate Lucien Clergue – Poète photographe Commissaire : Anne Clergue Du 24.11.2017 au 14.01.2018 Cercle Cité – Luxembourg I Tous les jours de 11:00 à 19:00 I Entrée libre _______________________________________________________________________________________ Après les deux très belles expositions consacrées à Jean Cocteau et Pablo Picasso, c’est l’œuvre de leur ami intime, le poète photographe Lucien Clergue, que le Cercle Cité nous invite à découvrir cet hiver. L’exposition « Lucien Clergue – Poète photographe » permet une vision globale du travail de celui qui fut le premier photographe académicien. A travers la sélection de près de quatre-vingt-dix photographies, cette exposition donne à voir ses thèmes de prédilections: Camargue, Sables, Nus, Cocteau, Saltimbanques et Gitans. Parmi les grands classiques présentés au Cercle Cité, une partie des oeuvres proviennent de la sélection de l’exposition montrée au Grand Palais à Paris en 2015 à laquelle se rajoutent plusieurs grands formats. Né en 1934 à Arles, Lucien Clergue a fait des études interrompues à seize ans pour entrer à l'usine. Il étudie le violon, puis se lance librement dans la photographie. En 1961, une exposition au Museum of Modern Art de New York, sur invitation d’Edward Steichen, consacre son talent. En 1984 le musée d’Art Moderne de Paris lui consacre une exposition rétrospective couvrant 30 ans d’activité. Son travail fouille les secrets de la vie et de la mort à travers ses scènes de saltimbanques, de charognes, puis la corrida, le nu féminin, le paysage camarguais, les portraits de personnalités (Picasso, Jean Cocteau, St John Perse...) s'imposent à lui comme les leitmotivs d'un univers à la fois particulier et universel. -

Lucien Clergue
Lucien Clergue APA94/Claude LAFONT / 13 mai 2015 Lucien Clergue, né le 14 août 1934 à Arles (France) et mort le 15 novembre 2014 à Nîmes , est un photographe français. Il est le premier photographe à être élu membre de l'Académie des Beaux- arts de l'Institut de France. Il en fut président pour l'année 2013. Biographie Enfance Lucien Clergue est né en 1934, en Arles, ville où il restera toute sa vie. Arles et la Camargue ont une grande importance dans la plupart de ses photos, les gitans, la tauromachie, la mer, les marais, etc... La vie artistique d’Arles lui permettra des rencontres et des amitiés déterminantes, Picasso, Cocteau, René Char, Manitas de Plata, Saint John Perse, pour les plus importants Ses parents se séparent alors qu’il n’a que six ans, au tout début de la guerre Dès l'âge de 7 ans, il apprend à jouer du violon sous l'impulsion de sa mère. Il est très doué, mais quelques années plus tard, son professeur lui révèle qu'elle ne peut plus rien lui apprendre. Issu d'une famille de commerçants modestes, il ne pourra pas poursuivre ses études au conservatoire. A l’âge de 10 ans, il est envoyé à l’intérieur des terres pour échapper à la guerre. A son retour, sa maison a été détruite par les bombardements. Sa mère est tombée gravement malade. Il prit soin d’elle, jusqu’à son décès à ses 18 ans et demi. Il a quitté l’école à l’âge de 19 ans pour travailler à l’usine. -

Arles 2021 Les Rencontres De La Photographie 4 July → 26
ARLES 2021 MINISTÈRE DE LA CULTURE MINISTÈRE DE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES PACA LES RENCONTRES RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE VILLE D’ARLES PHOTOGRAPH (DETAIL): SMITH, DESIDERATION, 2000-2021. COURTESY LES FILLES DU CALVAIRE GALLERY. DE LA PHOTOGRAPHIE DESIGN ABM STUDIO 4 JULY → 26 SEPTEMBER ARLES 2021 LES RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE JULY 4 → SEPTEMBER 26 PRESS RELEASE – JULY 2021 PRESS RELATIONS LES RENCONTRES CLAUDINE COLIN D’ARLES COMMUNICATION 34 RUE DU DOCTEUR FANTON MARINE MAUFRAS DU CHATELLIER 13200 ARLES & ALEXIS GREGORAT 3 RUE DE TURBIGO INFO@ 75001 PARIS RENCONTRES-ARLES.COM RENCONTRES-ARLES.COM RENCONTRESARLES@ TÉL. +33 (0)4 90 96 76 06 CLAUDINECOLIN.COM CLAUDINECOLIN.COM TÉL. +33 (0)1 42 72 60 01 INSTITUTIONAL PARTNERS MAIN PARTNERS MEDIA PARTNERS THE RENCONTRES D'ARLES IS ALSO ORGANIZED WITH AND THE ACTIVE COLLABORATION OF BARBICAN CENTRE, APERTURE, INA, INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE, SPECIAL SUPPORT FROM ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE LA PHOTOGRAPHIE, ASSOCIATION PRIX PICTET, FONDATION JAN MICHALSKI POUR DU MÉJAN, MONOPRIX ARLES, MUSEON ARLATEN – MUSÉE DE PROVENCE, L’ÉCRITURE ET LA LITTÉRATURE, LËT’Z ARLES (LUXEMBOURG), FONDATION ABBAYE DE MONTMAJOUR, MUSÉE RÉATTU, MUSÉE DE LA CAMARGUE, LOUIS ROEDERER, TECTONA, ACTES SUD, ADAGP, SAIF, FNAC, LUMA FONDATION MANUEL RIVERA-ORTIZ, CARRÉ D’ART – MUSÉE D’ART ARLES, COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ARLES CRAU CAMARGUE CONTEMPORAIN DE NÎMES, CARRÉ D’ART – BIBLIOTHÈQUE DE NÎMES, MONTAGNETTE. COLLECTION LAMBERT AVIGNON, FRAC PACA, MUCEM, CENTRE PHOTOGRAPHIQUE MARSEILLE, MUSÉE ESTRINE, CENTRE DE SUPPORT FROM LA PHOTOGRAPHIE DE MOUGINS, ASSOCIATION JEAN VILAR. -

Visualartsource Review 2012
Lucien Clergue Louis Stern Fine Arts, West Hollywood, California Preview by Margarita Nieto Lucien Clergue, "Deux Nu Zebres, New York," 2005, silver gelatin print, 12 x 16", edition 30. Continuing through September 8, 2012 In this selection of photographs by Lucien Clergue we are witnesses to the re-birth and transformation of ordinary things. Undulating sand dunes become nudes in a re-vision that pulls together lines and forms into an erotic illusion. Waves and boulders unite and become wombs. Animal and human worlds merge into zebras. Drawn from more than a half-century of work, Clergue’s powerful but simple vision compels the viewer to experience images shaped by a lifetime of exploring the possibilities of the camera. A native of Arles (born in 1934) he was a son of divorced parents who lost everything in the Allied bombings of World War II. His mother recognized the artist in the child, and at the age of thirteen bought him a cheap camera. She died when he was eighteen, he left school and began working in a factory. But even under these circumstances he dreamt of making films like those of his idols, the Italian social realist directors. Encouraged by the writer, Jean-Marie Magnan, a fellow Arlésien, he acquired a Semi-Flex 6x6 and began taking photos of Arles and its ruins, its Roman necropolis and its crumbling buildings. Creating tableaux vivants of children dressed as harlequins, he conjured the past, the comic and tragic life of the commedia. These static and theatrical visions are a dichotomy: movement captured by the photographic still. -

LUCIEN CLERGUE Vie Et Mort 1 to All of You Who Over the Years Helped and Made My Work Possible, Vie Et Mort My Heartfelt Thanks
LUCIEN CLERGUE vie et mort 1 to all of you who over the years helped and made my work possible, vie et mort my heartfelt thanks 2 LUCIEN CLERGUE vie et mort Odon Wagner Gallery I 198 Davenport Rd, Toronto ON M5R 1J2 Canada I odonwagnergallery.com Funambule traversant le Rhône, Arles 1956 silver gelatin print, ed. 2/30 GF, 24 x 20 in. / 60 x 50 cm 2 introductions I page 5 essay: vie et mort I page 9 hymn to aphrodite I page 15 painting with light I page 27 portfolio vénitien I page 39 the maestro I page 43 3 Still image from Lucien Clergue: A Film by Odon Wagner Gallery, directed by Jack Weisman, 2014 4 fondly remember my first conversation with Lucien in 2013, which led to a visit in Arles. It was after being warmly welcomed into Ihis home that my son Rafael and I were brought into his studio. Walking into his cluttered atelier was as if we had entered into a French cabinet of wonders. Clergue’s intimate relationships with Pablo Picasso, Jacqueline Roque, and Jean Cocteau unfold in his photographs, almost like sacred memorabilia of 20th century France. Over the next couple of days, we selected a fine selection of images for an upcoming exhibition in May 2014, Lucien Clergue: La Lumière Transcrite, which would be a highlight of both his and my career. Upon his arrival to our gallery, Lucien himself exclaimed “c’est la plus belle exposition de ma vie.” (This is the most beautiful exhibition of my life.) During his visit to Toronto, we made time to attend Francis Bacon and Henry Moore: Terror and Beauty at the AGO. -
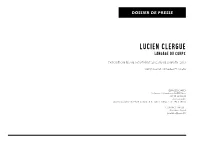
Lucien Clergue Langage Du Corps
DOSSIER DE PRESSE LUCIEN CLERGUE LANGAGE DU CORPS EXPOSITION DU 03 NOVEMBRE 2012 AU 05 JANVIER 2013 Commissariat : Amedeo M.Turello ESPACE SOARDI 9, Avenue Désambrois 06000 Nice 04 93 62 32 03 www.soardi.fr 0uvert au public du Mardi au Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 CONTACT PRESSE : Géraldine Soardi [email protected] COMMUNIQUÉ L’Espace Soardi présente du 03 Novembre 2012 au 05 Janvier 2013 l’exposition du photographe Lucien CLERGUE. Lucien CLERGUE est le premier photographe à être élu membre de l’Académie des beaux-arts de l’Institut de France. Il apprend le violon avant de se consacrer entièrement à la photographie. Ses premiers travaux sont marqués par la mort, les bombardements, il photographie les charognes des bords du Rhône, les corridas. Puis ce sera les nus de la mer, les paysages de Camargue et les éléments qui la compose: l’eau, le sable, les herbes, les signes du vent. Ses rencontres avec Cocteau puis avec Picasso en 1953 seront décisives. Lucien CLERGUE aura marqué l’histoire de la photographie par la création des Rencontres Internationales Nu Zébré, New York, 2012 © Lucien Clergue de la Photographie et de la première école nationale de photographie à Arles. Lucien CLERGUE - 03 11 12 > 05 01 13 - Page 2 BIOGRAPHIE Né le 14 Août 1934. Dès l’âge de 7 ans, Lucien Clergue apprend à jouer du violon sous l’impulsion de sa mère. Quelques années plus tard, son professeur lui révèle qu’elle ne peut plus rien lui apprendre. Issu d’une famille de commerçants modestes, il ne pourra pas poursuivre ses gammes au conservatoire. -
Focus on Photography
Focus on Photography Focus on Photography: Recent Acquisitions Karen K. Butler Mildred Lane Kemper Art Museum Doug Aitken screens, 2005 4 Focus on Photography: Recent Acquisitions Karen K. Butler Focus on Photography: Recent Acquisitions the limits of conventional genres such Francisco Museum of Modern Art’s 2010 draws together a selection of some of the as portraiture and landscape, to critique international symposium Is Photography significant photographs that the Mildred political and institutional structures Over?, point to the myriad positions Lane Kemper Art Museum has acquired and mores, and to explore questions of assumed and methods employed to through gifts and purchases in the last identity, subjectivity, and the very nature analyze the state of contemporary photog- five years. The exhibition presents a range of representation itself. The array of works raphy.1 Many of these critics have gone so of photographic practices, from historical on display in this exhibition, while varied far as to suggest that photography as it has works by photographers who defined the and unique, offers a lens through which traditionally been defined—as a modestly standards of the discipline to an interna- we might address a question weighing on scaled, handmade, black-and-white tional array of contemporary practitioners the minds of many artists and critics alike: print—is in a state of crisis or even, as who examine and expand the conventional what is photography today? the symposium title suggests, over. While parameters of the medium. In the -

LUCIEN CLERGUE Lucien Clergue' S Photographic Accomplishments Are
LUCIEN CLERGUE Lucien Clergue' s photographic accomplishments are so numerous and varied that almost any listing of them would be incomplete. Only this spring his work has been shown in four different one-man exhibitions: at the Galerie de France in Paris, the Sttt.dtische Kunsthalle in Dtisseldorf, Germany, the Kunsthal<Bern, Switzerland, and the present selection at the Art Institute of Chicago, the first presentation of hi.s photographs in Chicago. Today he is the most original and independent of French photographers and his fame is international. He was born in 1934 in Arles and continues to live there. When he was ten years old his home was destroyed during the August 1944 bombardments, an experience from which his mother never recovered and which resulted in her death several yea.rs later. In 1954, while working in an office and. devoting his Sundays to photography, he became known to Jean Renoir who had come to Arles th dir ect a production of Shakespeare's Julius Caesar. The encouragement of the great director intensified his ardor for photography. His fir st published work was a series of photographs for Nus de la mer (1956), illustrating poe ms by Paul Eluard. It was from this time he has had the friendship of Picasso who designed covers for his books, and of Jean Cocteau who contributed prefaces to them. By 1960 he had devoted himself entirely to photography. He had ditscovered the Arles swamp, and that remarkable part of France, the Camargue region with the Rhone River, the salt marshes, the corn and ri ce fields, the cowboys, the breeding of bulls, and the rice far ms. -

Clergue Se Révèle Dans Cette Exposition D’Une Grande Richesse
AUTOUR DE L’EXPOSITION CETTE SAISON AU GRAND PALAIS PLAN DE L’EXPOSITION Grand Palais, Galeries nationales ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES Entrée Porte H AUDIOGUIDES (en location) : français, anglais, espagnol 5€ VISITES ADULTES ÉLISABETH LOUISE VIGÉE LE BRUN Visite guidée 23 septembre 2015 – 11 janvier 2016 Fondateur des Rencontres d’Arles, devenues au fil des ans un lieu de référence international pour la photographie, premier Élisabeth Louise Vigée Le Brun est l’une des grandes portraitistes de son temps, à photographe élu à l’Académie des Beaux-Arts, ami de Picasso, Cocteau ou encore du grand guitariste gitan Manitas de Plata… Lucien Clergue se révèle dans cette exposition d’une grande richesse. Accompagnés d’un conférencier, découvrez LUCIEN CLERGUE l’égal de Quentin de La Tour ou Jean-Baptiste Greuze. Issue de la petite bourgeoisie, toutes les facettes de son talent. Durée : 1h30 / Tarif 19€ - Tarif réduit 14€ - Offre tarifaire Tribu 52€ (billet groupe de 4 payants composé de 2 jeunes de 16 à 25 ans). elle va trouver sa place au milieu des grands du royaume, et notamment auprès Dates : Hors vacances scolaires : mercredi 14h30, 19h30, samedi 11h, 16h du roi et de sa famille. Elle devient ainsi le peintre officiel de la reine Marie-Antoinette. Vacances scolaires : mercredi 14h30, 19h30, samedi 11h, 14h, 16h Les premiers albums les bombes les L’exposition, qui est la première rétrospective française à lui être consacrée, pré- après Arles sente près de 130 œuvres de l’artiste, construisant un parcours complet à travers VISITES FAMILLES ET ENFANTS Epilogue 14 novembre 2015 - 15 février 2016 un oeuvre pictural majeur et une grande page de l’histoire de l’Europe. -

Momaexh 0694 Masterchecklist Born in England in 1906, Bill Brandt Studied Photography in Paris in 1929, Returning to England Two Years Later a a Freelance
DIOGENESWITHACAMERAV BILL BRANDT, LUCIENCLJiRGUE,YASUHIROISHIM:lTO September 25 - November12, 1961 The "Df.ogenes with a Camera" series was initiated by Edward Steichen in 1952, to demonstrate the various ways - from literal representation to abstraction - in which photogra[:hers approach the truth. This exhibition has been directed by Edward Steichen, assisted by Grace M. Mayer, with Kathleen Haven as Design Consultant. The Museumaclmowledges its indebtedness to the participating photographers, and to Mr. Charles Rado of Rapho Guillumette Pictures, representing Bill Brandt. BILL BRANDT"PERSPECTIVEOF NUDES" MoMAExh_0694_MasterChecklist Born in England in 1906, Bill Brandt studied photography in Paris in 1929, returning to England two years later a a freelance. During the depression, he focused his camera on the industrial Midlands and Tyneside towns, and documented pre-war London. At the time of the Battle of Britain, he made documentary photographs of London under fire for the HomeOffice records, later working for the Ministry of Information, the National Buildings Record and the "Picture Post." After the war his work was seen in "Harper's Bazaar" and "Ho Li.day'! , His photographic studies of "Literary Britain" appeared in book form in 1951. He has had a solo show in Paris, and was represented in a four-man exhibition at The Museumof ModernArt in 1948. Since 1945 he has been concentrating on his "Perspective of Nudes," published this year by The Bodley Head in London, and Amphotoin NewYork. In the preface, Lavr ence Durrell wrote: " •••• Brandt uses the camera as an extension of the eye - the eye of a poet; he is to photography what a sculptor is to a block of marble. -

Canal Académie Sur Facebook Et Twitter Transmetttre À Un Ami Nous Contacter Version Imprimable
Canal Académie sur Facebook et Twitter Transmetttre à un ami Nous contacter Version imprimable ÉDITORIAL Chers amis, chers auditeurs, Samedi 15 novembre, le photographe Lucien Clergue, membre de l'Académie des beaux-arts nous a quittés. Artiste prolixe, auteur de quelque 800 000 images, il était particulièrement apprécié de ses pairs en raison de son action déterminée pour la reconnaissance de la photographie comme art. Créateur, avec l'écrivain Michel Tournier et l'historien Jean-Maurice Rouquette, des Rencontres d'Arles, désormais reconnues comme l'un des grands rendez-vous mondiaux de la photographie, il a aussi été le premier photographe à revêtir, ès qualité, l'habit d'académicien. Comme l'avait alors déclaré Guy de Rougement, chargé de l'accueillir sous la Coupole de l'Institut, « l'installation d'aujourd'hui revêt en effet une dimension historique, l'Académie des beaux-arts accueille, en la personne de M. Lucien Clergue, une discipline qui n'était pas représentée ; la photographie devient le 8ème art de l'Académie des beaux-arts de l'Institut de France ». En juin dernier, alors qu'il luttait avec courage contre la maladie, Lucien Clergue nous avait fait l'honneur de nous accorder un entretien consacré à l'édition 2014 des Rencontres d'Arles et dans lequel il évoquait avec vivacité sa passion intacte pour la photographie. Afin de lui rendre l'hommage qu'il mérite et de saluer son ouvre, nous avons décidé de rediffuser non seulement cette émission, mais un bouquet de celles auxquelles il avait participé sur notre antenne. Bonne écoute ! Jean-Robert PITTE Président de Canal Académie Le Gros plan de la semaine Avec Lucien Clergue c'est la photographie qui est entrée à l'Académie « L'installation d'un nouvel académicien est toujours un événement important.