Le Risque Inondation
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
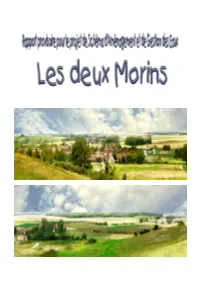
BAT Karine Guérand Janvier 2006 .PMD
1 2 Préambule 3 Document élaboré à la demande des élus, par la Direction de l'Eau et de l'Environnement du Conseil Général de Seine et Marne avec le concoursde l'Agence de l'Eau Seine Normandie (en particulier le rapport de stage de David NGUYEN-THE- septembre 1999), de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la Marne, des Missions Interservices de l'Eau de l'Aisne et de la Seine et Marne, et de la Direction Régionale de l'Environnement d'Ile de France. SITUATION ET TERRITOIRE ❚ Le Grand Morin et le Petit Morin sont deux affluents de la Marne. Ils sont situés dans la partie aval de celle-ci. Leurs confluences avec la Marne se trouvent pour ➧ le Grand Morin à Condé-Sainte-Libiaire et Esbly ➧ le Petit Morin à La Ferté-sous-Jouarre Ces deux confluences sont distantes d’une vingtaine de kilomètres. ❚ Les bassins versants des deux Morins sont mitoyens et se situent dans ➧ la Brie ➧ la Champagne ❚ Ils recouvrent trois régions administratives 4 ➧ la Picardie ➧ la Champagne-Ardennes ➧ l’Ile-de-France chacune étant représentée par un département ➧ l’Aisne ➧ la Marne ➧ la Seine-et-Marne ❚ Situation générale du bassin versant des deux Morins ❚ Répartition des communes appartenant au moins en partie, au bassin versant de l’un ou l’autre des Morins ➧ 7 dans l’Aisne ➧ 71 dans la Marne ➧ 105 dans la Seine et Marne soit 183 communes. La répartition de celles-ci entre les deux bassins versants est d'environ ➧ 1/3 pour le Petit Morin ➧ 2/3 pour le Grand Morin Limite du bassin versant ❚ Zoom sur le bassin versant des deux Morins LISTE -

N°22 La Gazette Vimpelloise
LA GAZETTE VIMPELLOISE N°22 Conception – Rédaction - Réalisation : MAIRIE de VIMPELLES Téléphone : 01 60 67 33 75 - Fax : 09.70.32.73.79 – email : [email protected] NOVEMBRE Site internet : www.mairie-vimpelles.fr 2019 Adresse : 4 rue du Vieux pont O1 60 67 33 75 – [email protected] Ouverture du secrétariat de mairie ****************************** Lundi, Mardi et Jeudi : de 10h à 12 h et de 14 h à 18 h Le dernier samedi du mois de 10 h à 12 h Permanence à CUTRELLES le premier mercredi du mois de 17 h 00 à 18 h 00 RECENSEMENT MILITAIRE : INSCRIPTIONS SUR LES LISTES Les jeunes (garçons et filles) âgés ELECTORALES de 16 ans en 2019 (nés en 2003) doivent se faire recenser à la Mairie dans le mois anniversaire Les jeunes âgés de 18 ans en 2019 sont - se présenter avec le livret de famille, carte d’identité inscrits d'office par l'INSEE. et justificatif de domicile. Les nouveaux administrés peuvent se faire inscrire en Mairie jusqu’au 7 février 2020 RAPPEL : Depuis le 2 mars 2017 les demandes de CNI sont instruites selon les mêmes modalités que les passeports biométriques. Afin de vous faire délivrer une nouvelle CNI, il faut vous rendre dans l’une des communes équipées d’une station de recueil de passeports – en l’occurrence BRAY SUR SEINE Pour dema nder ou renouveler une carte d'identité, il est possible de préparer votre demande en ligne (ants.gouv.fr) depuis chez vous Il suffira ensuite de vous rendre au guichet de la mairie muni de votre numéro de pré-demande en ligne et des pièces justificatives. -

1 3 4 2 Est Également Valide Sur Le Réseau
Voyager en règle Ozouer- Soignolles- Grisy Brie- Limeil- L Ma M J V Guignes Solers Coubert Servon Santeny Villecresnes Boissy-Saint-Léger A Infos voyageurs le-Voulgis en-Brie -Suisnes Comte-Robert Brevannes Jours de fonctionnement * A B GUIGNES Les Sablons 06:57 18:39 Eglise 06:58 18:40 Nogent sur Avon 07:00 18:42 OZOUER-LE-VOULGIS Village 07:04 18:46 Les Etards 07:07 18:49 Vos titres de transport “Je monte, SOLERS Mairie 05:47 06:17 06:43 07:10 07:12 07:42 08:14 08:41 09:10 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 14:56 15:32 16:30 17:28 18:09 18:54 19:27 20:00 20:30 Champs au Maigre 05:47 06:17 06:43 07:10 07:12 07:42 08:14 08:41 09:10 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 14:56 15:32 16:30 17:28 18:09 18:54 19:27 20:00 20:30 je valide …” SOIGNOLLES-EN-BRIE Passe Navigo La Burelle 05:48 06:18 06:44 07:11 07:13 07:43 08:15 08:42 09:11 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 14:57 15:33 16:31 17:29 18:10 18:55 19:28 20:01 20:31 Le Pont 05:50 06:20 06:46 07:13 07:15 07:45 08:17 08:44 09:13 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 14:59 15:35 16:33 17:31 18:12 18:57 19:30 20:03 20:33 Semaine : du lundi au La Côte 05:51 06:21 06:47 07:14 07:16 07:46 08:18 08:45 09:14 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:00 15:36 16:34 17:32 18:13 18:58 19:31 20:04 20:34 COUBERT dimanche inclus. -

Commune De SAINT MARD (77)
Commune de SAINT MARD (77) RAPPORT DE PRÉSENTATION Révision du P.O.S (Plan d’Occupation des Sols) Élaboration du P.L.U (Plan Local d’Urbanisme) Sommaire TOME I. DIAGNOSTIC 4 1. CONTEXTE TERRITORIAL 5 2.6. Les infrastructures. 28 1.1. Présentation régionale. 6 2.5.1. Les routes d’accès 28 2.5.2. Les chemins ruraux, chemins historiques et chemins piétonniers 29 1.2. Présentation locale. 7 2.5.3. La voie de chemin de fer 30 2. LE MILIEU HUMAIN 8 2.7. Les transports en communs. 31 2.8. Nuisances et risques présents 32 2.1. Petit historique 9 2.7.1. Les nuisances sonores 32 2.2. L’habitat ancien 10 2.7.2. Les risques industriels 32 2.2.1. Implantation 10 2.7.3. Les risques de mouvements de terrain 33 2.2.2. Le bourg : coeur ancien 13 2.9. Réflexion sur l’évolution du village dans son territoire 34 - L’architecture traditionnelle et régionale 13 - Les cours communes. 15 3. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 35 2.2.3. Le patrimoine architectural 16 2.2.4. Le petit patrimoine 17 3.1. Le relief 36 2.3. Les extensions urbaines 19 3.2. L’eau 37 2.3.1. Les maisons de seconde génération 19 2.3.2. Les extensions de dernière génération 19 3.3. Les boisements, les cultures et autres végétaux 38 2.3.3. Les activités. 22 3.3.1. Les boisements 38 2.3.4. Le mode d’occupation des sols 23 3.3.2. -

SALON INTERNATIONAL DE L'agriculture 22 FÉVRIER > 1ER MARS 2020 Métropole Du Grand Paris
SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE 22 FÉVRIER > 1ER MARS 2020 Métropole du Grand Paris La Ferté-sous-Jouarre 95 Meaux 93 Lagny- sur-Marne Marne- 75 la-Vallée PARIS Coulommiers 92 La Ferté-Gaucher 94 91 Sénart Provins Melun LA SEINE & MARNE CONNECTÉE AU MONDE Montereau- Fontainebleau Fault-Yonne Aéroport Paris - CDG Aéroport Paris - ORLY Nemours Gare de Lyon Gare de Paris Est Gare de Marne-la-Vallée Chessy Du 22 février au 1er mars, le Département de Seine-et-Marne, premier département agricole d’Île-de-France, vous accueille La Ferté-sous-Jouarre au Salon International de l’Agriculture autour du concept : Meaux 1 jour, 1 territoire. Lagny- sur-Marne Marne- La Seine-et-Marne se caractérise par de vastes terres agricoles la-Vallée et abrite également un patrimoine naturel et bâti exceptionnel. Coulommiers La Ferté-Gaucher Nous vous proposons de découvrir chaque jour les richesses et particularités d'un des sept territoires présentés. Diversité de la filière agricole, informations insolites et lieux touristiques incontournables vous sont dévoilés dans ce livret. Sénart Provins Tout au long du salon, nous vous attendons nombreux Melun sur notre stand. Au programme : petits jeux, rencontres avec les acteurs du tourisme seine-et-marnais et du monde agricole, animations et dégustations de produits du terroir. Montereau- Fontainebleau Fault-Yonne Bon voyage en Seine & Marne ! Nemours Rendez-vous Hall 3 - Allée F - Stand 007 22 FÉVRIER LE TERRITOIRE DE COULOMMIERS, PAYS CRÉÇOIS Ce territoire s’étend de la Brie aux vallées de la Marne et du Morin. Les sols, très fertiles, sont adaptés aux grandes cultures : principalement les céréales (blé, orge brassicole), les oléagineux (colza) et la betterave sucrière. -

TROPHÉE ZERO PHYT'eau
TROPHÉE ZERO PHYT'Eau Crouy- Oise sur- 60 Ourcq Vincy- Othis Coulombs- Manoeuvre en-Valois May-en- Germigny- Moussy- St-Pathus Puisieux Oissery Multien sous- le-Neuf Douy-la- Val-d'Oise Rouvres Coulombs 95 Dammartin- Ramée Le Plessis- en-Goële Marchémoret Forfry Placy ssy- Mou Trocy-en- ux Longperrier le-Vie Multien Lizy- Dhuisy Saint- Gesvres- Marcilly Vendrest St-Soupplets Étrépilly sur-Ourcq Villeneuve- Mard Montgé- le-Chapitre sous- en-Goële Ocquerre Cocherel Mauregard Dammartin Juilly Cuisy Mary- Le Mesnil- Barcy Congis-sur- sur-Marne Aisne anne Amelot Le Plessis- Monthyon Thérou Le Plessis- Tancrou Ste-Aulde 02 Thieux l'Évêque Varreddes Nantouillet Vinantes aux-Bois Isles-les- Iverny Chambry Meldeuses Saint- Penchard Nanteuil- Compans igny- Jaignes Chamigny Villeroy Germ Armentières- Méry- Mesmes Luzancy sur-Marne Mitry- Crégy- l'Évêque en-Brie sur- Mory Chauconin- lès-Meaux Poincy Ussy-sur- Marne Charny Neufmontiers Changis- Citry Messy Marne uil- Gressy sur-Marne La Ferté- Re Meaux Trilport sous-Jouarreen-Brie Saâcy- Trilbardou sur-Marne Fresnes- ontceaux- Charmentray M Sept- Villeparisis Claye- sur- lès-Meaux ne-Saint- Villenoy Fublaines Sammeron Sorts Sei Souilly Marne St-Jean- Denis Précy- Nanteuil- les-Deux- sur-Marne Vignely lès- Saint- Signy- Bassevelle Annet- Mareuil- Jumeaux Bussières 93 Meaux Fiacre Villemareuil Signets St-Cyr- sur-Marne Isles-lès- lès-Meaux ourtry sur-Morin C Jablines Villenoy Le Pin Lesches Boutigny Villevaudé Jouarre St-Ouen- Orly- Hondevilliers Carnetin Quincy- sur-Morin sur-Morin Boitron Esbly Condé- -

DE COULOMMES DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE Canton De
COMMUNE DE COULOMMES DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE Canton de SERRIS COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 10 Avril 2018 L’an deux mille dix-huit, le mardi 10 Avril, le Conseil Municipal de la commune de COULOMMES, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie au nombre prescrit par la loi sous la présidence de Françoise BERNARD, Maire PRESENTS : Mme : BERNARD Françoise, Maire – Mrs : DELINOTTE Jean-Marie 1 er Adjoint – PIOT Bernard, 2 ème Adjoint –DELAGARDE Laurent – MAHIOT Loïc – MARTINS Didier – ROSSIGNOL Roger ABSENT NON EXCUSE : Monsieur GABOYARD Daniel ABSENTS EXCUSES : Mrs GIBERT Pascal - THYOUX Laurent POUVOIR : Monsieur GIBERT à Madame BERNARD A ETE ELU SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur MAHIOT Loïc La séance est ouverte à 20h35. Le procès-verbal de la séance du 8 mars 2018, n’ayant fait l’objet d’aucune observation, est adopté à l’unanimité des membres présents. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION COMMUNE 2017 - Délibération N°09-2018 Madame le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter le budget de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes -

Inventaire Du Fonds De La Ferme De Rézy, Tigeaux
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE SEINE-ET-MARNE Fonds de la Ferme de Rézy, Tigeaux 1817-1930 106 J 1-5 Inventaire Marie-Odile Ducrot Direction de publication : Isabelle Rambaud, directrice des archives départementales de Seine-et-Marne. - 1999 106 J – Ferme de Rézy, Tigeaux Dates extrêmes : 1817 – 1930 Importance matérielle: 0,10 mètre linéaire. Historique du producteur : La ferme de Rézy, à Tigeaux, avec des terres sur le terroir de Guérard, a appartenu successivement aux familles de Biencourt et de Lur-Saluces. Le premier régisseur mentionné dans le dossier, en 1845, est Antoine Pierre Maugé, percepteur des contributions directes à Guérard, de 1845 à 1865 au moins. Claude Ambroise Alexandre Dantant apparaît comme régisseur, à Guérard, entre 1861 et 1871. Il veille aux intérêts de la comtesse de Biencourt puis du marquis de Lur-Saluces, jusqu'en 1910. Paul Rabourdin, régisseur héréditaire du château de Quincy, lui succède en 1912 (?). Modalités d’entrée : Achat réalisé le 5 octobre et 8 novembre 1999, auprès d’une descendante de Paul Rabourdin. Entrée N°15891, fonds 1779. Présentation du contenu : Ce fonds décrit essentiellement les baux et cessions de baux. Une part importante est également dédiée aux régies successives. Accroissements : Fonds clos. Mode de classement : Thématique et chronologique. Conditions d’accès : Selon les articles L.213-1 à L.213-7 du Code du Patrimoine, le fonds est librement communicable. Conditions de reproduction : Soumises aux conditions de la salle de lecture. Langue et écriture des documents : Français. 2 106 J – Ferme de Rézy, Tigeaux Bibliographie et sources complémentaires : - 106 F 13 : Fief et ferme de Rézy, titres divers, procès-verbal d’arpentage et de mesurage de la ferme, fragment du terrier 1499-1761. -

LETTRE ETAT N°38.Indd
L’ÉTAT EN SEINE-ET-MARNE N°38 - avril 2013 Nominations TROIS NOUVEAUX COMMISSAIRES Actualité Dossiers Visites ministérielles Agenda de la préfète Thierry Satiat, commissaire divisionnaire MELUN Natacha Merrien, commissaire divisionnaire SOMMAIRE MELUN MEAUX PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE DIRECTION DES SERVICES DU CABINET ET DE LA SÉCURITÉ Claude Mazerolle, commissaire de police 1 NOMINATIONS Arrivée de Thierry Satiat, commissaire divisionnaire Le vendredi 15 mars 2013, Thierry circonscription de police de Meaux, Satiat, commissaire divisionnaire, a que la cérémonie s’est déroulée dans été installé dans ses fonctions de chef la cour d’honneur du Commissariat. de la circonscription de police de Thierry Satiat a débuté sa carrière Meaux et de chef de district Nord par le 3/09/2001 comme chef de la Cir- Philippe Justo commissaire division- conscription de Sécurité Publique de naire et Directeur Départemental Livry Gargan, puis chef de la CSP de ARRIVÉE Adjoint de la Sécurité Publique de Drancy, il officie une première fois Seine-et-Marne. en 2007 en Seine-et-Marne, comme 15 mars 2013 chef de la CSP de Pontault-Combault. C’est en présence de Jean-Noël Humbert, En 2008 il devient chef de la CSP de Sous-Préfet de Meaux, de Jean-François Montreuil-sous-Bois et finit par reve- Parigi, premier adjoint au maire de nir en Seine-et-Marne à Meaux. Meaux, de Christian Girard, procu- reur de la République prés du Tribu- nal de Grande Instance de Meaux et de nombreux élus de communes de la Arrivée de Natacha Merrien, commissaire divisionnaire Le lundi 18 mars 2013, Natacha Mer- munes de la circonscription de police rien, commissaire divisionnaire, a été de Melun, que la cérémonie s’est installée dans ses fonctions de chef de déroulée dans la cour d’honneur du la Circonscription de police de Melun commissariat. -

Circonscriptions 2019 Avec Zones D'indemnité De Résidence
Crouy- sur-Ourcq Vinc Othis Manœuvry- Coulombs- Ger St- e en-Valois sous-Coulombsmign Moussy- Oissery Puisieux Le Plessis-May-en-Multien le-Neuf Pathus Douy- y- DAMMARTIN- Rouvres la-Ramée Plac EN-GOËLE Forfry Trocy- y Moussy- Marchémoret Longperrier en- Vendrest Dhuisy le-Vieux Gesvres- Multien Dammartin- le-Chapitre Marcilly Lizy-sur-Ourcq d Villeneuve- d Montgé- St-Soupplets Etrépilly ar sous- eg Dammartin Juilly en-Goële Ocquerre Cocherel St-Mar Cuisy Barcy Congis-sur- 2 Maur Le Mesnil- en-Goële Monthyon Mary-sur- V Varreddes Thérouanne Marne Amelot inantes Le Le Plessis- 2 Thieux Plessis- l'Evêque Tancrou Ste-Aulde Nantouillet aux- Iver Meaux Nord Isles-les- Bois ny Penc Chambry Meldeuses har y ne Nanteuil- Compans V d Jaignes sur iller y- Germigny- Chamigny St-Mesmes Chauconin- es-en-Brie -Mar o l'Evêque -Mar Mitry-Mory y Crég Armentièr Neufmontiers Luzanc Gr 2 Poincy Ussy- 2 lès-M. ne Changis- LA Citr essy Messy Charny MEAUX sur-Marne Reuil- y-sur y 2 1 Trilport sur-Marne FERTÉ- y a Meaux en-Brie Mér Claye- 2 Montceaux- St-Jean- SOUS- Saâcy- mentr Villenoy les-deux- JOUARRE Fresnes- lès-Meaux Sammeron Sept- sur-Marne Villeparisis CLAYE-SOUILLY sur-Marne dou Villenoy 2 Jumeaux Sorts Char Fublaines Trilbar y 2 1 1 Précy-sur- Nanteuil- Bassevelle Souilly Vignel euil- lès-Meaux Cour Marne St- La Ferté- Jouarre Bussières 1 Annet- Isles-lès- Mar Signy-Signets 1 1 sur-Marne hes Fiacre Villemareuil tr Le Pin Villenoy lès-Meaux 2 y Jablines Esb Car Lesc Boutigny St-Cyr- Villevaudé netin ly sous-Jouarre sur-Morin -Morin Orly- Condé-Ste- St-Ouen- Boitron Hondevilliers 1 t Libiaire Quincy- Vaucourtois La Haute-MaisonPierre-Levée sur sur-Morin Thorigny-1 1 Coulommes Brou- Pomponne1 DampmarChalifert Couill Voisins Sablonnières sur- 1 1 sur-M. -

OFFRE DU TERRITOIRE SEINE ET MARNE CENTRE NORD Hospitalisation a Domicile (HAD)
OFFRE DU TERRITOIRE SEINE ET MARNE CENTRE NORD Hospitalisation A Domicile (HAD) Zone d'intervention de l'HAD Centre 77 Zone d'intervention de l'HAD Nord Seine-et-Marne Crouy-sur-Ourcq Othis Vincy- Manoeuvre Coulombs-en-Valois St- Moussy- Pathus Oissery May-en-Multien le-Neuf Rouvres Puisieux Germigny- sous- Dammartin- Douy-la-Ramee Coulombs en-Goele Le Marchemoret Forfry Moussy- Plessis- Longperrier Placy le-Vieux Trocy- Saint-Mard St- en-Multien Vendrest Dhuisy Soupplets Gesvres- Marcilly Etrepilly Lizy-sur-Ourcq Montge - le-Chapitre Villeneuve- en- Ocquerre Mauregard sous-Dammartin Goele Juilly Mary- Cocherel Le Mesnil- Cuisy Barcy Amelot Congis-sur- sur-Marne Le Plessis- Thieux Monthyon Thérouanne Le Plessis- Varreddes Ste-Aulde Nantouillet Vinantes l'Eveque aux-Bois Chambry Isles-les- Tancrou Iverny Meldeuses Penchard Compans Jaignes St-Mesmes Villeroy Germigny-l'Eveque Chamigny Nanteuil- Cregy- Armentieres-en-Brie Mery- sur-Marne Mitry-Mory Chauconin- l ès - Luzancy sur- Neufmontiers Meaux Poincy Marne Charny Messy Changis- Ussy-sur-Marne Gressy sur-Marne Citry Trilbardou Trilport La Ferte- Meaux sous- Reuil-en-Brie Charmentray Jouarre Saacy-sur-Marne Fresnes-sur- Montceaux- St-Jean-les- Marne Sammeron Sept- Villeparisis Claye-Souilly Villenoy Fublaines lè s -Meaux Deux-Jumeaux Sorts Annet- Precy- Vignely sur-Marne Nanteuil- sur-Marne lè s -Meaux St- Bassevelle Mareuil- Fiacre Bussieres Isles-les- lè s -Meaux Villemareuil Signy-Signets Courtry Jablines Saint-Cyr- Le Villenoy sur-Morin Villevaude Lesches Boutigny St-Ouen- Pin sur-Morin -

Seine-Et-Marne
SEINE-ET-MARNE : Carte Scol’R demande à faire sur www.seine-et-marne.fr Carte Imagine’R demande à faire sur www.imagine-r.com Tarifs : Dossiers à retirer en Gare SNCF Ecoliers en RPI* ou assimilé** : 50 € Ecoliers hors RPI* ou assimilé** : 100 € Tarifs : Non boursier : Collégiens : 100 € - si élève de l’enseignement primaire ou collégien, scolarisé dans Lycéens : 150 € un établissement public ou privé sous contrat* le tarif est de 100€ Non Seine-et-Marnais : 303.20 € - si Lycéen ou apprenti, ou scolarisé dans un autre type d’établis- *RPI : regroupement pédagogique intercommunal sement que précisé ci-dessus (établissement hors contrat par **commune fusionnée ou dont l'école a été fermée exemple) le tarif régional est de 350€ Boursier d’un collège public ou privé sous contrat : - si la bourse est inférieure à 450€ le tarif est de 69.33€ Je suis concerné par cette carte si : - si la bourse est égale ou supérieure à 450€ le tarif est de 38.67€ Je suis écolier et réside : Baby, Balloy, Boursier d’un lycée public ou privé sous contrat : - si la bourse est comprise entre 1 et 4 le tarif est de236€ Bazoches-les-Bray, Blunay, Chalmaison, Ecuelles, Everly, Féricy, - si la bourse est comprise entre 5 et 6 le tarif est de 122€ Fontaine-Fourches, Gravon, Grisy-sur-Seine, Hermé, Jaulnes, La Tombe, Machault, Melz-sur-Seine, Montigny-le-Guesdier, Mous- seaux-les-Bray, Mouy-sur-Seine, Noyen-sur-Seine, St Germain Je suis concerné par cette carte si : Laval, Vernou-la-Celle, Villenauxe-la-Petite, Villiers-sur-Seine, Je suis écolier et je réside : St Sauveur- Villuis.