Volume Iii : Recueil Administratif
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Sec Civ 1328711366.Pdf
PREFECTURE DE LA MEUSE Service interministériel de défense et de protection civile Liste des DAE* /DSA** opérationnels (tout public et réservé aux personnels) Ancerville Centre de secours 1 Andernay Porche de la mairie 1 Bar-le-Duc Leclerc 1 Bar-le-Duc A.L Médical 1 Bar-le-Duc La Poste : centre courrier+ plateforme coliposte 3 Bar-le-Duc Sté d'ambulances AGUIR 2 Bar-le-Duc Sté Ambulances barisiennes 9 Bar-le-Duc Maison de retraite Blanpain 1 Bar-le-Duc Conseil départemental de la Croix Rouge 1 Bar-le-Duc Piscine 1 Bar-le-Duc Préfecture 1 Bar-le-Duc Inspection académique 1 Bar-le-Duc Direction départementale des territoires 1 Bar-le-Duc Lycées : Poincaré, Lycée Richier, Zola, EPL 4 AGRO Bar-le-Duc Hôpital 11 Bar-le-Duc Clinique du Parc 3 Bar-le-Duc Jeunesse et Sports/DDCSPP 1 Bar-le-Duc CPAM 1 Bar-le-Duc Sdis 2 Bar-le-Duc Conseil Général - Accueil de l'hôtel du 1 département Bar-le-Duc Fromagerie BEL 1 Beausite Centre de secours 1 Behonne Mairie 1 Belleville sur Meuse Pharmacie 1 Belleville sur Meuse Jean Dailly Ambulances 1 Beney en Woëvre Mairie 1 Beurey sur Saulx Centre de secours – Mairie 2 Biencourt sur Orge Gite communal de randonnée 1 Billy sous les Côtes Mairie 1 Billy sous Mangiennes Mairie 1 Boncourt sur Meuse Mairie 1 Bouchon sur Saulx (Le) Mairie 1 Bouligny Mairie 1 Bouligny Centre de secours 1 Bovée sur Barboure Mairie 1 Brabant le Roi Porche de la mairie 1 Bras sur Meuse MFR 1 Brauvillers Mairie 1 Bure Mairie 1 Charny sur Meuse Bechamp ambulances 1 Clermont en Argonne Maison de retraite 1 Clermont en Argonne Centre de secours -

Es Par Le Couloir De Migration Et D Hivernage Des Grues Cendr…
Annexe 2a : Communes concernées par le couloir de migration et d’hivernage des grues cendrées 13 Département de l’Aube : 180 communes • AILLEVILLE • FOUCHERES • AMONCE • FRALIGNES • ARGANCON • FRAVAUX • ARREMBECOURT • FRESNAY • ARRENTIERES • FRESNOY-LE-CHATEAU • ARSONVAL • FULIGNY • ASSENCIERES • GERAUDOT • AULNAY • GRANDVILLE • AVANT-LES-RAMERUPT • HAMPIGNY • BAILLY-LE-FRANC • ISLE-AUBIGNY • BALIGNICOURT • JASSEINES • BAR-SUR-AUBE • JAUCOURT • BAR-SUR-SEINE • JESSAINS • BATIGNICOURT • JONCREUIL • BEUREY • JULLY-SUR-SARCE • BLAINCOURT-SUR-AUBE • JUVANZE • BLIGNICOURT • JUZANVIGNY • BLIGNY • LA CHAISE • BOSSANCOURT • LA LOGE-AUX-CHEVRES • BOURANTON • LA ROTHIERE • BOURGUIGNONS • LA VILLE-AUX-BOIS • BOUY-LUXEMBOURG • LA VILLENEUVE-AU-CHENE • BRAUX • LASSICOURT • BREVONNES • LAUBRESSEL • BRIEL-SUR-BARSE • LAVAU • BRIENNE-LA-VIEILLE • LE CHENE • BRIENNE-LE-CHATEAU • LENTILLES • BRILLECOURT • LESMONT • BUXIERES-SUR-ARCE • LEVIGNY • CHALETTE-SUR-VOIRE • LHUITRE • CHAMP-SUR-BARSE • LIGNOL-LE-CHAUTEAU • CHAPRES • LONGPRE-LE-SEC • CHARMONT-SOUS-BARBUISE • LONGSOLS • CHAUDREY • LUSIGNY-SUR-BARSE • CHAUFFOUR-LES-BAILLY • LUYERES • CHAUMESNIL • MAGNANT • CHAVANGES • MAGNICOURT • CLEREY • MAGNY-FOUCHARD • COCLOIS • MAISON-DES-CHAMPS • COLOMBE-LA-FOSSE • MAISONS-LES-SOULAINES • COLOMBE-LE-SEC • MAIZIERES-LES-BRIENNE • COURCELLES-SUR-VOIRE • MAROLLES-LES-BAILLY • COURTENOT • MASNIL-LA-COMTESSE • COURTERANGES • MATHAUX • COUVIGNON • MERREY-SUR-ARCE • CRENEY-PRES-TROYES • MESNIL-LETTRE • CRESPY-LE-NEUF • MESNIL-SAINT-PERE • DAMPIERRE • MESNIL-SELLIERES -

0 CC De L'aire À L'argonne 0 Foncier Portrait
Communes membres : 0 Export_PDF de toutes les fiches A3 EPCI ortrait P Foncier Autrécourt-sur-Aire, Baudrémont, Beaulieu-en-Argonne, Beausite, Belrain, CC de l'Aire à Bouquemont, Brizeaux, Chaumont-sur-Aire, Les Hauts-de-Chée, Courcelles-en- Barrois, Courcelles-sur-Aire, Courouvre, Érize-la-Brûlée, Érize-la-Petite, Érize-Saint- Dizier, Èvres, Foucaucourt-sur-Thabas, Fresnes-au-Mont, Géry, Gimécourt, Ippécourt, Les Trois-Domaines, Lahaymeix, Lavallée, Lavoye, Levoncourt, Lignières- l'Argonne sur-Aire, Lisle-en-Barrois, Longchamps-sur-Aire, Louppy-le-Château, Neuville-en- Verdunois, Nicey-sur-Aire, Nubécourt, Pierrefitte-sur-Aire, Pretz-en-Argonne, Rembercourt-Sommaisne, Raival, Rupt-devant-Saint-Mihiel, Seigneulles, Thillombois, Seuil-d'Argonne, Vaubecourt, Ville-devant-Belrain, Villotte-devant- Louppy, Villotte-sur-Aire, Waly, Woimbey 0 Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement GRAND EST SAER / Mission Foncier Novembre 2019 http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/ 0 CC de l'Aire à l'Argonne Périmètre Communes membres 01/2019 47 ( Meuse : 47) Surface de l'EPCI (km²) 664,00 Dépt Meuse Densité (hab/km²) en 2016 EPCI 10 Poids dans la ZE Bar-le-Duc*(65,4%) Commercy(27,2%) Verdun(7,4%) ZE 43 Pop EPCI dans la ZE Bar-le-Duc(7,2%) Commercy(4,1%) Verdun(0,8%) Grand Est 96 * ZE de comparaison dans le portrait Population 2011 6 584 2016 6 579 Évolution 2006 - 2011 34 hab/an Évolution 2011 - 2016 -1 hab/an 10 communes les plus peuplées (2016) Les Hauts-de-Chée 739 11,2% Seuil-d'Argonne 518 7,9% 0 Rembercourt-Sommaisne -

ZRP Meuse Au 26 Oct 2020
INSEE NOM DEPT COMMUNE ZONE A RISQUE PARTICULIER / IA COM MEUSE 55008 AMEL-SUR-L’ETANG LA WOEVRE MEUSE 55010 ANCERVILLE CHAMPAGNE HUMIDE (DONT LAC DU DER) MEUSE 55011 ANDERNAY ETANGS D’ARGONNE (Nord et Sud) MEUSE 55012 APREMONT-LA-FORET LA WOEVRE MEUSE 55017 AUTRECOURT-SUR-AIRE ETANGS D’ARGONNE (Nord et Sud) MEUSE 55021 AVILLERS-SAINTE-CROIX LA WOEVRE MEUSE 55024 AZANNES-ET-SOUMAZANNES LA WOEVRE MEUSE 55031 BAUDONVILLIERS CHAMPAGNE HUMIDE (DONT LAC DU DER) MEUSE 55038 BEAULIEU-EN-ARGONNE ETANGS D’ARGONNE (Nord et Sud) MEUSE 55039 BEAUMONT-EN-VERDUNOIS LA WOEVRE MEUSE 55046 BENEY-EN-WOEVRE LA WOEVRE MEUSE 55049 BEUREY-SUR-SAULX CHAMPAGNE HUMIDE (DONT LAC DU DER) MEUSE 55053 BILLY-SOUS-MANGIENNES LA WOEVRE MEUSE 55058 BONCOURT-SUR-MEUSE LA WOEVRE MEUSE 55062 BOUCONVILLE-SUR-MADT LA WOEVRE MEUSE 55069 BRABANT-LE-ROI ETANGS D’ARGONNE (Nord et Sud) MEUSE 55070 BRABANT-SUR-MEUSE LA WOEVRE MEUSE 55076 BREHEVILLE LA WOEVRE MEUSE 55081 BRIZEAUX ETANGS D’ARGONNE (Nord et Sud) MEUSE 55085 BROUSSEY-RAULECOURT LA WOEVRE MEUSE 55093 BUXIERES-SOUS-LES-COTES LA WOEVRE MEUSE 55096 CHAILLON LA WOEVRE MEUSE 55101 CHARDOGNE ETANGS D’ARGONNE (Nord et Sud) MEUSE 55107 CHAUMONT-DEVANT-DAMVILLERS LA WOEVRE MEUSE 55117 CLERMONT-EN-ARGONNE ETANGS D’ARGONNE (Nord et Sud) MEUSE 55123 LES HAUTS-DE-CHEE ETANGS D’ARGONNE (Nord et Sud) MEUSE 55124 CONSENVOYE LA WOEVRE MEUSE 55125 CONTRISSON ETANGS D’ARGONNE (Nord et Sud) MEUSE 55132 COUSANCES-LES-FORGES CHAMPAGNE HUMIDE (DONT LAC DU DER) MEUSE 55134 COUVONGES CHAMPAGNE HUMIDE (DONT LAC DU DER) MEUSE 55145 DAMVILLERS -

Aire Nouvelle 70
MARS 2020 / Trimestriel / 1 € n°70 is o n u rd e V u d né en oy d le ns da re ’Ai e L es d cqu nt-Ja se Sai Bulletin de la parois Le sport est à la mode. Dans notre société, il faut transpirer pour avoir une activité physique qui nous permette de compenser l’inactivité au travail, pour avoir un corps qui corresponde aux canons de la beauté, E pour être en bonne santé afin de profiter pleinement de sa retraite, pour avoir la dose d’endorphines qui va nous permettre de nous dépasser et de nous rendre heureux. Ces activités vont soigner notre aspect D charnel mais tout cela a une fin inéluctable : nous savons que notre vie se termine par la mort. Au-delà de notre corps, au plus profond de lui, il y a une partie spirituelle à ne pas négliger qui pose la question que I les hommes se sont toujours posée : d’où je viens, où je vais ? T En ce mercredi, 1er jour du Carême, le prêtre nous marque le front d’une croix avec des cendres en prononçant ces paroles tirées de la Genèse : "Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en O poussière." C’est un avertissement fort, faisant réfléchir et pouvant peut-être effrayer. Il y a aussi cette autre formule tirée de l’évangile de Marc : "Convertissez-vous et croyez à l’Evangile" (Mc 1, 15). Les deux formulations s’éclairent l’une l’autre, elles ne sont pas en contradiction. -

Avant Toute Démarche
QUEL EST LE RÔLE DU CAUE ? Adaptez votre projet Les architectes du CAUE interviennent sur demande le plus tôt possible, avant toute démarche. Ils vous conseillent sur votre projet sans faire la maîtrise à vos besoins d’œuvre. Un architecte conseiller viendra sur place pour vous expliquer et vous orienter vers la ou les solutions les plus satisfaisantes. Ses propositions intègrent les préoccupations environnementales, sociales et éco- nomiques en conciliant votre intérêt et l’intérêt général. En consultant un des architectes du CAUE, vous vous donnez les moyens de réussir votre projet. ....................................................................................................................... Photo réalisée sans trucage Avant de… construire, rénover, aménager, agrandir POUR NOUS CONTACTER : CAUE de la Meuse - 3 rue François de Guise - BP 514 55 012 Bar-le-Duc Cedex Tél. : 03 29 45 77 68 - Fax : 03 29 45 77 69 Courriel : [email protected] Retrouvez-nous sur http://caue.meuse.fr - www.meuse.fr - www.meuse.fr CAUE_Dep_100x210_3volets_0110_2.indd 1 8/03/10 10:49:41 VOUS AVEZ UN PROJET ? CONSULtatIONS ARCHITECTURALES GratuITES Quel qu’il soit : Particuliers, entrepreneurs, agriculteurs… les architectes conseillers du CAUE sont à votre service. • Choisir un terrain • Construire ou réhabiliter une maison • Faire des économies d’énergie • Réaliser un ravalement de façade > SECTEUR NORD • Aménager des combles, une grange Codecom du Val Dunois ................................03 29 80 90 48 Une seule démarche pour rencontrer un • Créer une extension Mairie d’Etain .................................................03 29 87 10 35 architecte conseiller du CAUE : • Créer un hébergement touristique Mairie de Montmédy .....................................03 29 80 10 40 prendre rendez-vous auprès de la structure la • Restaurer une ferme Maison des Services de Spincourt ................03 29 85 95 44 plus proche de chez vous. -

Recensement De La Population
Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 55 MEUSE INSEE - décembre 2020 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 55 - MEUSE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 55-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 55-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 55-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 55-3 INSEE - décembre 2020 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, -

Carte Des Langues-État Des Lieux R15- Meuse
Liaison primaire - collège 55 Collèges 2015 Langues offertes dans les Bilangue BEF écoles du secteur de Ville Etablissement LV1 LV2 (LG hors recrutement du collège anglais) anglais ANCEMONT Louis de Broglie anglais allemand allemand anglais BOULIGNY Pierre et Marie Curie anglais allemand allemand italien anglais allemand CLERMONT Argonne Site de Clermont anglais espagnol allemand anglais DAMVILLERS Bastien Lepage anglais allemand allemand anglais DUN-SUR-MEUSE Jean Mermoz anglais allemand allemand anglais ETAIN Louise Michel anglais espagnol allemand anglais FRESNES-EN-WOEVRE Louis Pergaud anglais allemand allemand NORD espagnol MEUSIEN anglais MONTMEDY Jean d'Allamont anglais allemand allemand anglais STENAY Alfred Kastler anglais allemand allemand italien anglais allemand THIERVILLE-SUR-MEUSE Saint Exupéry anglais allemand allemand espagnol allemand anglais VERDUN Buvignier anglais allemand allemand espagnol italien anglais allemand VERDUN Maurice Barrès anglais allemand allemand espagnol Liaison primaire - collège 55 Collèges 2015 Langues offertes dans les Bilangue BEF écoles du secteur de Ville Etablissement LV1 LV2 (LG hors recrutement du collège anglais) anglais ANCERVILLE Emilie Carles anglais espagnol allemand italien anglais BAR-LE-DUC André Theuriet anglais espagnol allemand anglais BAR-LE-DUC Jacques Prévert anglais espagnol allemand anglais allemand BAR-LE-DUC Raymond Poincaré anglais espagnol allemand italien allemand anglais COMMERCY Les Tilleuls anglais espagnol allemand italien anglais GONDRECOURT-LE-CHATEAU du Val d'Ornois -
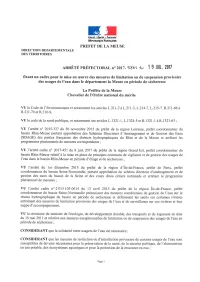
Arrêté Cadre Secheresse 2017
Page 1 Annexe 2 – Répartition des communes par zones d’alerte Zone d’alerte 1 : Aisne amont 55014 AUBREVILLE 55285 LAVOYE 55017 AUTRECOURT-SUR-AIRE 55116 LE CLAON 55023 AVOCOURT 55379 LE NEUFOUR 55032 BAUDREMONT 55253 LES ISLETTES 55033 BAULNY 55497 LES SOUHESMES-RAMPONT 55038 BEAULIEU-EN-ARGONNE 55254 LES TROIS-DOMAINES 55040 BEAUSITE 55289 LEVONCOURT 55044 BELRAIN 55290 LIGNIERES-SUR-AIRE 55065 BOUREUILLES 55295 LISLE-EN-BARROIS 55068 BRABANT-EN-ARGONNE 55301 LONGCHAMPS-SUR-AIRE 55081 BRIZEAUX 55343 MONTBLAINVILLE 55082 BROCOURT-EN-ARGONNE 55346 MONTFAUCON-D'ARGONNE 55103 CHARPENTRY 55380 NEUVILLE-EN-VERDUNOIS 55108 CHAUMONT-SUR-AIRE 55383 NEUVILLY-EN-ARGONNE 55113 CHEPPY 55384 NICEY-SUR-AIRE 55117 CLERMONT-EN-ARGONNE 55389 NUBECOURT 55128 COURCELLES-SUR-AIRE 55395 OSCHES 55129 COUROUVRE 55404 PIERREFITTE-SUR-AIRE 55518 COUSANCES-LES-TRICONVILLE 55409 PRETZ-EN-ARGONNE 55141 DAGONVILLE 55442 RAIVAL 55155 DOMBASLE-EN-ARGONNE 55416 RARECOURT 55174 EPINONVILLE 55419 RECICOURT 55175 ERIZE-LA-BRULEE 55446 RUMONT 55177 ERIZE-LA-PETITE 55453 SAINT-ANDRE-EN-BARROIS 55178 ERIZE-SAINT-DIZIER 55454 SAINT-AUBIN-SUR-AIRE 55179 ERNEVILLE-AUX-BOIS 55000 SEIGNEULLES 55185 EVRES 55517 SEUIL-D'ARGONNE 55194 FOUCAUCOURT-SUR-THABAS 55498 SOUILLY 55199 FROIDOS 55525 VADELAINCOURT 55202 FUTEAU 55527 VARENNES-EN-ARGONNE 55208 GESNES-EN-ARGONNE 55532 VAUBECOURT 55210 GIMECOURT 55536 VAUQUOIS 55251 IPPECOURT 55549 VERY 55257 JOUY-EN-ARGONNE 55555 VILLE-DEVANT-BELRAIN 55260 JULVECOURT 55567 VILLE-SUR-COUSANCES 55266 LACHALADE 55570 VILLOTTE-SUR-AIRE 55282 LAVALLEE -

SI D'électrification De La Région De Meuse Argonne Voie Sacrée (Siren : 255501181)
Groupement Mise à jour le 01/07/2021 SI d'électrification de la région de Meuse Argonne Voie Sacrée (Siren : 255501181) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) Syndicat à la carte oui Commune siège Beausite Arrondissement Bar-le-Duc Département Meuse Interdépartemental non Date de création Date de création 07/01/1924 Date d'effet 07/01/1924 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Même nombre de sièges Nom du président M. Didier ZAMBAUX Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège 42, rue Berne Numéro et libellé dans la voie Distribution spéciale Code postal - Ville 55250 BEAUSITE Téléphone Fax Courriel Site internet Profil financier Mode de financement Contributions budgétaires des membres Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non 1/4 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Population Population totale regroupée 8 581 Densité moyenne 13,46 Périmètres Nombre total de membres : 45 - Dont 45 communes membres : Dept Commune (N° SIREN) Population 55 Ancemont (215500091) 558 55 Autrécourt-sur-Aire (215500174) 121 55 Beaulieu-en-Argonne (215500380) 39 55 Beausite (215500406) 258 55 Béthelainville (215500471) 172 55 Brabant-en-Argonne (215500687) 111 55 Brizeaux (215500810) 59 55 Brocourt-en-Argonne (215500828) 47 55 Dombasle-en-Argonne (215501552) 409 55 Érize-la-Petite (215501776) 55 55 Èvres -
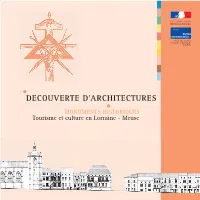
Decouverte D'architectures
DECOUVERTE D’ARCHITECTURES MONUMENTS HISTORIQUES Tourisme et culture en Lorraine - Meuse L’État, avec le concours des collectivités territoriales, protège et participe à la mise en valeur des monuments historiques. Il entend aussi promouvoir un environnement de qualité. Ces objectifs ne peuvent être atteints sans une politique de formation et de sensibilisation du public à l’architecture, à l’urbanisme et au paysage. Ce guide est un document pédagogique. Il nous aidera à découvrir la qualité artistique, la valeur historique, la richesse constructive et technique des monuments historiques de la Meuse tout en nous familiarisant avec le langage de l’architecture. Il nous permettra de mieux faire connaître le patrimoine de la Meuse et contribuera au développement touristique et culturel du département. Sa publication a été rendue possible grâce à l’action du service départemental de l’architecture et du patrimoine, grâce au concours des collectivités territoriales et des professionnels du patrimoine : architectes et entreprises du bâtiment. Cette large participation confirme l’intérêt de tous pour notre patrimoine. Michel LAFON Préfet de la Meuse Ce guide, édité en 1994, avait été réalisé par le SDAP de la Meuse : Avec le concours des partenaires suivants : Préfecture de la Meuse • Conseil régional de Lorraine • Conseil général de la Meuse • Conservation régionale des monuments historiques de la DRAC Lorraine • Archives départementales de la Meuse • Conservation des antiquités et objets d’art • Association les Amis du patrimoine Meusien • Des Villes et Communes de VERDUN, BAR LE DUC, COMMERCY, SAINT MIHIEL, VAUCOULEURS, MONTMEDY, CLERMONT EN ARGONNE, VIGNEULLES LES HATTONCHATEL, LIGNY EN BARROIS • Agence Alligator et ses collaborateurs. -

Randonnées Infos
INFOS RANDONNÉES du pays de Revigny COmmunauté de communes du PAys de RevignY (COPARY) 2, Place Pierre Gaxotte - 55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN 03 29 78 75 69 www.copary.fr - cultureencopary [email protected] Point d’Information Touristique - Camping Rue du stade - 55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN Livret d’accompagnement 03 29 78 73 34 de la randonnée [email protected] Office de Tourisme Meuse Grand Sud 7 rue Jeanne d’Arc - 55000 BAR-LE-DUC 03 29 79 11 13 www.tourisme-barleduc.fr Verdun Sommeilles Reims 1 Laheycourt 3 A découvrir également : Nettancourt 5 Villers-aux-Vents 1- La boucle des Girollis 2 8 2 - La boucle d’Éole Revigny-sur-Ornain 6 Laimont Bar-le-Duc 4 - La boucle des Aulnes Nancy Vitry-le-François 5 - La boucle des Boudières Andernay Boucle du Mognéville ary.fr 6 - La boucle de la Forestière 7 .cop 4 ww 7 - La boucle de Neptune Chêne Henriot r w su 8 - Le sentier pédagogique de l’Ancien étang à Laimont le ib on p Le circuit urbain de Revigny-sur-Ornain is d Saint-Dizier io d u a Retrouvez l’ensemble de nos sentiers en version téléchargeable papier ou n io audio sur notre site Internet : www.copary.fr s r e V Imprimé sur papier recyclé Plan de repérage des postes d’interprétation Infos pratiques 3 - Boucle du Chêne Henriot Village de départ : Laheycourt ChartePoint de départ du : devant randonneur le panneau des Randonnées, à l’angle de la Mairie et de la rue de la Chée. LongueurRestons de la boucle sur les : chemins14,5 km balisés Temps de marche indicatif : 4 heures Le long duAyons sentier, un équipement 15 postes adapté repérés : chaussures sur le plan de marche,vous invitent eau, vêtement à consulter de pluie les commentaires et croquis du guide de promenade qui s’y rapportent ou à écouter leur version audio.