Plan Local D'urbanisme
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

Persan Beaumont – Paris Est Arrivee
PERSAN BEAUMONT – PARIS EST ARRIVEE 48,9 km – 2:00h arrêt A: PERSAN BEAUMONT B: CHAMPAGNE SUR OISE A B PERSAN BEAUMONT C: L'ISLE ADAM PARMAIN CHAMPAGNE SUR OISE C L'ISLE ADAM PARMAIN D: VALMONDOIS D VALMONDOIS E MERIEL E: MERIEL F G MERY SUR OISE F: MERY SUR OISE HFREPILLON BESSANCOURT I J KTVAAUCELLESVERNY DIR =>PERSAN PARIS SAINT-LEU LA FORET G: FREPILLON L M GROS NOYER SAINT- N ERMONTO HALTE H: BESSANCOURT PRIXERMONTPCHAMP EAUBONNE DE COURSES Q ENGHIEN LES BAINS => D'ENGHIENRLA BARRE => ORMESSON PARIS PARISEPINA NORDY VILLETANEUSE NORD=> PARIS NORD I: TAVERNY DIR PERSAN S SAINT-DENIS J: VAUCELLES => PARIS TU K: SAINT-LEU LA FORET PPARISARIS NORDEST ARRIVEE (D NORD) L: GROS NOYER SAINT-PRIX M: ERMONT HALTE 10 km N: ERMONT EAUBONNE O: CHAMP DE COURSES D'ENGHIEN => PARIS NORD P: ENGHIEN LES BAINS => PARIS NORD Q: LA BARRE ORMESSON => PARIS NORD arrêt R:1: EPINA0,1 kmY VILLETtournezANEUSE légérement à droite D78 Avenue Jean Jaurès S: SAINT-DENIS 2: 0,2 km Faites demi-tour, si possible T: PARIS NORD (D NORD) 3: 0,7 km tournez à gauche D78 Avenue U: PARIS EST ARRIVEE Gaston Vermeire 4: 1,0 km tournez à gauche D4z 5: 1,0 km tournez à gauche D4z 6: 1,2 km Prenez la première sortie au rond- 54 point D4z Rue Etienne Dolet 6 7: 1,4 km Prenez la première sortie au rond- 3 7 point D4z Avenue Gaston Vermeire 1 2 A PERSAN BEAUMONT 300 m 7: 1,4 km Prenez la première sortie au rond- point D4z Avenue Gaston Vermeire 8: 2,4 km tournez légèrement à gauche D4 9: 2,4 km Prenez la première sortie au rond- point D4 Rue Raymond Poincaré 7 8 9 300 m 9: 2,4 -
6 Oct 15 Déc 2019
24e édition en Val d’Oise Infos et réservations : 01 39 89 87 51 www.jazzaufildeloise.fr 6 OCT 15 DÉC 2019 BEAUMONT-SUR-OISE BEZONS BUTRY-SUR-OISE CERGY COURDIMANCHE ERAGNY-SUR-OISE ERMONT GONESSE L’ISLE-ADAM JOUY-LE-MOUTIER MARINES MÉRIEL MONTMORENCY NEUVILLE-SUR-OISE OSNY PARMAIN PERSAN SAINT-OUEN L’AUMÔNE VALMONDOIS VAURÉAL CERGY-PONTOISE VAL D’OISE PRÉSENTATION DE L’ÉDITION 2019 SAMEDI 5 OCTOBRE PONTOISE à 18h30 Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise Théâtre des Louvrais, place de la Paix 95300 PONTOISE Entrée libre sur réservation 1/ Film de présentation du Festival 2019 2/ Carte blanche à FRANÇOIS SALQUE FRANÇOIS SALQUE, violoncelle, THOMAS ENHCO, piano FRANÇOIS SALQUE © Marc Chesneau PROGRAMME DIMANCHE 6 OCTOBRE PARMAIN à 17h Salle Jean Sarment Allée des peupliers 95620 PARMAIN Tarif plein : 17 € - Tarif réduit : 13 € ELECTRO DELUXE Rétrofutur JAMES COPLEY, voix, THOMAS FAURE, saxophone & programmation, VINCENT PAYEN, trompette, BERTRAND LUZIGNANT, trombone, GAËL CADOUX, claviers, JÉRÉMIE COKE, basse, ARNAUD RENAVILLE, batterie Sortie d’album Automne 2019 ELECTRO DELUXE © Roch Armando VENDREDI 8 NOVEMBRE PONTOISE à 20h30 Office du Tourisme de Cergy-Pontoise Place de la piscine 95300 PONTOISE Tarif plein : 17 € - Tarif réduit : 13 € BAPTISTE TROTIGNON Solo You’ve changed BAPTISTE TROTIGNON, piano Sortie d’album en novembre 2019 BAPTISTE TROTIGNON © Remi Angeli SAMEDI 9 NOVEMBRE NEUVILLE-SUR-OISE à 20h30 Foyer Communal 65 rue Joseph Cornudet 95000 NEUVILLE-SUR-OISE Tarif plein : 17 € - Tarif réduit : 13 € AKSHAM DAVID ENHCO, trompette, ELINA DUNI, voix, MARC PERRENOUD, piano, FLORENT NISSE, contrebasse, FRED PASQUA, batterie AKSHAM © D.R. -

Etab L'isle Adam)
35 SITE - COMMUNES EST (Etab l'Isle Adam) SITE - COMMUNES EST (Etab l'Isle Adam) Etablissements desservis L'ISLE-ADAM - College Pierre Et Marie Curie L'ISLE-ADAM - Lycee General Et Technologique Fragonard L'ISLE-ADAM - College Prive Notre Dame IEA 1 IEA 3 IEA 5 IEA 7 Code girouette 1700 1700 1700 1700 Jours de fonctionnement LMMJV LMMJV LMMJV LMMJV Persan Mairie 07:25 Persan Les Frenoys 07:27 Beaumont-Sur-Oise Rue de Senlis 07:34 Beaumont-Sur-Oise Sécurité Sociale 07:36 Bruyères-Sur-Oise Paul Verlaine 07:19 Bruyères-Sur-Oise Mairie 07:20 - Bruyères-Sur-Oise Croix Dorée 07:23 - Bernes-Sur-Oise Peupleraie 07:25 - Bernes-Sur-Oise La Bouville 07:27 - Nerville-La-Foret Mairie 07:28 - - 08:36 Nerville-La-Foret Harlay 07:29 - - 08:37 Presles Forgeron 07:40 - - 08:47 Presles Gare SNCF - 07:44 07:44 08:49 Presles Salle annexe 07:41 07:44 - 08:49 Nointel Vieux Village 07:47 - - 08:55 Nointel Vieux Potager 07:48 - - 08:56 Nointel Passage À Niveau 07:50 - - 08:58 Mours Les prés de Mours 07:53 - - 09:00 Mours Les lilas 07:56 - - 09:01 Mours Grandchamps 07:57 - - 09:02 L'Isle-Adam Ces P et M Curie 08:07 08:06 08:06 09:10 L'Isle-Adam Lycée Fragonard 08:07 08:06 08:06 09:10 L'Isle-Adam Navette Inst N Dame correspondance correspondance correspondance - IEA 9 IEA 11 Code girouette 1700 1700 Jours de fonctionnement LMMJV LMMJV Villiers-Adam Mairie 07:40 08:40 Villiers-Adam Charbonnière 07:41 08:41 Villiers-Adam Bord Haut 07:42 08:42 Villiers-Adam Pré Collard 07:43 08:43 Meriel Collège Cécile Sorel 07:46 08:46 Meriel Massenet 07:47 08:47 Meriel Faisanderie -

Accusé De Réception En Préfecture 075-287500078-20130710-2013-252-DE Date De Télétransmission : 15/07/2013 Date De Réception Préfecture : 15/07/2013
Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20130710-2013-252-DE Date de télétransmission : 15/07/2013 Date de réception préfecture : 15/07/2013 AVENANT N°3 au Contrat de type 2 Haut Val d’Oise – 002 016 1 Le présent avenant est établi entre : Le Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF), Etablissement public à caractère administratif régi par l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée et le décret n° 2005-664 du 10 juin 2005, dont le siège social est situé au 41 rue de Châteaudun, 75009 Paris, représenté par Sophie Mougard en sa qualité de directrice générale, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération du Conseil en date du 10 juillet 2013. Ci-après dénommé le « STIF », d'une part, ET La SOCIETE Les Courriers d’Ile de France, société par actions simplifiée au capital de 343 696 € inscrite au RCS de Meaux sous le numéro 562 091 132, dont le siège est situé 34 rue de Guivry au Mesnil Amelot (77990), représentée par Jean-Olivier Ehkirch, Directeur, dûment habilité à cet effet. ET La SOCIETE Keolis Val d’Oise, société en nom collectif au capital de 127.500 € inscrite au RCS de Pontoise sous le numéro 339 654 147, dont le siège est situé 1 chemin pavé à Bernes sur Oise (95340), représentée par Michel Rouvière, Directeur, dûment habilité à cet effet. ET La Société CARS LACROIX, SAS au capital de 558600 €, inscrite au RCS de Pontoise sous le n° SIREN 780 053 898 et n° SIRET 780053 898 000 42, dont le siège social est situé 53-55 Chaussée Jules César 95 250 BEAUCHAMP, représentée par son Président, Monsieur BARRAULT Jean-Sébastien, dûment habilité à cet effet. -

La Tragédie Ilfut Invité Avec Sa Maman Et Rrùs Une Ceinture De Balles Dans Son Arme Pour Terroriser Le Son Frère À Dormir À La Ferme De Monsieur Et Madame Van Grollpe
ARCHIVES NERVILLOISES Sous la direction de Jacques Mouclier, Maire de Nerville-la-Forêt Août 1944 , LA TRAGEDIE Dossier réalisé par Vincent et Claude Danis 1 TABLE DES MATIERES " là4 Titre - Liminaire 5&6 Avant-propos : Les faits en situation 7 à 12 Témoignages des familles des victimes: Monsieur Roland Duclos Gladys May Duclos Madame Simone Zanin, née Sadier Madame Simone Commelin 12 & 13 Témoignage du dernier otage survivant : Monsieur Roger Fort 13 & 14 Témoignages de Madame Georgette Danis et de Monsieur Albert Courcelle (extrait de son journal) 15 & 16 Les obsèques 16 & 17 Les faits relatés par la presse 18 &19 En librairie "Défense de la France" 20 & 21 Épilogue - Annexes · Sont-ils morts pour quelque chose, ou pour peu de choses ? « Tu peux serrer dans ta main une abeille jusqu'à ce qu'elle étouffe, écrivait Jean Paulhan (l'abeille 1942). Elle n'étouffera pas sans t'avoir piqué. e'est peu de choses, mais si elle ne te piquait pas, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus d'abeilles» Jean Paulhan, L'Abeille, 1942. 3 «Tous morts • » 'est par ces mots, qu'un soldat repousse accueillant toujours avec sympathie et les une jeune fille de dix-neuf ans, alors aidant si besoin était ? Cqu'elle demande ce qui va être fait aux Nous, les enfants qui étions à Nerville durant otages qui viennent d'être embarqués dans un cette période, nous nous souvenons de ces camion, stationné place de la mairie, à Nerville. jeunes gens qui nous étaient devenus familiers. Nous sommes le 15 août 1944 en fin d'après Mais pourquoi étaient-ils tous absents de midi. -

CIF-KVO Plan General-480X220 Juin 2018
F Bernes/Oise AFPA IM Réseau bus du Haut Val d’Oise rue A D A. Bruyères/Oise 2 MONTSOULT – PERSAN BEAUMONT Gance BRUYÈRES- Mairie Rue de Boran A BRUYÈRES/OISE Rue de Boran – PERSAN BEAUMONT – PERSAN ZAE Chemin Vert rue des Ayettes Creil SUR-OISE La Bouville Grande Rue de Collège r. de la B PERSAN BEAUMONT – NOINTEL MOURS C rue Perret r. de l’Église Centre Boran A Commercial Mairie C CHAMPAGNE/OISE Beaux Soleils – PERSAN BEAUMONT – PERSAN Felix Millet Persan Berlioz av. Hall des de Persan rue Felix Millet Peupleraie Mairie Sports Bienvenue BEAUMONT/OISE Lycée – NOINTEL – MOURS Grands Champs E Les Saules Bel Air BERNES- r. de le Ferme Blanche de rue Croix Dorée Bernes Paul Verlaine F PERSAN BEAUMONT – BERNES/OISE AFPA Lucien Colonel Catelas A SUR-OISE r. Jacques RoyerVogt Collège Château Centre G NOINTEL MOURS – NOINTEL – MOURS – BEAUMONT/OISE Duquesnel Brassens Fabien Persan av. de l’Ile de France r. Ville Collège ZAE Chemin Vert Pasteur Jean Bruyères-sur-Oise DIM BEAUMONT/OISE Mairie – PERSAN BEAUMONT – BRUYÈRES/OISE Rue de Boran Brassens Étienne rue A Dolet r. Vermeire Mairie r. Sémard Jacques Touati Centre B C F 2 DIM 100 rue Royer 01 30 34 26 50 Culturel Parc Robespierre r. É Dolet. Stade Péri Persan Beaumont DDASS D 922 keolis-valdoise.com Pl. de la vianavigo.com PERSAN République Oise A E BrossoletteEspace r. Mendela Vieux Pont Stade Beaumont-sur-Oise Keolis Val d’Oise Paul Eluard r. Jaurès Souvenir Lycée 3 chemin Pavé A16 Lycée Galois 95340 BERNES-SUR-OISE Zola La Soie Centre Blum Blum Senlis ôtel rue rue de l’H Commercial Piscine Van Gogh rue de Senlis D 922 membre de l’association Optile Elie et Corentin Quideau bd r. -

CLASSEMENT DES COMMUNES DU VAL D'oise ANNEXE 22 Dans Les
ANNEXE 22 CLASSEMENT DES COMMUNES DU VAL D'OISE dans les différentes zones de résidence COMMUNES Zone COMMUNES Zone COMMUNES Zone ABLEIGES 3 FONTENAY En PARISIS 2 NERVILLE La FORET 2 AINCOURT 3 FOSSES 2 NESLES La VALLEE 1 AMBLEVILLE 3 FRANCONVILLE 1 NEUILLY En VEXIN 3 ANDILLY 1 FREMAINVILLE 3 NEUVILLE Sur OISE 1 ARGENTEUIL 1 FREMECOURT 3 NOINTEL 2 ARNOUVILLE Les GONESSE 1 FREPILLON 1 NOISY Sur OISE 2 ARRONVILLE 3 FROUVILLE 3 NUCOURT 3 ARTHIES 3 ASNIERES Sur OISE 1 GARGES Les GONESSE 1 OMERVILLE 3 ATTAINVILLE 2 GENAINVILLE 3 OSNY 1 AUVERS Sur OISE 1 GENICOURT 2 AVERNES 3 GONESSE 1 PARMAIN 1 GOUSSAINVILLE 1 PERSAN 1 BAILLET En FRANCE 2 GOUZANGREZ 3 PIERRELAYE 1 BEAUCHAMP 1 GRISY Les PLATRES 3 PISCOP 1 BEAUMONT Sur OISE 1 GROSLAY 1 PONTOISE 1 BELLOY En FRANCE 2 PRESLES 2 BERNES Sur OISE 1 HARAVILLIERS 3 PUISEUX En FRANCE 1 BERVILLE 3 HEDOUVILLE 3 PUISEUX PONTOISE 1 BESSANCOURT 1 HERBLAY 1 BETHEMONT La FORET 2 HEROUVILLE 3 ROISSY En FRANCE 2 BEZONS 1 HODENT 3 RONQUEROLLES 1 BOISEMONT 2 BOISSY L'AILLERIE 2 JOUY Le MOUTIER 1 SAGY 3 BONNEUIL En FRANCE 1 SANNOIS 1 BOUFFEMONT 1 L'ISLE ADAM 1 SANTEUIL 3 BOUQUEVAL 2 LA CHAPELLE En VEXIN 3 SARCELLES 1 BRAY Et LU 3 LA FRETTE Sur SEINE 1 SERAINCOURT 3 BREANCON 3 LA ROCHE GUYON 3 SEUGY 1 BRIGNANCOURT 3 LABBEVILLE 3 SOISY Sous MONTMORENCY 1 BRUYERES Sur OISE 2 LE BELLAY En VEXIN 3 ST BRICE Sous FORET 1 BUHY 3 LE HAULME 3 ST CLAIR Sur EPTE 3 BUTRY Sur OISE 1 LE MESNIL AUBRY 2 ST CYR En ARTHIES 3 LE PERCHAY 3 ST GERVAIS 3 CERGY 1 LE PLESSIS BOUCHARD 1 ST GRATIEN 1 CHAMPAGNE Sur OISE 1 LE PLESSIS LUZARCHES -

PONTOISE VALMONDOIS PERSAN.Indd
INFO TRAVAUX LIGNE H FERMÉE AUCUN TRAIN ENTRE VALMONDOIS ET PONTOISE MAI MAI MAI 8 et 9 13 14 + D’INFORMATION transilien.com maligneh.transilien.com Appli Île-de-France Mobilités Assistant SNCF Agents SNCF PONTOISE Chaponval Auvers sur Oise Valmondois l'Isle Adam ParmainChampagne sur Oise Persan BeaumontBruyères sur Oise Boran sur OisePrécy sur OiseSaint-Leu d'EsserentCREIL St-Ouen l’AumôneÉpluches Pont Petit X BUS DE SUBSTITION Portion de ligne fermée X Gare non desservie par les bus PONTOISE <> VALMONDOIS Samedi 8 mai Dimanche 9 mai Jeudi 13 mai PONTOISE VALMONDOIS PONTOISE 06:03 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 16:03 ÉPLUCHES 06:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 16:12 PONT PETIT 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 16:16 VALMONDOIS 06:32 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 16:32 PONTOISE 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03 22:03 ÉPLUCHES 17:12 18:12 19:12 20:12 21:12 22:12 PONT PETIT 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16 22:16 VALMONDOIS 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32 22:32 VALMONDOIS PONTOISE VALMONDOIS 06:22 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 16:22 PONT PETIT 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 16:38 EPLUCHES 06:42 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 16:42 PONTOISE 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 16:51 VALMONDOIS 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 PONT PETIT 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38 EPLUCHES 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 PONTOISE 17:51 18:51 19:51 20:51 21:51 les horaires des bus sont donnés à titre indicatif et peuvent -

Des Services De Soins Et D'aides À La Vie Sociale Dans Le Val-D'oise 2017
UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES MALADES ET/OU HANDICAPÉES PSYCHIQUES GUIDE des services de soins et d’aides à la vie sociale dans le Val-d’Oise 2017 À l’attention des aidants familiaux et professionnels de personnes souffrant de troubles psychiques Guide édité par la Délégation Unafam du Val-d’Oise avec le soutien du Conseil Départemental du Val-d’Oise et de l'Union Départementale des CCAS du Val d'Oise Rédaction : Délégation de l’UNAFAM du Val-d’Oise Illustrations : Artistes du GEM Artame Gallery. Le Groupe d’Entraide Mutuelle Artame Gallery s’adresse à des artistes fragilisés par un trouble psychique, plasticiens formés ou autodidactes ayant une pratique régulière. 37 rue Ramponeau – 75020 PARIS www.artamegallery.com UNAFAM 95 : Guide Page 2 Nous sommes tous désemparés ou nous l’avons été, devant les manifestations de la maladie mentale de l’un de nos proches. Où aller ?... Qui consulter ?... Il refuse les soins… Elle va sortir de l’hôpital, Que faire ?… Peut-elle travailler ?... Le déni de la maladie, le sentiment de culpabilité et de honte, la méconnaissance des pathologies psychiatriques et des troubles qu’ils entraînent, l’hésitation voire le refus de demander de l’aide… Le tout, accentué par la détérioration de la communication avec le proche malade, donne aux familles un sentiment d’impuissance qui les plonge rapidement dans l’isolement. Ce petit ouvrage propose une première réponse : vous n’êtes pas seuls ! Vous n’êtes pas seuls à vous retrouver dans une telle situation. D’autres en ont fait la douloureuse expérience, certains se sont regroupés en association d’entraide, l’UNAFAM. -

PARMAIN NOTRE VILLE #1(Link Is External)
SOMMAIRE #1 Edito du maire p.3 Retour sur images p.30 • Cérémonie militaire 30 août Nouvelle équipe municipale p.4 Du côté des associations p.32 • Forum des associations Autour du tapis vert p.9 • Café associatif « la Cabane » • Futsal • Secours catholique Vie communale p.10 • CPCLC • Solidarités Nouvelles face au chômage • Travaux - circulation • AREJ • Sécurité – environnement • APEPJ • Zone bleue Arcades • Lyrae • Police municipale • Chœurs de la Vallée du Sausseron • Dépôts sauvages • Club Parminois du Temps des Loisirs • TRI-OR • SMBO • Urbanisme - Habitat p.18 A propos de… p.39 • Du côté des écoles p.19 • Toujours à vos côtés pour lutter contre les • Fermeture de la poste cancers • Commerce et artisanat • Changement d’adresse de la CAF • Marché de Parmain • Marché de Noël • Concours photos Internet CCVO3F p.40 • Cet été à l’accueil de loisirs • Plan de continuité d’activité de la mairie de Parmain p.27 • Permis de construire p.44 • Déclarations préalables p.44 Culturel p.28 • Rentrée culturelle TRIBUNES p.45 • Le jeu du lutin fouineur • Naissances p.46 • Mariages p.46 • Décès p.46 • Agenda p.47 2 Magazine d'informations - Octobre 2020 Chères Parminoises, Chers Parminois Vous avez entre les mains le premier numéro de "Parmain notre ville" qui symbolise le rebond et le dynamisme que nous souhaitons donner à notre commune. Comme vous le constaterez au fil des pages qui suivent, nous avons choisi non seulement de vous faire partager l’actualité par l’image, mais aussi d’expliquer plus longuement ce qui sous-tend certaines évolutions de notre commune. Au moment où cette brochure est mise sous presse, nous pouvons nous Retrouvez nous sur satisfaire d’une rentrée scolaire réussie. -

A Bruyères-Sur-Oise Persan
A BRUYÈRES-SUR-OISE PERSAN Horaires valables du 26 août 2019 au 23 août 2020 BRUYÈRES-SUR-OISE PERSAN BRUYÈRES-SUR-OISE BERNES-SUR-OISE BEAUMONT- PERSAN SUR-OISE Centre Ville Centre Aquatique Rue de BoranBienvenue Croix Dorée Peupleraie Mairie La Bouville Bel Air Les Tourelles Persan BeaumontCentre CommercialGareCAT La Soie Paul Éluard Mairie Collège BrassensColonel FabienLes Saules ZAE Chemin Vert Mairie 4 min 5 min Lycée Paul Verlaine Centre Commercial A certaines heures Arrêt desservi Cheminement piéton dans un seul sens ZONE 5 Du lundi au vendredi BRUYÈRES- Rue de Boran 5:08 5:52 6:07 6:20 6:37 6:52 7:10 7:36 7:51 8:04 SUR-OISE Bienvenue 5:09 5:53 6:08 6:21 6:38 6:53 7:11 7:37 7:52 8:05 Paul Verlaine 5:09 5:53 6:08 6:21 6:38 6:53 7:12 7:38 7:53 8:06 Mairie 5:10 5:54 6:09 6:22 6:39 6:54 7:13 7:39 7:54 8:00 8:07 Centre Commercial 5:12 5:56 6:11 6:24 6:41 6:56 7:15 7:41 7:56 8:02 8:09 Croix Dorée 5:13 5:57 6:12 6:25 6:42 6:57 7:16 7:42 7:57 8:03 8:10 BERNES- Peupleraie 5:16 6:00 6:15 6:28 6:45 7:00 7:19 7:45 8:00 8:06 8:13 SUR-OISE Mairie 5:18 6:02 6:17 6:30 6:47 7:02 7:21 7:47 8:02 8:08 8:15 La Bouville 5:19 6:03 6:18 6:31 6:48 7:03 7:22 7:48 8:03 8:09 8:16 Bel Air 5:20 6:04 6:19 6:32 6:49 7:04 7:23 7:49 8:04 8:10 8:17 BEAUMONT- Centre Aquatique 5:23 6:07 6:22 6:35 6:52 7:07 7:26 7:52 8:07 SUR-OISE Lycée 8:15 8:22 Les Tourelles 5:24 6:08 6:23 6:36 6:53 7:08 7:27 7:53 8:08 PERSAN Persan Beaumont Gare 5:28 6:12 6:27 6:40 6:57 7:12 7:31 7:57 8:12 Départ* du train vers Pontoise 5:49 6:19 6:49 7:19 7:49 8:19 Départ* vers Paris via Montsoult -
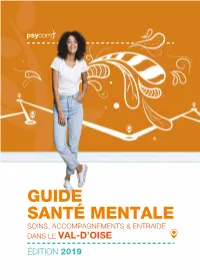
Guide Santé Mentale Soins, Accompagnements & Entraide Dans Le Val-D’Oise Édition 2019 2 Édito
GUIDE SANTÉ MENTALE SOINS, ACCOMPAGNEMENTS & ENTRAIDE DANS LE VAL-D’OISE ÉDITION 2019 2 ÉDITO a publication d’un guide santé mentale pour chaque dépar- L tement francilien est une des actions majeures du Psycom, soute- nue par l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France. Psycom est un groupement de coopération sanitaire à vocation régionale. Il a pour principales missions d’informer le public et les professionnels sur la santé mentale, ainsi que d’œuvrer à l’amélioration des conditions de vie et l’inclusion sociale et citoyenne des personnes vivant avec un trouble psychique. Chaque guide contribue à la mise en œuvre d’un des objectifs du projet régional de santé : assurer une meilleure lisibilité de l’offre de prise en charge et d’accompagnement, qu’elle soit sanitaire, médico-sociale et sociale. Ce travail est le fruit de la collaboration quotidienne avec l’ensemble des acteurs de la santé mentale du territoire. Je tiens à remercier, chaleureusement, toutes les personnes qui se sont engagées au service de ce projet. Psycom développe d’autres actions en matière de commu- ni ca tion, d’information, de formation et de conseils en santé mentale. Je vous invite à consulter son site Internet, www.psycom.org, pour en prendre connaissance et partager autour de vous ces initiatives en faveur de la promotion de la santé mentale et de l’accès aux soins. Lazare Reyes, Administrateur du Psycom 3 4 INTRODUCTION u cours des 40 dernières années, l’organisation des soins psychiatriques a beaucoup évolué, passant des soins A hospitaliers aux soins dans la Cité, au plus près des lieux de vie des personnes et de leur entourage.