BOURSEVILLE Sommaire
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
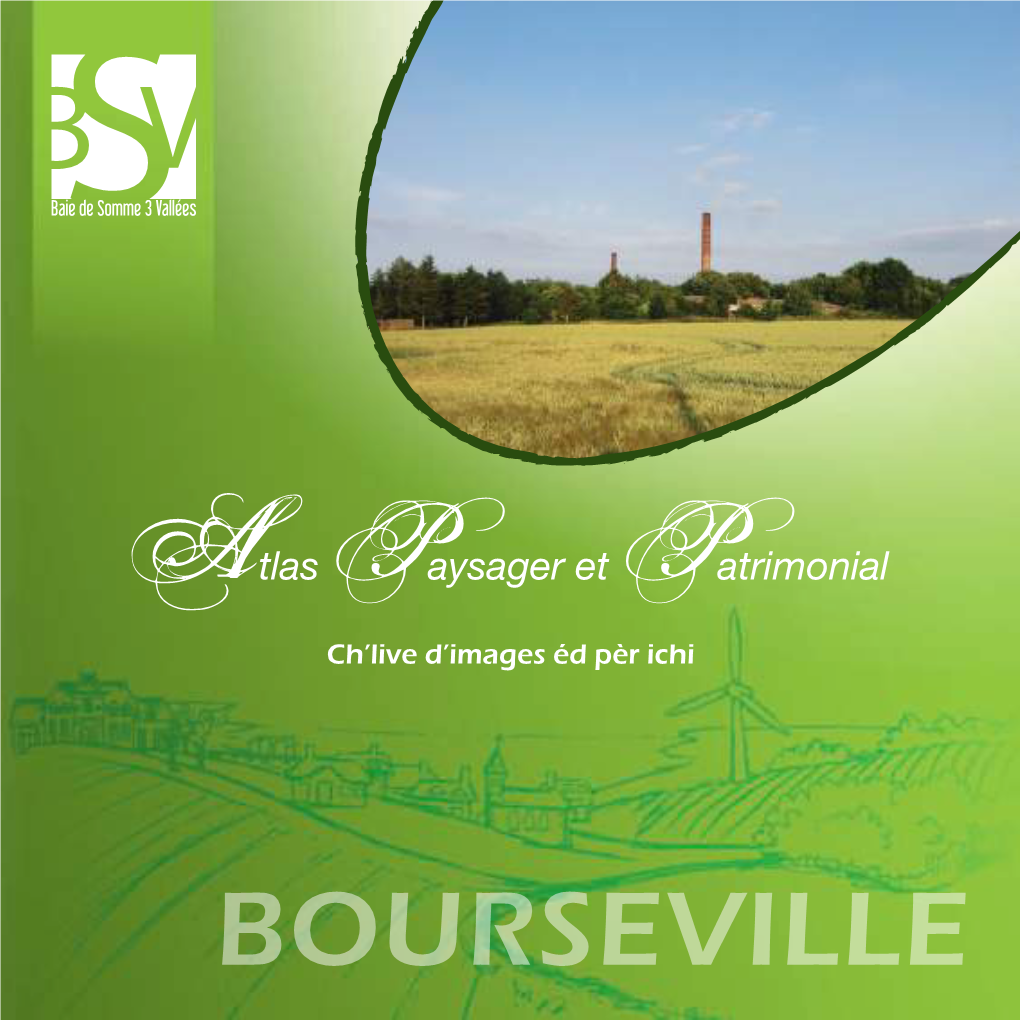
Load more
Recommended publications
-

Bourseville Infos
Bourseville Infos Octobre 2018 Edito : Comme vous pouvez le constater, chaque jour, en vous promenant dans notre village, Bourseville change ! De nouvelles maisons sortent de terre et nous pouvons que nous réjouir d’accueillir de nouveaux habitants. Plus d’habitations, cela veut dire, plus d’administrés… Le prochain recensement de la population, prévu du 17 janvier au 16 février 2019 sera l’occasion de mesurer cette évolution. L’arrivée de jeunes couples dans la commune, c’est aussi l’espoir de voir de nombreuses « petites têtes » venir compléter nos classes afin de préserver notre école ! Pour faciliter la venue des nouveaux arrivants, la commission de communication a réalisé un petit « livret d’accueil » proposant au fil des pages, de nombreux services, conseils et informations. Ce livret sera distribué à toutes les personnes qui arrivent à Bourseville et sera également disponible en Mairie. Concernant le fleurissement, la commune a obtenu de la part du jury départemental les « Félicitations du jury » pour les villages classés en catégorie 2. Merci à la commission fleurissement et aux boursevillois qui ont participé activement à l’embellissement de notre village. Un dernier mot, concernant les finances de la commune, qu’il ne faut jamais oublier ! A moins de trois mois de la fin de l’année, les différents éléments chiffrés en notre possession nous permettent de confirmer les objectifs que nous nous sommes fixés. Cela signifie, sauf imprévu, des comptes en équilibre, conformément au budget, sans avoir à puiser dans nos réserves. Je vous -

1 Sous-Préfecture D'abbeville
AD SOMME Sous-préfecture d'Abbeville. - Administration générale (sous-série 103W). La sous-série 103W comprend essentiellement des dossiers thématiques, des dossiers de contrôle des communes et des dossiers de subvention d'équipement, ainsi que quelques dossiers relatifs à l'Occupation. 1926 - 1968 Support : 289 articles Langue et écriture : Documents écrits en langues française et allemande. Administration générale et économie Administration de l'arrondissement (dossiers par année) 103W5 Dossiers de l'année 1940. - Administration générale. 1940 103W16 Dossiers de l'année 1940. - Circulation, cartes d'identité. Fonds de chômage. Contributions indirectes. Districts militaires. Etrangers. Hospices d'Abbeville. Hospice de Saint-Riquier. Hospice de Rue. Hospice de Saint-Valery-sur-Somme. Interdictions de séjour. Secours aux anciens militaires. Secours aux victimes civiles de la guerre 1939-1945. Sous-préfecture, personnel, traitements. Syndicats intercommunaux. Tabacs. Dossiers sur les communes du canton d'Abbeville-Sud (Bray-lès-Mareuil, Cambron, Eaucourt-sur-Somme, Epagne-Epagnette, Mareuil-Caubert), et communes du canton de Nouvion-en-Ponthieu. Sous-dossiers par ordre alphabétique des matières 1940 103W154 Dossiers de l'année 1941. - Administration, objets divers. Aliénés. Agents voyers et cantonniers. Agriculture. Associations sportives, courses de chevaux. Assistance publique. 1941 103W156 Dossiers de l'année 1941. - Bâtiments départementaux, casernes de gendarmerie, palais de justice, prisons. Chambre de commerce, tribunaux de commerce. Chemins vicinaux. Collèges, bourses. Contributions directes. Contributions indirectes. Douanes. 1941 103W180 Dossiers de l'année 1941. - Enregistrement. Etat civil, sépultures militaires. Etrangers. Fêtes et cérémonies publiques, 14 Juillet. Hospices d'Abbeville. Hospice de Crécy. Hospice de Saint-Riquier. Hospice de Rue. Hospice de Saint-Valery-sur-Somme. -

Conditions De Circulation Sur Le Réseau Routier Départemental Jusqu'au
Conditions de circulation sur le réseau routier départemental jusqu’au mardi 7 septembre 2021 Amiens, le mardi 31 août 2021 Secteur Picardie Maritime RD 925 hors agglomération de Saint-Quentin-La-Motte-Croix-Au-Bailly, Oust-Marest, Méneslies, Yzengremer et Friville-Escarbotin. Travaux de réalisation des enduits superficiels terminés le 25 août 2021. RD 1001 en agglomération de Abbeville (boulevard de la République). Travaux de purges localisées sur chaussée terminés le 25 août 2021. RD 928 hors agglomération de Fontaine-sur-Maye et Froyelles. Travaux de mise en place de réseau de fibre optique terminés le 26 août 2021. RD 925 hors agglomération d’Abbeville. Travaux de suppression du giratoire et renouvellement de la couche de surface terminés le 27 août 2021. RD 316 hors agglomération de Lafresguimont-Saint-Martin. Travaux de remplacement de poteaux téléphoniques terminés le 27 août 2021. RD 1001 en agglomération de Abbeville (côte de la Justice). Travaux de purges localisées sur chaussée terminés le 31 août 2021. R D 29 hors agglomération de Oisemont. Travaux de maintenance d’un pylône terminés le 31 août 2021. RD 48 et RD 106 en agglomération de Arrest. Travaux d’aménagement de la traverse prolongés jusqu’au 1er septembre 2021. Circulation interdite. Déviation mise en place par la RD 925, RD 19 et RD 940 via les communes de Béthencourt-sur- Mer, Allenay, Friaucourt, Ault, Brutelles, Lanchères et Pendé. RD 938 hors agglomération de Estrées-lès-Crécy. Travaux d’installation d’ouvrages pour le gaz prévus du 30 août au 3 septembre 2021. Limitation de vitesse à 50km/h. -

Bulletin Janvier 2011
Vieil Onival --- Les Blancarts Bulletin de Janvier 2011 --------------------------------------------------------------------N° 112 Vœux de la Municipalité à la population Discours du Maire Monsieur le Conseiller général du canton d’Ault et maire de mers les bains : Emmanuel Maquet Monsieur le président du syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral : Jean Claude Buisine Mesdames et Messieurs les Maires : Marthe Sueur Maire de Ault, Raynald Boulanger Maires de St Quentin la Motte, Guy Depoilly Maire de Friaucourt Monsieur le commandant de la brigade de Ault Je vous prie d’excuser Meur Thierry Vansevenant Conseiller Général du canton de Friville Escarbotin ainsi que Madame Masson Directrice d’école, souffrante. Chers collègues élus Mesdames, Messieurs, Chers amis. Permettez-moi tout d’abord, d’exprimer le réel plaisir que nous avons, les membres du conseil municipal et moi-même à vous accueillir pour cette cérémonie des vœux. La cérémonie des vœux, moment traditionnel, nous invite à nous tourner vers la nouvelle année qui s’ouvre devant nous, afin d’évoquer l’avenir et ses perspectives. Ce sera encore le cas ce matin. Pourtant, impossible de vous parlez de 2011, sans préalablement se rappeler 2010. Impossible de faire l’impasse sur cette année 2010 qui vient de s’écouler, tant elle aura été une année particulière… Particulière pour le Monde certainement, mais particulière également à notre échelle, pour nous, à Woignarue. De cette année particulière pour notre village, qu’en retiendrons-nous ? Dans un premier temps, le départ des PEP 80 de la Demeure d’Hautebut. Lors d’une rencontre en juillet dernier avec leur Président, il nous annonçait la décision prise par son conseil d’administration, de rompre le contrat qui les lie avec la commune. -

Bilan-SUXP19.Pdf
LES PARTENAIRES LE LIEU Abbeville Le 04/05/06 octobre 2019 LES EQUIPES Kids Care Bracelet connecté pour géolocaliser enfants perdus ou en détresse. e-Story Application ludique et culturelle pour apprendre à connaitre un territoire. Jeu déchec Jeu d'échec à base de produits recyclés, enjeux pour le recyclage et l'aide aux mathématiques / à la réflexion. Avertiz Application géolocalisante qui alerte des risques, catastrophes naturelles et industrielles. Park Easy Application pour faciliter le stationnement en ville et la découverte des points d’intérêts à proximité. Sleep’Zen Oreiller destiné à l’amélioration du sommeil, par luminothérapie, odeurs, sons blancs. LES PARTICIPANTS 27 participants 100% d’étudiants 19 ans de moyenne d'âge 19% Technicien 11 Hommes 48% 16 Femmes Commercial 33% Créatif PROVENANCE DES PARTICIPANTS Dans un rayon de 50km d’Abbeville Fressenneville Abbeville Aigneville Friville Abbeville Aigneville Friville Abbeville Brutelles Valines Amiens Béthencourt Equipe 1 Equipe Equipe 3 Equipe Equipe 2 Equipe Woincourt Blangy Tronville - Abbeville Amiens Cayeux sur Mer Abbeville Buigny-lès-Gamaches Embreville Amiens Frettemeule Lanchères Amiens St Valéry / Somme Oisemont Equipe 4 Equipe Equipe 5 Equipe Equipe 6 Equipe Feuquières en Vimeu - - PROVENANCE DES PARTICIPANTS Lycée du Vimeu Lycée St Pierre Abbeville Lycée du Vimeu Lycée du Vimeu Lycée E.Branly Amiens Lycée du Vimeu Lycée du Vimeu Lycée St Pierre Abbeville Lycée du Vimeu Lycée du Vimeu Lycée St Pierre Abbeville Lycée du Vimeu Equipe 1 Equipe Equipe 3 Equipe Equipe 2 -

VIMEU ECOLES 2018-2019 Page 1 ETABLISSEMENT DIRECTION TELEPHONE DIRECTION COURRIEL – ECOLE COMMUNE CODE POSTAL ADRESSE TELEPHO
VIMEU_ECOLES_2018-2019 ETABLISSEMENT DIRECTION TELEPHONE DIRECTION COURRIEL – ECOLE COMMUNE CODE POSTAL ADRESSE TELEPHONE 31, RUE DE AIGNEVILLE : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DELABRE ANNE-SOPHIE 03.22.26.62.46 [email protected] AIGNEVILLE 80210 03.22.26.62.46 FRESSENNEVILLE AIGNEVILLE 78, RUE DU PRESBYTERE 03.22.26.46.17 ANDAINVILLE : ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE DURIEZ ANITA 03.22.25.19.28 [email protected] ANDAINVILLE 80140 4, RUE DE L'EGLISE 03.22.25.19.28 ANSENNES : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE RICOURD-MAGGI MANON 02.35.93.63.26 [email protected] ANSENNES 80220 1, RUE DE MONTHIERES 02.35.93.63.26 1, PLACE AUGUSTIN ARREST : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE GODBERT MARTINE 03.22.26.84.39 [email protected] ARREST 80820 03.22.26.84.39 DELAHAYE AULT : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE SIMONE VEIL NOWAK AGNES 03.22.60.50.32 [email protected] AULT 80460 9, RUE DE DALHAUSEN 03.22.60.50.32 BEAUCHAMPS : ECOLE PRIMAIRE LES HORTENSIAS HAVARD ELISE 03.22.30.80.88 [email protected] BEAUCHAMPS 80770 4, RUE MANTES 03.22.30.80.88 BEAUCHAMPS 2, RUE DE LA MAIRIE 03.22.30.80.60 BETHENCOURT-SUR-MER : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE PORTENART LUDOVIC 03.22.26.48.32 [email protected] BETHENCOURT-SUR-MER 80130 GRANDE RUE 03.22.26.48.32 LES PETITS JARDINIERS DES QUATRE SAISONS BETHENCOURT-SUR-MER RUE DES BOST 03.22.30.27.39 BIENCOURT : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE HERBLOT PAULINE 03.22.28.54.42 [email protected] BIENCOURT 80140 1, RUE DE L'ECOLE 03.22.28.54.42 12, RUE LOUIS DE BOISMONT : ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DEVISSE VALERIE 03.22.26.82.98 -

Inventaire Des Anciens Sites Industriels Et Activités De Service Picardie, Volet Somme
Inventaire des anciens sites industriels et activités de service Picardie, volet Somme BRGM/RP-52522-FR octobre 2003 PICARDIE Inventaire des anciens sites industriels et activités de service Picardie, volet Somme État d’avancement au 1er septembre 2003 BRGM/RP-52522-FR octobre 2003 Étude réalisée dans le cadre des opérations de Service public du BRGM 2002-POL-145 A. Wuilleumier Avec la collaboration de C. Nail, S. Cocu PICARDIE Inventaire des anciens sites industriels de la Somme. Mots clés : Inventaire, Sites industriels, Activités de service, Picardie, Département de la Somme. En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante : Wuilleumier A., avec la collaboration de Nail C., Cocu S., (2003) – Inventaire des anciens sites industriels et activités de service de Picardie, volet Somme. État d’avancement au 1er septembre 2003. BRGM/RP-52522-FR, 38 p., 3 ann. © BRGM, 2003, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l’autorisation expresse du BRGM. 2 BRGM/RP-52522-FR Inventaire des anciens sites industriels de la Somme. Synthèse ans le cadre du contrat de plan État-Région Picardie 2000-2006, il a été décidé de D réaliser l’opération d’inventaire des anciens sites industriels et activités de service dans le département de la Somme. Lancée en juillet 2001 suite à la demande expresse du préfet de région, cette opération est financée par : - l’Agence de l’Eau Artois-Picardie ; - l’ADEME ; - le BRGM ; - le Conseil régional de Picardie. L’opération se poursuit toujours au 1er septembre 2003. À ce jour, les tâches suivantes sont réalisées : - cadrage de l’opération ; - présélection des cotes d’archives ; - consultation des Archives départementales et des données de la préfecture relatives aux installations classées ; - regroupement géographique par sites ; - report géographique des sites sur fond IGN au 1/25 000 (carte papier) ; - saisie des fiches sous l’application BASIAS sur la base des informations recueillies actuellement. -

Conditions De Circulation Sur Le Réseau Routier Départemental Jusqu'au 20
Conditions de circulation sur le réseau routier départemental jusqu’au 20 juillet 2021 Amiens, le mardi 13 juillet 2021 Secteur Picardie Maritime RD 925 en agglomération de Valines. Travaux d'assainissement eaux usées terminés le 9 juillet 2021 . Circulation restreinte par signaux tricolores y compris week-end et jours fériés. Limitation de vitesse à 30km/h. RD 933 hors agglomération de Prouville. Travaux de mise en place de réseau sur la parc éolien prévus jusqu’au 16 juillet 2021. Circulation alternée par signaux tricolores de 7h00 à 18h00, hors week-end. Limitation de vitesse à 50km/h. Dépassement interdit. RD 211 en agglomération de Brocourt. Travaux de réfection de l'ouvrage d'art prévus jusqu’au 16 juillet 2021. Circulation interdite. Déviation mise en place par les RD 29 et RD 25 via les communes de Oisemont et Sénarpont. RD 933 hors agglomération de Montigny-les-Jongleurs et Maizicourt. Travaux de remplacement de garde corps sur un ouvrage d’art prévus du 13 au 16 juillet 2021. Circulation alternée par signaux tricolores de 8h00 à 18h00. RD 928 hors agglomération d’Abbeville. Course « Club de Karting » prévu le 27 juillet 2021. Limitation de vitesse à 70km/h. Stationnement interdit. RD 2 hors agglomération de Friville-Escarbotin et Saint-Blimont. Travaux de renouvellement du réseau prévus du jusqu’au 6 août 2021. Circulation restreinte par signaux tricolores, de 8h00 à 18h00, hors week-end et jours fériés. RD 1001 en agglomération de Le Titre. Travaux de réaménagement sur la traverse prévus jusqu’au 14 août 2021. Circulation restreinte par signaux tricolores jours et nuits. -

Le Hameau De Salenelle À Pendé
Hauts-de-France, Somme Pendé Salenelle Le hameau de Salenelle à Pendé Références du dossier Numéro de dossier : IA80007314 Date de l'enquête initiale : 2004 Date(s) de rédaction : 2004 Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard Degré d'étude : étudié Désignation Dénomination : écart Compléments de localisation Milieu d'implantation : en écart Références cadastrales : Historique Au sud de la baie de Somme, Sallenelle, situé au pied de la falaise morte, est placé sur un banc de galets recouvert d´une couche végétale. En effet, l´ancienne ligne de rivage a joué un rôle structurant dans l´édification des zones urbaines : routes et villages se sont groupés au pied du plateau en limite de la zone humide et des bas-champs, le long de la falaise morte : à partir d´Onival, sur la route départementale 940, se succèdent Hautebut, Brutelles, Lanchères, Herlicourt et Salenelle. Le hameau, prolongeant Lanchères, tire son nom des salines qui l'entouraient jusqu'au 14e siècle (nelles salées), avant l ´endiguement qui permit de rendre les terres cultivables. L´occupation du territoire est ancienne puisque des fouilles ont déterminé la présence de sites gallo-romains et de sépultures creusées dans le banc de galets. La seigneurie était de l'élection d'Amiens et relevait de la châtellenie de Saint-Valery. Les coutumes locales furent rédigées en 1507. D´après le recensement de la population, en 1851, Sallenelle disposait de 106 maisons pour 475 habitants. En 1872, la population avait déjà baissé et quinze maisons avaient été détruites (données contradictoires entre le cadastre de 1832 et celui de 1882). -

Resultats-Transbaie-2009.Pdf
Feuille1 Classement Nom Prénom Ville Catégorie Nation Temps Club 1 WNDUWIMANA WILLY Senior FRA 00:51:24 2 NIYONIZIGIYE JEAN CLAUDE Senior FRA 00:51:58 3 MUSYOKI PETER Senior KEN 00:52:59 BOULOGNE OPALE ATHLETISME 4 NSUBUGA JOSEPH Senior UGA 00:53:06 BOULOGNE OPALE ATHLETISME 5 MANIRAKIZA EGIDE Senior FRA 00:53:19 6 EL GHAZOUANI MOHAMED NOTRE DAME DE GRAVENCHON Senior FRA 00:53:33 7 CHETTOUH NABIL LE PETIT QUEVILLY Senior FRA 00:54:43 8 MICHEL ARNAUD EPAGNE EPAGNETTE Espoir FRA 00:54:57 UPJV 9 ELKHADRAOUI EL MOSTAFA NOTRE DAME DE GRAVENCHON Vétéran 1 FRA 00:55:15 10 DUFRESNE JASON JENLAIN Senior FRA 00:55:41 11 LOPEZ MANUEL MANIQUERVILLE Senior FRA 00:56:42 12 ROUSSEAU VINCENT LEVALLOIS PERRET Senior FRA 00:56:46 13 POISSON NICOLAS PARFONVAL Senior FRA 00:57:07 BAILLEUL ATHLETISME 14 BOULOGNE JEREMY GUINES Senior FRA 00:57:20 AC AUDOMAROIS 15 LAPERSONNE ROMAIN BLARGIES Senior FRA 00:57:30 16 VERDIERE LUDOVIC SAINT LEONARD Vétéran 1 FRA 00:58:17 17 CHARENE YACINE AMIENS (CP 3) Senior FRA 00:58:45 18 DE ARAUJO GEORGES CROIX MARE Senior FRA 00:59:07 19 GOURLE PIERRE MARC FRIVILLE ESCARBOTIN Espoir FRA 00:59:24 20 COURTOIS JEREMY AUTHUILLE Espoir FRA 00:59:34 21 CHELLI AMAR SANNOIS Vétéran 1 FRA 00:59:58 22 POIDEVIN ANTOINE CORBIE Senior FRA 01:00:05 23 CARREEL LAURENT LE CROTOY Vétéran 1 FRA 01:00:10 SC ABBEVILLE 24 COSTA JOSE CUMIERES Vétéran 1 FRA 01:00:16 25 PILOT DIMITRI MEAULTE Senior FRA 01:00:24 26 BOUBERT STEPHANE NOGENT SUR MARNE Senior FRA 01:00:32 27 GRAVE FABRICE GISORS Senior FRA 01:00:36 28 VATTIER LAURENT CHATEAU THIERRY Senior -

Volet F : Territoires Des Falaises Et Valleuses Bloc 1 : Aspect Technique
Action Prioritaire Volet F : Territoires des falaises et valleuses Fiche Travaux Bloc 1 : Aspect technique réduction de la vulnérabilité Volet : Falaises F-1A Imperméabilisation et structure de voirie, réseau eaux pluviales et eau potable en centre Action n° F-1A bourg Mise en sécurité des personnes- Les actions présentées dans le cadre du contrat littoral sont les actions qui ont été retenues pour agir à court terme, dans un délai inférieur ou égal à 6 atteindre le bord de la falaise, situé en milieu urbain, dans une échéance proche. En effet, après la disparition successive de plusieurs ilots, la rue de Saint Valery, axe initialement structurant pour la ville, se trouve directement se notamment par des altérations du substrat crayeux dues à -bourg ltération par infiltration. Afin de performant. Les actions suivantes seront réalisées : - Eaux pluviales : repositionnement avaloirs, refonte - Assainissement : pose de canalisation gravitaire et poste de refoulement - consiste à réaliser des aménagements, à la pose de mobiliers urbains déplaçables et fractionnables intégrant le : - signalisation et mobilier - éclairage e la conception du projet (Phase AVP) dispose de la méthodologie de déplacement du mobilier. Aussi, à terme, la circulation de véhicules légers sera supprimée sur le front de mer (le front de mer sera aménagé dans un premier temps à sens unique). le du centre-bourg a été conduite entre 2013 et 2015 7 conformément au plan masse présenté ci- après. Agence UP Territoire concerné Territoire des falaises et valleuses du Vimeu Population -

Campagne Street Art Communauté De Communes Du Vimeu - Archipop Street Art / Photogrammes
Campagne Street Art Communauté de Communes du Vimeu - Archipop Street art / Photogrammes Quand les archives cinématographiques s‘affichent… Du 1er Mai au 31 Octobre 2018 La Fête du Cinéma est une opération de promotion organisée par la Fédération Nationale des Cinémas Français et BNP Paribas. Elle a lieu dans les salles de cinéma partout en France, du 1er au 4 juillet 2018. www.feteducinema.com Sommaire Le Contexte 3 Le Projet 3 Thématiques 3 Les Sites 3 Médiation 4 La Fête du Cinéma 4 Publics scolaires et hors scolaires 4 Grand Public 4 Communes 5 Un Artiste un Territoire 5 Equipe 7 Remerciements 7 Contact Médias 8 Dossier de Presse - Campagne Street Art 2/8 Le Contexte Commencé fin 2014 le projet de collecte, de sauvegarde et de valorisation des archives privées filmées sur le Vimeu s’est enrichi de collections très importantes issues du territoire. Après un cycle de projections, d’expositions, de ciné concerts et autres opérations autour du patrimoine il nous est apparu indispensable que cette mémoire puisse aussi irriguer différemment le territoire. Nous devions trouver un projet plus collectif qui mette en réseau les communes concernées et qui interpelle leurs habitants sur l’appropriation de la mémoire individuelle et collective et son rapport au temps. Le Projet Cette programmation interpelle les habitants sur l’appropriation de la mémoire individuelle et collective et son rapport au temps. Le projet repose sur la réalisation par un artiste de fresques issues de photogrammes tirés d’archives audiovisuelles collectées sur le Vimeu depuis 2014. Les photogrammes sont ensuite agrandis, remontés et retravaillés.