Etat Initial De L'environnement (PDF
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
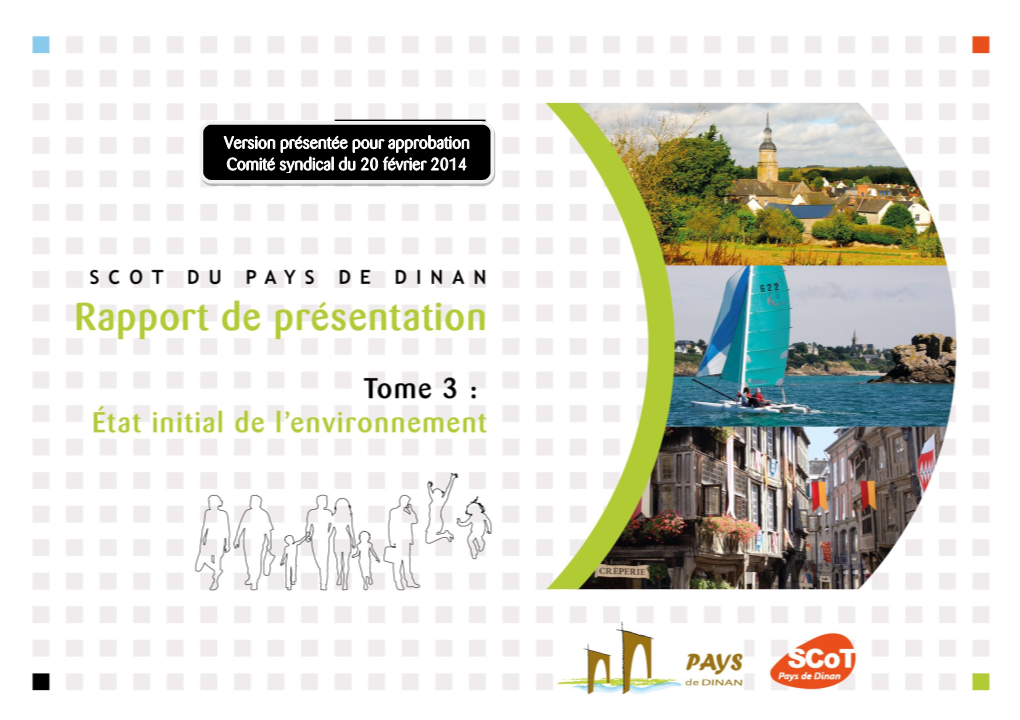
Load more
Recommended publications
-

Le Haut Moyen Âge 5
PATRIMOINE HISTORIQUE et ARCHITECTURAL du PAYS de DINAN § LIVRE 1 - la Préhistoire : Le Paléolithique - Le Mésolithique - Le Néolithique LIVRE 2 - la protohistoire ou les Âges des Métaux : Le Bronze - Le Fer - Les Celtes LIVRE 3 - l’Époque Gallo-Romaine LIVRE 4 - du Haut Moyen Âge à la féodalité : Migrations Bretonnes - Époque Carolingienne LIVRE 5 - l’Époque Féodale : Entre Normands, Plantagenets et Capétiens - Le Pays de Dinan, terre d’enjeu Architecture romane, cistercienne et gothique - Le retour du décor sculpté LIVRE 6 - Les châteaux forts et les manoirs : Les châteaux forts du Pays de Dinan : aspects résidentiels Les manoirs : une richesse pour la Bretagne LIVRE 7 - Le gothique flamboyant et la 2ème Renaissance : Monuments remarquables - L’architecture de la Renaissance LIVRE 8 - La Contre-Réforme : L’art dans les couvents et les paroisses - Les retables LIVRE 9 - Le XVIIIe siècle : Le contexte architectural en France et en Bretagne : Les hôtels urbains et maisons de plaisance en Pays de Dinan Tous ces documents ont été réalisés d’après des relevés et études archéologiques antérieurs à l’année 2004. Certains des monuments, châteaux, manoirs.. cités dans cet ouvrage sont des propriétés privées et ne sont donc pas ouverts au public ou seulement à quelques dates précises. Pour plus de renseignements vous pouvez vous adresser aux offices de tourisme ou consulter la presse. § Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L. 122-5, d’une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans le but d’exemple ou d’illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (article L. -

Printemps 2020
AnimaSport VacsPrintemps 2020 7-11 ANS 12-17 ANS www.dinan-agglomeration.fr Anima Sport Vacs PLUDUNO 7-11 ANS SEMAINE 1 > DU 14 AU 17 AVRIL 2020 Activités variées - 13h30/17h30 - Tarif : 27€ Salle omnisports de Pluduno Lundi Férié Mardi Flag rugby / Tir à l’arc Mercredi Dodgeball / Badminton Jeudi Foot en salle / Athlétisme Vendredi Chasse aux œufs 12-17 ANS SEMAINE 2 > DU 20 AU 24 AVRIL 2020 Activités variées - 13h30/17h30 - Tarif : 55€ Salle omnisports de Pluduno INSCRIPTIONS Lundi Badminton / Tchoukball à l’antenne de Matignon Mardi Paint Ball à Aucaleuc Rue du Chemin Vert 22550 MATIGNON RDV à 13h à Pluduno 02.96.41.15.11 Mercredi Handball / Baseball à l’antenne de Plancoët Jeudi Ultimate / Basketball 33 rue de la Madeleine 22130 PLANCOËT Vendredi Accrobranche 02.96.80.47.47 (inscription à déposer dans une RDV à 11h30 enveloppe avec le règlement) Prévoir un pique-nique. RENSEIGNEMENTS [email protected] 2 Anima Sport PLÉLAN-LE-PETIT Vacs 7-11 ANS SEMAINE 1 > DU 14 AU 17 AVRIL 2020 Activités variées - 13h30/17h30 - Tarif : 27€ Salle omnisports de Plélan-le-Petit Lundi Férié Mardi Badminton/Tchoukball / Gymnastique Mercredi Course d’orientation / Tennis de table Jeudi Golf / Basket / Jeux d’opposition Vendredi Trioathlon SEMAINE 2 > DU 20 AU 24 AVRIL 2020 Activités variées - 13h30/17h30 - Tarif : 33€ Salle omnisports de Plélan-le-Petit Lundi Basket Ball / Gymnastique / INSCRIPTIONS Course d’orientation Mardi Tennis de table / Football / à la Salle Omnisports de Plélan-le-Petit Ultimate 2 rue des Chênes 22980 PLELAN-LE-PETIT -

Améliorer La Prise En Charge De Nos Aînés
180 MAI // JUIN Plan senior départemental Améliorer la prise en charge de nos aînés Événement Le Tour de France en Côtes d’Armor Bleu, blanc, vert, Alexis Renard Charles Ménage Sterenn Roux Yoann Rehel © THIERRY JEANDOT © THIERRY affichons nos couleurs! 2 / SOMMAIRE À VOIR GALLO-FRANÇAIS-BRETON 4 26 ▶ Guirec Soudée. 4 ▶ ZAPPING Profession: aventurier 8 ▶ RETOUR EN IMAGES À DÉCOUVRIRProfession : aventurier À LA UNE 28 10 28 ▶ Bernard Kervoas. 10 ▶ Plan senior départemental. Le sabotier de Belle-Isle 14 Améliorer la prise en charge 29 ▶ Valentin Moricet, maraîcher de nos aînés à Vildé-Guingalan. Des fl eurs au menu de Valentin À SUIVRE... 30 ▶ 1939-1945, la France IRRÉDUCTIBLES ENTREPRENEURS 14 sous l’occupation. Femmes en Résistance 14 ▶ Anthénéa à Lannion. Le rêve bleu AH SI J’ÉTAIS… 15 ▶ Filaj à Locarn. 32 ▶ David Gaudu. 28 Leurs pailles de seigle Cycliste professionnel supplantent le plastique ACTIONS DÉPARTEMENTALES À PARTAGER 33 16 ▶ Élections départementales, 33 ▶ Clément Huot. les 20 et 27 juin. Un ange passe au-dessus des fl ots 18 ▶ Santé en Côtes d’Armor. 34 ▶ Dimitri Rouchon-Borie. Douze projets concrets Une entrée fracassante pour faire venir les médecins dans le monde littéraire Commission permanente du 8 mars. 34 19 ▶ 35 ▶ Paul Wenninger, Le Département en action réalisateur et chorégraphe. 20 ▶ Terres d’Armor habitat. Un regard fécond Une ambition nouvelle sur la villa Rohannec’h pour les Côtes d’Armor 36 ▶ Pierre Chomet. 21 ▶ Le Département investit! Candidat de «Top Chef » 22 ▶ Tour de France en Côtes d’Armor. 37 ▶ Mots fl échés par Briac Morvan Bleu, blanc, vert, affi chons nos couleurs ! PORTE-PAROLE À DÉCOUVRIR 38 ▶ L’expression des groupes 38 24 politiques du Conseil 24 ▶ Les thermes du Hogolo départemental à Plestin-les-Grèves. -

Secteur De Recrutement Collèges Et Lycées Par Commune
DIRECTION ACADÉMIQUE DES CÔTES D'ARMOR DIVEL * Modifications RS 2020 SECTEURS DE RECRUTEMENTS DES LYCÉES ET COLLÈGES CORRESPONDANTS PAR COMMUNES COMMUNES COLLÈGE DE RATTACHEMENT LYCÉE DE RATTACHEMENT ALLINEUC PLOEUC - L'HERMITAGE Lycée Rabelais - Saint-Brieuc ANDEL LAMBALLE Lycée H. Avril - Lamballe AUCALEUC DINAN - François Broussais Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BEAUSSAIS-SUR-MER (Ploubalay - Trégon - Plessix Balisson) PLANCOET Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BEGARD BEGARD Lycée A. Pavie - Guingamp BELLE-ISLE-EN-TERRE BELLE-ISLE-EN-TERRE Lycée A. Pavie - Guingamp BERHET BEGARD Lycée A. Pavie - Guingamp BINIC - ETABLES-SUR-MER (Binic-Etables sur Mer) ST-QUAY-PORTRIEUX Lycée Freyssinet - Saint-Brieuc BOBITAL DINAN - François Broussais Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BODEO (LE) (Pas d'école) QUINTIN Lycée Rabelais - Saint-Brieuc BON REPOS SUR BLAVET (LANISCAT) ST NICOLAS DU PELEM Lycée A. Pavie - Guingamp BON REPOS SUR BLAVET (PERRET) ROSTRENEN Lycée Sérurier de Carhaix (29) BON REPOS SUR BLAVET (ST GELVEN) GUERLEDAN (Mûr de Bretagne) Lycée F. Bienvenue - Loudéac BOQUEHO PLOUAGAT Lycée Freyssinet - Saint-Brieuc BOUILLIE (LA) ERQUY Lycée H. Avril - Lamballe BOURBRIAC BOURBRIAC Lycée A. Pavie - Guingamp BOURSEUL PLANCOET Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BREHAND MONCONTOUR Lycée H. Avril - Lamballe BREHAT PAIMPOL Lycée Kerraoul - Paimpol BRELIDY PONTRIEUX Lycée A. Pavie - Guingamp BRINGOLO PLOUAGAT Lycée A. Pavie - Guingamp BROONS BROONS Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BRUSVILY DINAN - François Broussais Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BULAT-PESTIVIEN CALLAC Lycée A. Pavie - Guingamp CALANHEL CALLAC Lycée A. Pavie - Guingamp CALLAC CALLAC Lycée A. Pavie - Guingamp CALORGUEN DINAN - Roger Vercel Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan CAMBOUT (LE) PLEMET Lycée F. -

Publicité Des Demandes D'autorisation D'exploiter Pour Mise
PRÉFET DES COTES-D'ARMOR Publicité des demandes d'autorisation d'exploiter pour mise en valeur agricole enregistrées par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Côtes-d'Armor du 14/08/2018 au 29/08/2018 Conformément aux articles R331-4 et D331-4-1 du code rural et de la pêche maritime, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Côtes-d'Armor publie les demandes d'autorisations d'exploiter enregistrées ci-dessous : Date limite de Date dépôt des d'enregistre demandes parcelle Superficie Propriétaires ou Mandataires Demandeur Cédant N°Dossier Références cadastrales ment de la concurrentes demande (dossier complet) LEGOUTTE/PATRICIA MARIE NOELLE SOLANGE 29170 ST EVARZEC - LEGOUTTE/GILBERT GERARD JEAN PIERRE JOSEPH 51100 REIMS - LEGOUTTE/CHRISTINE LILIANE CHAUVIERE Amélie MENARD Jean-Luc AUCALEUC B610 - B631 1,0540 ha RENEE 22100 AUCALEUC - LEGOUTTE/SOLANGE MARTINE C22180731 24/08/18 30/10/18 MARCELLE JOSETTE 22490 PLOUER SUR RANCE - 22130 BOURSEUL 22100 AUCALEUC LEGOUTTE/MARIANICK CHRISTIANE VIVIANE JACQUELINE 22100 AUCALEUC - LEGOUTTE/THEODORE CELESTIN LOUIS JOSEPH 22100 AUCALEUC AUCALEUC B632 1,6370 ha BOUGAULT NEE LEGOUTTE/MARYVONNE YVETTE CHAUVIERE Amélie MENARD Jean-Luc C22180731 24/08/18 30/10/18 JOSETTE ROSA 22190 PLERIN 22130 BOURSEUL 22100 AUCALEUC JAFFRELOT/PASCALE 22400 LAMBALLE - EARL DE MADEHEN BAUDET Jean Pierre BREHAND ZE111 - ZE112 0,8330 ha JAFFRELOT/DANIEL 22400 LAMBALLE - JAFFRELOT/JEAN- C22180743 28/08/18 30/10/18 YVES 22400 LAMBALLE - JAFFRELOT/JOEL 22400 22510 BREHAND 22510 BREHAND -

La Sectorisation Des Transports Scolaires 2020-2021 En Côtes D'armor COLLÈGES LYCÉES
La sectorisation des transports scolaires 2020-2021 en Côtes d'Armor COLLÈGES LYCÉES COMMUNES NOUVELLES COMMUNES SECTEUR PUBLIC SECTEUR PRIVÉ SECTEUR PUBLIC SECTEUR PRIVÉ ALLINEUC PLOEUC-SUR-LIE PLOEUC-SUR-LIE SAINT-BRIEUC QUINTIN ANDEL LAMBALLE LAMBALLE LAMBALLE LAMBALLE AUCALEUC DINAN DINAN DINAN DINAN BEGARD BEGARD GUINGAMP GUINGAMP GUINGAMP BELLE-ISLE-EN-TERRE BELLE-ISLE-EN-TERRE GUINGAMP GUINGAMP GUINGAMP BERHET BEGARD TREGUIER GUINGAMP GUINGAMP BINIC - ETABLES BINIC ST-QUAY-PORTRIEUX ST-QUAY-PORTRIEUX SAINT-BRIEUC SAINT-BRIEUC BOBITAL DINAN DINAN DINAN DINAN BODEO (LE) QUINTIN QUINTIN SAINT-BRIEUC QUINTIN BOQUEHO PLOUAGAT QUINTIN SAINT-BRIEUC SAINT-BRIEUC BOUILLIE (LA) ERQUY PLENEUF VAL ANDRE LAMBALLE LAMBALLE BOURBRIAC BOURBRIAC GUINGAMP GUINGAMP GUINGAMP BOURSEUL PLANCOET CREHEN DINAN DINAN BREHAND MONCONTOUR LAMBALLE LAMBALLE LAMBALLE BREHAT PAIMPOL PAIMPOL PAIMPOL PAIMPOL BRELIDY PONTRIEUX PONTRIEUX GUINGAMP GUINGAMP BRINGOLO PLOUAGAT LANVOLLON GUINGAMP GUINGAMP BROONS BROONS BROONS DINAN DINAN BRUSVILY DINAN DINAN DINAN DINAN BULAT-PESTIVIEN CALLAC GUINGAMP GUINGAMP GUINGAMP CALANHEL CALLAC GUINGAMP GUINGAMP GUINGAMP CALLAC CALLAC GUINGAMP GUINGAMP GUINGAMP CALORGUEN DINAN DINAN DINAN DINAN CAMBOUT (LE) PLEMET PLEMET LOUDEAC LOUDEAC CAMLEZ TREGUIER TREGUIER TREGUIER LANNION CANIHUEL ST-NICOLAS-DU-PELEM ROSTRENEN GUINGAMP ROSTRENEN CAOUENNEC-LANVEZEAC LANNION LANNION LANNION LANNION CARNOET CALLAC GUINGAMP GUINGAMP GUINGAMP CAULNES BROONS BROONS DINAN DINAN CAUREL MUR-DE-BRETAGNE MUR-DE-BRETAGNE LOUDEAC LOUDEAC CAVAN BEGARD -

Yannick HELLIO Matthieu JOUNEAU Stéphanie MISSIR Cécile PARIS
SAINT - POTAN LANGROLAY YVIGNAC SAINT SAINT ANDRE FREHEL TRELIVAN DINAN LE HINGLE PLUDUNO PLUMAUGAT SUR RANCE LA TOUR DINAN LANVALLAY DINAN JUVAT PLANCOET CORSEUL DES EAUX Arnaud LECUYER Président Suzanne LEBRETON Gérard BERHAULT Michel RAFFRAY Mickaël CHEVALIER Jean-Paul GAINCHE Jean-Luc BOISSEL René DEGRENNE Michèle MOISAN Bruno RICARD Françoise DESPRES Dominique RAMARD Patrick BARRAUX Alain JAN Jean-Louis NOGUES Didier LECHIEN ème ème ème ème ème ème ème ème 1ère VP 2èm VP 3ème VP 4ème VP 5 VP 6 VP 7 VP 8 VP 9 VP 10 VP 11 VP 12èmeVP 13 VP 14èmeVP 15ème VP Admistration Transports et Emploi, dévelop- Relations avec les Habitat et cohésion Petite enfance, Déploiement nu- Sport et équipe- Tourisme, Eau potable, Culture et Transition énergétique Politique maritime, Urbanisme, stratégie Environnement et générale et finances mobilité pement économi- communes, mu- sociale enfance jeunesse mérique, recherche ments Économie assainissement et patrimoine et déchets littorale et fluviale foncière et ruralité GEMAPI que et talisation, pacte et innovation maritime et voirie enseignement financier, fiscal et gestion du supérieur solidarité FEAMP AUCALEUC BOBITAL BOURSEUL BROONS BRUSVILY CALORGUEN CAULNES CREHEN DINAN Christophe Jacky Anne-Claude Denis Serge Claude Marcel Jean-Louis Christelle Pierre Chantal Didier Michel Anne-Sophie Yannick OLLIVIER HEUZE MORIN LAGUITTON ROUXEL ROBERT ROBERT CHALOIS LECAILLIER BOURGAULT- DERU FORGET GUILLEMOT HELLIO OUICE LEBRANCHU LA CHAPELLE LA VICOMTE DINAN EVRAN GUENROC GUITTE BLANCHE LA LANDEC SUR RANCE LANDEBIA -

Commune 22460 Allineuc 22400 Andel 22100 Aucaleuc 22810 Belle
Commune 22460 Allineuc 22400 Andel 22100 Aucaleuc 22810 Belle-Isle-en-Terre 22100 Bobital 22170 Boqueho 22240 Bouillie 22390 Bourbriac 22130 Bourseul 22510 Bréhand 22140 Brélidy 22170 Bringolo 22250 Broons 22100 Brusvily 22160 Calanhel 22100 Calorguen 22210 Cambout 22450 Camlez 22480 Canihuel 22300 Caouënnec-Lanvézéac 22350 Caulnes 22630 Champs-Géraux 22160 Chapelle-Neuve 22210 Chèze 22970 Coadout 22140 Coatascorn 22210 Coëtlogon 22800 Cohiniac 22270 Dolo 22250 Éréac 22290 Faouët 22210 Ferrière 22230 Gomené 22290 Gommenec'h 22290 Goudelin 22330 Gouray 22200 Grâces 22350 Guenroc 22350 Guitté 22390 Gurunhuel 22320 Harmoye 22320 Haut-Corlay 22400 Hénansal 22150 Hermitage-Lorge 22100 Hinglé 22230 Illifaut 22500 Kerfot 22110 Kergrist-Moëlou 22480 Kerien 22140 Kermoroc'h 22480 Kerpert 22400 Lamballe 22140 Landebaëron 22130 Landébia 22980 Landec 22400 Landéhen 22800 Lanfains 22330 Langourla 22980 Languédias 22130 Languenan 22570 Laniscat 22290 Lanleff 22580 Lanloup 22300 Lanmérin 22250 Lanrelas 22410 Lantic 22230 Laurenan 22100 Léhon 22800 Leslay 22810 Loc-Envel 22160 Lohuec 22230 Loscouët-sur-Meu 22540 Louargat 22640 Malhoure 22440 Méaugon 22270 Mégrit 22230 Mérillac 22200 Merzer 22400 Meslin 22220 Minihy-Tréguier 22600 Motte 22200 Moustéru 22540 Pédernec 22510 Penguily 22570 Perret 22800 Plaine-Haute 22940 Plaintel 22270 Plédéliac 22980 Plélan-le-Petit 22570 Plélauff 22170 Plélo 22640 Plénée-Jugon 22170 Plerneuf 22720 Plésidy 22330 Plessala 22650 Plessix-Balisson 22640 Plestan 22130 Pléven 22260 Ploëzal 22130 Plorec-sur-Arguenon 22830 Plouasne -

Travaux De Restauration Des Milieux Aquatiques
DINAN AGGLOMERATION Travaux de restauration des milieux aquatiques (CTEMA) sur les bassins versants de la Rance et de l’Arguenon sur les communes de : AUCALEUC, BOURSEUL, BROONS, CAULNES, CORSEUL, CREHEN, DINAN, EREAC, GUITTE, JUGON-LES-LACS COMMUNE NOUVELLE, LA LANDEC, LANGUEDIAS, LANGUENAN, LANRELAS, LE MENE, MEGRIT, MERILLAC, PLANCOET, PLELAN-LE- PETIT, PLEVEN, PLOREC-SUR-ARGUENON, PLUDUNO, PLUMAUDAN, PLUMAUGAT, QUEVERT, SAINT-ANDRE-DES-EAUX, SAINT-JOUAN-DE-L’ISLE, SAINT-JUVAT, SAINT-LAUNEUC, SAINT-MAUDEZ, SAINT-MICHEL- DE-PLELAN, SAINT-POTAN, SAINT-VRAN, TADEN, TREBEDAN, TREDIAS, YVIGNAC-LA-TOUR et VILDE-GUINGALAN AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE Le public est informé que, par arrêté préfectoral du 16 avril 2019, une enquête publique est ouverte du jeudi 9 mai 2019 (14 h 00) au mardi 28 mai 2019 (17 h 00). Cette enquête est organisée suite à la réception, le 31 janvier 2019, à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Côtes-d'Armor, de la demande d'autorisation environnementale présentée par Monsieur le Président de Dinan Agglomération concernant les travaux de restauration des milieux aquatiques (CTEMA) sur les bassins versants de la Rance et de l’Arguenon sur les communes listées ci-dessus. Ce projet est soumis à autorisation environnementale au titre de la loi sur l'eau, en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement sous les rubriques 3.1.1.0 (installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau), 3.1.2.0 (installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou en travers du lit mineur d’un cours d’eau), 3.1.3.0 (impact sensible à la luminosité) et 3.1.5.0 (installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d’un cours d’eau étant de nature à détruire les frayères de brochets) de la nomenclature annexée à l'article R. -

References – 2008-2012
… REFERENCES – 2008-2012 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES Réfection et amélioration thermique du groupe scolaire Victor Hugo et mise en place d’une chaufferie bois à LEHON (22) Label BBC Rénovation – Certification PREBAT - Maître d’ouvrage : commune de LEHON - Année de réalisation : chantier en cours - Montant des marchés de travaux : 1 532 690,76 € HT Restructuration et extension de l’école de BRUSVILY (22) - Maître d’ouvrage : commune de BRUSVILY - Année de réalisation : chantier en cours - SHON : 916 m² - Montant des marchés de travaux : 888 667.57 € HT Restructuration et extension de l’école d’AUCALEUC (22) - Maître d’ouvrage : commune d’AUCALEUC - Année de réalisation : chantier en cours - SHON : 708 m² - Montant des marchés de travaux: 400 736.10€ HT Extension du groupe scolaire : Construction d’une garderie, d’un restaurant scolaire et extension de l’école primaire à LANGROLAY Sur RANCE (22) - Maître d’ouvrage : commune de LANGROLAY Sur RANCE - Année de réalisation : 2012 - SHON extension : 236 m² - SHON existant : 274 m² - Montant des travaux : 595 000,00 € HT Restructuration et extension de l’école élémentaire de PLOEUC SUR LIE (22) - Maître d’ouvrage : commune de PLOEUC SUR LIE - Année de réalisation : 2011 - SHON : 1439 m² - Montant des travaux : 1 700 000,00 € TTC Construction de l’école élémentaire, d’une cuisine centrale, du restaurant scolaire à BOBITAL (22) - Maître d’ouvrage : commune de BOBITAL - Année de réalisation : en attente (PRO réalisé) - SHON : 1575 m² - Montant estimatif des travaux : 2 430 000,00 € TTC -

Vilde-Guingalan Au Fil Du Temps
VILDE-GUINGALAN AU FIL DU TEMPS Travail élaboré par Mme CAVAN Christine 1 | P a g e Table des matières Vildé-Guingalan ................................................................................................................................................................ 3 Origine : ........................................................................................................................................................................ 3 Guénolé, le saint patron de Vildé-Guingalan ........................................................................................................... 3 Historique : ................................................................................................................................................................... 5 A l’époque gallo-romaine (-52 av. J.-C. – 486 ap. J.-C.) ......................................................................................... 6 A l’époque médiévale (486 – 1492) ....................................................................................................................... 11 Sous l’Ancien régime (1492-1789) ........................................................................................................................ 24 Epoque contemporaine ........................................................................................................................................... 27 Légende ou rumeur : ...................................................................................................................................................... -

Secretariat General
PREFET DES COTES-D’ARMOR direction départementale Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration des territoires et de la mer en application de l'article L. 214-3 du code de service l'environnement relative au plan d’épandage des boues environnement de décantation issues de l’usine de production d’eau potable de la Ville Hatte à PLEVEN Le Préfet des Côtes-d’Armor Chevalier de la Légion d’honneur Officier de l'ordre national du Mérite VU le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 et suivants, l’article L 216-3 les articles L. 171-6 à 8 et L. 173-1, les articles R. 211-25 à R. 211-47 et les articles R. 214-1 et suivants ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code de la santé publique ; VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; VU l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées ; VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L.