Télécharger Le
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
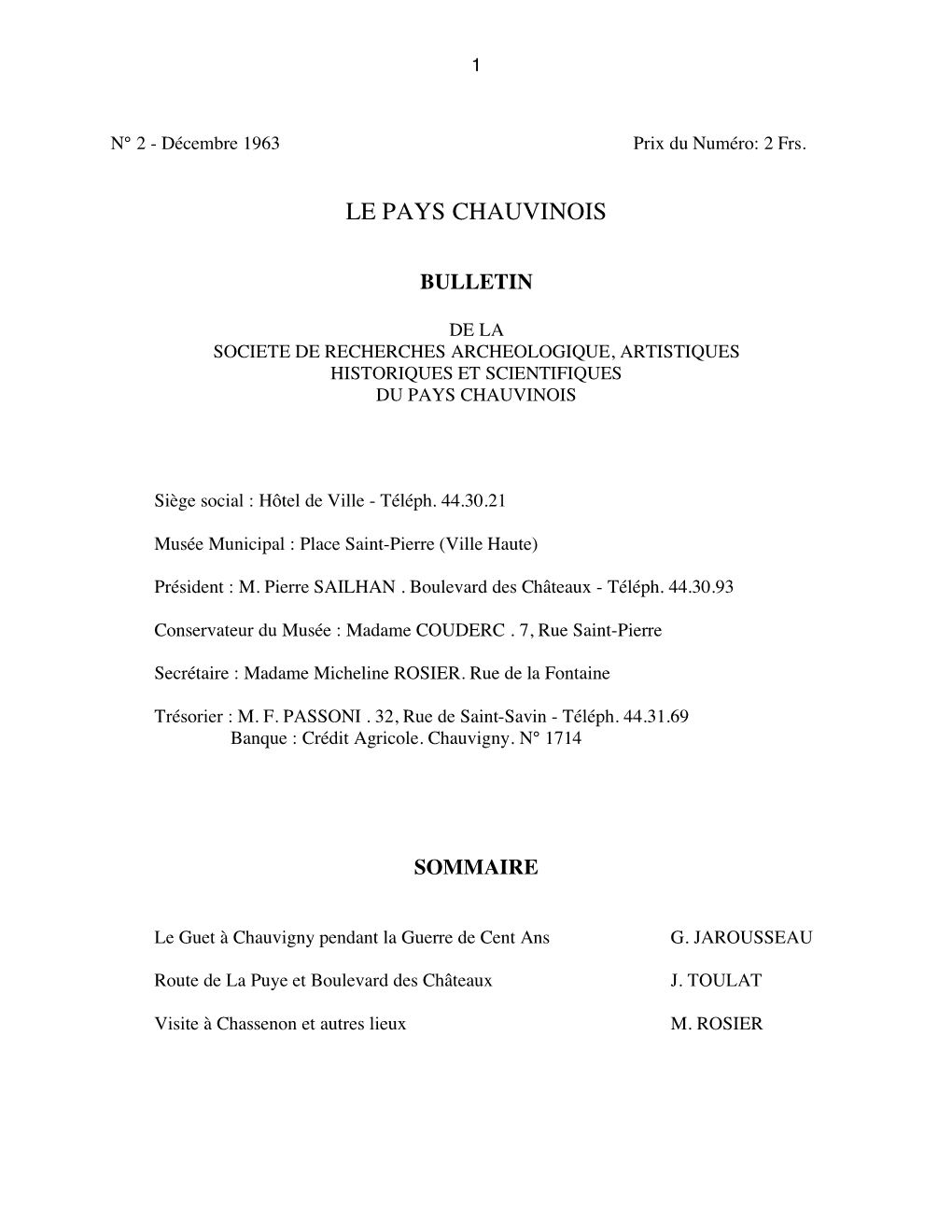
Load more
Recommended publications
-

L'accompagnement De Vos Territoires
L’accompagnement de vos territoires RELATION ADHÉRENTS ARCHITECTURE/PAYSAGE/URBANISME SERVICES NUMÉRIQUES SERVICE JURIDIQUE/AMF86/FORMATION DES ÉLUS Architecte Julien Secheresse AJSA -Photographe : Maud Piderit, Focalpix adriers - amberre - anche - angles-sur-l’anglin - angliers - antigny - an- tran - arcay - archigny - aslonnes - asnieres-sur-blour - asnois - aulnay - availles limouzine - availles-en-chatellerault - avan- ton - ayron - basses - beaumont saint cyr - bellefonds - berrie - ber- the- gon - beruges - bethines - beuxes - biard - bignoux - blanzay - boivre-la-vallee - bonnes - bonneuil-matours - bouresse - bourg-archambault - bournand - brigueil-le-chantre - brion - brux - buxerolles - buxeuil - ceaux-en-loudun - celle-l’evescault - cenon- sur-vienne - cernay - chabournay - chalais - chalandray - champagne- le-sec - champagne-saint-hilaire - champigny en rochereau - champniers - charroux - chasseneuil-du-poitou - chatain - chateau-garnier - chateau-larcher - chatellerault - chaunay - chauvigny - chenevelles - cherves - chire-en-montreuil - chouppes - cisse - civaux - civray - cloue - colombiers - valence-en-poitou - cou- lombiers - coulonges - coussay - coussay-les-bois - craon - croutelle - cuhon - cur- cay-sur-dive - curzay sur vonne - dange-saint-romain - derce - dienne - dissay - doussay - fleix - fleure - fontaine-le-comte - frozes - gencay - genouille - gizay - glenouze - gouex - guesnes - haims - ingrandes - iteuil - jardres - jaunay-marigny - jazeneuil - jouhet - journet - jousse - la bussiere - la chapelle viviers -

Petite Histoire Du Tramway Entre Châtellerault Et Chauvigny La Situation Des Chemins De Fer Dans La Vienne Vers 1914
Petite histoire du tramway entre Châtellerault et Chauvigny La situation des chemins de fer dans la Vienne vers 1914 Les VFEP Voies Ferrées Economiques du Poitou Dés 1872, le département se préoccupa de se doter d'un système de voies ferrées dont le premier réseau, Poitiers à Saint-Martin-L'ars, fut partiellement mis en service le 14 octobre 1895. Conformément à sa décision de 1893, le Conseil Général attendit les résultats d’exploitation de cette première ligne avant de décider en 1901 et 1902, la construction d'un deuxième réseau constitué des trois lignes suivantes : Lencloitre-Lavausseau-Lusignan Poitiers-Lavausseau Châtellerault – Chauvigny - Bouresse Les acteurs -Le Conseil général qui décide la construction de la ligne Châtellerault-Chauvigny-Bouresse (1901- 1902) . - Les études et les travaux sont confiés en 1904 à la société Baërt et Verney du Mans qui exploitait le 1er réseau. Par la suite, le 11 février1914, elle sera exploitante du réseau. - Les communes traversées et quelques communes intéressées par la desserte voisine. - Les Ponts et Chaussées qui surveillent la bonne réalisation des travaux. - L'administration en général. La mise en œuvre La conception de la ligne Le financement Les frais de premier établissement soit principalement : - Les études préliminaires - Les acquisitions de parcelles - La construction de la ligne - La construction des gares et des ouvrages d'art - L'achat du matériel roulant et d'entretien. Le montant estimatif en 1902 est estimé à : 3 689 011, 62F dont 1/5 à la charge de Baërt et Verney 4/5 à la charge du département qui souscrit un emprunt de 6 841 000F auprès du Crédit de France.(qui couvre aussi les autres réseaux). -

BR IFIC N° 2499 Index/Indice
BR IFIC N° 2499 Index/Indice International Frequency Information Circular (Terrestrial Services) ITU - Radiocommunication Bureau Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (Servicios Terrenales) UIT - Oficina de Radiocomunicaciones Circulaire Internationale d'Information sur les Fréquences (Services de Terre) UIT - Bureau des Radiocommunications Part 1 / Partie 1 / Parte 1 Date/Fecha: 29.07.2003 Description of Columns Description des colonnes Descripción de columnas No. Sequential number Numéro séquenciel Número sequencial BR Id. BR identification number Numéro d'identification du BR Número de identificación de la BR Adm Notifying Administration Administration notificatrice Administración notificante 1A [MHz] Assigned frequency [MHz] Fréquence assignée [MHz] Frecuencia asignada [MHz] Name of the location of Nom de l'emplacement de Nombre del emplazamiento de 4A/5A transmitting / receiving station la station d'émission / réception estación transmisora / receptora 4B/5B Geographical area Zone géographique Zona geográfica 4C/5C Geographical coordinates Coordonnées géographiques Coordenadas geográficas 6A Class of station Classe de station Clase de estación Purpose of the notification: Objet de la notification: Propósito de la notificación: Intent ADD-addition MOD-modify ADD-additioner MOD-modifier ADD-añadir MOD-modificar SUP-suppress W/D-withdraw SUP-supprimer W/D-retirer SUP-suprimir W/D-retirar No. BR Id Adm 1A [MHz] 4A/5A 4B/5B 4C/5C 6A Part Intent 1 100039437 AFS 5.245 JOHANNESBURG SANDTON AFS 28E3'53" 26S4'42" FX 1 ADD -

Horaires Horaires
LIGNE MONTMORILLON - CHAUVIGNY TRANSPORTS TRANSPORTS LIGNE 301 LIGNE PÉRIODICITÉ TOUTE L’ANNÉE VACANCES D’ETÉ 301 Itinéraires 301C03R 301C02R 301C01R 301E01R Jours de Fonctionnement du lundi au vendredi du lundi au samedi du lundi au dimanche 301 MONTMORILLON Renvoi(s) CHAUVIGNY MONTMORILLON Maison des services 17:25 CHAUVIGNY Centre (Avenue Fernand Tribot) 7:10 17:30 MONTMORILLON Saint Nicolas (Ecole Primaire) 7:17 17:37 LUSSAC LES CHATEAUX Salle des fêtes 7:27 17:47 Gare SNCF 7:32 17:52 CIVAUX Centre 7:42 18:02 Abysséa / Planète des Crocodiles – 17:19 HORAIRES Centrale CNPE 7:45 16:10 18:05 – HORAIRES VALDIVIENNE Cubord Usine 16:15 18:10 – HORAIRES VALABLES DU 03/09/18 AU 02/09/19 Le Gaschard 16:16 18:11 – HORAIRES VALABLES DU 03/09/18 AU 02/09/19 sauf jours fériés Mairie 16:19 18:14 17:29 sauf jours fériés Moulin Brault 16:21 18:16 – CHAUVIGNY Villeneuve 16:27 18:22 – Mairie 16:35 18:30 17:39 En été, départ à 16h05 de CIVAUX Abysséa / transports.nouvelle-aquitaine.fr Planète des crocodiles Dessertes estivales. transports.nouvelle-aquitaine.fr Le car continue vers POITIERS ET le FUTUROSCOPE en ligne 103 du lundi au dimanche, jours fériés inclus En été, CIVAUX Abysséa / Planète des crocodiles La Région vous transporte desservis à 18h04 La Région vous transporte LIGNE CHAUVIGNY - MONTMORILLON TITRES PRIX DE VENTE* 301 PÉRIODICITÉ TOUTE L’ANNÉE VACANCES D’ETÉ Itinéraires 301C01A 301C02A 301C03A 301E01A Titre Unitaire 2,50 € Jours de Fonctionnement du lundi au samedi du lundi au vendredi du lundi au dimanche Renvoi(s) 10 Voyages 15 € CHAUVIGNY Mairie 7:30 13:16 Mensuel 40 € Villeneuve 7:38 – Annuel 400 €** VALDIVIENNE Moulin Brault 7:44 – Mairie 7:46 13:26 Mensuel Jeune 20 € Le Gaschard 7:49 – Annuel Jeune 200 €** Cubord Usine 7:50 – CIVAUX Centrale C.N.P.E 7:55 16:15 17:15 – Coup de pouce mensuel 15 €*** Abysséa / Planète des Crocodiles – – – 13:36 Moins de 5 ans Gratuit Centre 7:58 16:18 17:18 LUSSAC LES CHATEAUX Gare SNCF 8:08 16:28 17:28 *Plus d’infos : lignes-en-vienne.fr **Les titres annuels peuvent être réglés en quatre fois. -

Vienne2 Liste Des Communes Rattachées À Chaque Centre De Mise
Centre de mise à disposition CIVRAY Centre d’intervention du SDIS Place du 8 mai 1945 86 400 CIVRAY - MAGNE - AVAILLES LIMOUSINE - MAUPREVOIR - BLANZAY - MOUTERRE SUR BLOURDE - CHAMPAGNE SAINT HILAIRE - PAYROUX - CHATEAU-GARNIER - PRESSAC - CHARROUX - ROMAGNE - CHAUNAY - SAINT GAUDENT - CIVRAY - SAINT MAURICE LA - COUHE CLOUERE - GENCAY - SAVIGNE - JOUSSE - SOMMIERE-DU-CLAIN - L’ISLE JOURDAIN - USSON -DU -POITOU - LIZANT Centre de mise à disposition MONTMORILLON Centre d’intervention du SDIS 58 rue des Clavières 86 500 MONTMORILLON - LUSSAC LES CHATEAUX - ADRIERS - MONTMORILLON - BETHINES - PERSAC - BONNES - SAINT GERMAIN - BRIGUEIL LE CHANTRE - SAINT SAVIN - CIVAUX - SILLARS - CHAUVIGNY - VALDIVIENNE - LATHUS - VERRIERES - LA TRIMOUILLE - LE VIGEANT Centre de mise à disposition LOUDUN Centre d’intervention du SDIS 3 Avenue de Ouagadougou 86 200 LOUDUN - COUSSAY LES BOIS - MONT SUR GUESNES - LES TROIS MOUTIERS - SAINT JEAN DE SAUVES - LOUDUN - SAINT LEGER DE MONTBRILLAIS - MONCONTOUR 1 Centre de mise à disposition de CHÂTELLERAULT Centre d’intervention du SDIS 14 rue Raymond Pitet 86 100 CHÂTELLRAULT - ANGLES-SUR-L’ANGLIN - LENCLOÎTRE - ARCHIGNY - LESIGNY - AVAILLES en CHÂTELLERAULT - LES ORMES - BEAUMONT - NAINTRE - BONNEUIL-MATOURS - PLEUMARTIN - BUXEUIL - SAINT GERVAIS LES TROIS CLOCHERS - CENON-SUR-VIENNE - SAINT PIERRE DE MAILLE - CHÂTELLERAULT - SCORBE-CLAIRVAUX - CHENECHE - SOSSAY - DANGE SAINT ROMAIN - TARGE - DISSAY - THURE - INGRANDES - USSEAU - LA ROCHE POSAY - VICQ SUR GARTEMPE - LA PUYE - VOUNEUIL SUR VIENNE Centre de mise -

La Vie Communale
La Vie Communale EFFONDREMENT D’UNE BUSE - ROUTE ANCIENNE DE LA PUYE À chaque épisode de forte pluie, les débordements sont fréquents et peu appréciés des riverains de la route Ancienne de La Puye. La municipalité a fait appel à la société S-EAUX-S pour localiser la cause du problème. Équipée du matériel nécessaire (caméra et autres) S-EAUX-S a pu fournir un résultat probant et a permis de localiser précisément la position du défaut : une buse effondrée. Les photos fournies par la caméra permettent de visualiser le défaut. Le lieu de l’intervention : route Ancienne de La Puye Dans un premier temps, le passage de caméra s’est fait dans le sens des champs vers les habitations. Sur les 16 premiers mètres, aucune anomalie marquante n’a été observée, hormis des fissures observées ici et là. Puis dans un second temps, la caméra a été passée dans le sens des habitations vers les champs. Après avoir introduit la caméra sur deux mètres, un effondrement de la canalisation s’est fait apercevoir. La position de l’anomalie ainsi que la profondeur ont été Un marquage au sol a été effectué. déterminées avec le localisateur de caméra. 2 - BM juillet 2019 La Vie Communale LE MOT DU MAIRE Nous sommes déjà au milieu de l’année 2019 avec un premier semestre riche en activités et festivités. Après le vote du budget en mars, nous avons travaillé pour sa réalisation avec notamment les travaux de voirie. En festivités, après la journée d’Antan début février, nous avons eu le plaisir de revoir passer sur les routes de Monthoiron le Rallye de la Vienne automobile le 16 mars. -

Grand Poitiers Projet De Territoire
bienveillance bienveillance projet de territoire & & audace audace Communauté urbaine Communauté projet de territoire Direction Communication - septembre 2018 - Création graphique : RC2C 2018 - Création graphique - septembre Direction Communication GRAND POITIERS GRAND POITIERS - Hôtel-de-Ville - 15, place du Maréchal Leclerc - CS 10569 - 86021 POITIERS CEDEX - Tél. 05 49 52 35 35 BEAUMONT-SAINT-CYR - BÉRUGES - BIARD - BIGNOUX - BONNES - BUXEROLLES - CELLE-L’éVESCAULT - CHASSENEUIL-DU-POITOU - CHAUVIGNY - CLOUÉ - COULOMBIERS - CROUTELLE CURZAY-SUR-VONNE - DISSAY - FONTAINE-LE-COMTE - JARDRES - JAUNAY-MARIGNY - JAZENEUIL - LA CHAPELLE-MOULIÈRE - LA PUYE - LAVOUX - LIGUGÉ - LINIERS - LUSIGNAN MIGNALOUX-BEAUVOIR - MIGNÉ-AUXANCES - MONTAMISÉ - POITIERS - POUILLÉ - ROUILLÉ - SAINT-BENOÎT - SAINTE-RADEGONDE - SAINT-GEORGES-LÈS-BAILLARGEAUX - SAINT-JULIEN-L’ARS SAINT-SAUVANT - SANXAY - SAVIGNY-LÉVESCAULT - SÈVRES-ANXAUMONT - TERCÉ - VOUNEUIL-SOUS-BIARD Crédits : Cyril Chigot, Alain Montaufier, Claire Marquis, Thomas Jelinek/CHU, iBooCréation, Daniel Proux iBooCréation, Thomas Jelinek/CHU, Marquis, Claire Chigot, Alain Montaufier, : Cyril Crédits Grand Poitiers, un territoire riche de sa diversité bienveillance De haut en bas et de gauche à droite : Rang 1 : Migné-Auxances ; Sanxay ; Chasseneuil-du-Poitou ; Béruges ; Pouillé ; Mignaloux-Beauvoir & Rang 2 : Bignoux ; Saint-Julien-l’Ars ; Sainte-Radegonde ; Coulombiers ; Vouneuil-sous-Biard Rang 3 : Liniers ; Saint-Benoît ; Buxerolles ; Lusignan ; audace COMMUNES Saint-Sauvant ; Tercé Rang 4 : -

9A3edbabd193.Pdf
LIGNE CARS 302 LE VIGEANT L’ISLE-JOURDAIN LUSSAC-LES-CHÂTEAUX CARS LE VIGEANT RÉGIONAUX LUSSAC-LES- RÉGIONAUX LIGNE CHÂTEAUX LIGNE L’ISLE-JOURDAIN 302 302 Car circulant toute l’année Période scolaire L’ISLE-JOURDAIN LUSSAC-LES- JOURS DE CIRCULATION Lundi au Vendredi Samedi Lundi au Vendredi CHÂTEAUX LE VIGEANT N° DU CAR 302C01A 302C02A 302S01A Horaires Horaires LE VIGEANT Bourpeuil 6:29 10:55 12:45 VALABLES DU 18/02/2021 AU 09/04/2021 VALABLES DU 18/02/2021 AU 09/04/2021 sauf jours fériés sauf jours fériés L'ISLE JOURDAIN Place du Poitou 6:35 11:01 12:51 MOUSSAC Bourg 6:44 11:10 13:00 PERSAC Bourg 6:55 11:21 13:11 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX Salle des fêtes 7:04 11:30 13:20 Gare SNCF 7:14 11:35 13:30 transports.nouvelle-aquitaine.fr transports.nouvelle-aquitaine.fr Les horaires de la ligne peuvent être modifiés en cours d’année selon le changement Gérez vos déplacements avec des horaires de correspondance TER. Aussi, avant chaque départ, nous vous Gérez vos déplacements avec conseillons de vérifier les horaires sur :https://transports.nouvelle-aquitaine.fr La Région vous transporte La Région vous transporte Où acheter votre titre de transport ? LIGNE Lignes à haut niveau LUSSAC-LES-CHÂTEAUX L’ISLE-JOURDAIN LE VIGEANT de service CHEZ LES TRANSPORTEURS 302 Lignes interurbaines Chinon Navettes TER (sauf les titres unitaires et tickets aller/retour). TAD LES RAPIDES DU POITOU TRANSPORTS MARTIN Ligne Routière 2 - LR2 Thouars-Loudun-Chinon 20 rue de la Plaine - 86000 POITIERS 8-10 rue des Métiers Loudun Lignes de trains LMMJV de 8h à 12h et de 14h à 17h. -

The Case of La Marche (Lussac-Les-Châteaux, Vienne)1
Open Archaeology 2018; 4: 239–261 Original Study Simone Chisena*, Christophe Delage On the Attribution of Palaeolithic Artworks: The Case of La Marche (Lussac-les-Châteaux, Vienne)1 https://doi.org/10.1515/opar-2018-0015 Received April 29, 2017; accepted December 12, 2017 Abstract: In this paper, we have explored the possibility of assigning the humanthemed engravings from La Marche to their authors, according to the method outlined by J.M. Apellaniz in the 1980s. The method employed here follows the first of the three stages postulated by Apellaniz: macroscopic observation, microscopic analysis and experimental protocol. From our study emerged a pattern of five groups and sixteen hands at work in this site. We believe, therefore, that it is possible to speak of La Marche as an “art workshop”, where portable art was produced and taught. Keywords: Magdalenian art; portable art; La Marche; authorship; attribution 1 Introduction The cave of La Marche, located in the town of Lussac-les-Châteaux in the French Département of Vienne (France), is by far one of the most intriguing portable prehistoric art discoveries of the 20th century. What makes this site outstanding in the European panorama is not just the amount of mobile art items (more than 3,000 engraved stones) but the fact that, out of these, numerous human representations may be encountered; so far, the largest concentration of human individual depictions in the whole Upper Palaeolithic in Europe. In this paper, we focused on the human-themed engravings from La Marche, followed the lines traced on the plaquettes and boulders to read the portraits’ outlines and, by applying a variation of the method devised by J.M. -

Répar on Des Agences Territoriales Et Des Centres D'exploita
Répar��on des Agences Territoriales et des Centres d'Exploita�on Agence de Neuville-de-Poitou Centre de Loudun Viennopôle 29 rue des Aubuies 86200 Loudun Saix Centre de Vaux-sur-Vienne Pouançay Roiffé [email protected] Raslay 37 Godet Morton Tel. 05 49 22 96 84 Vézières Beuxes Saint-Léger 86220 Vaux-sur-Vienne de Mbr. Marçay Les Trois Bournand (37) [email protected] Berrie Mou�ers Agence de Châtellerault Basses Tel. 05 49 93 04 48 Ternay Sammarçolles Ceaux-en Loudun Curçay Glénouze Pouant Loudun Messemé Ranton Mouterre Silly Port-de-Piles Centre de Châtellerault Nueil Saint Chalais Maulay Laon La Roche sous-Faye Rigault 8 rue Marcel Dassault Arçay Buxeuil 86100 Châtellerault Angliers Les Ormes Dercé Mondion Vellèches Martaizé Prinçay Saint-Rémy Sérigny Saint [email protected] Monts-sur Christophe Dangé sur-Creuse Leigné Guesnes Guesnes Saint-Romain Aulnay sur-Usseau Tel. 05 49 93 31 16 Berthegon Saint-Gervais Vaux Moncontour les-Trois-Clochers Saint-Clair La Chaussée Saires Leugny Orches Ingrandes Usseau Verrue Savigny Antran Marnes sous-Faye 79 (79) Sossay Oyré Doussay Mairé Centre de Saint-Savin Saint Saint-Jean-de-Sauves Coussay Chartres Cernay Saint-Genest Thuré Lésigny d'Ambière Châtellerault Route de Béthines La Grimaudière Chouppes Scorbé Coussay-les-Bois 86310 Saint-Germain Mazeuil Lencloître Clairvaux Mirebeau Senillé [email protected] Craon Thurageau Centre de Amberre Ouzilly Colombiers Saint-Sauveur Naintré Cuhon Varennes La Roche Tel. 05 49 48 16 48 Posay Massognes Availles Leigné Neuville-de-Poitou Cenon en-Ch. les-Bois Maisonneuve Saint-Mar�n-La-Pallu Beaumont Monthoiron Pleumar�n 11 rue de l'Outarde canepe�ère Champigny Saint-Cyr en-Rochereau Chenevelles Vicq-sur-Gartempe 86170 Neuville-de-Poitou Vouzailles Chabournay Vouneuil-sur-Vienne Cherves Neuville-de-P. -

CP TDF 2020 Vienne
COMMUNIQUE DE PRESSE Poitiers, le 03/09/2020 Tour de France 2020 Une fête populaire sous le sceau de la sécurité C’est dans un contexte in"dit marqu" par l’épid"#ie de Co&id-19 que se tient la (07e "dition du Tour de +rance, Elle -era "tape dans la .ienne %endant deu! /ours 0 les 9 et (0 septe#1re prochains, 3es 4clistes tra&erseront (3 om#unes et parcourront 72 5# alors que la %"riode esti&ale tou 2e 6 sa -in et que les " oles ont re%ris, Pour la %r"-7te de la .ienne, les en/eu! de s"curité, de irculation et d’in-or#ation de la %opulation sont donc pri#ordiau!, 8u cours de es deu! /ours de -esti&ités, les ser&ices de l’État et les ollecti&it"s seront pleine#ent #o1ilis"s au :té de l’or;anisateur A.S.O, <8#aury Sport Or;anisation=, LE VIRUS COVID !9 CIRCULE TOUJOURS Dans le contexte de la cir ulation du CO.ID-(9, plusieurs dispositions ont "t" %rises a-in d’assurer la s" urité sanitaire des oureurs et du pu1li qui sou2aiterait >tre %r"sent sur le par ours et dans les &illa;es ? d"part » et ? arri&"e @, 8,S,O, a pr"&u le dé%loie#ent d’a;ents de %r"&ention qui s’assureront de la #ise 6 disposition de #atériels et %roduits ontri1uant au respect des pr"cautions sanitaires, tels que le ;el 2ydro- al oolique, et sensi1iliseront coureurs et spectateurs au! ;estes 1arri7res dans les &illes et &illa;es "tapes, Sur l’ense#1le des deu! "tapes, le pla-ond d’une %r"sence si#ultan"e de A 000 personnes sera res%ect", 3a pr"-7te a pris un arr>té rendant o1li;atoire le port du masque de protection pour toute personne de onBe ans et plus 0 • 8u! a1ords -

Le Risque Mouvement De Terrain, Consulter
LES RISQUES NATURELS i LE RISQUE MOUVEMENT h DE TERRAIN 1- DÉFINITION Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels d'origines très diverses. Annuellement, ils provoquent en moyenne la mort de 800 à 1 000 personnes dans le monde et occasionnent des préjudices économiques et des dommages très importants. Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu sont compris entre quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour). 2- LES DIFFÉRENTS MOUVEMENTS DE TERRAIN . Le glissement de terrain : Il correspond au déplacement de terrains meubles ou rocheux le long d'une surface de rupture. Les chutes de blocs et éboulements : Les éboulements sont des phénomènes rapides ou événementiels mobilisant des éléments rocheux plus ou moins homogènes avec peu de déformation préalable d'une pente abrupte jusqu'à une zone de dépôt. Les effondrements : Un effondrement est un désordre créé par la rupture du toit d'une cavité souterraine (dissolution, mine, carrière...). Il existe 2 types de cavités : Cavités naturelles les karsts, gouffres, grottes, etc. ; les cavités de suffosion. (cavités liées à des phénomènes d'érosion interne générées par des circulations d'eau souterraines). Cavités anthropiques les carrières ; les marnières ; les caves ; les habitations troglodytiques ; les ouvrages civils ; les ouvrages militaires. 1 . Les tassements par retrait-gonflement des argiles : Les variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et des tassements (période sèche) et peuvent avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles.