Chapitre I Etude D'impact
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
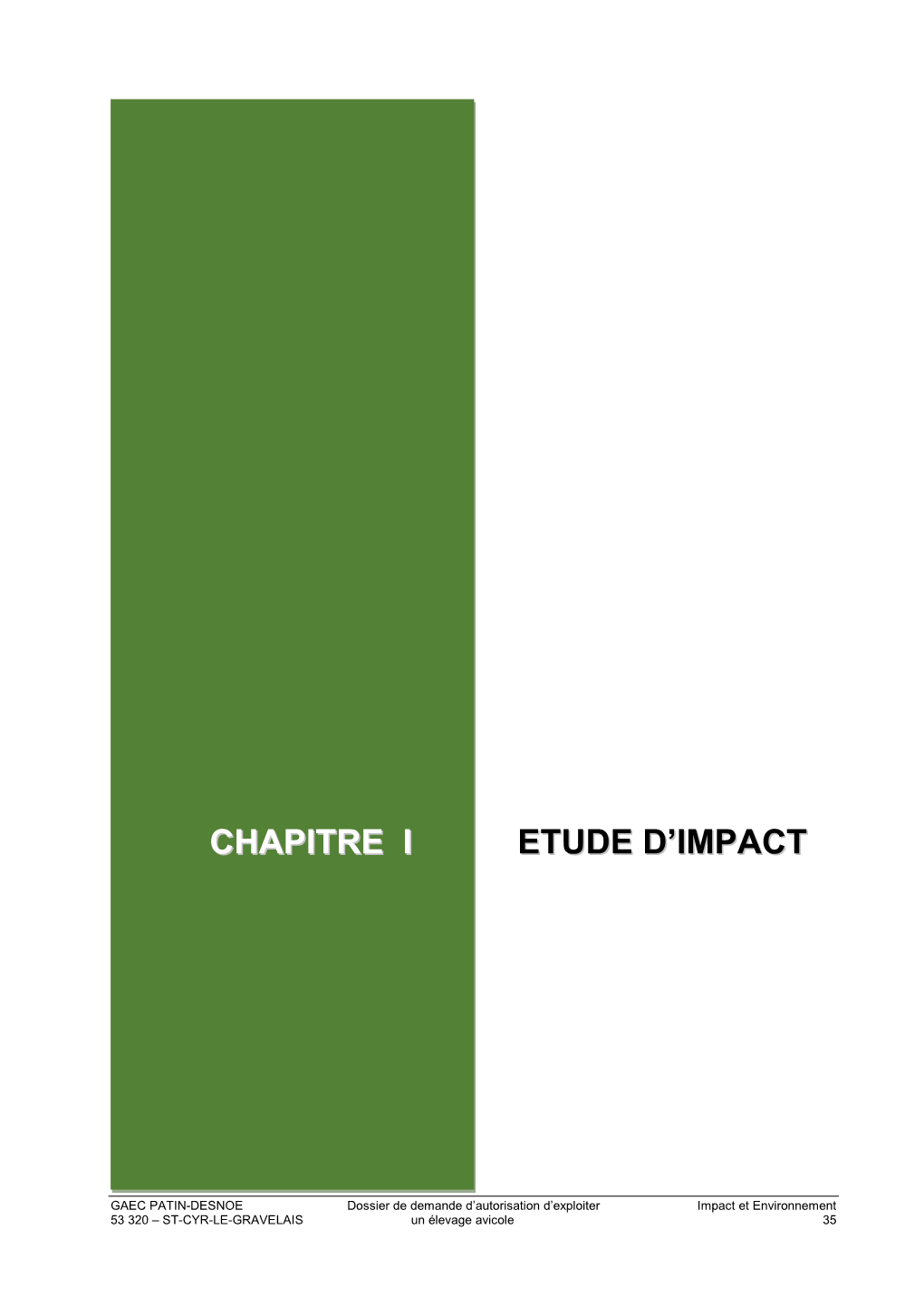
Load more
Recommended publications
-

Departement De La Mayenne Commune De Loiron-Ruillé
DEPARTEMENT DE LA MAYENNE COMMUNE DE LOIRON-RUILLÉ Zone d’activités de Chantepie Rapport annexé à la demande d'examen au cas par cas MAITRE D’OUVRAGE PAYS DE LOIRON CABINET D’URBANISME BUREAU D’ETUDES ENVIRONNEMENT Dossier réalisé par : EF ETUDES – antenne Rennes / Saint Germain Sur Ille Version 1 Date : Septembre 2018 Rapport annexé à la demande au « cas par cas » - Zone d’activités de Chantepie – Commune de Loiron-Ruillé TABLE DES MATIÈRES PRÉAMBULE .............................................................................................................................................................................. 3 CADRAGE PRÉALABLE DU PROJET ................................................................................................................................................... 5 ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT ........................................................................................................19 PRÉSENTATION DU PROJET ..........................................................................................................................................................28 2 Réalisation – EF Etudes – Antenne Rennes Rapport annexé à la demande au « cas par cas » - Zone d’activités de Chantepie – Commune de Loiron-Ruillé PREAMBULE La communauté de communes du Pays de Loiron a décidé d’engager une procédure de création, dès l’année 2016, d'un nouvel espace d'activités économiques, nommé zone d’activités de Chantepie, situé dans le prolongement Nord du centre-bourg de Loiron. -

Elaboration Du Schéma De Cohérence Territoriale Des Pays De Laval Et De Loiron
Elaboration du Schéma de Cohérence Territoriale des Pays de Laval et de Loiron Ateliers thématiques – 1 ère session Débats sur les enjeux COMPTE-RENDU DE L'ATELIER "AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TERRITOIRE" 16 novembre 2010 – Salle du Verger à Montigné-le-Brillant L’objectif de cette première session d’ateliers est de permettre aux participants de s’approprier et d’enrichir les résultats du diagnostic du SCoT, en particulier les enjeux propres à chaque thématique, puis de discuter des choix à faire pour l’avenir du territoire, de manière très large et ouverte. Date et heure : 16 novembre 2010 de 14h00 à 16h00 Elu référent : Christian BRIAND Animation de l'atelier : Arnaud CLEVEDE, Marc LAMARE Personnes présentes : Rémy BENOIT DG Communauté de Communes du Pays de Loiron Jean BODIN Maire d'Entrammes, Vice-président de Laval Agglomération Hervé BIRY Ville de Laval Christian BRIAND Maire de L'Huisserie, Vice-président de Laval Agglomération Arnaud CLEVEDE Chargé de mission SCOT des Pays de Laval et de Loiron Hervé CORNEE Maire de Beaulieu-sur-Oudon Olivier GIRMA Laval Agglomération Julien HAREL Laval Agglomération Marc LAMARE DGA Laval Agglomération, SG SM Pays de Laval et de Loiron Yves LETAILLEUR Laval Agglomération Louis MICHEL Chambre d'Agriculture Cédric MALFOIS DDT Eric PELTIER DDT Christian PERSIN Ville de Laval Olivier RICHEFOU Maire de Changé, Vice-président de Laval Agglomération Jean-Paul SCHOEMANN Maire de La Gravelle, Vice-président de la CCPL Isabelle VACHER Région Pays de la Loire David VIEL SAFER Maine Océan Personnes excusées : Jean-Marc BESNIER Laval Mayenne Aménagement Laurent GENEAU Conseil Général Gérard JALLU Pascal ORAIN Elisabeth PANNARD Maire de Parné-sur-R., Vice-présidente de Laval Agglomération François SAINT CODEV Pays de Loiron Le Syndicat mixte du territoire des Pays de Laval et de Loiron a choisi de mettre en oeuvre une concertation ambitieuse pour élaborer son Schéma de Cohérence Territoriale. -

Présentation Atelier Symbolipv2
Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto Le diagnostic du premier SAGE Le diagnostic du L’émergence du concept des premier S.A.G.E. et PPAE premières actions une nouvelle stratégie d’actions 1e octobre 2015 SY.M.B.O.L.I.P. 2 Un enjeu fort : la qualité de l’eau 1996-98 : premiers diagnostics sur les origines des pollutions détectées dans l’Oudon Le diagnostic du premier SAGE « Le cheptel du bassin versant de l’Oudon représente 1,8 millions d’équivalent habitants L’émergence du alors que la population est de 70 000 habitants. » concept des PPAE Diagnostic basé sur les normes CORPEN et des coefficients de transfert aux eaux tirés de la une nouvelle bibliographie stratégie d’actions 90% matières azotées d’origine agricole 70% matières phosphorées d’origine agricole 75% matières organiques d’origine agricole 1e octobre 2015 SY.M.B.O.L.I.P. 3 Matières azotées 90% d’origine agricole 1e octobre 2015 SY.M.B.O.L.I.P. 4 Des actions d’abord réglementaires Premier programme d’actions S.A.G.E. de 2003 Volet agricole très orienté sur les phyto car on Le diagnostic du suppose que le volet Nitrates est traité par la premier SAGE Directive Nitrate (bassin versant de l’Oudon en zone vulnérable puis zone d’action complémentaire) L’émergence du concept des 1998-2000 : étude sur la prévention des pollutions PPAE par les pesticides (définition de secteurs prioritaires) une nouvelle Méthodologie non validée par l’ensemble des stratégie partenaires : étude non utilisée par la suite d’actions 1999 : arrêtés limitant l’usage de l’Atrazine sur bassin versant de l’Oudon et instaurant une bande de sécurité le long des cours d’eau (2001 : interdiction nationale) 2004 : arrêtés réglementant l’usage de phyto non e 1 octobre 2015 agricole : diuron,SY.M.B.O.L.I.P. -

2020-03, Chalet Des Savoirs, Programme Du Mois
Programme du mois de Mars 2020 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Espace fermé le matin 9h15/10h15 à Montjean 2 3 Gym douce 4 Matin : accueil fermé 5 9h30/12h 6 10h45/11h45 Gym douce 10h à Laval : aquagym Suite des réalisations 20h30 Loiron , 10 H PETIT DEJ DES INITIATIVES (groupe en autono- théâtre des 3 chênes COUVERTE 14h/16h Club informatique seniorD É 14h/16h Lisons du théâtre au pupitre 14h/16h Olivet , café du garage mie) Danse (groupe complet) Cf verso Découverte du jeu tactik « Boys don’t cry » (en partenariat avec les résidents du CAJ de Robida) 14h/17h Cf verso 20h30 à La Brûlatte Danses bretonnes Art textile 9h15/10h15 à Montjean 9 10 Gym douce 11 10h45/11h45 Gym douce 12 10h à Laval : aquagym 9h45/14h Atelier repas Cf. verso 8h30/12h30 Changé 10h30/11h30 14h/17h Réalisation d’un pot décoratif Visite du site Séché Yoga du rire Cf verso 14h/17h Réalisation d’un pot décoratif (groupe complet) 14h/16h30 à La Gravelle Cf verso 14h/16h Club informatique senior Danses en ligne Cf verso (groupe complet) 20h30 à La Br ûlatte Danses bretonnes 17 18 19 16 10h45/11h45 Gym douce 9h15/10h15 à Montjean 10h à Laval : aquagym Gym douce 9h30/12h Suite des réalisations 15h RDV au jardin 14h/16h Lisons du théâtre au pupitre (groupe en autonomie) Cf verso Entretien des arbres fruitiers 14h/17h Scrapbooking 14h/17h Art textile 20h30 à La Brûlatte Danses bretonnes 23 10h à Laval : aquagym 24 9h15/10h15 à Montjean 25 Espace fermé le matin 26 Espace fermé la journée Gym douce 14h/16h Club informatique senior 14h/17h 10h45/11h45 Gym douce Réalisation d’un pot décoratif 10 H A LA CROISÉE , L AVAL (groupe complet) Cf verso 13h45/17h Randonnée ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’E DI 20h30 à La Brûlatte Danses bretonnes Inscription pour le covoiturage 9h15/10h15 à Montjean 30 31 Gym douce 10h à Laval : aquagym 9h45/14h Atelier repas Cf. -

Ahuillé /Argentré /Beaulieu
AHUILLÉ / ARGENTRÉ / BEAULIEU-SUR-OUDON / BONCHAMP / LE BOURGNEUF-LA-FORÊT / BOURGON LA BRÛLATTE / CHÂLONS-DU-MAINE / CHANGÉ / LA CHAPELLE-ANTHENAISE / ENTRAMMES / FORCÉ LE GENEST-ST-ISLE / LA GRAVELLE / LAUNAY-VILLIERS / LAVAL / L’HUISSERIE / LOIRON-RUILLÉ LOUVERNÉ / LOUVIGNÉ / MONTFLOURS / MONTIGNÉ-LE-BRILLANT / MONTJEAN / NUILLÉ - SUR - VICOIN OLIVET / PARNÉ - SUR - ROC / PORT-BRILLET / ST - BERTHEVIN / ST-CYR-LE-GRAVELAIS / ST-GERMAIN-LE-FOUILLOUX ST-JEAN-SUR-MAYENNE / ST-OUËN-DES-TOITS / ST-PIERRE-LA-COUR / SOULGÉ-SUR-OUETTE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 • Directeur de la publication : Benoît LION • Responsable du service communication externe : Julie JACQUES • Secrétariat de rédaction : Julie VELLAYOUDOM • Rédaction : Amélie LE BARS, Carole GERVAIS • Photographies : Chloé BREHIN, Kévin ROUSCHAUSSE • Maquette et mise en page : Diabolo, le studio graphique d’Imprim’Services • Impression : Imprim’Services Tous droits de reproduction réservés. 10 UN TERRITOIRE ATTRACTIF 12 • ÉCONOMIE : FAIRE DE L’AGGLO UNE DESTINATION EMPLOI 14 • INNOVATION : DÉVELOPPER LA CRÉATION 16 • ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : 30 DIVERSIFIER LA FORMATION ET CONSOLIDER L’OFFRE UN TERRITOIRE DE VIE DE PROXIMITÉ 32 • UNE CULTURE VIVANTE 18 • ACCOMPAGNER L’EMPLOI ET ENTRAÎNANTE 34 • COHÉSION SOCIALE : UNE SOLIDARITÉ AU SERVICE DE TOUS SOMMAIRE 36 • SPORT : FAIRE BOUGER 20 LES LIGNES 38 • TOURISME : UNE ESCALE UN TERRITOIRE DURABLE NATURELLE 22 • AMÉNAGER ET CONSTRUIRE UN TERRITOIRE RESPECTUEUX 24 • HABITAT : AMÉLIORER ET ANIMER LE LOGEMENT 40 26 • TRANSPORT : SE DÉPLACER GOUVERNANCE & AUJOURD’HUI VERS DEMAIN PERFORMANCE 28 • COLLECTER, SENSIBILISER, 42 • MUTUALISATION : ÉCONOMISER : AGIR POUR UN PREMIER SCHÉMA L’ENVIRONNEMENT À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE FUSIONNÉ 44 • RESSOURCES : UNE COLLECTIVITÉ SOCIÉTALE ET RESPONSABLE 46 • BUDGET : LE CHOIX DE LA CONTINUITÉ DANS UN CONTEXTE TERRITORIAL RENOUVELÉ 4 / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 LAVAL AGGLOMÉRATION // www.agglo-laval.fr 34 communes, un territoire 2019 marque la première année d’un nouveau territoire à 34 communes. -

2020APPDL37 & BRE-2020-7934/2020APB35 Du 24 Juillet 2020 Les Missions Régionales D’Autorité Environnementale Des Pays De La Loire Et De Bretagne 1/24 Avis
PAYS DE LA LOIRE et BRETAGNE Avis des Missions Régionales d’Autorité environnementale Pays de la Loire et Bretagne sur le projet de création d’une unité de méthanisation par la société Oudon biogaz sur la commune de Livré-la-Touche (53) n° : PDL-2019-4204 & BRE-2020-7934 AVIS n° PDL-2019-4204/2020APPDL37 & BRE-2020-7934/2020APB35 du 24 juillet 2020 Les missions régionales d’autorité environnementale des Pays de la Loire et de Bretagne 1/24 Avis Introduction sur le contexte réglementaire L’avis qui suit a été établi en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. L’autorité environnementale a été saisie le 12 février 2020 d’un dossier de demande d’autorisation environnementale d’une unité de valorisation de matières organiques par méthanisation que la société Oudon biogaz souhaite construire et exploiter sur la commune de Livré-la-Touche en Mayenne et du plan d’épandage associé à cette unité. Par suite de la décision du Conseil d’État n°400559 du 6 décembre 2017, venue annuler les dispositions du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’elles maintenaient les préfets de région comme autorité environnementale, le dossier a été transmis aux missions régionales d’autorité environnementale (MRAe) concernées. L'avis porte sur la qualité du dossier d’autorisation environnementale, en particulier l’étude d’impact, et sur la prise en compte de l’environnement dans le projet. Il ne préjuge pas de la décision finale, ni des éventuelles prescriptions environnementales associées à une autorisation qui seront apportées ultérieurement, conformément à la procédure relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (article L.512-1 du code de l'environnement). -

Carte Des 17 PIAL De La Mayenne
Les 17 PIAL de la Mayenne Lignières- Orgères La Rennes-en- Fougerolles- Thuboeuf Pallu Landivy Grenouilles Neuilly- St-Calais- du-Plessis St-Julien- le-Vendin du-Désert du-Terroux Couptrain Désertines Le Housseau- Soucé Brétignolles Ste-Marie- Madré St-Aubin- La du-Bois St-Aignan- Fosse- Lesbois Pré-en-Pail- Pontmain Dorée Couesmes-Vaucé de-Couptrain Vieuvy Louva St-Samson St-Mars- Chevaigné- sur-la-Futaie Lassay- du-Maine Ravigny Gorron Ambrières- les-Châteaux St-Cyr- Levaré Hercé Le Pas les-Vallées Javron- en-Pail Boulay- St-Berthevin- St-Ellier- Chantrigné les-Chapelles les-Ifs Champfrémont la-Tannière du-Maine Charchigné Colombiers- Villepail Carelles Brecé Le du-Plessis St-Mars- St-Loup- Montaudin Montreuil- Horps Saint-Pierre- sur-Colmont du-Gast Le Poulay Crennes- des-Nids Ribay sur-Fraubée La Haie- Le Ham Gesvres Traversaine Larchamp St-Denis- Oisseau Champéon de-Gastines St-Fraimbault- Averton Châtillon- de-Prières Hardanges sur-Colmont La Pellerine Parigné- VILLAINES-LA- Loupfougères ERNEE sur-Braye Marcillé- la-Ville JUHEL St-Aubin- La Chapelle- St-Georges- Aron au-Riboul du-Désert Vautorte Courcité Saint-Pierre- Buttavent St- MAYENNE des-Landes Champgenéteux Baudelle Montenay Grazay St-Mars-du-Désert Trans La Bazoge- Placé Montpinçon St-Thomas- Contest Moulay de-Courceriers St-Germain- de-Coulamer Hambers Belgeard Bais Juvigné Jublains Chailland Alexain Commer St-Hilaire- St-Martin- La du-Maine St-Germain- de-Connée Bigottière Izé d'Anxure St-Pierre- La Croixille St-Germain- Martigné-sur- Ste-Gemmes- sur-Orthe le-Guillaume -

Atlas Des Zones Inondables Des Principaux Affluents De L’Oudon
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT MAINE ETL OIRE ATLAS DES ZONES INONDABLES DES PRINCIPAUX AFFLUENTS DE L’OUDON SEPTEMBRE 2004 – DOCUMENT DEFINITIF ISL Bureau d’Ingénieurs Conseils Technopole d’Angers 1 av. du Bois l’Abbé 49070 Beaucouzé tel : 02 41 36 01 77 fax : 02 41 36 10 55 Parc scientifique Agropolis 2 34397 Montpellier Cedex 5 tel : 04 67 54 51 88 fax : 04 67 54 52 05 Parc de la Villette 75 bld Mac Donald 75019 Paris tel : 01 55 26 99 99 fax : 01 40 34 63 36 ATLAS DES ZONES INONDABLES DES PRINCIPAUX AFFLUENTS DE L’OUDON EN MAINE-ET-LOIRE (49) OBJET ET PERIMETRE DE L’ATLAS........................................................................................................................................................ 2 CONTENU DE L’ATLAS ............................................................................................................................................................................. 4 L’ARAIZE...................................................................................................................................................................................................... 5 L’ARGOS....................................................................................................................................................................................................... 6 LE CHERAN................................................................................................................................................................................................. -

Annexes Plan D’Aménagement Et De Gestion Durable De La Ressource En Eau Et Des Milieux Aquatiques Annexes Sommaire
COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU BASSIN VERSANT DE L’OUDON SCHÉMA D’AménagEMENT ET DE GESTION DES EAUX adopté par la C.L.E. le 24 octobre 2013 Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques Annexes Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques Annexes Sommaire 1 • Masses d’eau, cours d’eau et plans d’eau du bassin versant de l’Oudon : objectifs, délais, classements selon les critères S.D.A.G.E. et réglementaires .......p.7 2 • Liste des ouvrages concernés par le rétablissement de la continuité écologique ....................................................................................................p.15 3 • Liste des ouvrages concernés par l’application du règlement de l’ouverture des ouvrages de vannage ........................................................................p.55 4• Compatibilité S.D.A.G.E. Loire-Bretagne / S.A.G.E. de l’Oudon...........................p.69 5• Liste des zones humides inventoriées par la C.L.E. (Novembre 2009) .............. p.77 6• Indicateurs de suivi-évaluation du S.A.G.E. .................................................................p.103 7• Calcul des taux d’étagement et fixation des objectifs intermédiaires 2017. ......................................................................................p.121 Masses d’eau, cours d’eau et plans d’eau du bassin versant de l’Oudon : objectifs, délais, classements selon les critères S.D.A.G.E. et réglementaires 1 7 Masses d’eau, cours d’eau et plans d’eau du bassin versant -

Associationsassociations
AssociationsAssociations C.R.A.B. (Comité Rural d’Animation Brûlattais) Depuis quelques années, le comité rural d’animation de La Brûlatte renoue avec une ancienne tradition « le feu de la Saint-Jean ». Cette manifestation qui a eu lieu le 17 juin 2017 a connu un fort succès. Nous étions 300 convives à admirer le bûcher enflammé s’élevant à environ 7 mètres du sol. Merci pour votre présence et à l’année prochaine avec un nouveau spectacle. Le C.R.A.B. prévoit d’organiser en 2018 : 1er semestre : Feux de la Saint-Jean le 16 juin 2e semestre : Soirée le 13 octobre Téléthon le 8 décembre Composition du bureau : Président : M. Patrick BLAIN Vice-Président : M. Jean-Yves MÉTAYER Trésorier : M. René BÉNÉFIX Secrétaire : M. Mathieu CHACUN Les HURLETTES Si nous réussissons à trouver une troupe théâtrale, nous pourrions organiser une représentation le week- end du 17-18 Février 2018. Notre loto annuel sera le 14 octobre 2018. Les personnes désirant reconstituer une troupe de théâtre sur notre commune, peuvent venir nous rejoindre, il suffit de contacter : Madame JOUSSE Chantal - Présidente au 02 43 02 45 55 ou au 06 83 40 91 87 Madame POIRIER Nicole - Trésorière au 02 43 02 18 76 ou 06 72 16 16 16 C’est ouvert à tout public grand et petit Représentations du 24/25 Février 2017 par la Troupe les Hilliaciens Décembre 2017 16 La Brûlatte F i TENNIS CLUB n a n S i le nombre d'adhérents a été en forte diminution en 2016 – seulement 7 – cette année n'en compte c e qu'un seul qui par ailleurs a été remboursé, nous ne pouvons malheureusement que constater les faits et s encourager pour 2018 les jeunes et moins jeunes à la pratique de ce sport peu onéreux, voir ci-dessous. -

AVIS Consultation Du Public SAS
PREFECTURE DE LA MAYENNE Bureau des procédures environnementales et foncières AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Une enquête publique se déroulera sur la commune de Livré-la Touche du jeudi 5 novembre 2020, 9 h 00 au vendredi 4 décembre 2020, 17 h 00, concernant la demande présentée par la SAS OUDON BIOGAZ, dont le siège social est situé 3 rue du Portugal à Craon (53400), relative à son projet de création d'une unité de méthanisation de matières organiques d'une capacité de traitement de 385 tonnes/jour, au lieu-dit La Garenne à Livré-la-Touche (53400). Le projet prévoit l'épandage sur les communes de Ahuillé, Astillé, Athée, Ballots, Beaulieu-sur-Oudon, Bierné-les- Villages, Bouchamps-les-Craon, Brains-sur-les-Marches, Congrier, Cosmes, Cossé-le-Vivien, Courbeveille, Craon, Cuillé, Denazé, Fontaine-Couverte, Gastines, La Boissière, La Chapelle-Craonnaise, La Rouaudière, La Selle Craonnaise, Laubrières, Livré-la-Touche, Marigné-Peuton, Méral, Montigné-le-Brillant, Montjean, Niafles, Nuillé- sur-Vicoin, Pommerieux, Prée-d'Anjou, Quelaines-Saint-Gault, Renazé, Saint-Aignan-sur-Roë, Saint-Erblon, Saint- Martin-du-Limet, Saint-Michel-de-la-Roë, Saint-Poix, Saint-Quentin-les-Anges, Saint-Saturnin-du-Limet, Simplé (53), Bouillé-Ménard, Carbay, Ombrée-d'Anjou, Segré-en-Anjou-Bleu (49), Soudan (44), Argentré-du-Plessis, La Selle-Guerchaise, Le Pertre, Rannée (35). Pendant la durée de l'enquête, fixée à trente jours, le dossier de la demande d'autorisation environnementale sera déposé à la mairie de Livré-la-Touche afin que les personnes intéressées puissent le consulter sur place pendant les heures habituelles d'ouverture de la mairie (les lundi et jeudi,de9h00à 12h30et de14h00à18h00,levendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 30). -

Canton De Loiron-Ruillé
Canton de Loiron-Ruillé Élections Départementales Beaulieu-sur-Oudon • Le Bourgneuf-la-Forêt • Bourgon • La Brûlatte • Le-Genest-Saint-Isle • La Gravelle • Launay-Villiers 20 et 27 juin 2021 Loiron-Ruillé • Montjean • Olivet • Port-Brillet • Saint-Cyr-le-Gravelais • Saint-Ouen-des-Toits • Saint-Pierre-la-Cour Nicole BOUILLON Maire du Genest-Saint-Isle 1ère Vice-présidente du Conseil départemental Louis MICHEL Maire de Saint-Cyr-le-Gravelais Conseiller départemental Madame, Monsieur, Les 20 et 27 juin prochains, vous serez invités à élire vos 2 représentants au Conseil CONTACTEZ-NOUS départemental pour le canton de Loiron-Ruillé. Comme il y a 6 ans, nous avons choisi de nous présenter ensemble, et nous faisons équipe avec Isabelle Groseil et Hervé [email protected] Lhotellier. Durant les six années qui viennent de s’écouler beaucoup de travail a été accompli pour la solidarité, la petite enfance, le handicap, les personnes âgées, les collèges, la transition écologique, les routes, le sport ou encore la culture. Tout près de notre canton, et comme symbole de notre attractivité, comment ne pas évoquer l’Espace Mayenne, véritable emblème du dynamisme mayennais ; un lieu destiné Bourgon Le Bourgneuf- à recevoir les compétitions sportives, les animations culturelles et autres événements ; la-Forêt un lieu qui dès le 30 juin prochain accueillera l’arrivée d’une étape prestigieuse du Tour Saint-Ouën- de France ! Launay- des-Toits Villiers Port- Chaque jour, la vie quotidienne des Mayennais est marquée par l’action du Brillet Saint- Olivet Département. Nous sommes fiers de notre département et de sa bonne gestion des Pierre- Le Genest- la-Cour Saint-Isle deniers publics.