Saint-Sandoux
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
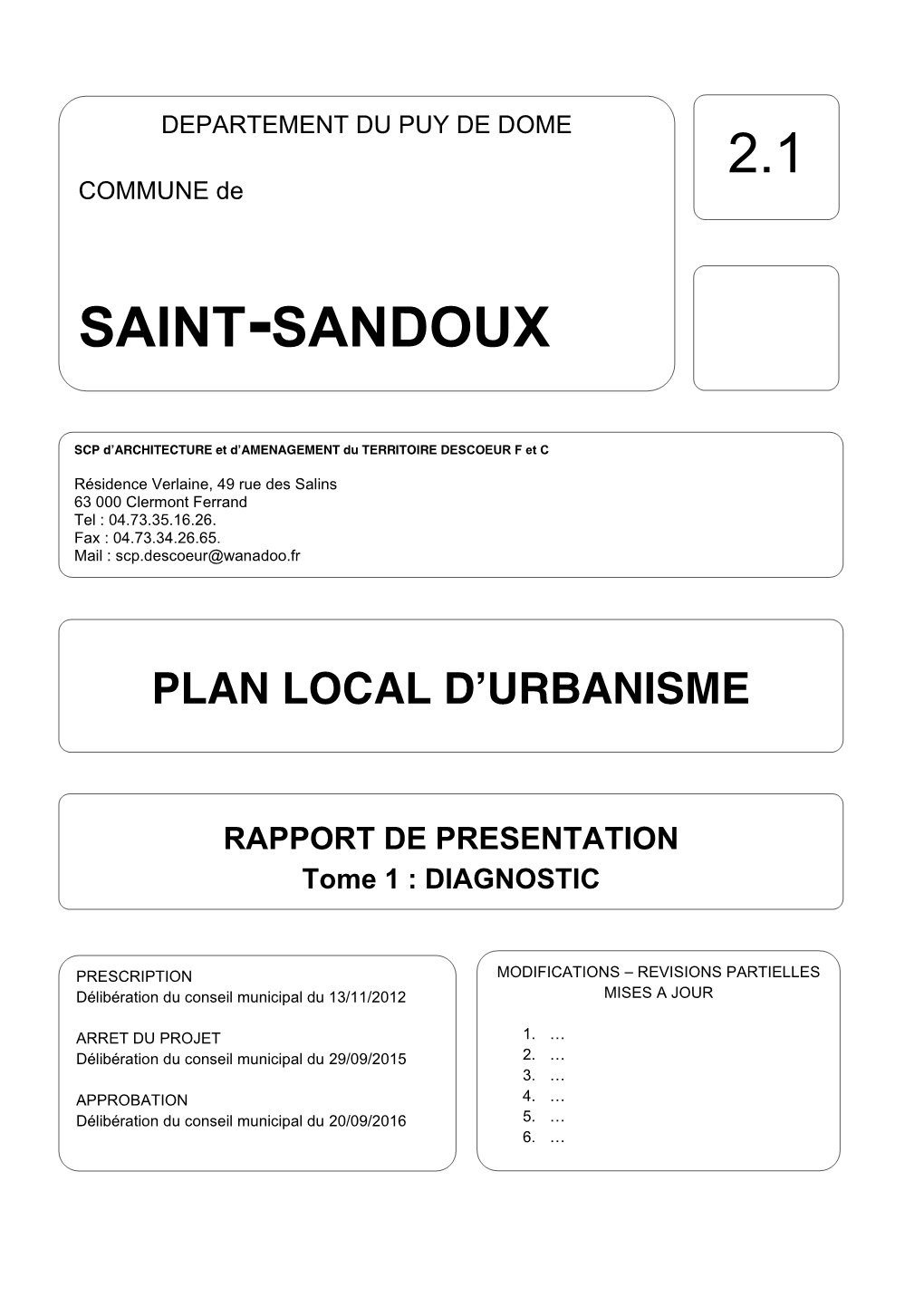
Load more
Recommended publications
-

Périmètre Des SPANC Périmètre Des Communes Compétences Du
Lapeyrouse Compétences des Services Publics d'Assainissement Non collectifs (SPANC) Buxières-sous-Montaigut Ars-les-Favets Durmignat Département du Puy de Dôme Montaigut La Crouzille Saint-Éloy-les-MinesMoureuille Virlet Youx Servant Le Quartier Château-sur-Cher Pionsat Menat Saint-Hilaire Saint-Gal-sur-Sioule TeilhetNeuf-Église La Cellette Pouzol Saint-Quintin-sur-Sioule Périmètre des SPANC Saint-Maigner Sainte-Christine Saint-Rémy-de-Blot Marcillat Saint-Maurice-près-Pionsat Gouttières Bussières Ayat-sur-Sioule Champs Saint-Genès-du-Retz Périmètre des communes Saint-Pardoux Vensat Saint-Julien-la-Geneste Lisseuil Saint-Sylvestre-Pragoulin Effiat Saint-Hilaire-la-CroixSaint-Agoulin Roche-d'AgouxEspinasse Montpensier Bas-et-Lezat Blot-l'Église Chaptuzat Saint-Priest-Bramefant Compétences du SPANC Vergheas Châteauneuf-les-Bains Jozerand Saint-Gervais-d'Auvergne Villeneuve-les-Cerfs Montcel Aigueperse Randan Lachaux Artonne Bussières-et-Pruns Ris Saint-Angel Mons Contrôle Charensat Saint-Clément-de-Régnat Biollet Sauret-Besserve Charbonnières-les-Vieilles Beaumont-lès-Randan CombrondeSaint-Myon Vitrac Aubiat Limons Ü ThuretSaint-Denis-Combarnazat Châteldon Saint-Priest-des-ChampsQueuille Beauregard-Vendon Contrôle, Réhabilitation La Moutade Sardon Teilhède Le Cheix Luzillat Puy-Guillaume Davayat Saint-André-le-Coq Saint-Georges-de-MonsManzat Prompsat Cellule Charnat Montel-de-Gelat Loubeyrat Martres-sur-MorgeSurat Saint-Victor-Montvianeix Contrôle, Vidange, Réhabilitation Les Ancizes-Comps Saint-Bonnet-près-Riom Paslières Pessat-Villeneuve -

Inventaire Départemental Des Cavités Souterraines Hors Mines Du Puy-De-Dôme
Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines du Puy-de-Dôme Rapport final BRGM/RP-55860-FR Octobre 2007 Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines du Puy-de-Dôme Rapport final BRGM/RP-55860-FR Octobre 2007 Étude réalisée dans le cadre des projets de Service public du BRGM 2006 06RISB06 Convention MEDD n° CV05000195 H. Pouderoux, Ph. Rocher et D. Rouzaire Vérificateur : Approbateur : Nom : S. Bes de Berc Nom : F. Deverly Date : 24/10/2007 Date : 24/10/2007 Signature : Signature : Le système de management de la qualité du BRGM est certifié AFAQ ISO 9001:2000. Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines du Puy-de-Dôme Mots clés : base de données, inventaire, département du Puy-de-Dôme, cavités souterraines, caves, ouvrages civils, carrières souterraines. En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante : Pouderoux H., Rocher Ph. et Rouzaire D. (2007) - Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines du Puy-de-Dôme. Rapport final. BRGM/RP-55860-FR, 98 pages, 13 illustrations, 3 annexes, 1 carte hors texte. © BRGM, 2007, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l’autorisation expresse du BRGM. Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines du Puy-de-Dôme Synthèse Dans le cadre de la constitution d'une base de données nationale des cavités souterraines, le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable (MEDD) a chargé le BRGM de réaliser l'inventaire des cavités souterraines abandonnées, hors mines, dans le département du Puy-de-Dôme (convention MEDD n° CV05000195). Cette étude, d’une durée de 18 mois, a permis de recenser 1253 cavités qui ont été intégrées dans la base de données nationale (BDCavités) disponible sur Internet (www.bdcavite.net). -

Le-Vernet-Sainte- Marguerite Plan Local D'urbanisme
DEPARTEMENT du Puy-de-Dôme 1.1 COMMUNE de LE-VERNET-SAINTE- DECEMBRE 2015 MARGUERITE TOME 1 SCP DESCOEUR F et C Architecture et Aménagement du Territoire 49 rue des Salins 63000 Clermont Ferrand Tel : 04.73.35.16.26. DOCUMENT PROVISOIRE Fax : 04.73.34.26.65. Mail : [email protected] PLAN LOCAL D’URBANISME RAPPORT DE PRESENTATION / Tome 1 : DIAGNOSTIC PRESCRIPTION MODIFICATIONS – REVISIONS PARTIELLES Délibération du conseil municipal du MISES A JOUR ARRET DU PROJET 1. … Délibération du conseil municipal du 2. … 3. … 4. … APPROBATION 5. … Délibération du conseil municipal du 6. … PREAMBULE ....................................................................................................................................................................... 3 A. LE CONTENU DU PLU .................................................................................................................................................................... 4 B. PRISE EN COMPTE DES DIFFERENTES PROBLEMATIQUES POUR DEFINIR LES ENJEUX DU PLU .......................................................................... 8 1ER PARTIE LE DIAGNOSTIC COMMUNAL ......................................................................................................................... 10 A. PRESENTATION DU TERRITOIRE ............................................................................................................................................. 11 1. Situation du territoire ...................................................................................................................................................... -

Claude ARNAUD 1915 1 .Pdf
SAINT-SANDOUX pendant la première guerre mondiale 2ème partie, 1er semestre 1915 Un grand merci pour vos réactions positives et chaleureuses Une exposition est envisagée. Nous attendons vos propositions et vos conseils auprès du secrétariat de la mairie. Le prêt d’objets, de documents, de correspondances, de photographies, d’habits seraient les bienvenus. Les mots soulignés sont expliqués en bas de page. 1 En ce dimanche 3 janvier 1915, Saint-Sandoux se réveille dans le froid ; un vent glacial a soufflé toute la nuit et il continue à balayer la neige. A 3 heures du matin il faisait -2°. Les hommes ont cassé la glace dans les fontaines pour permettre aux bêtes de boire, mais aussi aux femmes de venir s’approvisionner pour l’usage domestique. C’est une corvée dangereuse car des plaques de verglas se forment et une glissade est vite arrivée. Dans les rues, on met quelques pelletées de cendre de bois et de la mauvaise paille. Interdiction est faite aux garçons de faire du patinage sinon gare au coup de bâton qui leur en fera passer l’envie. Les hommes, après avoir effectué le pansage1 et la traite, curer les écuries, avalent un bol de soupe et mangent un morceau de fromage, le tout accompagné d’un verre de vin blanc. Ensuite ils vont par le village s’enquérir de la température et surtout des prévisions météorologiques en consultant le baromètre le plus proche car la commune en compte 6. Elles ne sont pas bonnes, comme la situation actuelle. La guerre semble prendre une mauvaise tournure. -

Dig Dle Ct5r Resume Non Technique
Dossier de demande de déclaration d’intérêt général et d’autorisation au titre du code de l’environnement pour le programme de travaux du contrat territorial des 5 rivières Résumé non technique Le Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l’Auzon souhaite mettre en œuvre un programme de travaux sur les bassins versants des Assats, de l’Auzon, du Pignols et de la Veyre. Ces bassins s’incluent pour tout ou partie sur le territoire de Mond’Arverne Communauté, collectivité ayant transféré au SMVVA la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques ». Communes riveraines faisant Bassin versant l’objet de projets de travaux dans le cadre du contrat territorial des 5 Rivières Auzon Chanonat, La Roche-Blanche, Le Crest, Orcet Assats Busséol, Chauriat, Mur sur Allier (Mezel), Pérignat-sur-Allier, Saint-Bonnet- les-Allier, Saint-Georges-sur-Allier Pignols Laps, Pignols, Sallèdes, Vic-le-Comte, Yronde-et-Buron Veyre (incluant Le Aurières, Aydat, Cournols, Le Vernet-Sainte-Marguerite, Les Martres-de- Randanne) Veyre, Ludesse, Olloix, Saint-Amant-Tallende, Saint-Sandoux, Saint-Saturnin, Saulzet-le-Froid, Tallende, Veyre-Monton 28 communes sont concernées par le programme de travaux du contrat territorial des 5 rivières Ce programme de travaux est inscrit au contrat territorial des 5 rivières, qui poursuit l’objectif de réaliser l’ensemble des actions nécessaires à l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau, conformément aux objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau. Il fait l’objet d’une demande de déclaration d’intérêt général, déposée conjointement au dossier « loi sur l’eau ». Le programme de travaux prévoit plusieurs types d’opérations, certaines relevant uniquement d’une demande de déclaration d’intérêt général, d’autres relevant également de la loi sur l’eau. -

Secteurs Géographiques
Secteurs géographiques LAPEYROUSE St-ELOY-les-MINES BUXIERES-sous- Puy-de-Dôme ARS-les-FAYETS MONTAIGUT DURMIGNAT MONTAIGUT-en- COMBRAILLES La CROUZILLE St-ELOY-les-MINES MOUREUILLE VIRLET AIGUEPERSE SERVANT YOUX Le QUARTIER CHATEAU-sur- PIONSAT CHER St-GAL- MARINGUES MENAT sur-SIOULE St-HILAIRE TEILHET NEUF-EGLISE La CELLETTE POUZOL St-QUINTIN- sur-SIOULE St-MAGNIER St-REMY-de-BLOT MARCILLAT Ste-CHRISTINE St-MAURICE- GOUTTIERES St-GENES- près-PIONSAT BUSSIERES CHAMPS St-GERVAIS-d’AUVERGNE St-JULIEN AYAT-sur- SIOULE du-RETZ -la-GENESTE LISSEUIL St-PARDOUX VENSAT St-SYLVESTRE- St-HILAIRE- PRAGOULIN RIOM EFFIAT BAS-et-LEZAT la-CROIX St-AGOULIN MONTPENSIER ROCHE d’AGOUX CHATEAUNEUF- St-PRIEST- ESPINASSE les-BAINS BLOT-l’EGLISE CHAPTUZAT JOSERAND BRAMEFANT VERGHEAS St-GERVAIS- VILLENEUVE AIGUEPERSE d’AUVERGNE MONTCEL -les-CERFS RANDAN BUSSIERES- RIS ARTONNE et-PRUNS MONS St-ANGEL BEAUMONT- St-CLEMENT- LACHAUX BIOLET les-RANDAN SAURET- CHARBONNIERES de-REIGNAT CHARENSAT St-MYON BESSERVE -les-VIEILLES COMBRONDE St-DENIS- LIMONS VITRAC AUBIAT COMBARNAZAT QUEUILLE THURET CHATELDON BEAUREGARD- St-PRIEST-des- THIERS PONTGIBAUD VENDON SARDON St-ANDRE LUZILLAT PUY-GUILLAUME TEILHEDE Le CHEIX- CHAMPS CHAMBARON- sur-MORGE -le-COQ MANZAT sur-MORGE GIMEAUX CHARNAT PROMPSAT DAVAYAT St-GEORGES- VARENNES- SURAT St-VICTOR- Le MONTEL- LOUBEYRAT sur-MORGE Les MARTRES- MONTVIANEIX de-MONS YSSAC-la-TOURETTE sur-MORGE de-GELAT Les ANCIZES- St-BONNET- PESSAT- VINZELLES PASLIERES COMPS près-RIOM VILLENEUVE MARINGUES NOALHAT VILLOSANGES St-IGNAT MIREMONT CHATEL-GUYON -

Spiranthes Spiralis Dans Le Puy-De-Dôme Durant La Saison 2015/2016
Société Française d’Orchidophilie Auvergne Note SFOA 2016-02 Observations de Spiranthes spiralis dans le Puy-de-Dôme durant la saison 2015/2016 Collectif *), 9 octobre 2016 *) Alain et Michelle Charreyron (AMC), Ghislain Constans (GC), Alain Falvard (AF), David Houston (DH), Françoise Peyrissat (FP), Louis Santhune (LS) L’an dernier, la fin de l’été 2015 (août/septembre) avait révélé de très belles populations de Spiranthes spiralis et cela dans toute la France comme pouvaient le suivre en direct tous ceux qui ont une fréquentation régulière sur Orchisauvage. Il est vrai que les circonstances avaient été favorables avec un hiver 2014/2015 très pluvieux sur l’ensemble du territoire. L’arrivée de la fraicheur nocturne à la fin août 2015 avait déclenché la floraison du nord au sud au contraire des autres espèces dont la floraison est plutôt corrélée à l’arrivée de la chaleur. Les observations menées par trois d’entre nous en 2015 (AF, DH et FP) avaient révélé une très belle floraison sur les communes d’Aydat (aux environs de Fohet) et de Cournols avec notamment la découverte par FP et DH d’une station extrêmement dense comportant un millier de fleurs sur quelques dizaines de mètres carrés. Au- delà de cette découverte exceptionnelle d’assez vastes surfaces avaient été prospectées sur les communes Aydat/Cournols et avaient montré une belle richesse pour l’espèce dans ce secteur, par ailleurs déjà bien connu pour ses populations de Spiranthes spiralis. L’hiver 2015/2016 assez pluvieux lui aussi même si c’était à un degré moindre que celui de l’année précédente a dû permettre aux bulbes de se gorger d’eau ; ceci pouvait laisser imaginer une belle population de Spirantes spiralis à la fin de l’été 2016. -

Notice De Présentation Du Projet De Quartier D'habitat Du Chardonnet À
Notice de présentation du projet de quartier d’habitat du Chardonnet à Veyre-Monton / Ophis du Puy-de-Dôme / Avril 2017 Page 1 Notice de présentation du projet de quartier d’habitat du Chardonnet à Veyre-Monton / Ophis du Puy-de-Dôme / Avril 2017 Les espaces naturels répertoriés ............................................................. 32 Les espaces naturels protégés .................................................................. 32 Occupation agricole des sols .................................................................... 33 TABLE DES MATIERES Occupation forestière des sols : l’inventaire forestier .............................. 34 Reportage photographique du site .......................................................... 35 PREAMBULE ................................................................... 4 Contexte urbanistique ........................................................................ 38 PIECE A : PLAN DE SITUATION ........................................ 6 Le SCOT du Grand Clermont ..................................................................... 39 Le PLU de Veyre-Monton .......................................................................... 42 PIECE B : NOTICE EXPLICATIVE ........................................ 9 Analyse urbaine ........................................................................................ 48 Déplacements ........................................................................................... 49 ETAT INITIAL DU SITE ................................................................... -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2019
Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2019 Arrondissements - cantons - communes 63 PUY-DE-DOME INSEE - décembre 2018 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2019 Arrondissements - cantons - communes 63 - PUY-DE-DOME RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 63-V 18, boulevard Adolphe Pinard 75675 Paris cedex 14 Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 63-1 Tél. : 01 41 17 50 50 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 63-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 63-3 INSEE - décembre 2018 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires -

Carte Sieg Grand Format Essai
LAPEYROUSE 28 SECTEURS INTERCOMMUNAUX D'ENERGIE ( S.I.E. ) BUXIERES ARS LES FAVETS SOUS MONTAIGUT DURMIGNAT Ardes sur Couze MONTAIGUT LA CROUZILLE ST ELOY Arlanc MOUREUILLE PUY-DE-DOME LES MINES VIRLET Champagnat le Jeune SERVANT YOUX Chateldon LE QUARTIER CHATEAU PIONSAT /CHER MENAT ST GAL Espinasse /SIOULE ST HILAIRE TEILHET LA POUZOL ST QUINTIN Forêt d'Aubusson CELLETTE NEUF /SIOULE EGLISE ST REMY ST MAIGNER DE BLOT ST MAURICE STE MARCILLAT Haute Vallée des Couzes ST GENES PRES CHRISTINE AYAT BUSSIERES GOUTTIERES CHAMPS DU RETZ PIONSAT ST JULIEN /SIOULE LISSEUIL Rive Droite de la Sioule ST PARDOUX VENSAT ST SYLVESTRE LA GENESTE PRAGOULIN ST HILAIRE ST ROCHE MONTPENSIER EFFIAT BAS CHATEAUNEUF LA CROIX AGOULIN Larodde D'AGOUX ESPINASSE BLOT ET LEZAT ST PRIEST LES CHAPTUZAT ST GERVAIS L'EGLISE JOZERAND BRAMEFANT VERGHEAS BAINS D'AUVERGNE Lezoux AIGUEPERSE VILLENEUVE RANDAN MONTCEL BUSSIERES LES CERFS ARTONNE ET PRUNS RIS ST BEAUMONT ST ANGEL MONS Moissat, Neuville, Reignat BIOLLET CHARBONNIERES CLEMENT LES SAURET DE REGNAT RANDAN LES ST ST DENIS CHARENSAT BESSERVE VIEILLES COMBRONDE LACHAUX VITRAC MYON COMBARNAZAT CHATELDON Pérignat es Allier ST PRIEST AUBIAT LIMONS QUEUILLE LA THURET DES CHAMPS PUY BEAUREGARD ST MOUTADE GUILLAUME Picherande TEILHEDE VENDON LE CHEIX SARDON ANDRE LUZILLAT /MORGE GIMEAUX LE COQ CHARNAT DAVAYAT MONTEL LES MANZAT CELLULE SURAT ST VICTOR Pionsat ST GEORGES PROMPSAT VARENNES DE GELAT ANCIZES LOUBEYRAT ST MARTRES MONTVIANEIX DE MONS YSSAC /MORGE COMPS BONNET /MORGE PASLIERES VINZELLES Pontaumur CHATEL PRES RIOM -

Conseil Communautaire 22 Juin 2017
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 22 JUIN 2017 COMPTE-RENDU Le vingt-deux juin deux mille dix-sept, à dix-neuf heures trente, le Conseil communautaire de Mond’Arverne Communauté s’est réuni en session ordinaire, au siège de la Communauté de communes à Veyre-Monton, à la suite de la convocation qui lui a été adressée le quinze juin, pour délibérer sur les affaires inscrites à l’ordre du jour ci-après : 1. Commission Intercommunale pour l’Accessibilité (CIA) : création : composition 2. Schéma départemental des services au public (SDAASAP) 3. Budget annexe Cheiractivités : suppression 4. Annexe budgétaire : listes des associations bénéficiaires de subventions 5. Site administratif annexe à saint Amant Tallende : convention de location Mond’Arverne/ Commune de Saint Amant Tallende 6. Suppression/Création d’un poste d’auxiliaire de puériculture 7. Création de deux postes en contrat d’avenir 8. PLUi : Chartre de gouvernance : méthode de travail 9. Lac d’Aydat : acquisition de parcelles à l’EPF SMAF : modification du bail emphytéotique avec la Fondation Jean Moulin 10. Maison de Gergovie : avenants aux marchés de travaux 11. Maison de Gergovie : scénographie : avenant n°1 au contrat du scénographe : avenant n°1 au contrat de la muséographe 12. Mond’Arverne Tourisme/ Mond’Arverne Communauté : convention cadre 2017-2020 : convention financière 2017 13. Lac d’Aydat : Surveillance de la baignade : convention Mond’Arverne Communauté/ Commune d’Aydat 14. Voie verte : avenant à la convention de prestation de services 15. PCAET : lancement de la démarche 16. Extension de l’aire de covoiturage « Les Cheires » : avenant aux travaux 17. Aire de covoiturage « Les Cheires » : labellisation 18. -

EPCI À Fiscalité Propre Du Puy-De-Dôme Au 01/01/2018
Lapeyrouse EPCI à fiscalité propre du Puy-de-Dôme au 01/01/2018 Buxières- Ars-les- sous- Favets Montaigut Durmignat Montaigut La Crouzille St-Eloy- les-Mines Moureuille Virlet Youx Servant Le Quartier Menat Château- Pionsat sur-Cher St-Gal- St-Hilaire sur- La Teilhet Sioule Cellette Neuf- Pouzol St-Quintin- Eglise sur-Sioule CC du Pays de Saint-Eloy St-Rémy- Métropole St-Maurice- Ste- Marcillat près-Pionsat St-Maigner Christine de-Blot St-Genès- Bussières Gouttières Ayat- Champs du-Retz St- sur-Sioule Julien- Lisseuil St-Pardoux Vensat CA = Communauté d’agglomération St-Sylvestre- la- St- Effiat Roche- Geneste Bas-et- Pragoulin St-Priest- Hilaire- St-Agoulin Lezat d'Agoux la-Croix Montpensier Bramefant Espinasse Châteauneuf- Blot-l'Eglise Joserand les-Bains Chaptuzat CC Plaine Limagne CC = Communauté de communes Vergheas St-Gervais- d'Auvergne Villeneuve- Randan CC Combrailles Sioule et Morge Aigueperse les-Cerfs Montcel Bussières- Artonne Beaumont- Ris et-Pruns Mons St-Angel St-Clément- lès- Charbonnières- Combronde de-Régnat Randan Lachaux Biollet Sauret- les-Vieilles St- Charensat St-Denis- Besserve Myon Limons Aubiat Combarnazat Vitrac Thuret St-Priest- Queuille Beauregard- Châteldon des-Champs Teilhède Vendon Sardon Puy-Guillaume Le Cheix Luzillat Chambaron St-André- Gimeaux Varennes- le-Coq Charnat Manzat Prompsat Davayat / Morge sur-Morge Montel- St-Georges- Surat St-Victor-Montvianeix de-Gelat Loubeyrat Yssac-la- Martres- de-Mons St-Bonnet- Paslières Les Ancizes- Tourette près-Riom sur-Morge Comps Vinzelles Maringues Châtelguyon