Revue Celtique
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
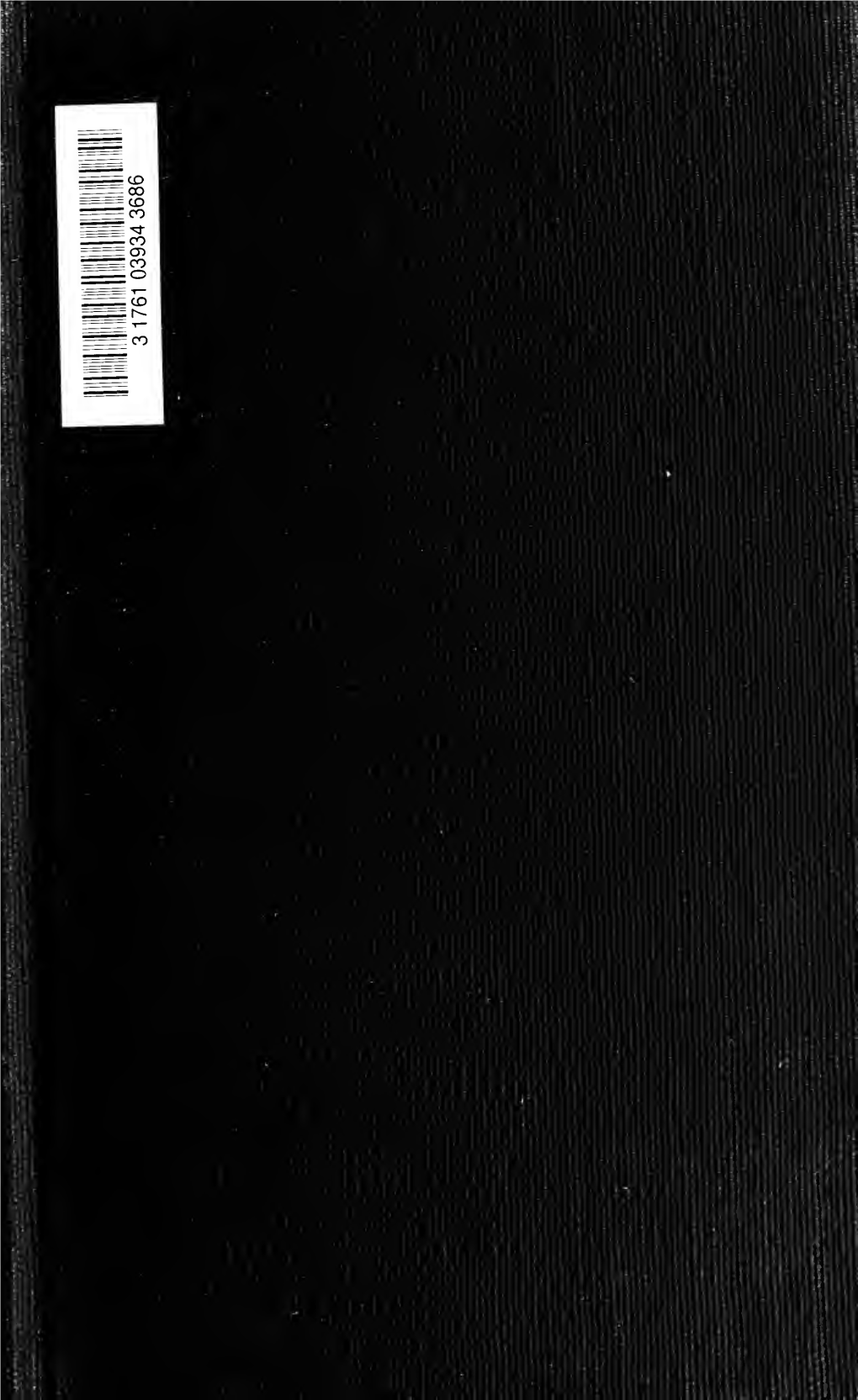
Load more
Recommended publications
-

Ireland Ireland Is Not the Prime Concern of This Website, and Its Main Author Cannot Claim to Know Its Landscape and History Really Well
Ireland Ireland is not the prime concern of this website, and its main author cannot claim to know its landscape and history really well. Nevertheless Ireland does offer useful insights into the earliest geographical names of western Europe, because it was never conquered by the Roman army. Importantly, there is just one main source for its earliest names: Ptolemy’s Geography names 53 of them. So all of Ireland can be tackled in this one article. The locations of Ptolemy’s Irish names have long been discussed, with recent attempts to improve the logic by Darcy and Flynn (2008), Kleineberg, Marx, and Lelgemann (2012), Warner (2013), and Counihan (2019). The present article was begun partly to help the work of Dmitri Gusev and colleagues, which is still only partly published at a conference. It takes the best Greek spellings from Stückelberger and Graßhoff (2006). Each name is transcribed once into the Latin alphabet and its position in Ptolemy’s text is reported as 2,2,2 or similar. In the words of one website: “The tribal and place-names in Ireland listed by Ptolemy were Celtic, and many survive in Old or Middle Irish forms.” This is a reasonable view, but the hard work of historical linguists (notably de Bernardo Stempel, 2000,2005) to find parallels in Celtic languages for elements in early Irish names has had disappointingly little success. This led Mallory (2013) to stress how much Ptolemy’s text might have been corrupted over the centuries. However, as name- to-place assignments have improved, with better geographical understanding and access to reliable texts, the linkage between Ireland’s earliest names and written Celtic languages has got weaker. -
Claudii Ptolemaei Alexandrini Geograghicae Enarrationis Libri Octo
* 'Vr/- - ^ 4 m CLAVDII PTOLB MAEI ALEXANDRINI GEOGRAPHICAE H S 4 R= LIBRI OCTO. y17»M EX BILIBALDI PIRCKBYMHERI OMCt W* tralatione fed , ad Gneca & prifca exemplaria i Mi* chaele Villanouano iam primum recogniti. Adiecta iniuper ab eodem Scholia, quibus exoleta urbium no# mina ad noftri iecu li more expo nimtur. * Q.V INQVAGINTA ILLAE QV O QVE CVM vctcrumtumreccntimtabuUakc(luiVur,u4rij^ incolentium ritiu ©• mores explicantur. ** MICHAEL VILLANOVANVS LECTORI S, ad multa milia nos rcfiituijje. quorum centurias aliquotreferre operaprecium foret , utfptcimcn aliquod gujiaturis prabcrctur.fidunmXarbonenfis Gallia exemplafaterunt.Libro.ij.capi.ic.tabuU.i.Buropa,Chctiraciuitaspriuslc gcbatur,cum ex graco codice Batirafuerit legendum,qua ejl Biterrenfis ciuitas,uulgp dida Befiers: Stepbantts etiam Plinius Betarram nominat , Mela ey Strabo Bliteram-Pojfa marina ibidem legebatur, cumFoJJas Marianas a Mario piari legebatur, in altero Tifara, cum neutro modofuerit legendum,fed Hifara,fiucgracum exemplar,fiue aliorum fcripta,cr maximi Cafaris comentarios quis infriciat, adflipulatur etiam hodiernum nomen quod idemfluuius uulgo retinet.Nec illos taceam qui pro Ararifluuio ibidem fcripferant Anar,er pro Dubi Budcn,Cepero pro Ceffiro,Loa* uenniorum pro Auenniorum colonia,Sempospopulos pro Sentijs,quos hodie Dignenfes. Omijfa quoq; CabeBioru eoa Ionia duas Mafilias feccre,a]teragracim,akcrlnongracam.Orobius infuperferibitur ibi fluuius, qui Obnscate, rts dicUur.Emendaffimus etiam,fi Ucuiffet, Tolofafilum, qui ad Garumna,non I Heris fluuij ripam confiftit. Longi* ti patuerint.Nec in ea re a Ptolemai mente difceflimus,fed tantum iuxta priores typos librariorum rejlituimus errata, libro odauoquifupra aliosfi Bilibaldo er Eraftno crcdimus,cajligationidefiderabat, adnotatiunculam adiecimus, qua etiam fi totus ille liber periret,facile quify uel mediocriter in Mathematicis peritusjionfilum 'm urbibus a Ptole maoibidefcriptis,fedinalijsquibufcun^,maiorumdierum quantitates, er ab Alexandria diflantias metiriqueat. -

British Isles
REMAKES ON PTOLEMY'S CtEOGRAPHY OF THE BRITISH ISLES. COMMUNICATED TO THE SOCIETY OF ANTIQUARIES BY HENRY BRADLEY, ESQ. WESTMINSTER: PRINTED BY NICHOLS ANI) SONS, 25, PARLIAMENT STREET. 1884. FROM THE AUCIT AEOLOG I Λ, VOL. XLYII [. PTOLEMY'S GEOGRAPHY OF THE BRITISH ISLES. To the Alexandrian Claudius Ptolemy, wlio flourished about the middle of the second Century after Christ, belongs tlie honour of liaving achievecl the final systernatisation of the results of ancient research in the two sciences of astronomv and geography. His treatise on Geography continued to be the Standard text-book on its own subject, as his Almagest Avas the Standard text-book on astronomy, until the brilliant discoveries of the fifteenth Century called the attention of Europe to their defects. The portion of Ptolemy's Geography relating to Britain has been for three centuries the subject of rnnch elaborate discussion among Englisli antiquaries. With regard, however, to the identification of very many of Ptolemy's positions, the conclusions of recent authorities of eminence are very far from being unani- mous. This divergence of opinion is in part due to the imperfections of Ptolemy's own knowledge of British geography; but to a much greater extent it may be ascribed to the extreme laxity of the metliods of investigation wliich have usually been adopted. In attempting an original examination of this sub- ject I am deeply sensible of the disadvantages arising from my unavoidably scanty acquaintance with the work of previous inquirers. The strongly favour- able opinion of some eminent scholars, to wliom an outline of the present Paj)er has been submitted, has, however, induced me to venture on offering it to the Society. -

A Classical Atlas, to Illustrate Ancient Geography
(o Victorian -\ 910.938 F493c 1857 Joseph Earl and Genevieve Thornton Arrington Collection of 19th Century Americana Brigham Young University Library BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY 3 1197 21976 0722 CLASSICAL ATLAS, TO ILLUSTRATE ANCIENT GEOGRAPHY; COMPRISED IN TWENTY-FIVE MAPS, SHOWING TBE VARIOUS DIVISIONS OF THE WORLD AS KNOWN TO THE ANCIENTS; COMPOSED FROM THE MOST AUTHENTIC SOURCES. WITH &n Bt&ex of tfte Ancient anfo Jfflotiem flames BY ALEXANDER G. FINDLAY, P.E.G.S. LONDON: WILLIAM TEGG & CO, 85, QUEEN STREET, CHEAPSIDE. 1857. : LONDON BRADBURY AND EVANS, PRINTERS, WHITEFRIARS. YtPft CONTENTS. INTRODUCTION, pp. v. to xvi. I. ORBIS VETERIBUS NOTUS. XIV. GERMANIA. II. ROMA. XV. VINDELICIA, NORICUM, RHiETIA, PANNONIA, ET III. ITALIA SEPTENTRIONALIS. ILLYRICUM. IV. ITALIA MEDIA. XVI. HISPANIA. V. ITALIA MERIDIONALIS. XVII. AFRICA SEPTENTRIONALIS. VI. ATHENE. XVIII. JEGYPTUS. VII. PELOPONNESUS ET ATTICA. XIX. ASIA MINOR. VIII. GRiECIA SEPTENTRIONALIS. XX. PAL^STINA. IX. INSULA MARIS MGMl. XXI. SYRIA. X. MACEDONIA, THRACIA, IL- XXII. ARMENIA, MESOPOTAMIA, LYRIA, MCESIA, ET DACIA. ASSYRIA, ET BABYLONIA. XL BRITANNIA. XXIII. ARABIA. XII. INSULJE BRITANNICiE. XXIV. IMPERIUM PERSICUM, v> XII) GALLIA. XXV. INDITE. INDEX TO THE MAPS, pp. 1 to 44. v INTRODUCTION. In the representation of Ancient Geography there is this disadvantage, that we use authorities, m many cases incomplete and mutilated in themselves, treating of subjects which frequently were very imperfectly known to their authors. It is true that very often the ancient writings are so lucid and explicit that we are compelled to acknowledge our inferiority in knowledge, and modern enterprise is continually re-discovering (so to speak) that which was perfectly familiar in the early ages ; and although, in many instances, we are enabled to follow their narratives and descriptions even to the most minute particulars, and apply them to existing facts ; yet, to make a complete picture of the countries av tnu period, we are compelled to fill up many vacancies, and supply many features from less clear and correct sources.